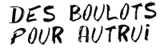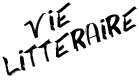- HOLLYWOOD MONSTERS
- Ghostland
- Le Serpent aux Mille Coupures
- Split
- Star Wars - The Force Awakens
- Le NIFFF 2015 - Bilan
- Mad Max - Fury Road
- The Hobbit - Battle of the 5 Armies
- Interstellar
- Dawn of the Planet of the Apes
- The RAID 2 - Berandal
- X Men - Days of Future Past
- 300 - Rise of an Empire
- Le PIFFF 2013 - bilan
- Las Brujas de Zugarramurdi
- The Hobbit - The Desolation of Smaug
- Gravity
- The Wolverine
- Star Trek - Into Darkness
- Oz the Great and Powerful
- Maniac (2013)
- Videogame Wasteland ? (Amazing! n°0)
- The Hobbit - an Unexpected Journey
- Looper
- Total Recall (2012)
- The Dark Knight Rises
- Prometheus
- Cosmopolis
- Wrath of The Titans
- Carpenter et Lovecraft
- Sherlock Holmes 2
- Rare Exports
- Drive / Real Steel
- The Thing (2011)
- Cowboys and Aliens
- X Men First Class
- Balada Triste de Trompeta
- Thor
- Scream 4
- Sucker Punch
- The Rite
- Paul
- Black Swan
- Harry Brown / Law Abiding Citizen
- Un Monde de Machines (FDI 2011)
- Starship Troopers
- Scott Pilgrim VS the World
- Monsters
- Buried
- Captifs
- Natural Born Killers
- Piranha 3D
- ChatRoom
- Predators
- Splice
- Last Exorcism
- Enter The Void
- Moon
- Lovely Bones
- Shutter Island
- Vynian
- Midnight Meat Train
- Le Vilain
- Le Locataire
- Heathers
- La Horde
- Nightmare on Elm Street 2010
- Getting Any ?
- Watchmen
- ______Chemical Wedding
- L'Autre
- ______[REC]
- A History of Violence
- ______Sabir Cyber
- RECIT LOVECRAFTIEN ET CINEMA (2007)
- ______Making Of et Captation
HOLLYWOOD MONSTERS
- roman ado écrit avec Estelle FAYE - un extrait
— Hé ! Chaud devant ! Gare-toi, gamin !
Mal sursauta, esquiva de justesse le char romain qui fonçait sur lui, tiré par une motocyclette qu'un homme pilotait à vingt miles à l'heure.
Mal toussa à cause des gaz d'échappement, resta un instant plaqué contre le mur du studio 3 pour reprendre ses esprits. Perdu dans ses pensées, il n'avait même pas entendu le moteur. Le technicien, lui, disparaissait déjà en jurant, juché sur son engin de course vers le studio 7, où se tournait le péplum de l'année. Quelques dizaines de figurants en toge ou en uniforme de légionnaire convergeaient dans la même direction, les casques en cuivre et les emblèmes romains rutilants dans les lueurs pâles de l'aube.
Dès sept heures du matin, les allées extérieures étaient aussi grouillantes de vie que les couloirs des bureaux. Les premières scènes de la journée se mettaient en place sur les plateaux de tournage. Une masse humaine et matérielle emplissait les lieux, mouvante, hétéroclite, déterminée. Des danseuses en costume à plumes, flanquées de boys en queue-de-pie, se frayaient leur chemin entre les techniciens portant ici des pieds de caméra, là des spots et rouleaux de fil électrique gainé de noir… Des assistants couraient partout en brandissant scripts, contrats et autres pots de café fumant. Comme le vieux Gus l'avait dit à Malachi, lorsque l'adolescent avait commencé à travailler aux studios : « T'es dans l'industrie du spectacle, petit. Ici personne n'a la place pour s'installer un hamac. »
Le vieux Gus était un projectionniste qui semblait avoir été là depuis le début des studios, et même avant, depuis la Ruée vers l'Or qui avait fait la célébrité de la Californie, avant même que les frères Lumière tournent leurs premières images animées à Paris. Quand Malachi était arrivé du Kansas avec des étoiles plein les yeux, et pas la moindre idée de comment se débrouiller à Hollywood, Gus l'avait pris sous son aile.
Alors qu'il débarquait tout juste des plaines immenses du Kansas, Mal avait cru qu'il ne s'habituerait jamais à ce chaos perpétuel des studios. Et pourtant, dès ses débuts, il avait été fasciné par cette cité dans la cité, immense fourmilière où l'on fabriquait les rêves. À présent, le garçon ne se voyait pas vivre ailleurs. Toute cette énergie le portait et le galvanisait. Très vite, il avait pris sa place dans la foule, s'y était installé à son aise.
En temps normal, il pouvait parcourir tout le lot les yeux fermés. Mais aujourd'hui il avait la tête ailleurs, au point de manquer se faire écraser comme un touriste.
À la fin de la journée, il aurait sauvé son job, ou il se retrouverait à la rue.
Il rajusta sa casquette. Une des danseuses plus loin lui adressa un clin d'oeil. Ils avaient travaillé ensemble sur une comédie musicale quelques mois plus tôt. Allez, on s'y remet. Il reprit son chemin avec un regain d'optimisme.
L'équipe devait filmer dans le back lot, les plateaux extérieurs au fond du domaine du studio, la partie de la propriété située le plus loin du bruit et de l'agitation du centre-ville. Plusieurs décors en plein air où l'on trouvait des façades et des bâtiments creux : une rue moderne, deux manoirs isolés, des murs médiévaux, et surtout un village européen traditionnel. Selon les productions, quelques accessoires et un peu de peinture lui donnaient le cachet d'un village du XXe siècle, du XIXe, ou même d'époques antérieures. Sur la grand-place, le bâtiment principal devenait, selon les besoins de la séquence, un office de bourgmestre, un pub anglais ou une vieille église.
Grosse journée en perspective : Mal rejoignait ce matin l'équipe d'ensembliers pour aider à habiller la place et la façade de la maison publique, avant de préparer les prises de vue de la soirée. Une bonne partie des extérieurs devait être en boîte dans les deux jours : quelques échanges entre les personnages principaux et secondaires, mais aussi une grande fête réunissant tous les villageois qui devait ouvrir le film, et pour finir l'enlèvement de Doris par le Nécromant. Étaient prévus pas moins de quarante figurants pour ces trois grandes séquences, l'une de jour et l'autre de nuit… Et une séquence à trucages qui causait tout le trac de Mal.
Perdu dans ces considérations, il ne fut saisi par l'ambiance étrange et lourde qu'en arrivant parmi les figurants et équipiers, sur le back lot lui-même. En temps normal, on aurait ressenti l'activité du plateau au moins à cent cinquante yards à la ronde. Pourtant, la foule des travailleurs, techniciens, costumières, figurants en costumes européens, se tenait là, interdite, au milieu du décor pittoresque.
Malachi ralentit, avisa un des techniciens et lui demanda :
— Qu'est-ce qui se passe ?
L'homme le considéra un instant. Il esquissa enfin un signe du menton en direction du portail d'une des maisonnettes pimpantes du village factice. Mal se hissa sur la pointe des pieds pour mieux voir. La plupart des techniciens étaient plus grands que lui. Il manqua trébucher.
Une figure grotesque était agrippée au portail du décor, dans une position inconfortable, inextricable. Mal reconnut un des assistants électro, les yeux grands ouverts et révulsés, le visage crispé, les muscles du cou et des bras saillants dans un effort permanent, ses mains blanches virant au bleuâtre sous la pression qu'elles exerçaient pour s'accrocher aux barreaux en fer forgé.
Dans le semi-silence, on entendait le gémissement bas et continu de l'homme.
— C'est une maladie ? s'inquiéta une scripte.
— Une nouvelle sorte de grippe espagnole ? Ou de polio ? s'alarma un perchman.
— C'est contagieux, vous croyez ? Parce que j'ai deux mômes, moi, grogna un gardien déjà âgé, et qui avait visiblement abandonné son poste.
— Plutôt un empoisonnement, intervint une costumière d'un ton très assuré. Ils parlent d'un empoisonnement.
— Qui ça, ils ?
— Les machinos du plateau 3. L'un d'eux a un cousin dans la police.
—Ce serait lié aux gangs…
Les murmures continuaient. Malachi ne les écoutait plus. Des ambulanciers en blanc vinrent détacher l'homme de la grille. Ils durent s'y mettre à quatre pour y arriver. L'homme avait encore les bras tordus lorsqu'ils le chargèrent sur un brancard.
— Vous savez où ils l'emmènent ? demanda Malachi à la costumière, qui semblait la mieux renseignée.
— À Cedars of Lebanon, au sanatorium. J'ai vu le nom sur l'ambulance à l'entrée.
Peu après, le service de sécurité du studio vint faire évacuer les lieux. Malachi comprit que le tournage n'allait pas reprendre tout de suite. Il avait l'habitude des aléas sur un film, mais là c'était vraiment de l'inédit.
---------------------------------------------------------------------------------------- ... La suite ?
- - - - - - - LE LIVRE EST DISPONIBLE PARTOUT, DANS LES RAYONS LITTERATURE JEUNESSE ET ADO - - - - - IL EST EDITE CHEZ GULF STREAM - - - - - -
- - ICI : https://gulfstream.fr/produit/hollywood-monsters/
Ghostland - Pascal Laugier
Pour qui suit la trajectoire de Pascal Laugier, Ghostland est surprenant car en rupture avec une évolution thématique jusque là constante. C'est un shocker excellent, pervers et rigoureux mais sans le supplément rhétorique qu'on avait appris à attendre du cinéaste.
NB : L'analyse va braconner un peu dans le récit et sa manière particulière d'arranger ses péripéties, mais aussi révéler quelques points-clé des efforts précédents de l'auteur. Gare donc aux spoilers, divulgâcheurs, little snitchy bitches ou quoi que le fait de dévoiler certains points d'une intrigue se nomme ces jours-ci. En gros, voyez le film avant de lire ce qui suit si vous êtes à cheval sur les effets de surprise.
Alors qu'elles emménagent chez feu une tante excentrique, Coleen, une mère célibataire qui couve Beth, toute jeune fille sensible férue d'écriture et de Lovecraft, bien plus que son ainée Vera, adolescente typique, sont attaquées en pleine nuit. Leurs assaillants sont deux horribles tueurs et tortionnaires qui défraient la chronique locale par leur mode opératoire : ils tuent les adultes et séquestrent leur jeunes filles pendant des jours pour leur faire subir toutes sortes de sévices en rapport avec des imageries enfantines, bonbons et poupées en premier lieu. Au moment où la mère parvient à se rebiffer, le récit embraye directement sur Beth, 15 ans plus tard, devenue une autrice à succès qui vient de sortir le récit autobiographique de l'attaque. Elle doit toutefois revenir dans la maison où sa soeur Vera vit encore un enfer de psychose post-traumatique, retenue tant bien que mal par Coleen dans la cave capitonnée...
Pascal Laugier, pour la première fois, signe un film problématique précisément parce que, pour la première fois, le film qui arrive dans les salles semble ne pas être en l'état problématisé. En tous cas, pas problématisé à hauteur de ce qu'on avait déjà vu du bonhomme. C'est parce qu'il fait pour la première fois ce que beaucoup lui ont fallacieusement reproché par le passé, c'est-à-dire un "simple" shocker movie parfaitement exécuté, que l'on se pose de sérieuses questions à la fin du générique, sur les écueils sans doute rencontrés dans les eaux tumultueuses de la production et de la distribution. Pourtant, face au tout venant du film d'horreur à ancrage "réaliste", le film qui nous arrive est excellent, à pousser les potards de déviance que suppose le genre, sans détourner le regard et en apportant le supplément de commentaire qui manque souvent à l'exercice. Mais de la part de Pascal Laugier, on est en droit de penser que ces qualités sont de l'ordre du pré-requis.
L'incompréhension qui a entouré le cinéma de Laugier depuis au moins Martyrs, pour être représentative de certains grégarismes, n'en est pas moins assez énigmatique, tant les efforts du cinéaste sont pourtant limpides quant à leur projet. Et l'aberration critique la plus grossière est aussi la plus évidente, donc la plus répandue : résumer le type à une prétendue glorification du splatter et du glauque, sans autre horizon que le totem street crèd' d'une interdiction aux moins de 16 ans. Non, Pascal Laugier n'est pas une Christine Angot du film épate-bourgeois, il ne se contente pas de servir un brouet de tripes nihiliste, c'est même tout le contraire.
Si l'on exclut un peu Saint-Ange, souffrant du contexte et des tropes d'une époque qui célébrait des Promenons-nous dans les Bois (entre autres scories, certaines répliques manquent cruellement d'oreille dans leur sur-signifiance), et handicapé par deux actrices principales qui ne s'intéressaient pas vraiment au projet, Laugier s'est déjà imposé en deux films comme un des cinéastes français les plus réfléchis en termes esthétiques ET cohérents au niveau thématique et philosophique. En effet, la première caractéristique de ses films (quand il a pu faire ce qu'il voulait s'entend) est le goût assez sûr dont il y fait preuve du point de vue plastique, sachant surjouer de l'outrance ou de l'esthétisation aux moments opportuns, mais surtout aussi filmer "platement" quand le récit le réclame : c'est l'erreur qu'ont fait beaucoup de jeunes cinéastes de genre français des 20 dernières années, que de faire inutilement tourner chaque plan de leurs films à la bande-démo de chef op' virevoltant, et que Laugier évite avec ce qu'on n'aura pas peur de qualifier de maturité, en se contentant de découpages factuels dans les moments du récit où le réalisateur doit s'effacer derrière sa narration.
C'est thématiquement surtout que cette attitude est révélatrice, car au cinéma la forme, c'est du fond (doit-on encore le rappeler ?). Laugier est radical car il n'aborde jamais le "cinéma de genre" sur la pointe des pieds. C'étaient par exemple les effets de Benoît Lestang montrés frontalement dans Martyrs, L'ampleur Kingienne des décors et des développements serialesques de The Secret, l'ambiance de cauchemar cotonneux du troisième acte muet de Saint-Ange. Ceci dit, Laugier embrasse pleinement ses émotions de cinéphile mais, encore une fois contrairement à pas mal de ses camarades du cinoche français dit "de genre", en les problématisant, c'est-à-dire qu'il ne se repose pas sur de la référence mais la prend comme objet à questionner. Dans le film qui nous occupe, et en partant du postulat d'un bête home invasion avec ce qu'il a d'arbitraire, Laugier profite assez ostensiblement de sa première bobine pour évacuer les esthétiques et trouvailles du genre français des années 2000/2010 : Siri, Maury/Bustillo, Aja/Levasseur, Rocher... Avec une certaine malice, à l'issue de la phase initiale de l'attaque, il va jusqu'à montrer Mylène Farmer dans un duel à mort avec l'image d'Epinal d'un fan de Mylène Farmer. Il embrassera ensuite une esthétique plus proche de Rob Zombie et de la nouvelle vague horrifique américaine.
- Attention spoiler - A partir de là, le film part bille-en-tête dans une temporalité seconde trop belle pour être vraie, celle de Beth adulte, avec des allers-retours entre la séquestration de ses 14 ans et ce "plus-tard" indéfini. De fait deux univers s'opposent et on est amenés à départager le "vrai" du "faux", débat rapidement tranché dès le début du deuxième acte. Le paradoxe que manie alors le récit est d'inverser la versification des deux espaces narratifs. En effet le monde fantasmatique est le plus anodin dans son esthétique, qui passe du chic beigasse de quartier gentrifié au prosaïque hivernal lors de la visite familiale, alors que la "réalité" des évènements advenus dans la maison est présentée avec le baroque le plus décomplexé : on y voit une inflation de poupées, des agresseurs littéralement désignés comme "une sorcière et un ogre" qui conduisent un camion de bonbons, une maison isolée au sous-sol gigantesque et remplie de curiosités et chausse-trappes à la Fu-Manchu... Ceci-dit, si le film s'offre de ces intrigants pas-de-côté dans son sous-texte, le récit lui-même ne s'autorise pas un tel jeu, un dépassement de son sujet, auquel pourtant nous avait accoutumés Pascal Laugier, et c'est là qu'il pourrait décevoir, ou qu'en tous cas il surprend.
Deux théories s'opposent de fait, aussi déplaisantes l'une que l'autre car toutes deux représentatives de l'époque. La première, c'est celle du cinéaste qui acquiert assez de levier, par une circonstance ou une autre, pour faire un peu ce qu'il veut sur un projet, et se prend les pieds dans le tapis de désirs pas ou mal canalisés. On a vu, ces dernières années, des cinéastes d'envergure trébucher de la sorte et sortir des versions grossières de leurs œuvres marquantes, des films faibles parce que trop satisfaits d'eux-mêmes : le redondant Mientras Duermes de Jaume Balaguero, Peter Jackson et son fastidieux Lovely Bones, 31 où Rob Zombie dilue son idiosyncrasie dans le dilettantisme de celui à qui le crowdfunding a offert un blanc-seing, et jusqu'au récent et douloureusement pompier Shape of Water du grand Guillermo, manifeste de deltorisme pour les nuls à la structure étonnamment peu rigoureuse, et célébration du temps présent logiquement prétexte à consécration critique... La question est : n'ayant pas essuyé, avec The Secret, le tir de barrage de protestations qu'avait subi Martyrs, Laugier s'est-il "fait plaisir" avec une version lénifiée de son idiome, en oubliant qu'il avait jadis la dalle et la colère qui va avec ? Nanti d'une tête d'affiche vendeuse (Mylène Farmer donc, avec qui la rencontre artistique semble authentique suite au clip qu'il lui avait réalisé) et acquise à sa cause, avec le confort que peut supposer cet état de fait, n'en aurait-il fait qu'à sa tête en oubliant au passage la rigueur qui caractérise ses précédents efforts?
Il y a certes ici une confirmation, sur un mode plus explicite, de certaines thématiques et partis-pris, poussés avec encore plus d'insolence que précédemment ; et justement, les plus grandes qualités du film se trouvent là. En particulier la peinture cruelle et imagée des injonctions constantes faites aux femmes dans nos sociétés. Ici, c'est la vision atroce de deux jeunes filles manipulées comme des chiffons, mutilées, humiliées, autant apprêtées qu'elles sont niées en tant que sujets agissants ("Ne bouge pas, ne pleure pas, quoi qu'il te fasse, sinon ce sera pire" dira Vera à Beth). Les films de Laugier grouillent littéralement de jolies jeunes femmes frappées, entravées, objectifiées, et montrées couvertes de blessures affreuses notamment au visage. Loin d'être anodin, le motif est assez imparable : et à nouveau, on a reproché à Laugier l'exact inverse de ce qu'il faisait dans ses films, c'est-à-dire une supposée complaisance dans les sévices à des figures féminines trivialisées, alors que son discours est tourné justement vers la dénonciation de cet effet. Il est ainsi l'un des rares cinéastes, par exemple, à ne pas fétichiser ses protagonistes féminines en tant qu'objets sexuels, propres à exciter gratuitement la concupiscence du spectateur. Dans Martyrs, les violences cliniques perpétrées ne sont pas motivées par des tempéraments à la Weinstein, pas plus que l'héroïne ou l'adolescente de The Secret ne sont posées en appâts à libido comme dans l'immense majorité du cinéma moderne (même le dernier plan de Saint Ange, dans sa relecture érotique de Fulci, focalise davantage sur le regard blanc de Ledoyen que sur sa nudité).
Ce n'est pourtant pas une marque de bigoterie puisqu'il ne nie jamais la dimension corporelle des femmes qu'il montre, par la convocation de toutes sortes de fluides (sang, sueur, excrétions, menstruations), ou en montrant des nudités entièrement désexualisées (ici, Vera en crise). Bref, et c'est d'autant plus précieux que c'est extrêmement rare dans un cinéma hors-militance politique, il revendique une prise de position consciente sur l'image de la femme dans l'occident moderne, et le fait qu'une somme d'impensés et d'hypocrisies plus ou moins hébéphiles, s'avère aussi meurtrière que certaines négations plus bruyantes dans ces Moyen-Orients chimériques que l'on fustige volontiers dans les pages de Causeur... Le sérieux papal des deux précédents films, l'absence de lénification et de ludisme dans le traitement disent assez la position du cinéaste sur les sujets qu'il commente. Ici, via les figures des deux meurtriers/tortionnaires et surtout leur mode opératoire, le discours sur la négation de la femme est plus criard, plus évident. La torture se fait sur des adolescentes transformées en poupées, maquillées comme des demi-mondaines victoriennes par-dessus les cicatrices et tuméfactions qui les défigurent : difficile d'être plus explicite quant à la thématique d'une société où la négation des femmes passe par leur réification. Difficile en tous cas d'y voir l'effet fortuit d'un film de sale gosse capricieux...
L'autre possibilité est plus probable, car elle semble appuyée par certains éléments du film qui, pourtant lourds de sens (aucune chance qu'ils soient fortuits), ne font pas l'objet de pay-offs en fin de métrage. En l'occurrence, soyons clairs : le film a l'air d'avoir vu sa fin sabrée cavalièrement aux ultimes étapes de son montage, comme cela arrive quand les décideurs décident en cours de route de vendre un projet initialement abrasif sur un seul élément supposément fédérateur, et s'épouvantent alors de voir qu'un cinéaste qu'ils couvraient de louanges pour sa patte unique a fait effectivement montre de singularité. Pour revenir à Rob Zombie dont l'ombre plane sur tout Ghostland, on se souviendra du final du cut cinéma d'Halloween 2, complètement incohérent, artificiel et simpliste, alors que la proposition du director's cut est autrement plus pertinente, et s'est vue reléguée à la confidentielle édition BR... Plus proche de nos contrées, on citera Frontières, sur lequel Xavier Gens et son film furent trahis carrément au soir de la préproduction, certains acteurs du projet prenant des décisions aberrantes du point de vue créatif (chercher à supprimer tout gore pour faire du PG-13 avec un matériau de NC-17), avec pour effet de couper les ailes au film sur son principe même (on a vu depuis que Gens livre effectivement des films excellents quand on le laisse faire son boulot, cf. The Divide et l'incroyable Cold Skin).
La grande signature du Laugier conteur est l'induction en fin de récit d'un twist pas tant narratif que rhétorique : poser un contexte, un discours radical que le spectateur doit déjà accepter comme un parti-pris extrême, puis retourner le point de vue porté dessus pour l'interpeller directement. Plus que les idées radicales dépeintes dans le corps du récit, c'est ce retournement rhétorique in fine qui crée l'inconfort intellectuel, donc l'intérêt discursif. En ce sens, Martyrs et The Secret ont souffert de la même réception qu'un Orange Mécanique en son temps, où le gros du public (et de la critique) se donnait à voir comme choqué par les outrances graphiques du premier acte, et pas par le pamphlet politique du troisième, autrement plus corrosif. Autrement dit, on aura préféré n'y voir que des transgressions adolescentes pour ne pas voir les vrais constats adultes (c'est-à-dire atrabilaires et désabusés) que recelaient ces films. Car Laugier est radical surtout dans ses prises de positions philosophiques et sociales ; les constats qu'il pose ne donnent généralement pas dans la sucrerie dans la forme comme dans le fond.
Le thème le plus saillant de la filmographie du cinéaste est ainsi l'esclavage social et métaphysique, la consommation de l'homme par l'homme. C'est-à-dire les mécanismes de puissants qui disposent de personnes qu'ils voient comme subordonnées par nature ou par circonstance : typiquement, des riches et des nantis faisant ce qu'ils veulent de pauvres et de laissés-pour-compte, habillant le cynisme inhérent à leur mode de vie d'une idéologie sujette à caution. Evidemment, cette coupable hiérarchisation se fait en particulier sur les femmes et les enfants, récurrentes victimes des abus de pouvoir de par le monde. Ce pouvoir dont la condition d'existence est qu'on en abuse, c'est la bonne société d'après la mort de Dieu dans Martyrs, qui essaie par la torture d'anonymes de percer le mystère de l'au-delà, mais aussi l'organisation de bons samaritains dans The Secret qui kidnappe des gosses de pauvres pour les offrir à des foyers aisés, selon le principe pour le moins discutable de l'organisation Arche de Zoé... Dans les deux cas, le procès était foncièrement à charge, même si l'ambigüité du traitement de The Secret (jamais l'empathie pour le personnage de Julia n'y est remise en question) tendait à brouiller les cartes : qu'on ne s'y trompe pas, le discours y était encore plus virulent, le regard-caméra interrogateur de Jodelle Ferland achevant de mettre le spectateur devant le système de valeurs du monde moderne, qui ne s'interroge même plus sur son principe de base voulant que "plus, c'est mieux", pour tout le monde et en tous temps. La question posée, le constat évoqué, c'est simplement : de quel droit cette mise à disposition de certains par d'autres ? En retournant dans la dernière bobine les finalités des activités de ces puissants, Laugier envoie bouler ce fourvoiement moral : dans Martyrs, Anna voit effectivement un au-delà, dépasse donc les objectifs qui ont poussé à de telles exactions, et ses révélations poussent Mademoiselle à se tuer ; dans The Secret, la jeune Jenny n'est pas dupe d'un système qui en apparence la sert. Cette massue rhétorique est assénée dans les dernières secondes des métrages pour plus d'effet.
- Attention spoiler - Quelques éléments appellent un prolongement de cette réflexion dans Ghostland. Le principal est une séquence de dialogue apparemment anodine entre Beth et sa mère qui, alcoolisée, babille sur l'odeur familière de sa progéniture, puis regrette de ne pas avoir "dévoré" ses filles afin qu'elles lui appartiennent à jamais, et en particulier afin qu'aucun homme ne les lui enlève. Etant données les préoccupations de Laugier, il était logique que le film se terminât sur une révélation quelconque d'une séquestration des gamines par leur mère même : quoi de plus dévorateur, quel pouvoir plus absolu et donc injuste, que celui d'un parent sur son engeance ? Le caractère pitoresque, bigger than life des deux agresseurs, qui tire vers la bande dessinée, tend aussi à les envisager comme une traduction supplémentaire, baroque, dans l'esprit de Beth, d'un mal inconcevable parce qu'il serait perpétré par sa génitrice. Or, rien de tout ça dans le Ghostland qui sort en salles ; pourtant, à l'aune de ces quelques annonces dans la caractérisation de la famille, de la pente que prend globalement le deuxième acte et de la propension générale du métrage à donner de fausses pistes narratives, on a l'espoir aux premiers cartons de générique qu'un épilogue aussi abrasif que la mise en cause totale ou partielle de la mère dans les déconvenues de ses gamines nous saute à la tête.
On ne doute pas que Pascal Laugier, qui a l'habitude de dire ce qu'il pense en interviews, ait été sincère en louant ici et là il y a quelques mois la liberté totale qui lui a été laissée aux étapes de la production et du montage, ainsi que le soutien enthousiaste de sa tête d'affiche. La présence de la réplique de Coleen évoquée plus haut l'attesterait même. Ceci dit, c'est dans un second temps que le marketing autour du film s'est mis à insister presque exclusivement sur la présence de Mylène Farmer au générique... Aura-t-on eu peur, chez les distributeurs, qu'un public de fans de la chanteuse, qu'on aura supposés excessivement cauteleux, se gendarme de voir son idole présentée comme un personnage trop négatif et crapoteux de Médée domestique, et se mette à bouder voire à boycotter le film ? A-t-on voulu que rien ne dissuade les veaux d'aller au pré ? L'aspect très abrupt de la fin du film et de certains points de montage, les éléments orphelins et les quelques trous occasionnés, permettent de s'interroger sur la possibilité d'un film fini qu'on aurait mutilé sur le tard à la va-comme-je-te-pousse, à la manière d'un comité de censure gouvernemental des années 70...
Car hélas, le seul biais pris par le récit sera une espèce de fustigation de l'imaginaire dans lequel Beth se réfugie pour échapper aux sévices d'agresseurs extérieurs, réels bien que présentés avec un excès esthétique qui les rends peu réalistes. L'intervention "physique" de H.P. Lovecraft (dont le maquillage n'est pas très heureux) et les dernières apparitions de Coleen participent de cela, dans un discours étrange qui semble discréditer l'idée de mythe en soi, qu'il pousse l'une des filles à ne pas affronter le réel, l'autre à vivre un cauchemar permanent, ou les tueurs à des horreurs sans nom... C'est l'autre aspect qui surprend de la part du cinéaste, qui auparavant interpellait davantage la morale du spectateur et ses contradictions. Le problème principal du home invasion n'est en effet pas la complaisance dont on le taxe, mais bien plus le fait qu'en ne présentant une menace qu'extérieure aux personnages principaux, le genre glisse souvent la conscience du spectateur dans ses propres pantoufles : il n'y a pas franchement d'ambigüité, donc peu de questionnement, dans des histoires où l'élément disruptif est strictement étranger.
En se contentant d'une horreur "rassurante", car gardée à une distance prophylactique des protagonistes et de leurs propres ramifications mentales, le film interroge, au final, bien peu. Pascal Laugier a-t-il cherché à se montrer accessible en réduisant sa voilure philosophique le temps d'un film, où l'a-t-on contraint à sacrifier une partie de sa rage désabusée sur l'autel d'une politesse préemptive ? En l'état, et tout excellent qu'il soit à sa valeur faciale, son film ne permet pas de le dire. On attend avec curiosité les interviews des prochaines années ou, qui sait, un director's cut en vidéo... Car de la part de Pascal Laugier (mais là c'est peut-être l'admirateur qui parle), avec l'horizon d'attente qu'il a créé avec ses précédents efforts, ne sortir qu'un grand ride pervers et retors, signer "seulement" un très bon film, sera vu comme un peu court.
N.B.: vu qu'on n'est pas dans la presse people, on ne glosera pas sur la plainte suite à un accident survenu sur le plateau, qui n'a pas grand-chose à voir avec le contenu du film, mais que les amateurs de bad buzz faciles brandissent déjà jusqu'à plus soif, toutes occasions de discréditer les cultures de l'imaginaire dans leur ensemble étant encore aussi vendeuses 30 ans après la V-chip et les video nasties.
Le Serpent aux Mille Coupures
Eric Valette gagne encore en assurance et en efficacité, avec un mélange de polar et de western rural d'une maîtrise appréciable. Un vrai divertissement populaire, un travail d'artisan dans le sens le plus noble du terme.
Il y a un film formidable qui sort entre Boule et Bill 2, Baby Boss et Sage Femme. C'est un polar sec, efficace, bien écrit, avec des personnages crédibles et marquants, des enjeux contenus, une mise en scène ample et sans ostentation, et un délicieux goût de western crépusculaire. Un film français, adapté d'un bouquin de DOA, auteur qui bénéficie tout de même d'une certaine hype, emballé par un réalisateur solide qui nous a donné quelques films allant de l'estimable au carrément enthousiasmant, qui a fait le seul Bee Movie entièrement valide (Maléfique) et nous avait laissés sur un thriller politique de haute volée et un polar excellent (respectivement Une Affaire d'Etat et La Proie). Toutes choses qui devraient, dans un monde logique, faire piaffer d'anticipation des armées d'amateurs de cinoche depuis des mois dans tout le pays. Ce film, pourtant, vous n'en entendrez parler que brièvement et par miracle, et ne pourrez le voir qu'en vous précipitant dans de rares multiplexes de quelques grandes villes, pour peu qu'il n'ait pas été déprogrammé entre votre départ de chez vous et votre arrivée dans la salle, au profit d'un mastodonte quelconque adoubé par les services de presse de grands groupes. Il convient donc de lui rendre justice avant qu'il reparte dans les cartons avec l'espoir de se rentabiliser en vidéo, comme tant d'autres. Mais bonne chance, vu l'interdiction aux moins de 16 ans dont a écopé, un peu au pifomètre, un film qui ne mérite pas un tel coup de bambou.
Humblement, surement, sans vraiment faire de bruit, Eric Valette continue son chemin en artisan. Il lui arrive bien entendu de trébucher, de se faire subvertir par des exécutifs sans goût, de jouer les utilités dans des exercices télévisuels pas indispensables. Comme tout le monde. Néanmoins le bonhomme perpétue, à son niveau et avec constance, une tradition considérée à tort comme désuète. Celle, héritée du roman-feuilleton et de la série noire, du divertissement populaire, adulte, respectueux de l'intelligence de son spectateur, exigeant sans être précieux. Avec quelques autres (Cavayé, Rocher, Boukhrief, Siri, Gans, Kounen, Laugier, etc.) il fait partie d'une sorte de secte de purs conteurs dont le but semble n'être que de raconter des histoires intéressantes aux gens. Une démarche qui met de côté les amphigouris de publications bien mises, ce rideau de fumée rhétorique d'un système qui organise sa propre illisibilité, pour cacher des crapuleries de classe. Une démarche, aussi, à mille lieues du cynisme mercantile "Hanouna Approved" refilant des pelletées de sous-produits toxiques à des masses supposées passives qu'on méprise avec leur propre assentiment. Un type qui aime faire des films, pour les films eux-mêmes, et a même la présence d'esprit de préférer signer des adaptations que des scénarii originaux, repoussant du pied le bénéfice symbolique très français du statut d'auteur. Bref, un illuminé.
Dans la campagne du Sud-Ouest se croisent plusieurs trajectoires hétéroclites : un couple de fermiers en butte aux attaques racistes de ses voisins, un homme d'action mystérieux avec un plan épervier rien que pour lui, des trafiquants de drogue en négociation transfrontalière. Le fugitif se retrouve à occire les trafiquants par pure défense et doit se réfugier chez le couple, qu'il séquestre sans états d'âme. Mais la mort des hommes déclenche l'arrivée d'un terrifiant homme de main venu nettoyer les traces du trafic, alors que les voisins indélicats et le chef de la gendarmerie convergent vers la ferme.
Pour qui s'attend au ron-ron compartimenté du tout-venant actuel, Le Serpent aux Mille Coupures aura de quoi décontenancer. Ce n'est pas plus une œuvre réflexive qu'un trip de fan-boy, son humilité réelle ne le pousse pas au misérabilisme et son désir de divertir ne l'entraine pas dans une débauche de cosmétique pyrotechnique ou stylistique. Le ton est rigoureux sans être âpre, épuré sans être dépouillé, frontal sans complaisance, allusif sans pudibonderie. Cet équilibre assez périlleux rend le film en lui-même peu séduisant au demeurant : de l'introduction aux plus gros développements bellicistes, l'optique est résolument anti-climatique. On sent bien que le désir de ne pas tomber dans le comic book involontaire pousse le film à un certain excès de circonspection, que des explosions de violence très graphique contrebalancent ponctuellement au risque de paraître flanquées là par caprice. Bref, à tant vouloir ne pas singer la démonstrativité d'un Canicule, Le Serpent... se présente comme austère, presque monacal, et s'aliène peut-être un public qui le trouvera, à tort, revêche. On peut déplorer cet apparent manque de générosité, c'est pourtant cette approche qui fait toute la valeur du projet.
De l'écriture à la direction d'acteurs, Valette voit bien qu'ayant des situations et des personnages difficiles à crédibiliser dans leur agencement, il lui faut redoubler de retenue pour conférer le réalisme qui sied à son récit. Le dernier acte diffère par exemple sensiblement de celui du roman, plus grandiloquent, et certains contextes sont judicieusement laissés dans l'ombre. Ainsi de l'identité du fugitif (Tomer Sisley laisse enfin au placard ses sourires en coin d'affiche Dreamworks et c'est tant mieux) ne sera jamais évoquée en dehors d'une salutation sibylline en toute fin de métrage, les beaufards racistes ne dissertent pas entre eux sur leur beauferie raciste, et les divers jeux de pistes et d'influences s'entrecroisent avec une économie de dialogue pertinente. C'est une approche très casse-gueule pourtant, en ce sens qu'elle demande une certaine éducation au spectateur, envisagé non comme un post-ado ne devant réagir qu'à des stimuli simples et appliquer des grilles de lecture inculquées, mais comme un adulte, doté d'une expérience de l'existence suffisante pour admettre la part d'arbitraire et d'illisibilité du monde, l'absence même de résolution des évènements, bref la condition humaine dans toute son impuissance face aux hasards de l'abjection.
Car le réalisme dont certains refuseront de gratifier l'effort de Valette est précisément celui-ci. Les situations qui s'imbriquent sont hétéroclites, toutes les justifications narratives ne font pas l'objet de payoff (notamment l'arrière-plan politique qu'on devine derrière le plan épervier lancé à l'encontre du protagoniste, recherché fallacieusement pour djihadisme), les rencontres sont parfois carrément arbitraires, la violence s'abat sur les justes comme sur les injustes et rien n'est vraiment résolu à la fin. On n'est pas dans un Hercule Poirot ici : la solution au mystère ne sera pas apportée pour revenir à un statu quo de départ, laisser tout un chacun dans l'illusion rassurante d'un ordre, d'un apollinien qu'on pourrait restaurer, d'un dionysiaque qu'on peut ranger dans un compartiment étanche une fois le mot "fin" atteint. Le polar moderne baguenaude plus volontiers dans le monde de l'omniprésence du mal, de sa banalité, de son inéluctabilité. Il n'y a d'ailleurs plus vraiment de mystère à résoudre, pas vraiment de héros à suivre : Valette met sur le même plan, en parallèle, les enquêtes du gendarme et de son homologue espagnol (avec un Pascal Gregorry impeccable en mode Nid de Guèpes) et celle menée par le tueur à la solde des trafiquants boliviens. Chacun obtient une sorte de fin mot, mais l'ordre attendu n'est finalement qu'une vague contention du problème loin des civils, dont on doit bien accepter que certains se trouveront parmi les dommages collatéraux. Du point de vue de l'écriture de fiction, on voit bien ce que cette approche brise comme règles, le flou entretenu sur les motivations ou les contextes ne permettant pas de vraiment boucler le récit. Valette lui-même trébuche et ne résiste pas par moments à rentrer dans les clous en donnant des informations pas forcément utiles (les deux mentions de l'affaire Alègre, le monologue du flic espagnol, deux échanges avec la mère de famille et la fillette), sans toutefois que ça réduise l'impact du film qui semble ne nous dire qu'une chose : shit happens. Cette sécheresse de ton, loin d'être un effet pervers de la démarche, est bien le constituant assumé d'une mise en scène de l'arbitraire, qui de coups de malchance en explosions de violence pose un univers extrêmement palpable, réaliste dans sa peinture d'un monde rural triste comme un dimanche après-midi d'hiver. Par moments, on pense un peu au travail similaire qu'accomplissait l'incroyable Green Room de Saulnier.
Mais alors de quelle manière. On a peut-être sous les yeux le meilleur film de Valette, le plus mature en termes de propos et de forme en tous cas, précisément dans son optique antispectaculaire. Justement, il ressemble étrangement à un mélange organique entre Une Affaire d'Etat et La Proie. Le même regard à la fois ample et clinique, appuyé par une mise en scène qui met systématiquement sa recherche esthétique au profit de son récit (l'école du western et de la série B dont Valette s'est toujours réclamé), le même goût pour les dialogues arides, un arrière-plan politique omniprésent mais de façon irrémédiablement occulte, et surtout, la figure d'un ex-barbouze/tueur à gages absolument iconisé, qui porte le film sur ses épaules intimidantes au risque d'éclipser les autres personnages (Valette parvient d'ailleurs à l'exploit de faire exister les autres personnages au même niveau). C'était jadis le Fernandez joué par le gigantesque Thierry Frémont. C'est cette fois un autre acteur injustement condamné à jouer les utilités qui démontre définitivement sa valeur à ceux qui ne l'avait pas encore remarquée : Terrence Yin dans le rôle de Tod. Dans ce Serpent aux Mille Coupures (du nom d'une charmante méthode traditionnelle chinoise de torture et d'exécution), il est LE clou du spectacle, un mix sino-germanique terrifiant, aussi posé que sadique, aussi calme que parfaitement psychopathe, qui n'a besoin que d'arriver dans le plan pour le voler à son profit de la manière la plus inconfortable qui soit. Même en mettant de côté le discours discret mais salubre sur le racisme ordinaire, les implications macroéconomiques de la consommation de drogues dites récréatives, les personnages multidimensionnels et l'élégance d'une mise en scène opératique ET humble, la seule peinture de cette espèce de Mads Mikkelsen extrême-oriental entièrement dévoué à l'horreur ordinaire justifie de se précipiter en salles. Maintenant. Pour soutenir un artisanat cinématographique de qualité.
Split
Oui, Split est un bon film, peuplé de tout ce qu'on vient y rechercher : un cast habité et talentueux, une mise en scène inspirée et surtout un récit aux virtualités enthousiasmantes. Cependant, se greffent sur ce projet méritoire les démons de Shyamalan, et on s'interroge toujours sur la pertinence de certains de ses tics et méthodes.
Attention, ce texte contient ce qui peut s'apparenter à des semi-spoilers, inévitables dans sa réflexion sur l'usage des plot twists, en tant que fin et que moyen.
"C'est l'histoire, pas celui qui raconte", écrivait Stephen King dans The Breathing Method. Etrangement, c'est sans doute le prisme le plus pertinent pour pointer le paradoxe M. Night Shyamalan, monstre mi-wunderkind mi-repoussoir au gré des conjonctures et de ses propres humeurs. Ce prisme est étrange de prime abord, car c'est apparemment pour ses histoires que Shyamalan est totémisé : c'est leur écriture au demeurant retorse qui lui sert souvent de produit d'appel, ce que le retournement de spectateurs prompts à capituler devant un peu de bagout est sensé attester. Ce raisonnement consiste bien entendu à confondre l'ombre et la proie, dans la mesure où c'est précisément l'aspect démonstratif de la démarche du cinéaste qui en constitue la face la moins intéressante, ou en tous cas la plus contre-productive. Autrement dit, le virtuose chez lui étouffe l'auteur, comme un buisson aromatique qui foisonne tant et si bien que ses racines bouffent celles de l'arbre fruitier d'à-côté.
Dans un paysage critique et public qui, en gros, ne voit plus les nuances et n'envisage les réalisateurs que comme des Kubrick ou des Ed Wood, c'est-à-dire des auteurs gigantesques ne se trompant jamais ou des tâcherons complets sans espoir de rédemption, la réalité et ses cahots se montre de moins en moins lisible. Les carrières à la Richard Fleischer, peuplées de hauts et de bas, ponctuées d'autant de coup de génie que d'erreurs d'appréciation, s'accordent mal à cette vision binaire du monde artistique, qui fait aller les veaux au pré et permet à quelques coquins de créer des légendes ex nihilo sensées camoufler les crapuleries ordinaires du vrai monde qui sent pas bon (par exemple le marché de l'art contemporain, qui vit la cote d'un Jeff Koontz artificiellement gonflée par ses propres agents et galeristes qui rachetaient à perte les œuvres qu'ils mettaient eux-mêmes en vente, ou Canal + qui censure maladroitement sur Youtube le t-shirt à l'effigie de Bolloré et le discours de François Ruffin aux Césars...). Voir, à ce titre, la soif forcenée de célébration qui tente de nous imposer un nouveau Tarkovski médiatique toutes les deux semaines, de Dolan à Nolan, de Scott à Tarantino... Pourtant les cinéastes simplement humains et concrets, qui tapent parfois dans le mille mais pas à chaque coup, constituent une part plus que substantielle du 7ème art. Doit-on vraiment rappeler que les hommes, et parmi eux les artistes, mènent par définition des vies inégales ? Shyamalan, c'est évidemment ça : autant 6th Sense et Unbreakable que After Earth ou The Happening. A l'exception notoire que les péripéties professionnelles du bonhomme ont acquis, depuis Unbreakable, une qualité feuilletonnesque basée sur la figure même du cinéaste, régulièrement voué aux gémonies ou loué pour de "grands retours" forcément triomphants et définitifs... Jusqu'à la prochaine fois.
Nouveau "Grand Retour", donc, de M. Night Shyamalan (à croire qu'il était parti quelque part ?), nous dit-on de toutes parts depuis 6 bons mois avant même la sortie de ce Split, manifestement auréolé de mille merveilles indiscutables, qui auraient toutes plus ou moins la tête virginale d'un Haley Joel Osmond éternellement prépubère... Sauf que le film pose au moins autant de questions procédurales (d'écriture, de mise en scène, de jeu, de projet) qu'il n'apporte de jouissances de spectateur. Derrière cette dialectique, c'est la personnalité de son auteur qui est le plus petit dénominateur commun. Car depuis le début de sa carrière, M. Night Shyamalan fait montre d'une conscience de soi qui confine à un certain narcissisme, ce que n'aide pas une communication autour de ses efforts donnant elle-même dans un certain culte de la personnalité. On évoquera le nombre de court métrages amateurs, datant parfois de l'adolescence du cinéaste, balancés dans nombre d'éditions DVD de ses films successifs... Difficile d'y voir une marque de recul. Le souci du cinéaste, c'est que trop conscient de lui-même et de ses atouts sociaux, il se perd régulièrement dans l'exploitation pure et simple de ces derniers au détriment des réelles qualités intrinsèques de son cinéma, notamment la fluidité et la sobriété de sa mise en scène, et la lisibilité de ses enjeux narratifs qui rappelle les fameux "oners" de Spielberg (la scène de l'hôpital au début de Unbreakable). C'est hélas ce qui arrive sur Split. Il met ainsi plus d'énergie à donner des signes de virtuosité, qu'à se mettre au service des besoins organiques de son histoire.
L'erreur que l'on a commis est de ne louer le travail du cinéaste que pour son aspect performatif. Dans une certaine mesure, il commet lui-même cette erreur, semble même régulièrement s'y rouler avec délices. A trop regarder l'effet "à produire", certains de ces films ratent les qualités qu'ils ont sous le nez : en résultent de pénibles pensums qui ratent et l'émotion et le propos par manque de discernement dans leurs priorités. La parabole politique assénée de The Village, ou l'autoglorification et les accès revanchards de Lady in the Water (la mort du critique...), tombent ainsi en travers de sujets en or que le talent de conteur de Shyamalan a par ailleurs tout pour transcender, dut-il s'oublier au profit de son art.
Or, le principal composant du marqueur social apposé à Shyamalan lui est venu des qualités commerciales, et non esthétiques, de 6th Sense : la qualité du jeu de ses comédiens (tout le monde aime les performances à Oscars), et le sacro-saint plot twist final. Il faut dire que le plot twist, à l'instar du cliffhanger en série télévisuelle, fonctionne quasiment à coup sûr dans notre monde régi par la communication "virale". Et que la mode n'est pas venue que de 6th Sense (on se paumoyait déjà plus abondamment sur Usual Suspects ou The Crying Game, merci bien). L'une des marques du cinéma de Shyamalan est en outre qu'il sait mettre en valeur non pas le plot twist, mais les indices du plot twist, à l'aide de signes que l'on peut aisément reconnaitre à la seconde vision du métrage (le jeu sur des couleurs isolées, des cadres sursignifiants, des fusils de Tchekhov, etc.). Le procédé est flatteur autant pour le réalisateur que pour le spectateur, il remporte donc un succès proportionnel, mais il n'est pas interdit de le trouver grossier, voire véhément : "regarde comme je réalise bien !". Il n'est pas non plus interdit de pointer que cette véhémence est aussi dans la pulsion d'adoration que l'exercice assouvit chez l'interlocuteur.
Surtout, le temps de métrage pris par cette véhémence n'est pas consacré à la narration effective, effet d'autant plus rageant que lorsque les histoires racontées ont l'heur de se développer selon leur pente naturelle, le résultat est formidable (Unbreakable, encore). Mais voilà, Shyamalan s'emploie trop pour son propre bien à se faire accepter, à la poursuite du double bénéfice symbolique de la conformité et de la glorification personnelle. Soit par des tentatives de blockbusters dont on peut contester la pertinence (Avatar, After Earth), soit en émulant la formule qui a fait son succès initial sur des récits qui n'en ont pas forcément besoin. En cela, il n'est pas aidé par la manière unilatérale dont est envisagé son cinéma, par le public et la critique, qui part systématiquement à la chasse aux fameux plot twist, et s'offusque lorsqu'il n'y en a pas (Unbreakable, toujours)...
Il y a bien un twist au centre de Split (voilà, vous pouvez laisser cet article et courir en salle avec l'assurance d'avoir un sujet de conversation en sortant). Mais justement, pour la première fois dans la filmographie de Shyamalan, le twist effectif entre en conflit ouvert avec l'annonce de plot twist qui caviarde le film. Cette annonce joue en effet uniquement la carte de la fausse alerte - pour mieux nous surprendre et nous retourner comme des crêpes, mais aussi et surtout pour nous convaincre de la virtuosité d'écriture de l'auteur. De fait, une part énorme de l'énergie du film est employée à mettre le spectateur sur une fausse piste : celle de la spéculation sur la nature réelle du personnage de Casey et le fait qu'elle est peut-être l'une des personnalités de Kevin. Tout, des cadres à la caractérisation, concourt à jeter cette poudre aux yeux et l'on redoute pendant presque tout le métrage que le scénario prenne la voie facile du plot twist schizo-pirandellien. On guette donc ces faux indices en anticipant l'accablement à venir : un mouvement de caméra ambigu à l'extérieur de la voiture, une séparation stricte de Casey et de ses compagnes de servitude dans les cadres, les raccords sur l'axe des 180° lors des dialogues (qu'on ne retrouve, par ailleurs, que lors des entretiens avec la thérapeute), la passivité apparente du personnage alliée à sa connaissance instinctive du fonctionnement de son geôlier. Et le film de traire bien plus que de raison le trauma de l'héroïne via 5 retours en arrière alors que 2 auraient suffi... Pendant ce temps, cinéaste et spectateur ignorent plus ou moins volontairement ce qui fait pourtant le cœur du film : les personnages eux-mêmes et leur rapport à la dépersonnalisation d'abord, et ensuite l'argument fantastique passionnant autour de la plasticité du corps sous influence cérébrale, qui revisite avec brio Jekyl et Hyde.
Ainsi lorsqu'arrivent les révélations, et notamment le twist émotionnel relatif à Casey, son histoire et son mode de vie qui la rapprochent effectivement grandement de Kevin, tout tombe un peu à plat. D'autant que la mise en scène choisit le troisième acte pour tirer à la ligne et s'intéresser enfin aux deux adolescentes qu'on a hélas déjà appris à voir comme négligeables (selon la terminologie de leur , et dont on se fiche vite comme d'une guigne qu'elles s'en sortent ou pas. A cela s'ajoute une débauche de signifiants qui touchent au ridicule lors de deux échanges bizarrement bâclés entre Casey et Kevin.
Il est absolument dommage que le démonstratif dilue la justesse de la sorte. Au point que cette course à l'échalote sensationnaliste se phagocyte elle-même en trivialisant, in fine, son principal produit d'appel réel au profit de l'illusion d'un autre. C'est bien entendu du jeu de James McAvoy qu'il est question ici : si la performance est bluffante, c'est justement dans les moments où Shyamalan ne réclame une "PERFORMANCE", mais dans des moments calmes a priori mineurs. La caractérisation très Actor Studio de la Bête, appuyée par un peu subtil jeu de miroir en fin de métrage, ne doit surtout pas éclipser la subtilité assez folle des scènes de journal vidéo, ou cette scène où l'une des personnalité en imite une autre pour abuser la thérapeute, avec juste ce qu'il faut de nuance pour vendre la mèche. Dans ces quelques minutes, on assiste à l'équivalent, en termes de jeu, de ces lettres des Liaisons Dangereuses où Valmont et Merteuil émulent le style de Volanges, la plume de Laclos faisant merveille à caractériser les styles distincts. Stylistiquement, narrativement, c'est tout simplement fou. La même virtuosité se retrouve chez McAvoy qui n'a plus à prouver sa valeur depuis longtemps... Et tombe dans la panneau de l'inévitable scène "benchmark" où les personnalités tiennent conciliabule alternativement face-caméra pour la gouverne de Casey, que de trop nombreux découpages de flashes-back ont achevé de disqualifier en tant que vecteur du spectateur. On aura soin d'oublier vite cette minute embarrassante, où les personnages soigneusement échafaudés (au point qu'on les distinguerait presque par moments), se retrouvent ravalés brièvement au rang de ces sketches télévisuels d'imitateurs qui annoncent nommément chaque nouvelle voix... Or, Shyamalan prouve qu'il est capable de bien plus d'humanité et de subtilité à bien des reprises dans le métrage, via en particulier la thérapeute (qui souffre pourtant de son lot de fiches wikipedia assénées dans le dialogue) et le jeu impeccable de Anna Taylor-Joy, la seule semble à ne pas se noyer dans les injonctions contradictoires de son réalisateur...
Car le film, même couvert de ces parasites hélas récurrents chez son auteur, est bel et bien là et survit jusqu'à la révélation du caractère de Casey qui justifie tout ce qui a précédé, non pas narrativement (option "Bruce Willis était déjà mort!!!"), mais dans son projet même. La révélation émotionnelle du personnage, qui peut paraître anodine (pas de montée musicale, pas de payoff visuel) est une proposition d'une noirceur et d'une justesse psychologique rares, qui prouve à nouveau l'intelligence de Shyamalan lorsqu'il s'agit de sonder les cœurs ; proposition qui met salubrement à mal le cynisme ordinaire qui ne voit le spectateur satisfait qu'en cas de revanche armée de la victime, au mépris du réalisme le plus quotidien. Ici le discours se rapproche de celui d'Hannah Arendt sur la banalité du mal, et l'étend à l'ensemble de la condition humaine, les actes de bonté étant placés sur le même plan philosophique. Que "la Bête" se pose comme un pas en avant l'évolution humaine, en appuyant en outre cette affirmation par des miracles, pose l'idée de connaissance au-dessus de celle de la vertu, comme dans les cultes lucifériens ou celui de Kali... Kevin d'ailleurs, le "vaisseau" de toutes les personnalités, est lui parfaitement ignorant des apprentissages de ses avatars, et demande en toute logique à être éliminé. L'argument du pouvoir du cerveau sur le corps et ses mutations, qui pousse un fait médical encore peu exploré jusqu'au fantastique le plus échevelé, offre, à l'occasion du très bel épilogue, rien moins qu'une origin story parmi les plus excitantes qu'il nous ait été donné depuis au moins... Unbreakable tiens ! On rêve alors que ce dernier plan atteste du désir de Shyamalan de revenir à l'humilité qui lui a fait commettre le chef-d'œuvre du film super-héroïque, délaissant sa foire à la conformité pour un "univers étendu" qui a plus de gueule que les empoignades routinières de chez Marvel. Avouons qu'un Shyamalan qui s'oublierait un peu au profit de ses récits ET ne s'étiole plus à ménager toutes les chèvres et tous les choux (c'était le bémol de The Visit), est une perspective sacrément exaltante.
Star Wars - The Force Awakens -JJ Abrams
Marketé très en amont, jusque dans la mise en scène des réticences de ceux qui l'attendaient au tournant, ce Star Wars s'avère au final très agréable. Atteindre ce but était son seul projet : c'est logiquement sa seule caractéristique.
LA DEFENSE CHEWBACCA
Comme peut l'être une O.P.A., un phénomène climatique ou l'ouverture d'un parc d'attractions, la sortie de Star Wars - Le Réveil de la Force est un non-évènement critique : quoi qu'on en dise dans les journaux, sur les ondes ou sur les toits, on n'en changera ni le destin ni les finalités. L'investissement est remboursé avant même que quiconque ait pu en dire quoi que ce soit, la moitié de la planète a déjà docilement payé sa place. C'est une caravane qui passe d'autant plus aisément qu'elle est précédée d'un appareil promotionnel performant. Et la sphère médiatique de relayer gaiement la nouvelle d'un nouveau record battu, encore et encore. Il était donc curieux que le plan média colossal, savamment mais massivement mis en place autour du film depuis des années, se termine avec une petite stratégie paranoïaque vis-à-vis de la presse. On ne s'étendra pas sur l'affaire, déjà abondamment traitée ailleurs, du blocus de projections en amont de la sortie du film : la pratique se généralise de ces films sortant avec des projections-presse assorties d'embargo critique avant une certaine date. Là où Disney se distingue (bravo les copains), c'est en interdisant contractuellement aux quelques organes invités à une avant-première de dire quoi que soit sortant du plan-média dithyrambique prévu. Officiellement pour éviter les spoilers, réellement pour museler une critique qui pourrait se sentir flattée de faire aussi peur. Si la pratique est très très limite, elle présente un petit avantage pour le film qui nous occupe et n'avait pas besoin de tant de précautions : la carrière toute tracée du film permet de ne pas se limiter à distribuer blâmes et satisfécits, et aucun contrat n'oblige le rhéteur à ne pas décrire le film vu en salle. Reste donc l'analyse.
Alors, Star Wars. Si l'on veut parler de méta-phénomène, protéiforme, paradoxal, tentaculaire, élusif pour l'analyse, en voilà un qui se pose là, tant dans ses dynamiques culturelles que de production. C'est de fait un monument intéressant à explorer en commençant par l'hypogée. Depuis 1977 et même avant, Star Wars est l'objet de tous les hiatus. Hiatus critique, hiatus entre le public et les "geeks", et surtout rapport ambigu de George Lucas à sa création. C'est que Star Wars ne l'intéressait pas tant que ça, George : frustré d'être résumé à son plus grand succès, il n'a jamais vraiment compris la nature cosmogonique de la bombe qu'il avait lâchée en 77. Et cet aspect est bel et bien structurel à l'objet Star Wars, si on veut bien se souvenir de l'inénarrable show télé Au temps de la Guerre des Etoiles... Datant de 1978. De son propre aveu envisagé comme un simple exercice (exercice du monomythe et défi logistique) par l'intéressé, devenu phénomène commercial sans précédent, l'univers et sa peinture devait au moins autant à des tierces personnes qu'à lui... Ralph McQuarrie, Marcia Lucas, Gary Kurtz, etc. : Lucas, résigné à construire un empire sur cette pierre plutôt que d'autres qui lui plaisaient davantage (l'architecture, l'ingénierie, le film d'auteur - il produira par exemple le Ran de Kurosawa), n'aura de cesse que d'écarter ceux qui pouvaient altérer selon lui sa vision d'origine, à savoir refaire les Flash Gordon de son enfance, en faisant mieux que lui sur son propre terrain. Il est bon de rappeler à ce propos que le succès artistique de The Empire Strikes Back, célébré comme le point d'orgue de la saga, est précisément dû au fait que Lucas, déjà en délicatesse avec sa propre création, avait laissé les coudées franches à Lawrence Kasdan et Irwin Kershner, ne posant que quelques grandes lignes scénaristiques. L'histoire de Return of the Jedi fut bien différente, car le succès du second opus lui avait démontré l'ampleur du phénomène Star Wars, à défaut de comprendre sa nature culturelle: il est paradoxal, et sans doute frustrant pour l'intéressé, qu'une part substantielle de la renommée de sa saga soit le fait d'autres, et au moins partiellement pour des éléments indépendants de sa propre volonté (*)...
Aux yeux du monde, les enjeux se cristallisèrent à l'occasion de la "prélogie", saccage monumental par son instigateur d'un univers qui lui avait échappé. Pour les fans, les tripatouillages des éditions "spéciales" avaient déjà montré le problème de cet homme tabassant sa création à coups de bistouri lénificateur (HAN SHOT FIRST !). Cependant, c'est bien le succès public de ces éditions iniques qui encouragea Lucas dans un élan mégalomane de mainmise sur l'univers Star Wars, au mépris des ajouts de légions de professionnels (dans la BD, le jeu vidéo, le roman, le jeu de rôles) dont le seul tort semblait être de ne pas être George Lucas lui-même. C'est ainsi que d'éditions charcutées en "prélogie" insultante, de Jar-Jar Binks en rétention des anciens montages de la trilogie originale, le bonhomme passa de Dieu à Mammon aux yeux de tous sous l'impulsion des geeks.
L'histoire des religions organisées le montre bien : les gardiens du Temple en deviennent vite les potentats exclusifs et jaloux. Les fans de Star Wars, qu'on n'assimilait pas encore au système commercial de masse en les qualifiant de "geeks", ont de fait confisqué dans une certaine mesure un univers destiné au grand public, comme ils l'avaient fait auparavant avec le comic book par exemple (depuis revenu dans le giron du mass media, Marvel s'étant elle aussi promptement Disney-isée au cinéma). EUX savaient que le monde se fourvoyait à révérer George Lucas à coups de millions d'entrées (tout en participant eux-mêmes, massivement, à la débauche mercantile autour de chaque film et produit dérivé qui sortait, et continuaient à camper devant les cinémas sapés en stormtroopers). Le discours des geeks, qui à la même période prenaient un certain poids à Hollywood (Smith, Pegg, Del Toro , Raimi, Jackson... Mais aussi les Parker et Stone de South Park, très ouvertement critiques de la méthode Lucas), fut massivement relayé et fit florès dans les sphères des cultures de l'imaginaire, jusqu'à déborder sur le grand public. Public qui admit plus ou moins généralement l'image d'Epinal d'un George Lucas masturbateur, capricieux, méprisant de son public, retiré dans sa tour d'ivoire du Skywalker Ranch, jouant avec ses figurines Kenner pendant que son univers mourrait sous ses coups de boutoir. Lucas, de son côté, répondait non sans malice dans ses interviews que les fans ne comprenaient rien, que la trilogie d'origine était constituée de films pour enfants (mais s'éclatait à mettre en place des intrigues politico-financières confuses et des massacres d'enfants dans ses épisodes 1 à 3), et d'ailleurs "Qui n'aime pas Jar-Jar?" (sic!). Par esprit de provocation sans doute, par goût excessif du contrôle sûrement, il truffe ainsi sa prélogie, qui est de loin l'occurrence émanant le plus de sa seule volonté propre, de détails purement vexatoires pour le noyau dur des fans (par exemple tel plan de wookies imitant Tarzan, cri à l'appui...), méprisant ses enjeux mythologiques quand il ne donne pas dans le contresens pur et simple : ainsi de la désacralisation des sabres laser qu'on perd, casse et s'échange tous les deux jours, ou de la faute grave consistant à trivialiser la nature de la Force EN L'EXPLIQUANT par un argument fumeux de physique-chimie... Quand le bougre n'avoue pas carrément n'avoir aucune idée de la manière dont des points-clés de son univers sont sensés fonctionner (cf. l'anecdote racontée par Gendy Tartakovski sur le baptême Jedi dans la première série animée Clone Wars : "J'ai demandé à George comment devait se dérouler l'adoubement des Padawans pour en faire des Jedi, il m'a dit ne pas le savoir")...
Ce divorce inévitable une fois consommé, mais avec un public de plus en plus prompt à se rouler dans la nostalgie culturalo-commerciale (racheter des leggings fluo, des albums de Madona, ou des reboots de remakes d'adaptations ciné de lignes de jouets : même combat, mêmes moutons, mêmes cornacs cyniques), la suite était tracée. C'est le départ d'un Lucas manifestement dégouté de ses rapport avec son public et "sa" saga, envers lesquels il n'avait pourtant pas fait l'effort d'entendement minimal qu'il lui devait. 10 ans et une série d'animation en CGI plus tard (un autre enjeu thématique qu'il serait trop long de détailler ici), la vente à Disney et la mise en chantier d'une flottille de films sur 15 ans se mettent en place, sur le principe des calendriers Marvel et DC. L'histoire des passations de pouvoirs chez LucasFilm et Disney et des circonvolutions pour mener à bien le deal et le greenlighting de la nouvelle trilogie est passionnant en soi et rappelle les grandes batailles de l'âge d'argent d'Holywood, mais ce feuilleton est déjà très bien raconté dans pas mal d'organes de presse. On se contentera d'évoquer, en forme d'épilogue, la "bénédiction" glaciale qu'a consentie George Lucas en donnant son avis sur le film que nous avons aujourd'hui sous les yeux : "Je crois que les fans vont adorer. C'est tout à fait le film qu'ils attendent". Si l'avis est motivé par le ressentiment, il n'en pose pas moins le problème crucial de cet épisode VII...
Le film qui en sort en 2015 est à la fois le pur produit des évènements relatés plus haut, leur continuation logique, et envisagé comme une clôture de ceux-ci. En ce sens, paradoxalement, ce qui le rend un peu décevant est précisément qu'il n'est pas décevant. Pourtant la gageure était réelle. Car pour revenir aux hiatus qui caractérisent le tissu même des Star Wars, celui de cet épisode VII est bel et bien ce funambulisme auquel il est contraint entre déférence et actualisation, réassurance et perspective. Cet équilibre n'est bien entendu pas réalisé, car le but même de ce premier film d'une nouvelle et longue série est de montrer patte blanche afin que public et investisseurs (4 milliards tout de même pour le rachat de LucasFilm) couvent les films suivants avec toute la bienveillance possible. Il s'agit à ce titre moins de cinéma que de benchmarking. Toutefois, il serait réducteur de fustiger le film à cette seule aune : autant reprocher à un grille-pain de ne pas produire de glaçons, il n'a pas été fabriqué pour ça. De même il faut garder à l'esprit que dans le cluster qui se reforme autour de Star Wars, les avatars cinématographiques de la saga n'en constituent qu'une des occurrences, et peut-être même pas la plus importante ; cependant, balayer l'ensemble du phénomène sous l'épithète de pompe à fric serait aussi erroné. Pendant 40 ans toutes sortes d'exécutifs (dont Lucas lui-même) ont tenté de réduire au pur commerce un système mythologique qui est plus large que la somme de ses parties, et représente aux yeux de ses admirateurs beaucoup plus que des BB-8 radiocommandés.
Ni logo Disney ni logo Bad Robot avant le déroulant d'introduction, seul trône celui de LucasFilm. C'est le premier des nombreux appels du pied que fait le métrage au public et surtout aux fans : Nous sommes respectueux de vos souvenirs d'enfance. Et il faut reconnaitre qu'Abrams, qui ne bitait absolument rien à Star Trek, est manifestement bien plus à l'aise avec l'univers de Star Wars qui a bien plus à voir avec la fantasy qu'avec la science-fiction, dans la mesure où la prospective en est absente : on est toujours dans un monde connu, vaisseaux spatiaux et droïdes n'étant qu'une surcouche de folklore technologique appliquée dessus. La construction en serial, propre à la trilogie originale, sied aussi au tempérament du bonhomme, qui peine à envisager ses récits sur un autre mode que celui de la série à épisodes. Un récit qui reprend à la lettre la plupart des éléments-clé de la trilogie originale, ou plutôt, à nouveau, les motifs saillants tels qu'on s'en souvient : intrigues filiales, Cantina, une nouvelle Etoile Noire pour un nouvel Empire galactique, des droïdes renfermant des cartes... Et tandis que les lieux émulent ceux vus jadis (Jakku en nouvelle Tatooine, Coruscant en nouvelle Alderaan, la station Starkiller et son climat à la Hoth), les personnages ne sont typés que selon les canons jadis posés : un empereur holographique, un Vader impétueux, une Yoda orange, une nouvelle trinité Leïa/Han/Luke à laquelle la première passe le relai, une capitaine qui ressemble beaucoup à Bobba Fett, un Ténardier du désert qui mixe Jabba et Wato, et un acteur du répertoire pour faire bonne mesure (Max Von Sydow remplace Alec Guiness). De même des révélations et évènements disruptifs, dont aucun n'est neuf ni franchement surprenant : oui, un droïde est égaré dans le désert et opportunément recueilli par le protagoniste, caché là dans enfance. Oui, un personnage majeur meurt et c'était "ton père". Oui, le Millenium Falcon sert à des manœuvres évasives ET à une incursion dans un vaisseau impérial. Oui, la station de mort de l'espace possède une longue tranchée et un seul point faible. Mille fois oui, toutes sortes de petites citations jouent le fan service avec une énergie telle qu'elle en deviendrait suspecte. Oui, il y a des raccords en volet et on entend même au moins un Wilhelm scream. Un exemple : dans le Falcon, le jeu d'échecs holographique se voit brièvement allumé. Cette poignée d'images du holochess a été refaite en stop motion par Phil Tippett lui-même, exactement à l'identique de l'originale...
Là où LucasFilm et ILM posaient de nouveaux standards à chaque nouveau Star Wars par le passé, il semble ainsi que ce film met un point d'honneur à enclencher la marche arrière en signe de déférence. Certaines des décisions qui en découlent sont excellentes. En particulier le choix, a priori dispendieux, d'utiliser autant que possible des décors et des effets physiques, en opposition ontologique avec la fameuse prélogie et ses pauvres acteurs désœuvrés, perdus devant des kilomètres de fonds verts. Paradoxalement d'ailleurs, ce choix du tangible crée un contraste négatif sur les quelques créations numériques qui restent : Maz Kanata et surtout Snoke, objectivement loupés de la conception à la texture, confirment par contraste que le prochain pallier de réalisme en termes de créatures numériques reste à atteindre. Surtout, on se demande l'intérêt de recourir au numérique pour des designs de personnages aussi humanoïdes et convenus, dans un univers où d'innombrables créatures exubérantes remplissent chaque coin du cadre de leur splendeur caoutchoutée. La séquence d’attaque des grosses bestioles en plein affrontement de contrebandiers (avec le caméo le plus amusant du film : Yayan Ruhian et Iko Uwais !), outre qu’elle recycle aussi un morceau de bravoure de Empire Strikes Back (les mynoks), est elle aussi handicapée par un numérique pas forcément heureux, qui frôle même le hors sujet dans un spectacle qui revendique sa patine à l’ancienne. Car la direction artistique, loin du clinquant artificiel de la prélogie honnie, fait preuve d'un goût très sûr, toujours crédible et incarné, jusqu'à un BB-8 fonctionnel sur le plateau... Outre les concessions à la nostalgie (qui avouons-le font leur effet), l'univers est admirablement dépeint, y compris dans les séquences "transgressives" qui nous donnent à voir la manière dont les choses se passent dans le cockpit d'un TIE fighter par exemple.
De même, l’arrivée de Lawrence Kasdan au script se ressent clairement sur la qualité de l’écriture, même si on s’interroge sur la façon dont celui-ci n’a pas tiré les thématiques vers la gloire du passé au détriment de pistes plus inédites. Il se murmure que l’éviction de Arnt aurait été motivée par le fait qu’il privilégiait les nouveaux personnages aux anciens... Est-ce à lui ou à Kasdan qu’on doit cette évolution de la thématique guerrière dans le film, peut-être la seule nouveauté du métrage ? Là où la première trilogie montrait une version fantasmée de l’Amérique de la seconde guerre mondiale (l’axe du bien, l’axe du mal), et la prélogie une réflexion mal dégrossie de la montée des fascismes (une prise de pouvoir se faisant uniquement sur la démagogie ? Réducteur, non ?), cet épisode VII démarre sur la désertion de Finn suite au massacre d'un village: l'amorce d'une réflexion sur l'Amérique post-Vietnam, avec à l'horizon la multipolarisation des conflits ? Le fait que les troopers soient désormais soumis à une forme extrême de conscription, et que le système d'espionnage soit plus tard montré comme allant de soi (la notion d'informations sensibles et donc monnayables est une fois de plus au centre du récit), tendrait à confirmer ce point, avec l'espoir de voir un jour de vrais pouvoirs alternatifs s'activer dans les conflits à venir (Les Hutt ? Kamino ? Les ligues de commerce ?), et pourquoi pas des jedis gris (c'est-à-dire hors de la bigoterie des côtés lumineux et obscur, seuls montrés jusqu'à maintenant).
Néanmoins, la patte de Kasdan a tout son intérêt sur la caractérisation, notamment en ce qui concerne les personnages originaux, au ton très proche de celui abandonné après 1983 : loin du sérieux compassé mâtiné d’éclairs comiques infantiles de la prélogie, les quelques échanges entre Solo et Leïa étant à la fois naturels et consistants... Quand les dialogues ne sacrifient pas à la logique assez irritante du « un cliffhanger et un twist par bobine ». Que d'effets d'annonce et de pseudo-non-dits de bac à sable, tout ça pour faire du name-dropping à la fin ! On se croirait parfois dans les plus faibles épisodes de Buffy... Car bon, nous sommes tout de même devant un film de JJ Abrams, avec tous les tics de showrunner du bonhomme, qui faisaient déjà "merveille" sur Star Trek... Travelings circulaires sur des personnages assis devant des écrans, vue interne de l'hyperespace (pourquoi, JJ? A quoi ça sert ?), caméo de personnalités télévisuelles, et surtout un rythme séquentiel affreusement étal : là où le rythme exemplaire d'Empire... ménageait toutes les intensités sur une échelle de 1 à 10, avec des relâchements, des respirations ET de l'épisme échevelé, The Force Awakens garde constamment ses potards à 7 que ce soit dans une séquence de dogfight ou un dialogue sursignifiant, et cela se ressent aussi dans la partition de John Williams qui se réduit à un bruit de fond orchestral. L'effet est dévastateur pour le tragique : La mort d'Untel ou la destruction de tout un système solaire (qui sonne comme un règlement de comptes définitif, mais mesquin, avec la prélogie) passent comme un pet sur un toile cirée, sans qu'on n'en ait un steak à s'en battre.
Dommage que ce montage séquentiel atténue par ailleurs un découpage souvent inspiré au sein des divers moments-clés du film, tout en accentuant les quelques raccourcis pris par désir de remplir jusqu'à la gueule les deux heures douze de ce que Abrams envisage comme un pilote de série. Et plus que les dei ex machina gênants (le retour de Poe, le réveil de R2-D2) voués sans doute à être expliqués dans d'autres films, ou la sous-exploitation de personnages tels que Phasma ou Maz Kanata, c'est vraiment ce sentiment d'une grandiloquence de façade vouée à camoufler une retenue scénaristique qui s'avère dommageable. Il n'est pas surprenant que le film soit formidable sur ses 40 premières minutes (c'est enlevé, malin, empathique), puis qu'il parte en eau de boudin quand les concessions à la nostalgie s'enchainent (persos historiques, fan service, distillation excessive d'éléments). Le bât blesse justement lorsque de bonnes idées ou des éléments bien vus (l'interprétation notamment, avec un Oscar Isaac surprenant et une Daisy Ridley qui devient immédiatement le nerd crush des 10 prochaines années) se voient sacrifiés sur l'autel de la narration de série télé, au point d'annuler l'iconisation dont a cruellement besoin le récit . Pourquoi diable montrer le visage de Kylo Ren (à part pour lancer une rumeur sur le fait qu'il serait le fils caché de Roger Waters ?) si ce n'est pour sacrifier à un tic de série d'aventure pour ados ? De même, il y a un vrai souci de désacralisation avec l'utilisation faite dans le récit du sabre laser de Luke, présenté brièvement comme une relique puis utilisé à tort et à travers et même contre un tonfa électrique...
Au final, un métrage qui laisse bel et bien une impression mitigée : ça devait incroyable, et c'est seulement sympathique. Pour ne pas céder à la colère ou aux jugements hâtifs (la colère mène au Côté Obscur et à caster Hayden Christensen, ne l'oublions pas), on se souviendra que ce film est au sens strict un reboot, un passage de relai. Beaucoup de plans appuient ce voeu, où l'on voit un nouveau personnage dans le même cadre qu'un ancien. Le but est de montrer patte blanche aux fans, de se défaire ostensiblement de certains héritages embarrassants pour relancer une série de récits affranchis des errements du passé. On peut certes être déçus du film bancal qui nous arrive pour le moment - on peut aussi attendre avec d'autant plus d'intérêt ceux qui vont suivre, en particulier le tout prochain Rogue One. C'est ainsi: ce film n'existe pas pour lui-même mais pour d'autres objets à venir, et pour eux, il écarte surtout George Lucas. Or, on aurait beau jeu de ne pas reconnaître la cohérence avec le fait Star Wars tourne autour d'un pivot symbolique qui est aussi un ressort scénaristique : tuer le père.
Autrement dit, Star Wars – The Force Awakens s’enlise dans son propres succès, s’abime dans son désir de faire plaisir, précisément parce qu'il y parvient. En substance, c'est presque d'ailleurs tout ce qu'on peut dire du dernier JJ Abrams : il tient (la plupart de) ses promesses. Il ne tient que celles-ci, et le fait même qu'elles soient tenues est le point nodal du problème que pose le film : ces promesses étaient toutes des promesses de confort. La question n'est pas celle du film, de sa facture, ou du cynisme réel ou fantasmé de ses instigateurs. Elle est rien moins que celle de notre exigence en tant que spectateurs. Ceci dit, il n'y a rien de condamnable à simplement jouir de l'agrément et de la légèreté que procure un spectacle. N'avions-nous tout simplement pas tort de vouloir être excités par un calmant ?
*Voir par exemple la première idée d'apparence de Yoda, avant qu'Irwin Kershner et surtout Frank Oz le fassent évoluer vers le design asiatisant qu'on connait : Lucas voulait un grand patriarche barbu et musclé. Notons aussi que l'idée des phrases inversées à la japonaise du maître Jedi, soit l'un des traits les plus caractéristiques la saga, viendrait également de Frank Oz lui-même.
NEUCHÂTEL FANTASTIC FILM FESTIVAL 2015 - Bilan
NB : impossible de tout voir dans la programmation pléthorique du NIFFF ; il aura fallu faire des choix. Certains films présentés (Love, Gaz de France...) ne seront donc pas traités ici, ainsi des films projetés en rétrospective. De même, les films sont évoqués thématiquement et non rangés par sélection.
Neuchâtel... Son lac, ses fontaines, son banc public surdimensionné, sa vie quotidienne à prix suisses (ouch), et son festival du film fantastique qui fêtait déjà, en ce caniculaire mois de juillet, ses trois premiers lustres. Un évènement dont le prix est peut-être bien, justement, d'être suisse, dans cette partie "libérale" du pays qui peut se permettre un certain iconoclasme tranquille : à proximité, on trouve entre autres la Chaux-de-Fonds et le musée Giger de Gruyère. Hans Ruedi Giger d'ailleurs, figure tutélaire revendiquée dont le nom est associé à certains prix et sélections, et dont l'une des œuvres est le logo même de l'évènement. Décédé cette année, le festival lui rendait discrètement hommage via la programmation d'un documentaire sur l'artiste, Dark Star, pudique et émouvante peinture du quotidien de l'artiste entouré de ses proches, collaborateurs, et de son œuvre.
15 ans donc, cet âge supposément beau, propice aux expérimentations, aux sporadiques moments de sérieux grandiloquent et aux potacheries prépondérantes. Et de fait, le NIFFF n'usurpe pas sa réputation d'être l'un des plus intéressants festivals de film de genre en Europe, précisément parce qu'il emprunte sans tabou toutes sortes de directions, au point même de se disperser jusqu'à friser le hors sujet. Toutefois, c'est cet aspect bon enfant qui, s'il fait grincer par moment des dents (de sa programmation parfois irritante, à son village qui évoque plutôt une soirée d'école d'ingés qu'autre chose), fait le sel certes un peu désordonné de la manifestation. Le charme du NIFFF est de ne pas être un machin guindé, ce que bien d'autres festoches pourraient prendre en exemple. On voit peu, ailleurs, des salles entières (organisateurs compris) mettre en place des rituels de foutage de gueule des messages de sponsors à l'écran...
Exercice de festival oblige, le bilan de la programmation elle-même est nécessairement contrasté, dans la mesure où il dresse un panorama à un instant T. A cet égard, ce NIFFF confirme la tendance qu'on pressent depuis quelques années déjà, et que nul ne peut plus vraiment ignorer cet été avec l'invasion de blockbusters clonaux et paresseux qu'on a eus à voir (Marvel phase 2, Terminator Genisys, Jurassic World, Pixels... What year is this ?!): la radicalisation du cynisme des exécutifs (ou d'auteurs qui jouent les je-sais-tout) d'un côté du spectre, et de l'autre la réémergence d'une forme de sincérité, souvent mais pas nécessairement teintée de colère, qui sort des interstices de la production indépendante, pour montrer sa frimousse sous un éclairage de plus en plus franc. Et cette année se voit bien dotée en ce qui concernait le ratio purges/bons films, et dont on retrouve en ce moment même une partie des fleurons à l'Etrange Festival. Et un de ces jours dans vos bacs à DVDs.
A l'est... Pas grand'chose.
A propos de tendances qui se confirment, le marasme routinier du cinéma de genre extrême-oriental des années 2010 se porte encore assez bien : budgets largement en deçà des ambitions des films, inflation de mièvrerie cul-cul et/ou de propagandisme revendiqué, photographie à la ramasse (tout a l'air d'avoir été shooté en hdv ntsc)... Et Miike qui se ballade au milieu. Au rayon "Auteurs Célébrés", Oshii déçoit (à nouveau) avec son prochain effort. Son Nowhere Girl est looooooong, statique, ampoulé. Avec ce paradoxe étrange chez le réa des deux GITS, qui montre ses acteurs de films live bouger et parler sans aucun naturel, là où ses films d'animations débordaient de grâces naturalistes... Une excellente séquence fantasmée de démastiquage de soldats en fin de troisième acte ne suffit pas à tirer le film de la glue où il s'embourbe, apparemment avec délices. Au rayon déceptions et vêtements pour hommes, le grocoupin de tous les festivals européens, Takeshi "Visitor Q" Miike, s'en sort mieux que son compatriote : son Yakuza Apocalypse est au moins amusant pour une bonne moitié, ce qui le classe accessoirement dans les très bons Miike. Et tape même juste avec son histoire de yakuzas vampires, même si la parabole est grosse : dès que tout le monde devient un vampire, plus personne n'a besoin de suceurs de sang en costards. Mais le spectacle se laisse apprécier pour ses quelques moments de wtf-isme, son tueur-grenouille et sa garderie de vieux mafieux tricoteurs. On lui pardonnerait presque (presque) de ne rien faire des prouesses martiales de Yayan Ruhian par ailleurs très rigolo attifé en chemise Vieux Campeur, et de finir son film, comme d'habitude, en eau de boudin... et il faut bien avouer qu'à l'époque où s'est institutionnalisé, y compris sur le marché mondial, le Z japonais nimpeux comme genre en surpopulation, Miike perd beaucoup de sa spécificité. Heureusement, il y avait Sono Sion, dont on ne parlera que du gigantesque Tokyo Tribes, qui devrait être distribué prochainement en France, et sur lequel il faudra se jeter pour se laver un peu les yeux et les oreilles : Comédie musicale hip-hop, guerre des gangs, pamphlet anti-trust et pacifiste au ton et à la réalisation incroyablement libres et maîtrisés, Tokyo Tribes est l'un de ces très rares films à tenir plus de promesses que celles qu'il a faites.
Essai trop imparfait pour être vraiment concluant (réalisation sans réel point de vue, rythme problématique), Hollow a pourtant un intérêt dans sa peinture des folklores magiques et superstitieux de l'Asie du sud-est, et du Vietnam en particulier, qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir sur des écrans occidentaux. Il est pourtant plus recommandable de ce point de vue ethnographique que de celui du cinoche pur, même si son imagerie se déploie au profit d'un discours et de personnages plus soignés qu'on ne le croit de prime abord. Ethnographie toujours avec le "plus gros blockbuster taïwannais de l'histoire", Black and White - Dawn of Justice. Si le film part d'un postulat intrigant (une organisation terroriste isole la ville pour y libérer un virus mortel, dans un but qui aurait amusé Karl Kraus), le résultat devient hilarant à force de collisions entre tous les codes les plus lénifiants du film d'action mainstream américain et asiatique. De la caractérisation aux situations en passant par les grandes tirades sur le devoir ou l'importance d'avoir des amis (!!!), le film de Tsai Yueh-Hsun semble s'échiner à être une caricature de lui-même. Mangeons plutôt coréen, où les saveurs restent plus épicées : Office, première réalisation Hong The Chaser Won-Chan, est bien plus qu'un thriller antisocial tendu. Il dépeint et interroge surtout l'horreur institutionnalisée du monde des open spaces, du middle management et des grandes capitales, son écrasement des faibles, des stagiaires, et de ceux qui glissent une fois de trop. Société dure qui crée des comportements durs, la Corée du Sud continue de nous donner des cinéastes forts qui tendent un miroir amplifié mais exact au spectateur oublieux. En attendant que le Japon se réveille on a de quoi se titiller les nerfs.
Les précieuses ridicules
A certains égards, un festival actif met bien en évidence l'affrontement entre les deux forces fondamentales qui sous-tendent la création au cinéma, la sincérité et le cynisme. Combat souvent amusant à suivre tant le second tend à revêtir les oripeaux de la première. Amphigouris auteurisants, véhémences adolescentes et flatteries du snobisme d'un certain public de professionnels se retrouvent ainsi dans des proportions impressionnantes dans les festivals, boîtes de Petri au milieu riche et concentré profitable à tout ce qui pousse et sporule - y compris les moisissures les moins nobles. Comme dans tout festival, le NIFFF n'est pas à l'abri des génies autoproclamés, à l'infatuation vaine, naïve, et même pas délétère. Tout cela se veut scandaleux ou débordant d'humanité dérangeante, ça ne suscite qu'un ennui au mieux bienveillant. Avec un petit twist idéologique amusant cette année.
Paradoxalement, c'est sans doute la décision un peu démagogique de convoquer un jury exclusivement féminin (il est étrange bien que très contemporain de créer des exclusivités de ce style dans le but de promouvoir l'égalitarisme), qui aura alimenté une partie des perles de cet acabit cette année. Le pouvoir, au sein d'un festival, n'est pas au jury mais au comité de programmation : on ne vote après tout que sur ce qu'on nous donne à voir. Ce n'est donc pas la féminité (notion floue et protéiforme) qu'on interrogera, mais l'idée paternaliste monobloc que d'aucuns se font de la féminité et de ses valeurs. Celle-là même, sous prétexte d'une émancipation qui ne lui doit rien, d'où est sortie une sélection marquée par quelques métrages qui caricaturent les préoccupations "de filles"... Ainsi de The Falling de Carol Morley, film sur l'hystérie ne parvenant qu'à faire montre d'hystérie, qui culmine dans une sorte de Footloose de la crise de tétanie, puis dans la mise en scène sur un ton perdu et farouchement faux d'un drame familial téléphoné avec inceste présumé et (tentative de) suicide. Les images sont jolies et les actrices convaincues, mais Dieux ! Que c'est pénible à voir ! Dans une lettre en apparence plus moderne et trash mais touillant le même marigot de complaisance, Excess Flesh de Patrick Kennely se montre d'une rare gratuité, même dans le monde du brûlot revendicatif pour jeune occidentale aisée. Il ne suffit pas de montrer des personnages désespérément unidimensionnels (une fille mince méchante et une moins en surpoids victime, quelle finesse d'analyse) hurlant, baisant et se gavant (longuement), puis vomissant (longuement également) et tentant de s'entretuer (mollement), pour s'acheter une street crèd' de réveilleur de consciences. 90 minutes pas super bien filmées de cris et mâchonnements en culotte sale ne font pas de vous Gaspard Noé.
Apparemment plus posé, le germanique Homesick irrite pourtant tout autant par sa prévisibilité et l'orgueil petit-bourgeois de son projet. Histoire d'une jeune violoncelliste qui sombre dans une joute parano avec sa voisine âgée dans son nouvel immeuble, le film de Jakob Erwa trahit très vite ce qu'il est, un petit pensum affecté de bobo dont la plus grande peur semble être que les habitants des quartiers populaires qu'il gentrifie se rebiffent un peu... Ça part mal, avec l'incapacité où l'on est mis d'avoir de l'empathie pour une héroïne qui se présente presque d'emblée comme une post-adolescente autocentrée. Et au fil de péripéties trop évidentes pour que le démonstratif twist hallucinatoire ne soit pas vite éventé (cf. le chaton), on se rend vite compte que cette autophilie vétilleuse est celle du film même, qui se donne des airs d'émuler la clinique de Polanski et Hanneke à l'aide d'un seul gimmick répété à l'envi : le plan fixe et large, qui reste en place quand un personnage sort du champ, pour nous laisser un cadre vide avec des voix off. Quelle joie de regarder ces murs grisâtres qui nous crient "je suis un auteur!" pendant de longues minutes !
Quelques films de gros malins fleurissent encore dans cette sélection, sur lesquels on passera avec mansuétude, car certains ratent leur cible par simple méconnaissance de leurs enjeux narratifs ou thématiques. L'espagnol The Corpse of Anna Fritz (des viandards violent le cadavre d'une petite starlette et sont pris au dépourvu quand la fille se réveille) a ainsi des arguments dans sa misanthropie apparente, mais échoue précisément parce qu'il ne peut s'empêcher de se conformer aux codes les plus lénifiants dans sa deuxième moitié revancharde, qui laisse le spectateur la conscience dans les pantoufles. Sur un sujet similaire, on reverra de préférence le bien plus délétère Dead Girl. De même de Scherzo Diabolico du mexicain Adrian Bogliano, dont on ne sait jamais s'il fustige réellement le cynisme de son protagoniste crapuleux qui kidnappe une jeune fille pour monter dans l'échelle sociale, ou s'il partage en fait la petitesse de ses préoccupations ; question encore une fois soulevée par un dernier acte vengeur qui ne cherche qu'à annuler les sentiments inconfortables qu'aurait pu susciter la séance, presque même à s'en excuser... On passera aussi sur le snobisme estampillé "rions des bouseux" d'un Der Bunker, qui se veut un conte bizarre et déviant, mais ressemble surtout à un épisode des Deschiens en allemand, quelques moments amusants ne parvenant pas à masquer le goût de mépris citadin de la chose. Peu à voir aussi du boursoufflé Der Polder, qui recycle dans le désordre tout ce qui s'est fait en cyberpunk Dickien depuis 25 ans, le sens de l'unité noyé sous la satisfaction de se trouver intelligents. Plastiquement, ça ressemble vaguement à un DTV post-Hackers qui aurait été tourné en 1998, scénaristiquement à un film de fin d'année de licence. Un peu comme Crumbs, imbitable et prétentiard dans son post-modernisme d'expo d'art contemporain, et qui fait illusion pendant deux bobines avant de tourner sérieusement en rond dans son contentement de lui-même et son affectation arty.
Du travail honnête fait honnêtement
Heureusement, on eu surtout (et à quel point) l'occasion d'aimer le cinoche lors de cet évènement surchauffé de canicule alpine. Et d'abord, parmi les métrages problématiques évoqués plus hauts les films humbles, ceux qui cherchent avant tout à raconter une histoire sans se faire mousser. Ces travaux d'artisans qui ne prétendent pas au génie autocrate, et vous font retrouver foi dans le médium. C'est la sélection de courts internationaux qui, étonnamment, montrait le plus de ces candidats à l'honnêteté... Délicatesse et même tendresse y étaient manifestement le fil rouge. Aucun des films présentés n'y regarde ses personnages ou son action de haut, y compris le très léché et apparemment distant Triptyque de C. Mikolajczak, ou Juliet de Marc-Henry Boulier qui part pourtant comme un court "astucieux" à la française (lire : une grolanderie mais bien filmée). Ce dernier , sous ses dehors de critique sociopolitique facile à base de produits Apple tournés en ridicule, va plus loin que le discours immédiat auquel se cantonne le plus souvent l'exercice, et finit par dépeindre un monde étrangement plausible de machines fonctionnelles mais vides de sens : le nôtre, +1. On retient encore le très sympatoche Aun Hay Tiempo (après Timecrimes, on va finir par croire l'Espagne obsédée par les boucles temporelles), où un portail ramène un type 40 secondes en arrière pour lui permettre d'apprendre à ne pas être un crétin, et le très beau et délicat Dive de M. Saville (Nouvelle Zélande) qui traite de sujets lourds et complexes - le deuil et la tentation du suicide - avec une économie de moyens narratifs et une légèreté (au sens premier du mot) trop rares dans le court contemporain.
Du film honnête et modeste, il y en avait beaucoup au NIFFF. Du sérieux pas pompeux, du léger pas débilitant, de l'émotion sans mièvrerie. Cette modestie est en effet celle de l'attitude mais pas de l'intention ou des ambitions : Robot Overlords, par exemple, met en scène l'occupation à échelle apocalyptique de la Terre par des robots extraterrestres et compte à son casting Ben Kingsley et Gillian Anderson. Mais c'est son ton profondément humain, l'astuce dont il fait preuve pour transcender son budget et son sujet, et le fait qu'il ne regarde jamais ce dernier sans le sérieux qui sied (ça reste de la SF de bout en bout), qui confirment tout le bien qu'on pensait déjà de John Wright depuis le très bon Grabbers. Dans le même esprit, Stung de Benni Diez est un B très recommandable, aux personnages savamment archétypaux et à l'humour bien dosé, c'est-à-dire qu'il n'annule pas les enjeux au premier degré du film. Il pose son projet avec vigueur en recourant notamment à beaucoup d'effets physiques pour ses guêpes mutantes, et en embrassant pleinement son statut decreature feature du samedi soir. Et vivement le moment où tous ces film inonderont les bacs de ta FNAC, parce que des samedi soirs bien remplis, on en aura quelques uns de qualitatifs, et ça va nous changer : dans le domaine du thriller notamment, on saluera Emelie de Michael Thelin, un Babysitter gone wrong qui ose aborder frontalement le potentiel de déviance de son sujet et instille une ambiance oppressante de bout en bout (interprétation glaçante de Sarah Bolger) tout en posant, en creux mais avec acuité, la question de notre représentation de l'adolescente et la façon dont elle a été faussée par trois décennies de fictions télé où des trentenaires plus ou moins juvéniles d'aspect jouent des lycéens...
La comédie Ava's Possessions de J. Galland, elle, part d'un postulat malin étrangement jamais vraiment évoqué sauf peut-être dans le court épilogue du film séminal de Friedkin : une fois libéré à l'issue d'un exorcisme, qu'est-ce qu'on fait de sa vie chamboulée par les blasphèmes, le cul débridé, les mutilations et les meurtres commis sous l'emprise du démon ? Ava découvre ainsi qu'elle va devoir se réhabiliter via un programme des Possédés Anonymes, avec l'ensemble des twelve steps afférents, qui va la mener à découvrir les tenants et aboutissants de sa possession par un démon... Enlevé et bien écrit, c'est un vrai petit bonheur de comédie noire. Moins évidente pour des publics latins mais dotée d'un cœur gros comme ça, la comédie romantique Lovemilla excuse largement ses maladresses de rythme par son ouverture sur toutes sortes d'imaginaires (mention spéciale pour les enquêteurs du dimanche en guerre contre un supervilain épandeur d'E-coli) et son ton humaniste qui le rend extrêmement attachant. Une sorte d'alchimie étrange lui permet de faire du "post-moderne candide", ce qu'on savait déjà possible de l'autre côté de l'Atlantique avec par exemple un Kevin Smith, autre gros nounours plein de tendresse caché derrière des vannes de potache.
En apparence plus parodique, Turbo Kid s'avère être un excellent post-apo à l'univers très cohérent. Ainsi son hommage à la candeur du cinéma pop des années 80 n'a rien de postmoderne ou de méprisant envers cette candeur, dans la veine moqueuse d'un Kung Fury. Au contraire, il suit avec la même "naïveté maîtrisée" que ses modèles les imageries et la logique de son univers : et en effet, dans un futur sans carburant, tout le monde se baladera sans doute en VTT. Bourré d'idées de script et d'imagerie inventives, Turbo Kid ne souffre jamais vraiment de son budget qu'on devine restreint, et qu'il intègre dans sa propre imagerie. Dans une lettre plus gentiment trash, Deathgasm a tout pour devenir la nouvelle bande de chevet des métalleux qui se prennent pas trop au sérieux (c'est-à-dire TOUS nos amis métalleux, hors les 0,3% dont les loisirs comportent l'incendie volontaire d'églises scandinaves après un en-cas vegan/straight edge), en supplantant même le mètre-étalon du sujet qu'était Little Nicky. C'est l'histoire d'un loser adolescent qui, tout à son enthousiasme d'avoir un groupe de metal et un nouveau pote hardcore, se retrouve à invoquer par erreur un démon apocalyptique qui infeste son village de zombies agressifs. Tout le monde panique ou s'entredévore, sauf nos héros pour qui l'aubaine est trop belle de démastiquer tout ce beau monde dans une débauche de gore et d'armes improvisées (dont une collection impressionnante de sextoys trouvés chez la famille d'accueil dévote). ET avec un montage et une bande son à l'avenant, et une cohérence dans l'imagerie qui décuple le potentiel comique du film (bref tout ce qu'on fait trop rarement chez nous, à bon entendeur). C'est comme voir une version live de Metalopocalypse : c'est merveilleux. Prévoir des binouzes et des live de Pantera pour compléter la séance.
Un mot en passant sur Maggie (présenté au NIFFF après sa sortie francophone), le joli récit zombiesque qui a souffert de beaucoup d'a priori et de mépris du seul fait de la présence de Schwarzie à son cast. Le film subit manifestement la mauvaise réputation de sa tête d'affiche, vaguement justifiée par l'autoparodie pataude à laquelle l'intéressé se livre depuis 10 ans. Maggie, pourtant, est un très beau film, pas prétentieux pour un sou, qui suit les pas d'un I, Zombie Chronicles of Pain pour dépeindre le phénomène sous l'angle intimiste de la maladie incurable. Il le fait avec délicatesse, sinon avec classe, et mérite d'être vu sans cynisme. Et Arnold y joue très bien, na.
Prends ça !
Et puis, tout de même, quelques films importants, chacun à sa manière. D'abord un polar curieux, qui part graduellement vers une étrangeté quasi-fantastique : Bridgend est un film particulier dans la mesure où, contrairement à la plupart des films "basés sur des faits réels", le fait que l'histoire soit vraie ajoute à la bizarrerie ressentie plutôt que de la normaliser. Et le fait divers dont s'inspire le danois Jepper Ronde est d'autant plus troublant qu'il est encore en cours : dans un bled du Pays de Galles, une épidémie de suicides frappe les jeunes gens sans qu'on parvienne à se l'expliquer. Si le script joue la langueur dans les rapports entre l'héroïne et son père policier fraîchement débarqués, c'est pour mieux instiller la confusion face à cette communauté de jeunes gens soudés par des rituels, des modes de communication et des valeurs opaques pour qui ne fait pas partie de leur groupe ou n'a pas leur âge. Comme dans la vraie vie, l'explication ne viendra jamais, et surtout pas dans le final, qui convoque par la bande les reliquats de paganisme de l'Angleterre rurale, qui irriguent un cinéma incroyable depuis dix ans (on pense même furtivement au Kill List de Ben Wheatley, c'est dire).
Avatar récent de la nouvelle scène horrifique indépendante des Etats Unis, le formidable We Are Still Here de Ted Geoghegan est un film de fantômes qui a (enfin!) le bon goût de se détourner de toutes les infortunes de l'esthétique qui gangrènent le fantastique surnaturel post-Paranormal Activity : jumpscares, persos insipides, temps morts sur 95% du métrage, imagerie au ras du cortex d'un ado de 13 ans... Ici, ce qui démarre comme une démarcation de Fulci (des parents s'installent à la campagne pour faire le deuil de leur fils, et tombent face à des présences hostiles) prend très vite de l'envol par un script malin (l'univers, notamment l'histoire de la maison et du village, est riches de virtualités), une très belle interprétation et surtout le fait de ne jamais se cacher derrière son petit doigt à l'idée de raconter une histoire surnaturelle. Et lorsque les villageois, les fantômes et les protagonistes s'affrontent, la tension étouffante patiemment amassée dans les premiers actes explose de façon décomplexée, jusqu'à un plan et une réplique finaux absolument magnifiques dans leur simplicité. Un apaisement (relatif) qu'on ne trouvera pas dans le hargneux et désespéré Some Kind of Hate de A. Mortimer, sorte de traité sur la contagion irrémédiable de la haine, de la douleur et de la rancœur, sous forme d'un slasher surnaturel à la croisée deNightmare on Elm Street et Ju-On. On y voit le fantôme d'une adolescente harcelée jusqu'à la mort se venger par un mode opératoire viscéral : les blessures quelle s'inflige se répercutent immédiatement sur ses victimes, dans une revanche qui confine à la folie totalitaire lorsque celle-ci dit à l'un des ados vivants auxquels elle s'est attachée "ils sont tous les mêmes". Que l'aspect whodunit soit un peu en retrait, et que le héros soit un peu falot, n'éclipse en rien la force d'un vrai film d'horreur au premier degré, brutal mais pas complaisant (Dieux comme ça fait du bien), et moins primaire qu'il n'y parait. La rhétorique autour des jeunes filles qui s'entaillent, et des ramifications psychologiques et sociales du phénomène, est loin d'être anodine, et blanchit un film efficace de tout soupçon de nihilisme.
Pas fantastique pour deux ronds mais emballé avec la rage et la ferveur des vrais arpenteurs d'imaginaires, Green Room s'est accaparé le gros des récompenses. Et il faut dire qu'après son Blue Ruin qui a assommé tout le monde d'un grand coup au plexus, Jeremy Saulnier tape encore très très fort. Green Room est sans doute le meilleur survival sorti depuis 5 ans, parce qu'il est non seulement efficace et jusqu'au-boutiste, inventif dans la caractérisation autant que dans la violence, mais surtout parce qu'il suit sa propre logique sans en dévier pour de fallacieuses raisons de politiquement correct : quand on oppose des punks à des skins (les premiers sont témoins malgré eux d'un meurtre perpétré par les seconds, dans le "club" où ils viennent de jouer), on sait qu'on ne va pas donner dans la sucrerie, mais il est tentant de jouer la carte de la jubilation facile à l'usage exclusif du petit blanc antifa fan de Minor Threat. C'est l'erreur que commettait par moments le récent Un Français. Saulnier, lui, chatouille cette fibre avec ses personnages au demeurant attachants, quand ils jouent l'éternel Nazi Punks Fuck Off (en entier !) devant un parterre de neuskis pas conquis. Il montre pourtant très vite que ce monde est plus complexe dans ses lignes de force, en alliant une skin avec nos héros, et surtout en nous montrant un patriarche hautement inconfortable en la personne de Patrick Stewart froid et efficace comme un général assiégé lorsque les rapports de forces évoluent, et au charisme corrosif. Sec et tendu mais ne perdant jamais de vue l'humanité de chacun de ses personnages au profit de leur seule idéologie (l'enjeu n'est pas le désaccord entre les factions, mais prosaïquement l'élimination de témoins), Green Room est un très beau moment de cinoche. Espérons que ça lui vaudra une sortie salles.
Le monde des humains n'est pas bien bon ; c'est entendu dès les premières images de The Invitation de Karyn Kusama, enfin libéré des jougs d'exécutifs qui la tenaient jadis sur des productions cossues mais mal pensées (Aeon Flux...Haheum.). The Invitation est le dernier représentant en date d'un courant jeune de films, aux contours flous, qu'on peut qualifier de perplexes face à un état terminal d'anomie de nos sociétés qui rappelle les derniers jours de Rome. On peut le voir comme le complémentaire du magistral Cheap Thrillsd'E.L. Katz : si celui-là parle de détresse économique et sociale au final librement consentie par ses victimes même, celui-là prend le même décor (les hauts de Los Angeles, nadir du bullshit CSP+) pour mettre en évidence une forme de détresse spirituelle et métaphysique, inhérente à un certain occident riche élevé depuis le baby boom dans un narcissisme forcené. Dans ce supermarché des sectes, coaches de vie et cultes en tous genres qui sont pour la plupart les faux-nez de la même célébration de soi en tant qu'enfant tout-puissant, n'importe quelle soirée informelle peut tourner au recrutement : au mieux ce sera une pyramide de Ponzi, au pire un trip à la Jim Jones. Ici le suspense tourne bien autour de la perception du protagoniste (il revoit son ex pour la première fois depuis la mort de leur enfant, alors qu'elle l'invite à un mystérieux get-together), et consiste à savoir s'il est paranoïaque ou s'il a raison d'être paranoïaque. La mise en scène pose bien ses enjeux en en joue habilement via un rythme lancinant et une construction progressive des espaces, le luxe oppressant de la maison appuyant parfaitement l'ambiance funèbre et lourde de menace de l'ensemble. On nous laisse cependant peu de doute sur la nature des évènements (la fête pue le danger et la mort dès le départ), qui semblent contaminer de manière préemptive toute la région (l'épisode du coyote). Pourtant, lorsque les évènements prennent, le spectateur est effectivement surpris autant par la rapidité de la dégradation que par son aspect total et sans appel, jusqu'à une conclusion qui est moins une cauda que la dernière touche d'un réquisitoire. A voir avec toutes ses antennes dressées.
Chaque festival a ses injustices : pourtant remarqué partout où il a été montré, Spring n'a été distingué au NIFFF par aucun honneur... Erreur, car c'est un joyau d'autant plus chatoyant qu'il montre ses qualités remarquables sans ostentation, qu'il se donne à voir avec la simplicité d'une rencontre avec une biche dans un sous-bois. La métaphore est intentionnelle, tant le terme "naturel" est le mieux à même de décrire l'équilibre extraordinaire du film. Quelqu'un a écrit jadis que la beauté de la nature nous cache son abjection. Le poème de Benson et Moorhead (deux réas à suivre de tous nos yeux) nous affirme la vérité de cette intuition, mais celle aussi de sa réciproque. En de longs plans naturalistes et maîtrisés, l'histoire de ce jeune homme qui rencontre une femme à la nature mystérieuse et en tombe amoureux touche au cœur du spectateur à de multiples reprises, sans agressivité mais avec résolution. Déflorer plus avant l'histoire serait sinon criminel, en tous cas impoli, on précisera seulement qu'il faut tenir la première bobine, volontairement à se pendre, pour accompagner le protagoniste dans son voyage en Italie. Le reste parvient à faire d'un argument lovecraftien crédible, une ode désarmante à l'amour et la beauté. Ne tournons pas autour du pot : ce film est un miracle d'intelligence et d'émotion, racontant à la fois une histoire d'amour, un récit d'accession à la maturité ET une fresque fantastique qui n'a jamais honte d'elle-même, et mêle tous ces éléments de manière très organique en y insufflant une vie et une crédibilité dont la plupart de nos réalisateurs germanopratins n'oseraient même pas rêver. Les dialogues, le jeu des acteurs (tous parfaits) et la temporisation des actions sont tels qu'on a constamment l'impression d'être au milieu de ces gens, des moments les plus anodins aux visions les plus baroques. Certains moments, par exemple le ralenti de l'arrivée dans le village, ou le voyage à Pompeï, sont portés par cet art précis et sincère de mise en scène qui propulse l'ensemble de l'ouvrage, pour devenir des moments de perfection cinématographique qui vous parlent directement, avec calme et évidence. On ressort de la séance le sourire aux lèvres, la larme à l'œil, avec l'envie de tomber amoureux et de rester au soleil pour toujours. Qu'il est bon de vivre ça au cinéma à nouveau, cette émotion juvénile qui pourrait presque ressembler au bonheur si nous ne nous targuions pas d'être des hommes détrompés. Quand un film fait tomber brièvement, délicatement, les écailles de snobisme de vos yeux et vous fait revoir le cinéma comme un miracle ou un lever de soleil à nouveau, on dit simplement merci.
Bon, les distributeurs, vous nous sortez tout ça cette année, cette fois-ci ?
MAD MAX - FURY ROAD
2015 : George Miller enfin reconnu pour ce qu'il est, c'est-à-dire un des très, très grands cinéastes de ces 40 dernières années ? Au vu de cet opus magnum et de son hallucinante profondeur à tous points de vue, il serait temps. WITNESS THIS !
"Je ne sais pas avec quelles armes sera combattue la troisième guerre mondiale, mais la quatrième le sera avec des cailloux et des bâtons". Suivant la sentence d’Einstein presque à la lettre, le monde de l’après-boom nucléaire n’a apparemment plus rien à voir avec le nôtre, à part quelques rares artefacts et l’exacerbation extrême des comportements de sauvagerie inhérents à l'humain en état de pénurie. Des années (des décennies ?) plus tard, des poches d’organisation de la barbarie se sont constituées sur les trop maigres ressources encore exploitables : l’eau pure, la terre non contaminée propre à faire pousser les dernières graines, le pétrole restant, les êtres humains sains aptes à engendrer des enfants sans difformités... Ce qui reste d’humanité est non seulement en péril permanent, mais surtout perdu et prompt à suivre les plus charismatiques pour se réfugier religieusement sous leur tutelle. Max Rockatanski, ancien policier hanté par un très lourd passé, est fait prisonnier au sein de la communauté d’Immortan Joe, qui règne à coups de carotte et de bâton sur quelques centaines de survivants, et une armée de fous furieux motorisés qui voient en lui un messie revenu d’entre les morts. Joe détient et organise les ressources d'une oasis très hiérarchisée, qui n'hésite pas à exploiter les êtres humains pour leur sang ou leur lait. Bref, un capitalisme "de crise" où les monopoles vont aux plus implacables, qui n'hésitent pas à s'entourer de psychopathes pour que les veaux continuent en ordre d'aller au pré : vieille antienne hélas universellement d'actualité (une journée de travail dans n'importe quel coupe-gorge corporate permet de s'en rendre compte). Donneur universel qu'on utilise pour perfuser les War Boys fatigués, Max se retrouvera au centre d’une guerre déclenchée contre le système par l'imperator Furiosa, lieutenant émérite d’Immortan Joe, lorsqu’elle enlève les favorites du potentat pour leur rendre liberté et dignité, dans Terre Verte dont elle a le vague souvenir...
Au vu de ce pitch qui n’expose pourtant qu’à peine une bobine de métrage, on balaie déjà l’inanité des critiques entendues çà et là quant à l’absence de scénario du projet Fury Road. Comprendre : pas de scénarisation ostensible au sens tayloriste de l'époque. Ni division utilitaire des séquences, ni tunnels de dialogue soi-disant indispensables au character building, ni surlignement systématique de chaque élément narratif, ni simplification de l'univers pour le faire rentrer dans les rangs d'ognons des futures coupures publicitaires de l'exploitation télé. Il est d'ailleurs amusant que les films les plus "écrits" de ces dernières années, au point d'être d'une fluidité et d'une évidence qu'on devrait enseigner en écoles de cinéma, se voient reprocher un prétendu manque de travail sur leur substance, par des gens qui ne parviennent pas à les pitcher en moins d'une demi-page (remember Avatar, Gravity, Pacific Rim, Matrix et environ 40 autres ?). Pour info, hors histoires antérieures des personnages et storyboards, le script de Fury Road avoisinerait les 170 pages... Pour un film qui parvient à poser ses personnages, son univers avec l'ensemble de son écosystème, ses lignes de forces et de pouvoirs, puis à y imposer un retournement complet de paradigme, le tout en une bobine, le chiffre toutefois n'est guère surprenant. Mais c'est bien entendu le traitement de cette matière, sous une formes alliant la plus cinglante modernité à la geste médiévale, qui surprendra le chaland.
Tout au long de sa carrière, George Miller s’est montré réfléchi et déroutant, incompris tant de ses détracteurs que de certains de ses zélateurs. En premier lieu, son projet de pur cinéma se heurte invariablement aux attentes d’une industrie sclérosée par ses propres paresses structurelles, mais aussi aux réflexes de publics qui se sont habitués à la radio filmée qui constitue la part du lion des productions de l’époque. Autrement dit, ses boulets ne correspondent pas à la taille de nos canons (canons parmi lesquels le choix de calibre se fait plus restreint chaque année), avec les réactions de rejet néophobe qu’on peut en attendre... Et qui rappellent le petit enfant habitué aux knakis sous vide qui refuse mordicus du foie gras parce que c’est "bizarre". Et en effet, le cinéma de Miller est une bizarrerie en regard des méthodes (et des fins) du médium filmique tel qu'il est pratiqué (ou en tous cas, telle qu'on versifie sa facture) en général à notre époque. Et sa filmographie, enfermée dans aucun autre genre que celui, disons, des expérimentations en iconisation et lisibilité cosmogonique, achève de perdre le passant distrait. Il ne faut pourtant pas confondre la variété des sujets qu'il aura traités pour de l'inconstance artistique, loin s'en faut.
A ce titre, Fury Road peut être vu non comme un nouveau départ, un retour aux sources (ou en grâce) à la manière par exemple de la folle filmo récente d'un Friedkin, mais bien comme une œuvre quintessentielle de son auteur, tant en termes de philosophie que de forme. C'est la cohérence des considérations de l'auteur sur la notion d'univers (terme à ne pas prendre, on l'aura compris, au sens employé par les magazines de décoration intérieure...), d'action et de personnages, qui frappe en premier lieu lors du visionnage de cette incroyable fresque. Autrement dit, le propos de Miller reste de créer du mythe et du signifiant sous forme de distillat, pas des artefacts inoffensifs ou de la nostalgie à bon compte. Dans ce Fury Road, la manière dont le récit passe non par la versification, mais par l'intrication des symboles et des éléments eux-mêmes, ramène directement à celle dont Miller a fourbi ses armes sur les incroyablement matures Happy Feet et le second Babe ; c'est-à-dire qu'en allant dans la catégorie généralement méprisée du film "pour enfants" afin de trouver une formule d'implication du public qui s'affranchisse des préjugés et des conventions, Miller a pu affuter son art sur un projet poli pendant plus de 15 ans, au point que Mad Max 2, pourtant référence écrasante, passe désormais en comparaison pour un effort qui reste à la surface de son sujet !
Oui, c'est à ce point.
C'est au point qu'on réévalue la saga dans son ensemble (et notamment le problématique Beyond Thunderdome) pour y voir une fresque à la fois universelle dans l'implication des spectateurs et inédite dans son projet, sa facture et son mariage du séculaire et du futuriste. C'est au point qu'on voit d'un autre œil le reste de l'œuvre de Miller comme tendant intégralement vers cette débauche de sens et de dynamisme furieux : films personnels, travaux de commande, projets avortés, recyclés ou maudits... En termes de discours, mais surtout de questionnement. Miller s'intéresse surtout à interroger le statut de l'individu dans ses déterminismes (par exemple la maladie du petit Lorenzo dans le beau film éponyme) ou face aux tourments qu'un univers implacable parce qu'indifférent lui balancera au visage. En disciple d'Hippocrate (il a été médecin), il s'interroge non seulement sur la notion de guérison chez l'humain (et en creux sur son intérêt) mais aussi sur les couches mythiques profondes qui fondent celui-ci : ce qu'il considère important, sa faculté à survivre, ses tentatives pour transcender ces besoins, ses questionnements métaphysiques. Autrement dit, il oppose une éthique de la pensée concrète, donc de l'action, au besoin désespéré de l'humain d'appliquer sa pulsion de ferveur à n'importe quel prédateur se faisant passer pour un prophète.
Miller se consacre surtout, à l'instar d'autres grands conteurs comme Miyazaki, Spielberg, Kubrick ou Tarkovski sur des modes différents, à affranchir le propos narratif du cadre strict de l'histoire racontée, pour en tirer une forme de récit "totalisant". Un récit qui place au même niveau ses composantes techniques, thématiques et narratives sans aucune inhibition arbitraire. Cela demande mieux que de la virtuosité, cela demande un profond sens artistique et en ce sens, on comprendra mieux les déceptions quant au rendu temporel ou la caractérisation en retrait du rôle-titre.
Car il faut bien en venir au film lui-même, quoique son opulence appelle des analyses qui battent un peu la campagne. Et il est gargantuesque, si l'on nous passe la litote. Pour en revenir aux considérations qui précèdent, on recommandera, pour apprécier l'art consommé du narrateur, de voir Fury Road moins comme un film épique, avec ses suites linéaires de séquences, de personnages et de situations étanches les uns par rapport aux autres, que comme une tapisserie au sens médiéval du terme. En effet d'un côté, les référents et citations implicites ou explicites de Fury Road puisent largement dans la culture classique et antique : enlèvement des sabines, religion nordique, courses de chars, traversée des Alpes par Hannibal, ou encore tambours de guerre revisités (et de quelle manière!). De l'autre, la structure rappelle grandement une construction médiévale du récit, qui évoque grandement, par exemple, la tapisserie de Bayeux : l'ensemble de l'histoire contée peut être appréhendé comme un tout compact, embrassable d'un seul regard. Dans le même mouvement, le déroulé du récit, l'enchainement temporel d'évènements et l'articulation des éléments, peut évidemment être visualisé comme un vecteur allant de A à B. Chaque approche profite de l'autre pour renforcer le tout, la porosité entre les éléments du récit permettant d'explorer l'univers dépeint de façon verticale (la suite d'évènements) et horizontale (les associations d'idées, le discours philosophique, le travail sur les archétypes ET la maestria technique) et ce au même instant. C'est ainsi qu'au-delà de l'émerveillement que cause la débauche cinétique, les cascades sans CGI, de l'interprétation et des personnages hauts en couleur nommés en fonction de leurs actions ou de leur fonction (les lieutenants, le Doof Warrior et sa guitare lance-flammes), c'est la profondeur, la richesse et la cohérence de l'univers dépeint qui déteignent jusque sur les trois films précédents.
En effet, la répétition, et même la reprise de motifs et d'éléments voire de fonctions de personnages d'un film à l'autre, ne s'embarrasse pas d'une notion restreinte de continuité. Ainsi de l'interceptor V8, véhicule emblématique de Max qu'on retrouve ici alors qu'il a été détruit dans Road Warrior. Le fait qu'Immortan Joe sois joué par le même acteur que Toe Cutter dans le premier Mad Max peut impliquer qu'il s'agit du même personnage, monté en grade et s'étant très bien accommodé du cataclysme par sa capacité à faire régner une terreur religieuse chez les paumés, qu'il soient bikers à l'époque ou survivants aujourd'hui (l'insert d'yeux exorbités tiré du premier film, au moment de la dernière collision, pourrait en être l'indice). L'organisation hiérarchique et topographique de son royaume rappelle, lui, le Barter Town du numéro 3 (où le chef et ses possessions sont logés dans les hauteurs, à l'abri de la plèbe), où déjà le pilote de l'autogyre du numéro 2 réapparaissait sous une nouvelle identité mais avec le même rôle dans les évènements. Cela rappelle bien entendu le flou entretenu autour d'Hummungus dans ce même Mad Max 2, qui pouvait ou pouvait ne pas être Goose, l'ancien ami de Max mutilé dans le premier récit. Plutôt que récit, on devrait d'ailleurs parler de chants, tant la structure globale de l'histoire de Max, reproduite dans Fury Road en microcosme, reprend en effet les sagas médiévales et scandinaves telles que l'Edda : il est certes tentant d'évoquer ce parallèle au vu du système de foi des War Boys, jeunes hommes condamnés à moyen terme par la maladie, qui rêvent de hauts faits pour séjourner au Valhalla et renaître... Et on pourrait continuer longtemps ce jeu de piste qui n'oublie pas de créer ses propres signifiants, (ATTENTION SPOILER) comme cet homme qui apparaît dans les expressionnistes flashes-back traumatiques de Max, puis est montré au milieu de la foule en liesse à la fin du film (FIN DU SPOILER)...
Au sein de ce programme où le flux est plus signifiant que la lettre (voir l'agréable économie de dialogues du film), le personnage de Max lui-même pourrait décevoir du fait de sa position en retrait dans le récit. Or c'est précisément le point d'achoppement du projet. En effet, si l'antagoniste est clairement identifié comme tel (Joe), le protagoniste n'est pas le rôle-titre mais l'Imperator Furiosa, alter-ego de Max dont elle représente à la fois la part de d'humanité et sa possibilité de se rédimer, même si c'est via une croyance sujette à caution (autrement dit : un espoir). Opposant l'intensité et l'intelligence de Charlize Theron à la présence animale de Tom Hardy, les deux personnages sont d'ailleurs constamment posés en regard l'un de l'autre, Miller insistant notamment sur la marque au fer rouge faite sur leurs nuques, le sigle de Joe se retrouvant aussi sur son volant à elle et de façon stylisée sur le masque dont Max aura tant de mal à se débarrasser. Cette caractérisation double culmine bien entendu dans le combat aux poings des deux personnages, modèle de narration par l'image, le geste et le découpage, où chaque revirement impose sa marque sur la relation des belligérants. A ce propos, on ne dira jamais assez comme il est agréable d'avoir enfin un personnage féminin fort, positif, et qui ne tombe pas amoureuse du mâle en présence ! Qui n'est d'ailleurs pas le héros, puisqu'il reprend le statut de témoin (la notion est d'ailleurs cruciale dans ce film), presque même de juif errant, que Miller lui assigne depuis Mad Max 2. L'ensemble de la mise en scène, en jouant constamment sur le placement de Max dans l'action et donc sur son point de vue sur les évènements, s'emploie à montrer Max moins comme acteur de l'action que comme greffier ou narrateur (il est le seul qui dispose de monologue en off). Son action est d'ailleurs assez marginale, sauf lorsqu'il décide enfin d'aider Furiosa et la communauté matriarcale de l'autre côté du désert, personnages magnifiques de véritables vieilles dames crédibles, c'est-à-dire sans concession, sachant apprécier la vie pour ce qu'elle est et se battre pour celle des autres.
De toutes les trajectoires des personnages, c'est peut-être d'ailleurs celle de Nux qui confirme la grande maturité du propos de Miller : dans un monde où la seule transcendance est un dévoiement du religieux au service d'un potentat sanguinaire, mais où la beauté et le savoir sont vues comme des manifestations du divin, ce War Boy (parfait Nicolas Hoult) qui décide d'aider la cause de Furiosa et des fiancées ne passe pas outre sa foi en se retournant contre le système qui l'instrumentalise : il la sublime, dans une séquence climatique parmi les plus sauvagement belles qu'on a vues depuis longtemps.
Fury Road est un film-monde dont la pertinence procède de l'inédit. On pourrait jouer longtemps au jeu des référents mais, finalement, le propos de Miller n'est pas là. A 70 ans, il n'a pas le temps de chercher les félicitations ou de s'appesantir sur ce qu'il sait déjà, et qu'il nous dit en substance dans tous ses films, notamment son message écologiste. Il avance, et nous laisse le soin de le suivre en attrapant ce qu'on veut de la course - ou ce qu'on peut. En effet, c'est l'un des très très rares cinéastes à faire effectivement confiance à son spectateur en lui laissant le soin de scruter lui-même chaque plan, chaque information, chaque déflagration sensitive. Voir par exemple comme des données thématiques essentielles comme la ferme à lait humain, les cultures hydroponiques, ou les handicaps des proches de Joe, se voient montrés en coup de vent pour ne pas altérer le rythme. Car pour Miller qui considère le cinéma comme de la musique visuelle, c'est le rythme qui est la vertu cardinale (qu'on se souvienne de la photo dans l'étui à pistolet d'Hummungus).
A cet égard, Mad Max Fury Road est l'une de ces dates qui font avancer d'un bond le cinéma dans son ensemble (le dernier à faire ça c'était Cuaron...), au moins sur ses bases esthétiques et opératoires. Logistiquement, le film est fou. Par son écriture (et notamment son montage), il est d'une puissance qu'il sera très dur d'égaler. Par son humanité sans mièvrerie, son économie de moyens narratif, c'est le blockbuster qu'on n'attendait plus pour nous réconcilier avec le film d'action. Et par film d'action, on parle ici simplement de film, l'objet même d'une histoire étant la transformation du réel par refus du monde donné. On pourrait louanger pendant longtemps le film de George Miller, se réjouir de la reconnaissance dont il pourrait jouir à l'occasion de ce spectacle sauvage et réfléchi, mais ce serait bien futile en regard d'une expérience qui SE DOIT D'ETRE VECUE ET PARTAGEE EN SALLE. C'est du cinéma pur et total (si ces mots ont un sens quelconque) au sens où le média, trop souvent ramené à de la radio filmée, a besoin de se trouver libéré des arbitraires culturels pour redevenir une expérience se suffisant à elle-même. Le cinéma, comme la musique, est avant tout une expérience sensorielle qui convoie du sens. Les grands savent faire de ces deux composantes des bombes de masse critique qui, en s'entrechoquant, provoquent cataclysmes dévastateurs et éveils dorés, vous emmènent plus haut et plus loin que vous-même en vous ayant touché au cœur puis à la tête par les yeux et les oreilles.
Monsieur Miller, merci. Tous les autres, il va falloir plancher pour rattraper le septuagénaire.
The Hobbit - Battle of the 5 Armies
Attendu comme le chapitre qui devait définitivement unifier les éléments épars d'un récit que sa structure dessert, et en dépit de ses qualités, la conclusion grandiose et opératique du Hobbit ne tient, hélas, que les promesses qu'il lui était possible de tenir. L'absolution n'est hélas pas arrivée.
NB : l'article qui suit peut être considéré comme une conclusion de la réflexion entamée dans les papiers concernant le premier et le second film de la trilogie, publiés en leur temps dans ces pages.
L'info tombe cette semaine : Peter Jackson (mais aussi Fran Walsh, Philippa Boyens et Richard Taylor, et l'armée entière levée pour un des plus ambitieux et incroyables projets de l'histoire du cinéma) ne pourra pas adapter d'autres écrits liés à la Terre du Milieu, faute (pour le moment) du soutien des ayants-droits de Tolkien pour d'obscures, voire sordides, affaires de sous : la gourmandise oublieuse de Warner semble avoir fait quelques dégâts. La nouvelle est-elle si mauvaise ? Pour les spectateurs, mais aussi pour le cinéaste ? La question se pose. A la vue de cette conclusion du roman fondateur devenu "prélogie" de façon discutable, Jackson lui-même semble ambitionner de partir explorer d'autres contrées cinématographiques. Non que le cœur n'y soit plus, mais les circonstances de la mise en chantier de ce projet l'ont peut-être trop coloré pour que le cinéaste puisse en être pleinement satisfait, comme l'indiquerait un certain relâchement dans la facture, et même l'écriture, de ce qu'on a trop vite présenté comme un Opus Magnum devant surpasser de trente coudées au moins la saga d'il y a dix ans.
On en attendait beaucoup suite aux émerveillements, et encore plus suite aux réserves que suscitaient les deux premiers métrages. Tout est donc sensé se nouer puis se résoudre dans ces presque trois heures : les destins de Smaug, Gandalf, et des orcs Azog et Bolg, le bannissement provisoire de Sauron, la folie de Thorin et son sursaut, la salvation des gens de Laketown et l'émancipation de Legolas de son père xénophobe, sans oublier l'histoire naissante de Kili et Tauriel. Le tout au sein d'une débauche belliciste du meilleur aloi pour l'appropriation stratégique d'Erebor.
Bien entendu, ce périple bien rempli est arpenté de bout en bout, d'avenues noires de trolls en chemins de traverse intimistes d'une retenue tonale bienvenue. Tout est à sa place, tout est très beau, le rythme est enlevé et varié, les idées de mise en scène les plus folles fusent, les setpieces sont magnifiques et le propos est servi comme il se doit, dans un univers toujours bluffant de cohérence esthétique. Bref, on ne peut à sa valeur faciale rien reprocher à cette Bataille des Cinq Armées. Au point qu'on déplore vite la quasi-absence de surprises que ménage le film, sa prévisibilité qui le fait parfois passer pour une checklist avec des séquences d'un expéditif surprenant, toutes cruciales que soient certaines : difficile par exemple de ne pas croire entendre l'écho lointain d'un "bon, ça, c'est fait" à la fin de l'affrontement de Dol Guldur... Mais encore une fois tout est là. Et pourtant le job n'est pas fait. Le spectateur n'est jamais mis en position de s'impliquer émotionnellement avec les situations et les personnages, quand bien même les trajectoires de chacun suivent la logique amorcée dans les deux chapitres précédents. Ce sont des pans entiers de cataclysmes qu'on regarde ainsi come une vache le fait avec un train : on feuillette un imagier somptueux, on compulse une saga fantastique d'une beauté souvent écrasante, mais d'un œil détaché d'entomologiste.
C'est l'écriture, et principalement sa structure, qui crée ce hiatus. Car si tous les ingrédients sont bel et bien réunis (et redisons-le, question ingrédients on est plutôt en présence de truffe blanche que de ketchup), c'est le liant qui fait défaut. Le liant, ici, ç'aurait été une narration au rythme dosé correctement au sein de l'ensemble de ses chapitres. Hélas, la faute est à aller chercher du côté de la frilosité crasse de la production de gros projets, quant aux formes qu'ils ont à prendre pour être vendus selon des calibrages désespérément uniformes. Parmi ces calibrages (séquelles, remakes, franchises, morcellement des marchés...), l'un des plus pernicieux est l'incapacité des studios à investir un récit ambitieux sur un autre mode que celui de la trilogie. C'est d'ailleurs un format qui s'est imposé dans les dernières années en partie à cause de la saga Lord of the Rings, qui avait à l'époque arraché à New Line cette durée plutôt que celle d'un film unique... Cependant c'est un format qui n'est pas adapté à toutes les histoires, et certainement pas à celle que nous avons sous les yeux. Redisons-le une bonne fois : le format idéal était celui envisagé dès le départ, soit un dyptique de films de trois bonnes heures, avec une coupure avant ou après le passage du groupe de nains à Laketown. On aurait eu deux récits interdépendants, ménageant chacun sa montée dramatique de manière cohérente, et élaguant au passage les tirages à la ligne du premier tiers en donnant un peu d'air aux péripéties du troisième, ici bien à l'étroit.
L'avanie qui achève de prouver cet état de fait est la décision aberrante de créer artificiellement un cliffhanger entre la Désolation... et La Bataille... , qui coupe sans aucune raison tangible le chapitre des combats contre Smaug, en séparant la confrontation d'Erebor de l'attaque de Laketown. Le film démarre donc bille en tête et avant même d'afficher son titre sur le développement ET la résolution de cette attaque, qui mène bien entendu à un Smaug terrassé par Bard à l'aide de la dernière flèche noire. La séquence est magnifique, de la destruction de la ville à la gestion de l'espace et du rythme, dans un flamboiement pictural digne du Pandemonium de John Martin. Certes. Mais la voilà réduite à un simple avant-propos, et de fait déconnectée émotionnellement non seulement des évènements qui vont suivre, mais aussi de ceux qui y ont mené. Accessoirement, on pourra dire adieu à l'idée (pourtant exprimée auparavant) de Sauron convoitant une éventuelle alliance avec le dragon... Pire, cette séquence placée entre les deux métrages joue le rôle d'un barrage narratif et dramatique étanche : adieu alors à toutes les amorces patiemment mises en place en termes de caractérisation. Difficile, sinon impossible pour le spectateur, de se raccrocher à des trajectoires de personnages qu'on a si soigneusement sectionnées net... D'où l'indifférence qui le gagne à la vue de ce qui suit, pourtant très proprement écrit. Il faut voir à ce titre comment la mort d'un personnage pourtant important (et réceptacle d'une grande sympathie dans le reste du récit) laisse nous laisse froids au coeur d'un troisième acte pourtant bourré jusqu'à la gueule de moments magnifiques. Autrement dit, les motivations des personnages et des situations sont par ce geste rendues strictement théoriques, privées de toute leur chair émotionnelle, et apparaissent, en partie à tort, comme artificielles voire fallacieuses (notamment en ce qui concerne Thranduil).
Imaginons The Empire Strikes Back posant son générique de fin juste au moment où Han solo est précipité dans la carbonite, laissant le soin au film suivant d'accrocher le climax emblématique ("I am your Father", tout ça), à la va-comme-je-te-pousse, à sa propre trame narrative, jetant au passage ses ellipses et évolutions de personnages en vrac à la face du spectateur en lui laissant le soin de faire le tri. Le résultat parait révoltant ? C'est ce qui arrive aujourd'hui au Hobbit.
Dramatiquement, c'est LA grande erreur, révélatrice d'un relâchement de l'écriture qu'on a bien du mal à comprendre, surtout en regard de la rigueur scénaristique qui avait présidé à la trilogie LOTR. L'impression d'une écriture mécanique, voire même fastidieuse, noie de fait la grande justesse des thèmes abordés, et met en évidence le manque de pertinence de certains ajouts : si Radagast ne dépasse définitivement pas le stade de l'anecdote, Tauriel est irrémédiablement une pièce rapportée largement sujette à caution, et disons inutile, tant l'intégralité des enjeux thématiques qui lui sont rattachés pourraient être placés dans les mains d'autres personnages. On ne peut plus nier que son imposition se soit faite sous un prétexte aussi frileux qu'extérieur au récit (en gros, on avait peur que des mécont(e)s crient à la misogynie si on ne mettait pas un "grand rôle féminin" - et Galadriel, c'est du poulet?). Et que dire d'Alfrid, Grima aux petits pieds de Laketown, embarrassante caricature qui sert un discours moraliste sur l'égoïsme aussi pachydermique dans la forme qu'inutile au sein d'un récit qui regorge de figures aux prises avec la tentation de la cupidité ? Ce discours, louable et au cœur du propos de Tolkien (l'altruisme et la communication comme seul espoir face à l'accaparement qui mène à la destruction mutuelle), se trouve autrement mieux servi dans la dépiction de la folie de Thorin, qui va jusqu'à renier des serments et prendre à l'occasion les accents de Smaug : une excellente idée parmi une foule d'autres, noyées sous cette indifférence générale d'une dramaturgie mal pensée, qui castre toute émotion par son choix structurel déplorable, avec pour effet de jeter une lumière bien peu flatteuse sur tous les autres aspects du film, en particulier la grande tenue de sa mise en scène, de sa technique et de son esthétique.
Que de belles choses, de fait, se trouvent tristement trivialisées par cet état de fait, cet aspect mécanique que prennent malgré eux narration et personnages ! Car la bataille elle-même regorge de trouvailles soit visuelles, soit stratégiques qui auraient tour à tour émerveillé, terrifié, ému ou amusé dans un métrage plus tenu : Bolg et Azog eux-mêmes qui ont enfin leur pleine stature, les sémaphores, les chauves-souris géantes qu'on jurerait sorties de Skull Island et leur forteresse évoquant Beksinski, les trolls de combat, les mange-terre (clignez des yeux et vous ne les verrez pas), le porc que chevauche Dain qui répond parfaitement au cerf de Thranduil, et la citadelle enneigée qui sert d'écrin au dénouement de l'affrontement funeste entre nains et orcs, dans une ambiance d'un gothique irréprochable... Pourquoi alors se moquer de ses propres acquis par des plans parodiques qui arrivent comme des cheveux sur la soupe, tel ce troll qui force une muraille en s'assommant dessus, une pièce de maçonnerie attachée à la tête (citation rigolarde et malvenue du huruk haï qui crée une brèche dans Helm's Deep, dans The Two Towers) ? Encore une fois, Jackson est maitre dans l'exercice de faire passer des séquences autrement casse-gueule avec l'évidence du génie, pour peu que sa dramaturgie le permette : on pensera à la scène de Central Park dans son King Kong, qui aurait été ridicule entre les mains de n'importe qui d'autre. Cet aspect strictement mécanique, d'enchaînement sans réelle appétence, pose cette bataille pourtant à tous points de vue grandiose comme une escarmouche sans grande conséquence, chacun se quittant à son issue comme à la fin d'une soirée arrosée (rappelons quand même que nombre de personnages important sont MORTS le jour même, dont un roi). On est loin du sommet d'épisme cinématographique, pour le moment jamais surpassé, de la bataille des champs du Pelenor et du siège de Minas Tirith, non pas en termes de faits de guerre, mais d'implication pure et simple.
Ici, parce que la dramaturgie réduit l'histoire à un catalogue d'idées et de péripéties sans réel propos dramatique global, le tout se vit au mieux comme un ride qu'on a du mal à ne pas comme un "Fuck this, I quit" de la part d'un grand cinéaste blanchi sous le harnois. Deux éléments, à ce propos, ne laissent d'embarrasser : d'abord la fin de la séquence de Dol Guldur, se closant sans autre forme procès sur Saroumane déclarant "laissez-moi m'occuper de Sauron", en l'absence totale de commentaire de la part du reste du Conseil Blanc, laissé exsangue par ce qui devrait être un moment de basculement bouleversant, mais aussi de commentaire a posteriori des évènements : un cut au noir, et vogue la galère ; on s'en fout, on n'a jamais vu que le retour du principe maléfique primordial et de l'ensemble de ses lieutenants, alors qu'une armée qui lui est inféodée menace un point stratégique de toute la région... Seconde séquence bien plus problématique, la répétition, à la lisière de la Comté, d'une très belle séquence muette entre Bilbo et Gandalf ayant eu lieu une bobine plus tôt sur le champ de bataille de Dale, et qui se suffisait à elle-même ; les deux amis devisent gaiement et Gandalf lâche comme une plaisanterie qu'il sait que Bilbo détient un anneau de pouvoir, avant de partir sans plus de préoccupation à ce sujet... Que penser de cette conclusion, comment ne pas y voir, encore, une trivialisation cette fois volontaire de l'ensemble de la saga ? On repart avec le sentiment d'un rendez-vous à moitié raté, en espérant, tout de même, que la vision de l'ensemble des trois films dos-à-dos nous permettra de retrouver un souffle dramatique intact, qui nous confirmerait que le film qu'on a sous les yeux est encore un acte de foi de la part de son auteur. Mais c'est un vœux pieux. Allez Peter, tu as bien mérité de nous emmener ailleurs, et on est impatients. Pour le moment, en espérant sincèrement avoir eu la dent trop dure (eh les versions longues réparent peut-être tout!), on ne peut dire que : dommage, il s'en fallait de peu, mais à quoi servent des finitions somptueuses sur des fondations bancales ?
Interstellar - C. Nolan
Il ne suffit d'évoquer un sujet passionnant pour être passionnant soi-même. Nouvel effort d'un cinéaste qualifié un peu vite et unanimement de génie, Interstellar confirme les quelques atouts, mais surtout les problèmes que pose le cinéma de Nolan, en premier lieu son manque d'humanité.
Sur une Terre condamnée à moyen terme, la NASA fonctionne encore en secret, jugée inutile et dispendieuse par une opinion publique qui cherche simplement à manger à sa faim. L'instance travaille sur un moyen de trouver une nouvelle planète habitable, grâce à un trou de ver apparu mystérieusement près de Saturne, qui permet de traverser une distance prodigieuse instantanément et ainsi de s'affranchir de la durée des voyages interstellaires. Cooper, ex-pilote reconverti en fermier, embarque pour l'ultime expédition, abandonnant sa propre famille pour la sauvegarde de l'humanité.
Il y a un énorme hiatus autour de Christopher Nolan, assez comparable à celui dont bénéficie depuis 20 ans Quentin Tarantino. A savoir que des armées de zélateurs les suivent aveuglément et glorifient l'un comme l'autre pour des raisons qui ont finalement peu à voir avec la stricte cinématographie. Nous avons dans les deux cas affaire à des bateleurs qui vendent avant tout leur propre persona en tant que valeur sociale, en une image soigneusement élaborée de wunderkind au génie indiscutable. L'auteur de True Romance se fait passer pour un virtuose boulimique de référents hétéroclites, celui de Dark Knight Rises pour un grand penseur faisant preuve d'une ascèse toute kantienne, mais les deux ne jettent finalement que deux nuances de la même poudre, aux yeux de publics qui, seulement à moitié dupes, se laissent faire pour avoir des trucs à raconter à la machine à café : j'admire tel auteur dit "intelligent", je suis en mesure de répéter les arguments d'autres gens intelligents à ce sujet, je suis donc intelligent moi-même. Et que je te crie au grand architecte pour me glorifier d'avoir moi-même compris plein de trucs sensément compliqués.
Seulement voilà, derrière le clinquant des procédés ou des effets des films de ces messieurs (éclatement de la narration, signes véhéments d'intelligence ou de culture, cynisme à la mode, cool attitude...), l'art du conteur, à l'analyse, est bien moins riche que ce qui est promis sur la jaquette. La pyrotechnie sémantique déployée dans la note d'intention cache mal l'aspect très convenu des scripts et de la mise en scène, où souvent l'illusion de la qualité n'est due qu'aux acteurs talentueux portant sur leurs épaules des enjeux qui n'existent pas dans l'objet qui nous est proposé (le film lui-même), mais seulement dans le pacte social consistant à "être allé voir le dernier Untel" et en avoir ramené des perles de sagesse ou d'esprit. Ou pire, des aphorismes. En bref, plutôt que de nous donner à voir la pièce d'artisanat pour elle-même, on nous propose de ne regarder que l'artisan se mettant en scène. Il y a quelque chose de la spéculation relative au marché de l'art contemporain dans cet état de fait : on se fout in fine de ce qu'il y a sur la toile, c'est la cote de l'artiste qui nous dicte l'opinion à avoir et à relayer.
De fait, Nolan est décidément plutôt un essayiste qu'un cinéaste, au sens où la thèse développée dans son film est plus importante à ses yeux que l'histoire qu'il entend raconter, et ne lui sert au sens fort que de prétexte à la munificence de sa pensée. Lire les interviews du bonhomme est à ce titre magique, tant il y clame à mots à peine mouchetés son rôle d'éducateur des masses. Ce faisant, il tombe dans le piège qui guette rhéteur : frapper trop fort au mépris de la précision, c'est-à-dire chercher à convaincre à tout prix, au point d'atrophier les autres composantes de l'objet final. La théorie qui irriguait la trilogie Dark Knight le montre assez, dans sa dérive terrifiante vers l'apologie pure et simple de la violence des marchés sur des masses de toutes façons bêlantes, seulement tempérée momentanément par l'intervention de David Goyer et Heath Ledger... Peut-être conscient d'avoir tapé un peu fort, Nolan donne ici dans un humanisme que rien n'interdit de croire sincère, en proposant l'idée de fédérer l'humanité vers le but commun et transcendant de la conquête spatiale. Après tout, Jacques Cheminade y croyait aussi dur comme fer en 2012. L'idée en soi n'est d'ailleurs pas absurde, et il est hors de question d'attaquer le bonhomme dessus. Le problème ici est d'ordre cinématographique, narratif, artistique : Nolan prétend tout de même nous raconter une histoire avec des images et du son. Avec des personnages, une trame narrative et émotionnelle, une évolution et un point de vue. Or de tout cela on n'aura même pas la portion congrue, dans la mesure où seuls des acteurs impliqués (surtout McKenzie Foy et un Matt McConaughey qui décidément transfigure ses rôles au-delà de l'impressionnant) s'acquittent de cette tâche.
Et le sujet du film, en effet, EST passionnant. Le fait de ne pas éluder les façons dont la physique fondamentale et la physique quantique constituent la base indispensable de tout voyage dans l'espace, est en soi un parti-pris courageux dans le contexte d'une production s'adressant à un public aussi large. Plusieurs idées sont même excellentes, à l'instar de la gravité envisagée comme prochaine frontière technologique (sa maîtrise pour voyager, communiquer, ou dompter jusqu'au temps), et les connections émotionnelles entre individus envisagées comme une donnée objective et mesurable. De même, l'idée d'explorer les dimensions supérieures aux nôtres est pour le moins intéressante dans la mesure où l'on tape littéralement dans l'inconnu de notre sphère conceptuelle. Enfin, elle est louable cette volonté d'unifier la race humaine autour d'une transcendance plutôt que contre un ennemi commun. Mais en aucun cas ces prises de positions ne sont nouvelles au point de surqualifier leur compilateur de "visionnaire", ni son ouvrage de "révolutionnaire".
Par exemple, on évoque dans Interstellar des êtres vivant consciemment en 5 dimensions ou plus, pour qui arpenter le temps comme une dimension physique est de l'ordre du naturel. Loin de s'arrêter là, le film entreprend de trouver comment communiqueraient ces "êtres" avec nous, en imaginant la création d'un tesseract permettant à Cooper d'appréhender cinq dimensions avec ses moyens tridimensionnels. De fait il aura fallu se creuser la tête pour rendre visuellement de manière concluante le fameux tesseract, et il faut bien admettre que cette séquence est visuellement très interessante. C'est pour le coup audacieux en termes de cinéma (le seul moment réellement audacieux du film à vrai dire), et pour une fois chez l'auteur d'un didactisme qui n'est pas trop ampoulé (on prend quand même soin de faire commenter le tout dans un dialogue constant entre Cooper et son robot). Très bien. Mais qui se souviendra qu'un être pentadimensionnel est déjà au centre d'un (haheum) Men in Black 3, pour lequel on rappellera que personne n'a jamais crié à la perfection kubrickienne propre à nous faire vaciller sur nos bases théoriques ? Plus largement, si le motif des dimensions gigognes de l'espace-temps, peu exploité au cinéma hors récits de paradoxes temporels, est certes un fascinant concept que nous devons entre autres à la théorie des cordes, mais tout de même vieux comme au moins St Augustin... Calmons-nous, donc, et surtout rendons à César ce qui lui appartient. Et quand bien même, le fait d'évoquer un sujet passionnant ne suffit pas pour rendre mécaniquement son film passionnant. Prenons une brochure de magasin de téléphonie mobile, un livre d'ex-première dame, ou un talk-show télé rigolard d'access prime time. Collons une photo de Stephen Hawking dedans et contentons-nous de ce geste. Avons-nous créé magiquement un objet discursif qui transcende le monde culturel de son époque ?
Car non, rien n'est de l'ordre du révolutionnaire ou même de l'inédit dans l'effort quelque peu vain de Nolan. Pour chaque élément du script ou de la mise en scène, on pourrait mettre en regard son équivalent thématique ou esthétique plus ou moins récent, et plus ou moins mainstream, mais presque toujours plus concluant ailleurs. De l'émotion métaphysique face à l'immensité vue au centuple dans Gravity, à l'héroïsme désintéressé beaucoup plus convaincant et sincère dans Sunshine par exemple, en passant par l'intuition de l'identité entre surnaturel et naturel en milieu rural dépeint de façon plus candide dans Signs, ou encore l'universalité de l'amour bien plus poignante dans un The Fountain, Interstellar fait figure de retardataire véhément. Voire d'avatar déjà décadent de la Hard Science Fiction spatiale moderne, recyclant en moins percutant les motifs excavés avec talent par d'autres. Il serait d'ailleurs futile d'aller jouer les ratiocineurs à ce propos, le problème n'étant pas dans le quoi, mais bien dans la manière dont ce quoi est exposé via les moyens du cinéma.
Autant le dire tout net, du point de vue cinématographique Nolan ne s'est pas foulé, et il tartine à nouveau l'écran de ses pénibles tics et raccourcis. En premier lieu, tout ceci est assez mal écrit. Le rythme est bancal et heurté, bourré de péripéties plus ou moins inutiles, et pour la plupart enchainées apparemment dans le seul but de déclencher mécaniquement une réponse pavlovienne de la part du spectateur. Le "sentimentalisme" qui a été reproché çà et là au film, à ce titre, apparaît surtout comme purement artificiel, provoqué à distance de façon presque cynique : seuls les acteurs y croient, et relaient d'ailleurs avec une conviction communicative des émotions qui n'existent pas dans le récit lui-même. Autrement dit, Nolan semble croire qu'il suffit de nous montrer des gens qui pleurent, et de bien appuyer l'effet avec des montées de Hans Zimmer pendant des plans interminables, pour qu'on soit mécaniquement pénétrés de la charge émotionnelle d'une situation. Un spectateur, cependant, c'est plus complexe que ça, et en termes d'émotion l'effet grossier, plaqué là au chausse-pied, est toujours moins concluant que le sentiment qui s'élève de l'histoire. Mais surtout, ce qui gène dans cette convocation du sentiment, c'est qu'elle n'est envisagée que sur un plan intellectuel : Nolan ne sait pas (ou ne veux pas) investir ses récits sur le plan humain, et colle des séquences "d'émotion" lorsqu'il estime devoir le faire dans une optique de taylorisme thématique. On sent que l'émotion est pour lui mystérieuse et étrangère, qu'elle lui fait un peu peur, et que le caractère de son frère sur les scénarios qu'ils coécrivent le tire encore dans cette direction. D'où cette froideur qu'on retrouve dans l'ensemble de sa filmographie, et ce dosage approximatif dans la mesure où lorsqu'il se résout à en mettre, l'émotion est trop poussée, artificielle, disproportionnée (voir les caprices de gosse de Bruce Wayne dans TDKR). Pour Nolan, le sentiment est strictement une motivation à donner à un personnage, et il l'investit donc de manière purement abstraite. A ce titre, il n'est pas étonnant que ses meilleurs films soient ceux qui sont centrés sur personnages dénués de cette part d'humanité qui nous met en rapport direct avec d'autres êtres ; que ce soit l'amnésique perplexe de Memento, ou les magiciens qui littéralement nient leur humanité au profit de leur activité dans le Prestige. Ce qui intéresse Nolan, c'est son propre discours sur le monde, dont on est en droit de ne pas partager la froideur, la verticalité, voire le cynisme socioculturel, et pour lequel ses récits n'existent que comme propulseurs et prétextes.
Logiquement, ici comme dans ses précédents efforts, le récit est beaucoup trop didactique pour être honnête, notamment dans sa propension à TOUT élucider uniquement par le dialogue, tic numéro un de Nolan, qui peine toujours autant à s'exprimer via les moyens du cinématographe plutôt qu'à faire de la radio filmée. C'est bien simple, ici, rien n'existe tant qu'on ne l'a pas nommé, commenté, et expliqué trois fois de suite à l'oral, les personnages paraphrasant constamment les évènements et notions évoqués pour la gouverne du spectateur : on a peine à croire que des discussions, du niveau des vulgarisations pour enfants de Karl Sagan, soient nécessaires entre des astronautes et chercheurs chevronnés alors qu'ils sont déjà de l'autre côté du trou de ver au bout de deux ans de mission spatiale, alors que par ailleurs le moins "calé" d'entre eux trouve à la volée des solutions à des problèmes quantiques complexes deux séquences plus tard ! C'est que, comme à son habitude, Nolan n'a aucune confiance dans l'intelligence de son spectateur, choisit de fait de tout lui expliquer constamment, et lui assène donc son gros raisonnement de droit divin dans la seule direction qu'il conçoit : du haut vers le bas. Le sectateur du génie, dans son paradoxe d'identification/admiration, prend bizarrement cette condescendance pour la preuve qu'il a été touché par une intelligence contagieuse. Pourquoi diable penser être malin précisément parce qu'on vous parle comme à un crétin ?
Ce faisant, il prend tout de même soin de "faire cinématographique", ici en prenant 10 minutes pour transformer un drone indien en faux fusil de Tchekhov (on n'en entendra plus parler ensuite), là en utilisant des répétitions de motifs telles que des plans fréquents (mais peu utiles) où la caméra est attachée à un véhicule en mouvement... Sans qu'aucune de ces affèteries n'aie d'incidence réelle sur le récit lui-même. Le cinéma semble en fait, lui-même, n'être qu'une valeur sociale pour un Nolan dont les exigences apparaissent comme plus personnelles qu'artistiques. Ainsi, les vidéos qui émaillent le film (interviews dans le musée, conversations en vidéoconférence) ont été filmées en 35mm, avec un gain nul pour le film, et l'inflation de véhicules construits en dur n'a pas plus d'incidence. On serait tentés de parler de caprices, d'un auteur qui cultive ses petits idiomes persos pour préserver l'image qu'il se fait de lui-même (comme par exemple le fait de retaper ses scripts sur une vieille machine à écrire, de refuser de bosser le week end, ou de forcer ses collaborateurs à imprimer leurs communication parce qu'il refuse d'avoir une adresse mail... Quelle différence avec le hipster qui va en fixie au Starbucks du coin pour blogger sur son mac book? Et surtout, ça sert à quoi et à qui ?), et le fait au détriment de son art. Parce que c'est bien beau d'avoir des exigences, mais il est irresponsable que ces exigences ne soient pas à l'écran à la fin de la journée, ou qu'elles impliquent des options de production inutilement dispendieuses, alors qu'un film attend là-dehors que son auteur se bouge un peu le cortex pour lui.
Et là, l'écriture et le découpage, mais aussi le montage séquentiel, sont carrément démissionnaires : tunnels de dialogues en champ/contrechamp, péripéties inutiles ne servant qu'à allonger la durée du film ou à ajouter des fonctions thématiques de l'écriture en 9 actes (sans déconner, la sous-intrigue du docteur Mann...), séquences se closant carrément par de paresseux fondus au noir, écriture totalement téléphonée (dès le milieu de la première bobine on sait qui est le "poltergeist" de la petite Murph, ce qu'il fait/fera/a fait, pour quelles raisons et ce que ça implique, au point que c'en est presque insultant et que la vision du reste du métrage en devient fastidieuse), montage parallèle artificiel... Le gros problème de tout ceci est que, cerise sur le gâteau, les enjeux thématiques et narratifs ne sont pas résolus, même de loin : la psychologie des personnages est à géométrie variable quad elle n'est pas simplement aberrante, les twists parfaitement vains se multiplient en milieu de métrage, et le générique intervient alors que le sort de l'ensemble du casting est en suspens dans le but évident d'émuler la fin "ouverte" d'Inception... Ce qui nous fait quand même beaucoup à pardonner.
Que reste-t-il alors pour justifier l'attente délirante qu'a pu susciter la com en amont du film ? D'abord quelques jolies idées de D.A. comme les robots à tout faire ou le morse gravitationnel dans la poussière. L'interprétation ensuite, grande qualité des films de Nolan qui sait caster ses films en ne recrutant quasiment que dans la A-List. McConaughey est comme à son habitude époustouflant d'incarnation et d'intelligence, tant qu'il parvient à en insuffler un peu à un projet par ailleurs, hélas, pompeux et assez creux. On pourra, si on n'a jamais entendu parler d'astrophysique de sa vie, être impressionné par la dépiction des paradoxes temporels aux abords d'un trou noir, et se laisser ballotter tranquillement dans le montage séquentiel du troisième acte. Mais dans la mesure où tout le discours autour de ce film prétend nous en faire le nouveau 2001, en discréditant au passage Gravity alors que ce dernier réussit partout où Interstellar échoue, on pourra passer son chemin : il y a d'autres moyens de se sentir intelligent, et des auteurs bien plus humains à soutenir avec son joli lollypop durement gagné.
Dawn of the Planet of the Apes
La mode du reboot accouche périodiquement de films qui justifient l’exercice. Suite d’un de ces rares représentants de bonne soupe faite dans un vieux pot, le film de Matt Reeves est une belle réussite qui quoique sur un mode plus calme, creuse intelligemment le même sillon que son modèle.
Dix ans après l’épidémie qui a décimé la quasi-totalité de la population humaine sur la planète, Caesar et sa tribu de singes génétiquement modifiés ont constitué une société primitive florissante dans la forêt aux alentours de San Francisco. Les dernières poches d’humains survivent quant à elles dans une organisation précaire, dans les vestiges des villes. A la recherche d’énergie, ces derniers tentent de réactiver un barrage hydraulique en amont de la rivière, sur le territoire des singes dont ils ne soupçonnent pas le degré d’évolution…
Le reboot de Planet of the Apes était une bonne surprise, précisément parce qu’il ne prenait pas l’exercice comme une facilité apte à engranger les pépettes de la nostalgie. L’intelligence du projet, notamment le fait de ne pas tenter d’émuler le film à twist des origines (″You maniacs ! You blew it up ! Damn you all to hell !″) pour reprendre une structure chronologique, y était pour beaucoup. Son utilisation de la perf cap et des millions de polygones virtuoses de magiciens du numérique, aussi, était au service d’une caractérisation réelle de Caesar au lieu de ne servir que de prétexte technique d’attraction de foire, comme trop souvent. Caesar traité comme le protagoniste du récit, sans jamais que la trajectoire dévie de ce programme au demeurant assez casse-gueule. On se trouvait de fait devant un film au parti-pris anti-spéciste fort, qui utilisait son pathos au profit d’un discours d’une radicalité rare pour un produit de studio.
Ce qu’en fait Matt Reeves est d’autant plus intéressant. Sa propension à traiter avec sensibilité et surtout distance ses sujets avait déjà fait ses preuves sur Let Me In, remake de Morse qu’on est en droit de trouver largement supérieur à son modèle poseur. Il applique, avec ses scénaristes dont deux sont à l’origine du sympathique The Relic, cette vision volontairement anti-climatique des choses. Alors que le premier film faisait monter sa sauce presque avec véhémence jusqu’à la première vocalisation de Caesar, pour montrer la révolte manichéenne sous un jour purement cathartique, celui-ci n’appuie aucun de ses effets. En fait, le traitement des deux groupes de protagonistes ne s’encombre pas de différencier ceux-ci sur la base de l’espèce : on se trouve simplement témoins de la lutte entre deux groupes sociaux, assez semblables dans leurs préoccupations, assujettis à la même pyramide de Maslow. Le besoin de territoire, de ressources, de sécurité, et de stabilité politique, est présenté comme universel et non subordonné à l’espèce. Partant de là, le concept même d’humanité s’épanouit au-delà de la seule génétique.
Le parti-pris est très fort précisément dans le fait que les artisans du récit nous le présentent comme parfaitement naturel. Le changement de paradigme qui se dessine (la fin de l’humanité comme espèce dominante) n’est finalement ici qu’un changement d’ordre géopolitique et ethnique. Cela passe par un principe à la simplicité biblique : mettre systématiquement en parallèle les jeux de pouvoirs, prises de positions idéologiques, spéculations et plans de part et d’autre. Les intrigues sont placées ainsi sur le même plan d’importance dans la mesure où le discours ne penche pas en faveur de l’une ou l’autre faction, mais condamne ou glorifie des catégories de personnes et de comportements individuels : typiquement, ceux qui prônent le repli et le rejet de façon inconditionnelle sur des bases spécistes. Pour reprendre le mot de Doug Stanhope, ″on ne déteste pas une équipe, on déteste les supporters arrogants qui l’encouragent jusqu’à la connarderie″, qu’il s’agisse dans ce cas d’un chimpanzé qui veut instaurer une dictature à des fins de vengeance personnelle contre toute la race des hommes, ou de messieurs à la gâchette beaucoup trop facile. Si les besoins sont universels, les motivations plus ou moins crapuleuses ne sont l’apanage ni d’une espèce ni de l’autre, les premières esquisses d’asservissement des humains se faisant par pure idéologie raciste. De même, les hommes de bien ne se reconnaissent pas à la quantité de pelage qui les couvre, mais à leurs seules actions et velléités.
Les rapports entre les personnages sont d’ailleurs suffisamment complexes pour être salués, dans la mesure où ils suivent cette trame complexe et politique, tout en personnalisant bien entendu les enjeux pour l’économie du récit. Après des années de World War Z divers, où les motivations du protagoniste sont généralement à la fois foncièrement égoïstes et minces comme un argument d’Anna Gavalda, pouvoir contempler des altruismes sincères et des interactions multipolaires riches dans un blockbuster est une bouffée d’air frais. La mise en scène relaie malignement ces enjeux interpersonnels Koba/Caesar/Blue Eyes et Dreyfus/Malcolm/Alexander en ménageant deux climax pour le coup très impressionnants dans leur mise en avant d’une inéluctabilité, lors de l’attaque de la colonie et de l’affrontement en fin de troisième acte, où le leader de fait de chaque faction prend enfin toute sa place (bigre, ce ″You no ape″ !). L’interprétation, à la fois habitée et transparente, sert évidemment ce propos, même si la concentration de l’essentiel du buzz autour du film s’est faite sur Andy Serkis, ce qui n’est pas très juste pour les animateurs de Weta qui sont pour autant dans le succès de Caesar que l’acteur. L’ensemble de ce qui concerne les singes est absolument incroyable de vérisme, et à cette manière calme et discrète que prend l’ensemble du projet, les effets entérinent un pas en avant en termes de rendus (pluie, vent, poussière, fourrures… Attendez juste de voir l’orang-outan Maurice) que peu verront précisément parce qu’il semble naturel. Ceci dit, Andy Serkis confirme définitivement son statut de Lon Chaney de l’ère numérique, et Caesar dans sa dimension de vieux lion de la révolution qui fait face aux ambitions de ses anciens lieutenants est peut- l’un des personnages les plus passionnants qu’on a vus depuis longtemps dans une fresque de cette envergure. En tous cas, le spectacle, avec son dosage bien pensé, sa sincérité et son projet thématique atypique, laisse augurer du meilleur pour l’atterrissage des astronautes égarés, en 2016…
The Raid 2 - Berandal
Grâce au stupéfiant et furieux The Raid, Gareth Evans a logiquement obtenu les coudées franches pour faire à peu près tout ce qu'il veut. Si cette concrétisation ne tient pas du mètre-étalon de l'actioner moderne, elle dépasse largement ses promesses par sa virtuosité et son sens du spectacle.
Même pas le temps de cicatriser qu'on vous renvoie au charbon. Deux heures après les évènements relatés dans The Raid, Rama se retrouve ainsi embrigadé dans une mission d'infiltration des milieux criminels de Jakarta, afin de faire tomber le système de corruption à grande échelle de la police locale. Après un séjour en prison arrangé pour son infiltration, il devient bientôt un lieutenant important du jeune Uco, fils ambitieux de l'un des potentats mafieux de la ville, alors que l'équilibre entre les diverses factions rivales est mis en péril par l'intervention d'un nouveau larron, Bejo. Motivé par la protection des siens et son désir de vengeance (son frère a entre temps été éliminé), Rama perdra bientôt ses repères moraux au milieu d'une guerre des gangs sans aucun code d'honneur...
Qui trop embrasse mal étreint. L'adage, qui s'applique schématiquement au personnage principal du film, résume aussi les réserves émises à la vision de ce Berandal, réserves qui toutefois n'entament que marginalement ce que le film de Gareth Evans apporte sur la table : sa maîtrise, son jusqu'au-boutisme et sa folie. Autrement dit, si le film est bien le sommet cinétique et martial vanté çà-et-là (et ils ont raison : jetez-vous dessus crénom), c'est du point de vue de la dramaturgie que ses ambitions démesurées, mais désordonnées, le trahissent.
Le script original de Berandal date en fait d'avant The Raid, juste après la surprise Merantau. Admirateur notamment des grandes sagas criminelles des cinémas du Japon et de Hong Kong, Evans imagine une histoire de guerre des gangs largement tournée vers les performances martiales, les énormes fusillades et les cascades de voitures emphatiques. Trop cher et trop ambitieux, le film est remis aux calendes, au profit d'un "petit" projet au concept simple et fort : The Raid. L'efficacité modale de son script, de sa mise en scène et surtout de ses séquences d'action et de combats, emporte tout sur son passage tant du point de vue critique que public, attirant bien entendu ponts d'or et subsides... Pour un autre The Raid. Et voilà donc une équipe relancée aux trousses de son rêve d'antan, à la condition d'y loger le personnage de Rama à sa sortie de la tour infernale à laquelle il a survécu, fut-ce au prix de distorsions douloureuses.
C'est de cet accouplement forcé entre des histoires dont les essences respectives tendent à se contredire (fresque martiale et policière d'un côté, drame des aristocraties criminelles de l'autre), qu'émerge le hiatus qui empêche le film d'être tout à fait ce graal qu'on attendait la bave aux lèvres. Ainsi, le récit se perd régulièrement dans des imbroglios inutiles, complique à l'excès ses nombreuses sous-intrigues et multiplie les péripéties confuses ou disproportionnées en regard de leur importance dramatique. On roule donc de caractérisations plus ou moins approximatives en tunnels de dialogues pleins de pose mais peu éloquents, en passant parfois par des affèteries d'écriture pas toujours pertinentes ou maîtrisées : une construction de premier acte amusante mais bordélique (multiples flashes-back intriqués dans la prison, où apparaissent des éléments qu'on ne reverra plus), une dernière heure totalement basique qu'on ne sait pas comment conclure, un gros surplace narratif entre les deux et des ellipses brutales... La progression dramatique n'est quasiment perceptible d'ailleurs que sur le papier où via des passages purement utilitaires, et à part Rama, qui manque de perdre sa probité en se jetant tête baissée dans sa propre violence, aucun personnage n'évolue particulièrement entre les deux génériques. Uco reste de bout en bout un ambitieux destructeur, Bejo ne sort jamais de sa posture de méchant sorti d’un DTV avec Steven Seagal, etc. . Plus gênant, d'autres éléments se voient carrément sacrifiés au nouveau déroulement utilitaire des évènements ; si l'on aurait aimé par exemple voir développé Eka, l'"autre" lieutenant qui est peut-être aussi un flic en planque, ce sacrifice est surtout problématique en ce qui concerne le frère de Rama, éliminé dès l'ouverture. Voilà l'une des promesses thématiques les plus excitantes de The Raid balayée d'un revers de main, dans le but manifeste de donner une motivation supplémentaire à un héros dont la trajectoire ne le réclamait pourtant pas... Hélas. La thématique pourtant centrale de la corruption de la police se perd très vite en chemin également au profit de la seule chronique criminelle, le projet raccrochant les wagons de façon encore assez confuse en début de dernier acte sans qu’on sache trop pourquoi à ce moment-là.
Le script, donc, est trop foisonnant pour son propre bien en regard de la simplicité angélique de son principe, soit, mais ce n'est pas là que se trouve le cœur du projet. Evans est avant tout un formaliste talentueux (pour le moment du moins étant donnée la courbe de progression impressionnante de son cinéma), mais un formaliste à la fois dingue et raisonné. En ce sens on n'est pas surpris qu'il se soit passionné pour les diverses formes du silat, art martial indonésien qui, à l'instar d'autres configurations de combat de la région (boxe thaïlandaise, muay thai, krabi krabong), est à la fois un déclenchement de fureur proprement tétanisant à voir et un art de l'efficacité la plus froidement pensée : c'est pas de la danse hein, le but est de neutraliser l'adversaire le plus vite possible et l’abandonner au sol, sans haine mais sans pitié. Les affrontements en espaces confinés de The Raid encore en mémoire, il est réjouissant d’être aussi surpris devant l’ampleur de ce dont tout ce petit monde est capable avec plus de joli lolipop dans les carmanes. Au niveau martial d’abord où chaque séquence est envisagée comme une setpiece propre à sublimer un aspect des performances martiales des protagonistes, en utilisant les environnements au meilleur escient. On se souviendra longtemps des deux séquences où se bat Yayan Ruhian (maître martial qui jouait Mad Dog dans le premier film), machine à tuer au regard étrangement doux, tantôt terrifiant, agile ou émouvant.
Plus encore, l’émeute dans la cour de prison est incroyable de virtuosité et de sauvagerie, la mise en scène en (faux) plan-séquence décuplant l’effet de réel et la dinguerie de ce qui se déclenche en quelques instants sous nos yeux. Une scène qui n’a rien de gratuit dans la mesure où le concassage de détenus dans les toilettes (un mètre de large à tout casser) a auparavant posé l’enjeu spatial comme central dans la manière de penser l’action du récit tout entier. Evans embrasse les racines culturelles multiples du pays où il tourne, Rama (présenté comme musulman lors d’un plan de prière de The Raid) prenant soin de ne pas briser un autel bouddhiste au cœur d’une empoignade pourtant décisive de sa folie belliqueuse… Dans un sens très oriental, on retrouve toujours ainsi une attention particulière portée sur de petits objets ou éléments qui prêtent leur sens aux scènes qui les contiennent, ici une vis, là un verre… Une manière de poser philosophiquement les actes dans leur environnement. Car le sens ahurissant de l’espace et de la temporalité de l’action dont fait preuve Evans se retrouve dans l’ensemble de ces séquences d’action, sans pour autant s’appuyer sur le décor, culminant dans un combat d’une bonne demi-bobine entre Rama et l’assassin en chef de Bejo, où la cuisine de restaurant est un théâtre passif pour une joute du niveau du final d’un Fist of Legend ou d’un Hardboiled… Toute emphatique qu’elle soit, l’action n’est jamais gratuite en ce sens qu’elle porte non pas sur le récit en tant que tel (dont on finit par se moquer comme d’une guigne dans la mesure où, comme pour Rama, seul compte la prochaine confrontation), mais sur le projet d’action lui-même, pour lequel cascadeurs, coordinateurs et réalisateur ont des idées à la tonne, comme lors de cette poursuite automobile où la caméra suit l’action à moto, s’engouffre dans une voiture pour brièvement filmer le conducteur, puis ressort par la fenêtre arrière pour se concentrer sur ses assaillants… Le tout sans coupe et réalisé à même le plateau !
L’excès comme horizon, l’efficacité comme credo : à force d’aller toujours plus fort et plus fou, Evans livre un objet abstrait. Peut-être conscient de ses lacunes scénaristiques, c’est le film en soi qui devient une abstraction sur la violence elle-même, qui s’auto-dévore tout en s’amplifiant au point de gagner une vie propre. La surenchère de gore (et le film est gratiné à ce niveau) doit ainsi se comprendre d’un point de vue culturel, le cinéma d’exploitation indonésien ayant été l’un des plus décomplexés à ce niveau, et non comme un sensationnalisme gratuit. C’est aussi par ce mouvement vers le pur concept que se trouvent certains des éléments les plus enthousiasmants du métrage, ceux qui, justement, ne se voient pas plombés par les amphigouris du script. L’irruption, dans cet univers qui se veut par ailleurs «vériste », de véritables personnages de manga tenant entièrement sur leur caractérisation plus grande que nature, est logiquement l’une des grandes réussites du film : le baseball bat man et la hammer girl n’ont besoin de rien d’autre qu’eux-mêmes pour emporter le morceau, et parviennent sans peine à faire oublier, émotionnellement parlant, d’autres tentatives bien plus bavardes (Rama et son épouse, Uco et son papa)… On attend les sorties vidéo pour se passer en boucle la scène du métro, et celle du couloir rouge.
Alors oui ce Raid 2 est moins maîtrisé que son prédécesseur, sans doute parce qu’il était moins maîtrisable d’ailleurs. C’est bordélique, ça part dans tous les sens et ça tatanne sur le modèle du tapis de bombes. C’est pourtant, pour le moment LE film de combats martiaux, et même peut-être le film d’action, de cette année. Inventif, jusqu’au-boutiste, fou et maîtrisé en diable dans ses excès autant qu’il se viande lorsqu’il s’essaie à la sobriété, Raid 2 est une bouffée d’air frais dans une époque où on nous sort un Expendables classé PG 13… Comme on dit, choisis ton camp camarade.
X Men Days of Future Past – B. Singer
Après avoir plus ou moins créé le film de super-héros moderne avec X-Men, Singer revient sur son bébé histoire de prouver une bonne fois qu’il en est le maître légitime. Il boucle la boucle avec maestria, et livre le film le plus mature et poignant de la série, et l'un des tout meilleurs du genre. Vas-y Joss Whedon, chouine.
Dans un futur apocalyptique, les Sentinelles créées pour traquer les mutants ont évolué et se sont retournées contre l’humanité entière : la guerre est totale. Les derniers mutants luttent pied à pied et mettent au point un procédé permettant à l’un des leurs de remonter le temps en esprit jusqu’à son corps du passé. Suffisamment âgé et robuste pour le trip, Wolverine est ainsi renvoyé en 1973, à la veille du déploiement des premières machines qui devra faire suite à l’assassinat de leur créateur par une Mystique juvénile et vengeresse. Une difficile alliance entre mutants, notamment entre Xavier et Magneto, devra être mise en place pour empêcher cet acte fondateur et enterrer la guerre avant même ses prémices.
Beaucoup d'embûches se dressaient devant ce retour effectif de Singer parmi ses X-men. L'approche infantile des grandes franchises Marvel (pour montrer patte blanche à Disney ?) en était la principale. Du sacrifice des Avengers dans les négations pétaradantes de ses personnages et enjeux, à la destruction à coups de boutoir, dans les récents reboots, de tous les acquis des Spiderman de Sam Raimi, le saccage est presque général. On tremblait pour les X-men, franchise exigeante rouée de coups par le traitement hasardeux des deux Wolverine (Mais qu'avez-vous donc fait à Deadpool?), et celui, nanardesque, de ce beauffard de Brett Ratner dans le tristement notable Last Stand (Mais que diable avez-vous fait à Dark Phoenix?). De fait ce X-men 3, aussi irréfutable qu'un cafard sur un gâteau de mariage, dressait jusqu'à présent son ombre méphitique sur une franchise ainsi vidée d'une grosse part de sa substance.
C'est logiquement avec le précédent film canonique de la franchise, l'excellent First Class, qu'on parvenait enfin à relever la tête : bien que Matthew Vaughn en ait assuré la mise en images avec classe et ampleur, c'est bien la main de Brian Singer qui repousse ses mutants sur les rails qu'il avait lui-même, jadis, posés. Et ce miracle apparent venait de causes pourtant évidentes, bien que boudées souvent au pays des exécutifs triomphants, à savoir le sens de la dramaturgie et le respect de l'esprit du matériau de base. Cela passait par une réelle mise en valeur des enjeux thématiques du comic book et de ses personnages (en n'éludant plus les considérations ethiques, ethniques, politiques), mais aussi et surtout par une perspective adulte sur l'histoire elle-même (en ramenant une réelle notion de péril et d'antagonisme dans le récit, avec des actions ayant des conséquences). Belle astuce pour parvenir à faire passer ce revirement, placer le récit dans les années 1960 et préparer ainsi un tapis sous lequel enfouir les erreurs du passé.
Une part du prix de la belle apothéose que nous avons aujourd'hui sous les yeux est l'élimination définitive des scories d'après X-men 2, avec l'argument du voyage dans le temps et de sa nécessaire modification de paradigme dans le futur : en changeant de ligne temporelle et historique, on efface virtuellement jusqu'au souvenir de Last Stand et Origins, et de leurs pachydermiques profanations. Enfin ! A croire que First Class ne servait (presque) qu'à préparer le public à ce tour de passe-passe, et passer enfin aux choses sérieuses laissées en plan à la mort de Jean Grey. Dans les faits, Singer devait réaliser First Class et Vaughn ce DOFP avant que des contraintes d'emplois du temps n'inversent le rapport. Quoi qu'il en soit, et plutôt que d'assurer seulement la transition, Singer se jette directement dans le gros-oeuvre. Il ose, ce faisant, de nouveau reprendre un arc connu du comic book (alors que First Class développait une storyline plus ou moins originale), l'un des plus aimé des lecteurs, celui donc du Days of Future Past, en le pliant aux impératifs cinématographiques déjà posés par sa propre saga. Pas question ainsi que Kitty Pride fasse le voyage, ce qui thématiquement n'aurait pas eu de sens au sein d'une série où le principal vecteur du spectateur a toujours été Wolverine. De même, l'excellente idée de faire un nain de Bolivar Trask, farouche opposant aux mutants et créateur des sentinelles (dont la taille est standard dans le comic), c'est-à-dire un homme condamné à être perçu d'emblée par le prisme de son physique, pose un peu plus les considérations spécistes de cet univers tel que le lit Singer : il retrouve finalement la forme et la fonction d'un récit épique ambitieux, qui montre les combats ontologiques de personnages contre leur destin, autour de leur propre patrimoine génétique ; choisissant soit de s'y résumer dans la revanche ou le suprématisme (Magneto, Shaw, ici Trask, plus tard Apocalypse), soit de le transcender par l'empathie (Xavier, Wolverine dans une certaine mesure, ou encore via les difficultés sociales de Rogue ou Mystique). Le cinéaste creuse son sillon et parle encore et toujours des guerres et de leurs fondements: le simple fait de tordre légèrement sa timeline pour poser le récit à la fin du conflit vietnamien n'a rien d'anodin (cf. le look de Xavier en 1973, citation évidente de Born on the 4th of July).
Car le film est là : il montre des personnages au lieu de se contenter de situations ou d'effets. L'évolution de points de vue et d'attitudes est d'ailleurs le cœur même de la mission salutaire des mutants ; il s'agit de pousser les personnalités-clés de l'histoire en marche à voir plus loin et plus haut qu'elles-mêmes car c'est littéralement le seul espoir de salut du monde. Xavier doit passer outre son désespoir et sa peur, Mystique sa soif de vengeance, Magneto et Trask leur aveuglement idéologique, afin qu'un péché de sang fondateur ne soit pas commis. Sous peine de se trouver à la merci de robots surdoués, personnification même d'un raisonnement systémique rigide qui signifie la mort pure, simple, arbitraire. Difficile de faire plus explicite. Rien qu'en cela DOFP se démarque du tout-venant des blockbusters récents, qui ne cherchent au mieux qu'à rétablir en fin de récit le statu quo de leur scène d'ouverture. Rien qu'en cela, DOFP est précieux, autant par son message que par la manière qu'il a de le délivrer.
Parce que bon, on est quand même dans un récit mythologique moderne qui prétend nous captiver par le spectcale d'empoignades furieuses entre übermenchen propres à nous coller à nos sièges. Pari plus que tenu. Singer n'est ni un clippeur, ni un téléaste, et il maîtrise enfin l'ensemble de sa palette de mise en scène pour porter les progressions et qualités de son écriture. Il a surtout fait d'énormes progrès en termes de scènes d'action. A l'inverse de Whedon sur Avengers (plan moyen / plan large / plan-moyen / démo technique d'ILM / re-plan moyen...), mais aussi des réguliers coups de frime de Vaughn sur le précédent opus (inserts tournoyants, effets de découpage ou de focale, plans de ponctuation ou de commentaire), Singer pose une mise en images classique et fluide, mais surtout constamment lisible, avec un sens de l'espace qui commence, fugacement, à évoquer le John McTiernan des débuts. De fait, il fait passer des notions spatiales ou conceptuelles complexes d'une façon incroyablement naturelle, rendant intelligibles, sans avoir besoin de les paraphraser dans le dialogue, des pouvoirs pas forcément évidents à poser avec des moyens cinématographiques. A ce titre, l'ensemble des séquences du futur sont d'une célérité et d'une virtuosité qu'on n'avait pas vue depuis longtemps dans un blockbuster. Les portails de Blink ou les décharges d'énergie de Bishop sont d'emblée compris visuellement avec facilité, sans jamais ralentir une action à la fois crédible et spectaculaire : les mutants combinent leurs pouvoirs avec naturel pour des résultats à la fois dérisoires dans la mesure où les sentinelles X ne peuvent être que retardées, et grandioses parce que ce sens de dernier acte d'une guerre totale appelle toutes les ressources d'iconisation dont Singer s'est peu à peu fait expert. Mais c'est bien entendu la reconstitution des années 70, juste jusque dans le grain de l'image, et son naturalisme bienvenu (attendez de voir la nouvelle tête de Toad), qui crédibilise une bonne fois pour toutes l'univers des X-men de plus en plus en plus vériste et de moins en moins "uncanny". Alors même que les péripéties sont au sens fort incroyables (Magnéto soulève un stade entier ou détourne les premières sentinelles d'une manière inédite), on n'est jamais amené à en questionner ni la vraisemblance, ni le bien fondé : la grande scène de combat de Beast (enfin beau en fourure!), pour stigmatisante qu'elle soit pour les mutants, mêle dynamisme et implication avec une maestria qui force le respect. Là comme dans les pérégrination de Mystique (belle retenue de la part de Jennifer Lawrence), le contexte est constamment mis en valeur, et si l'on doit chercher la vraie résurgence du thriller politique parano des 70's dans les blockbusters de cette année, c'est plutôt ici que dans le récent et un peu fadasse Captain America qu'on la trouve.
Cette maîtrise est aussi celle du ton, et fait merveille dans des séquences qu'on attendait a priori avec circonspection, notamment la déjà sur-commentée heure de gloire de Quicksilver (entre autres parce que le personnage doit se retrouver dans le prochain Avengers, avec le hiatus qui peut en découler), qui s'en va libérer Magneto dans les sous-sols du Pentagone. Si le look du gosse ultrarapide est le moins réussi du film, la couverture rythmique et spatiale de la séquence est si fluide et ludique qu'elle constitue un véritable court métrage enchâssé dans un récit par ailleurs extrêmement juste, tant dans la caractérisation des personnages que dans le jeu de leurs interprètes. Alors que Michael Fassbender était l'attraction principale du précédent, ici, c'est James McAvoy qui emporte le morceau avec une sensibilité incroyable. Xavier y gagne enfin sa cohérence en tant que personnage (plus encore que la condition exhorbitante pour pouvoir en user, sa mutation en fait une sorte de réceptacle virtuel de toutes les souffrances de l'humanité), notamment dans l'épilogue, faux happy ending biaisé où lui et Wolverine partagent désormais ce sens du tragique du "last man standing" : ils sont les seuls à savoir, à avoir vécu plusieurs vies entières de déchirements et de pertes insupportables, et ne peuvent partager cette expérience qu'entre "vétérans psychiques". Le mode même de communication entre les deux époques, qui emprunte à celui de La Jetée de Marker, et que seuls les deux mutants expérimentent, pose assez l'appréhension avant tout humaine de la saga par son promoteur principal. Des personnages incarnés dans un univers tangible et complexe, appuyé par une DA qui va enfin intégralement dans la même direction, et une écriture précise et pertinente, voilà qui nous fait le meilleur X-men cinématographique à l'heure actuelle, et l'un des tous meilleurs films du genre. Avec Godzilla, le coup de poker Guardians of the Universe, Jupiter Ascending, et le prochain Planet of the Apes, 2014 s'annonce en tous cas très excitante en matière de blockbusters exigeants. En attendant, réjouissons-nous de savoir Singer aux commande du prochain X-men, où c'est carrément Apocalypse qui interviendra comme l'annonce le post-générique de DOFP, le premier d'ailleurs des films Marvel à être vraiment aussi riche de virtualités. La thématique suprématiste sera encore plus explorée, et on peut espérer qu'après le paradoxe temporel, la saga se frotte à un autre fondamental du comic book : le Multiverse. Vivement 2016.
300 Rise of an Empire
Une séquelle tardive qui s'obstine à ne rien comprendre de son modèle, et qui à confondre emphase et démonstrativité, efficacité et dilettantisme, tombe dans le grand n'importe quoi anti-iconique.
Un résumé des événements de la guerre entre la Perse et la Grèce, de la mort de Darius à Marathon aux batailles suivant celle des Thermopyles. L'on suit cette fois la destinée de Thémistocle et des athéniens, et leurs tentatives pour unifier les cités grecques contre l'envahisseur et notamment Artémise, grecque d'origine à la tête de la flotte de l'empereur-dieu Xerxès.
Voilà un projet bien étrange. De ces hypothèses fantasmatiques de soirée entre potes, qui ne tiennent pas le premier examen de faisabilité parce qu'elles ne passent en toute logique pas la seconde réflexion quant à leur pertinence. En effet, pourquoi vouloir, d'un point de vue thématique et narratologique, broder autour d'un récit qui tient sur son concept tendu, sur sa concision et son apparente simplicité ? Pourquoi titrer "300" un film qui ne subit pas la contrainte d'une armée limitée à 300 hommes ? Et quel est l'intérêt de réduire l'aura mythologique d'un récit dont le propos étaient de rendre légendaires ses protagonistes et événements, en y jetant une lumière crue sans commune mesure avec le traitement qui faisait tout le prix de l'original ? Pourquoi si peu de perspective ? Nous sommes, il est vrai, à une période où Hollywood lance ses franchises les plus onéreuses sur un cameo de Samuel Jackson à la fin d'un Iron Man...
300 a dans la cinéphilie contemporaine un statut comparable à celui qu'a pu avoir Matrix au début des années 2000. A savoir une indéniable date technique et esthétique, un film qui s'il n'invente pas à proprement parler ses procédés qualifiés hâtivement de révolutionnaires, contribue à cristalliser la tendance pour l'imposer durablement. De même que Matrix rendait durablement tangibles des idées (techniques, esthétiques) qu'on avait pu deviner de Dark City à Blade, 300, dans son projet dingue de fabriquer un péplum épique dans un hangar, finissait de rendre impossible à ignorer les expérimentations techniques et esthétiques de Sin City à Lord of the Rings, et entérinait la maturité de procédés et de pratiques qui aujourd'hui ne suscitent plus de méfiance que dans les rédactions les plus catafalqueuses de notre cinéphilie nationale : inflation de décors sur fonds verts, stylisation extrême de la photographie et du découpage (de la pose pour certains), prépondérance de la postproduction et de l'effet optique, avec les effets logiques de ces bouleversements sur les modes de production. Les deux films ont été d'ailleurs autant conspuées que célébrées pour leur formalisme et leur style dramatisé, mais ont aussi pris un certain coup de vieux prématuré, aidés en cela par une palanquée d'ersatz médiocres qui n'émulent qu'à leur valeur faciale leurs avancées les plus reconnaissables. Combien d'empoignades martiales surdécoupées et illisibles, de personnages sans charisme vêtus de cache-poussières en cuir noir, de bullet-time gratuits, ont suivi Matrix ? De même, on ne compte plus les épopées en balsa sur fond de percussions et cuivres tonitruants, bourrées de photographies désaturées et jaunâtres, de ralentis au petit bonheur la chance et d'action incrédible à force de pousser le bouchon, écume de la vague qu'à représenté le film de Snyder. Cette suite mal pensée en est d'ailleurs le dernier représentant en date.
Car tout dans ce projet, de son principe à sa mise en œuvre, sent l'incompréhension volontaire et forcenée non seulement de la facture de l'original, mais aussi de ses enjeux en termes de production et de construction thématique. Le projet semble en tous cas précipité en regard de son objet, dans la mesure où leXerxès de Frank Miller a été remis aux calendes, entre autres pour cause de Sin City 2. De là a conclure que Snyder et Miller (à la production) et leur protégé Noam Murro (à la caméra) naviguent à vue, il n’y a qu’un pas que le résultat aujourd’hui sous nos yeux aide grandement à franchir. Ne retenant de 300 que son imagerie, sans jamais réfléchir à ce qui la sous-tend, ce Rise of an Empire ratisse aussi large que possible et lénifie l’ensemble de son histoire : adieu donc au paradoxe d’une société spartiate poussant son élitisme au service de la liberté (le film s’ouvrait quand même sur la vision frontale de l’eugénisme à Lacédémone), bonjour à des grecs qu’on a ramené au rang de G.I.s antiques. C’est ainsi qu’on passe par toutes les scènes obligées de séries télé pour vétérans de type Band Of Brothers, avec grands discours toutes les dix minutes sur la responsabilité, la patrie et les familles restées à la maison, dilemmes moraux américano-centrés, et même la mort d'un personnage dans les bras d'un autre qu'on jurerait avoir déjà vue dans Tropic Thunder ! Par la même trappe, s'écoule le vérisme culturel que convoquait au moins à la marge le film de 2006 : par exemple, pas un grec en deuil (et on nous en agite pas mal sous le nez) ne se couvre la tête de cendres alors que le père d'Astinos accomplit ce geste dans 300...
Cet ethnocentrisme explique sans doute grandement LE gros point noir du film, à savoir le miscast total d'Eva Green en Artémise, pourtant le personnage de loin le plus séduisant du film. Il ne s'agit pas ici de contester la légitimité intrinsèque d'Eva Green en tant qu'actrice (ah non), simplement de pointer la disparité de son emploi et de ce rôle en particulier. Pour résumer, c'est la guerrière d'origine grecque la moins crédible au cinéma depuis Jennifer Gardner en Elektra. Tout, chez l'actrice, de sa diction à ses expressions, de sa gestuelle à son magnifique profil patricien, hurle le 5ème arrondissement de Paris - ce n'est pas forcément une mauvaise chose en soi, mais c'est un emploi très restreint quand on prétend camper une cheffe de guerre jusqu'au-boutiste, prostituée depuis son enfance et au cuir tanné par les soleils et écumes de tout l'empire Perse. Seulement cette perspective sur l'erreur de casting n’est aussi criante que de notre côté de l’Atlantique. Eva Green fait carrière aux Etats Unis, où le seul fait d'être français confère automatiquement l'exotisme requis pour jouer tout étranger au nouveau monde; assortie à sa présence à l'affiche de Sin City 2, il n'en aura pas fallu plus pour la qualifier de cast "parfait"... Et cela n'est rien fasse à la caractérisation confinant au foutage de gueule : ainsi Artémise est recceuillie et entrainée par l'émissaire du premier film sans qu'on sache trop en quel honneur, et se permet carrément d'insulter son empereur lorsqu'il la contrarie avant d'aller faire ce qui lui chante avec une armée entière, sans être plus inquiétées que ça. Dans une nation où l'on décapite à tours de bras pour la moindre contrariété, quel pouvoir ! On est tout de même régulièrement estomaqué que Miller et Snyder aient multiplié des choix à aussi courte vue sur un projet dont on se demande, finalement, s'ils y tiennent.
Car tout ou presque est du même métal dans ce film, à croire parfois que ce Rise of an Empire entreprend le même travail de sape revancharde sur un modèle dont il ne comprend pas les dynamiques, que l’a fait Dark Knight Rises avec Dark Knight. C’est-à-dire que tout ce qui était autonome, vivant, ou possédait un souffle mythologique s’y voit ratiboisé, plaqué au sol et abâtardi jusqu’à la stérilité. Au prix des pires invraisemblances et reniements thématiques. Ainsi d’Ephialtès devenu incongrument sarcastique, de Xerxès montré comme un strict pantin dandy seulement capable de se tenir sur des promontoires, de Daxos devenu un banal coursier, mais aussi et surtout de Lena Headey en reine Gorgo : peut-être pour capitaliser sur la notoriété de l’interprète de Cercei Lannister, la voilà artificiellement bombardée tour à tour narratrice (à la manière de Delios dans le premier), capitaine de marine, guerrière émérite et bretteuse pleine de hargne, au côté d'ailleurs d'un homme dont son mari récemment décédé combattait les ambitions... Si la prépondérance du rôle des femmes dans l'original, quoique condamnée par certains comme un contresens thématique d'avec le comic (le signe d'assentiment avant le "this is sparta" en particulier), trouvait une justification dans le discours féministe (certes naïf) qui irrigue l'œuvre de Snyder. Ici, on se demande bien ce que défend Murro avec cette alternance de fadeurs embarrassantes et de surenchères grotesques, tant l'ensemble de son exercice consiste à ne gêner personne et à ménager toutes les chèvres et tous les choux : qu'on ne se méprenne pas face à la démonstrativité gore et cul qui émaille le film au point de le faire tourner au ridicule : ce 300 ne choque jamais qu'avec la forme, pour cacher l'amputation totale de sa substance.
C'est donc à un inventaire de la beauferie et du saccage que se résume bientôt la projection; saccage et beauferie dont Murro n'est que l'instrument et qui sont hélas surtout le fait de Snyder lui-même. Evidemment, puisque le film se base sur un modèle formaliste, c'est au niveau de sa forme qu'il se couvre effectivement de ridicule. La mise en scène ne propose rien de cohérent, avec une 3D exploitée uniquement dans la première bobine, collant des ralentis partout sauf aux moments-clef des actions, et toujours dans une topographie hasardeuse (on met quiconque au défi de comprendre ce qui se passe lors de la seconde bataille navale ou de l'assaut de Marathon), posant des personnages unidimensionnels et des situations qui émulent platement ceux du premier, sur une musique sans souffle mais toujours tonitruante. Le problème est que dans un univers où la forme était le principal vecteur du sens du récit, ledit récit, déjà ténu pour cette suite, perd tout ce qu'il pouvait posséder d'intérêt. A part à vouloir tuer l'histoire racontée précédemment, la chose est inexplicable car impossible à corréler uniquement à un manque de compétence : comment en effet cautionner, ces compositings dégueulasses, ces plaisanteries homophobes, ces revirements constants de caractères, ces visages falots moins mémorables qu'un moulage en latex de la tête de Léonidas, ce gore de cartoon (une pichenette et on perd un bras dans des gerbes de sang numérique modélisé avec des mouffles), ces pubs de parfums pour hommes où l'on chevauche des destriers à travers des incendies en pleine mer, où l'on fait exploser des pétroliers en nageant la brasse sous les projectiles les plus divers (ça fait beaucoup pour la Grèce antique, non ?), et où l'on exhibe du nichon sans autre but que celui d'écoper d'un classement R ? La scène de sexe en Themistocle et Artémise, à ce niveau, est d'un grotesque et d'un vain rarement atteint ces dernières années sur un écran : l'empoignade ne sert en effet qu'à sortir une vanne aussi épaisse qu'un gif animé circonstanciel sur un tumblr de lycéen, et à faire une autoréférence attendue lors du duel final, où l'arme blanche remplacera les appendices de chair, mais sans aucune mise en abyme ni sens de la métaphore, sans que quoi que ce soit dans l'épisode n'ait un quelconque poids symbolique, dans la mesure ou aucune opposition effective de caractères n'est esquissée à aucun moment du film.
Comment, donc, assumer cette déconfiture ? En l'appelant, manifestement, de ses vœux. Deux détails tendent à le prouver : L'inversion du statut de la narration dans l'histoire qu'on nous montre, et la séquence d'ouverture. Dans 300, le récit de Délios encapsule complètement le métrage, établissant de fait le statut mythologique de ce qui y est raconté ; Léonidas y est posé selon les canons du récit classique, et Xerxès y apparaît sortant de nulle part comme la déité qu'il prétend être. Dans Rise of an Empire, Gorgo commence à raconter les faits alors qu'elle y prend part, en omettant les évènements les plus récents (les Thermopyles) mais en posant de sordides petites considérations sur un Xerxès désiconisé à l'extrême et donc plus menaçant du tout. Surtout elle le fait après un court prologue et avant de rejoindre l'action qu'elle évoque. Dans le premier cas , les récit sur un mode épique est une fin en soi, dans le second il n'est qu'un passe-temps pour le voyage. Autrement dit, rien n'est plus versifié parce que tout est sans forme, chaotique, sans signification d'aucune sorte. Une négation de l'essence même de 300, confirmée dès la première séquence où l'on voit Léonidas, mort, être d'emblée mutilé et trivialisé en tant qu'accessoire qu'on trimbale et avec le quel on s'amuse un peu avant de ne plus trop savoir qu'en faire et de l'oublier dans un coin afin de faire place à la grande foire au n'importe quoi qui se déroule dans le bruit, la fureur et surtout l'insouciance. Belle manière de faire table rase, Zack, on se croirait définitivement dans un Rodriguez, ou un God of War sur smartphone. Bravo.
PARIS FANTASTIC FILM FESTIVAL 2013 - BILAN
Au commencement, cette semaine, de celui de Gerardmer, revenons de manière extensive sur "l'autre" festival français de genre, le PIFFF, qui soufflait une belle troisième bougie en Novembre dernier. De quoi trianguler un peu notre position de ce début d'année.
NB : Nous n'avions pu accéder à la projection du film L'Etrange Couleur des Larmes de ton Corps, pleine comme un œuf. L'exercice giallesque de Cattet et Forzani, prix Ciné+ Frissons, se verra donc traité, lors de sa sortie, dans d'autres lignes.
"Mon film n'est pas un bon film, je ne suis pas une bonne personne, vous n'êtes pas un bon public et ce genre de festival n'est pas un bon genre de festival. C’est très bien qu’on puisse s’amuser entre mauvaises personnes." C'est en ces termes parfaits qu'Alex de la Iglesia a présenté son dernier film délicieusement foutraque et ouvert la troisième édition du PIFFF en Novembre dernier. A vrai dire, son Sorcières de Zugarramurdi avait tout de l'ouverture idéale pour un tel évènement, tant par sa facture à la fois très moderne et discrètement référentielle, que par son esprit iconoclaste et son dynamisme à décorner les Krampus : le premier acte est fou, et les suivants haussent la mise encore et encore. Le film vient d’avoir la bonne idée de sortir en salles. C'est en tous cas l'un des tout meilleurs métrages à avoir été projetés cette semaine-là au Gaumont Capucines.
Depuis la mise en place de ses "nuits" hors festival, le PIFFF semble avoir enfin trouvé sa formule et atteint une certaine vitesse de croisière. A la faveur de l'assurance acquise par les organisateurs, voilà derrière nous l'impression désagréable qu'on avait parfois lors des deux premières éditions, d'un festival fait un peu sur un coin de table (ah, devoir se frayer un chemin sous le regard désapprobateur des transhumants de la file d'attente pour Intouchables, quel beau souvenir). Bref, voilà qu'enfin on ne s'excuse plus d'être là, à bouffer un maximum avant de se faire virer du buffet par un vigile du bon goût français placé en faction comme dans un épisode des trois Stooges, ce qui est heureux. On a retrouvé cette dynamique plus sereine dans une programmation plus resserrée, moins pléthorique, laissant la place aux films de respirer à leur aise. L'éclectisme, en tous cas, était d'autant plus évident cette année que les projections étaient moins nombreuses, avec un résultat inégal mais toujours intéressant (au moins, par moments, d'un point de vue tératologique). L'équipe de bénévoles, toujours aussi volontaire, porte à bouts de bras l'évènement avec une abnégation et un désir palpables, bref une dévotion qu'on ne trouve pas forcément dans les festivals dits de prestige. La différence entre co-équipiers en t-shirt et larbins en col blanc en somme, qui paraît un cliché jusqu'à ce qu'on arpente effectivement quelques festivals...
Dans les vieux pots de la communauté
Les projections de patrimoine, toujours baptisées « séances culte », se sont avérées à ce titre un vrai bonheur, soit parce qu’elles permettaient de voir des films plus ou moins inédits chez nous, soit pour le plaisir de voir en salle des films qu’on n’a que trop rarement l’occasion de regarder dans des conditions optimales. Outre que revoir Re-Animator, Christine, Creepshow ou Perfect Blue sur grand écran constitue forcément un plaisir de gourmet, qui plus est dans des salles à l'ambiance toujours bon-enfant, les deux très gros morceaux de la sélection étaient les "inédits": Seconds de John Frankenheimer et le montage définitif du Wicker Man de Robin Hardy. Ce montage "définitif" pouvait être attendu ou craint (Hardy s'est rendu coupable de Wicker Tree récemment) - il s'avère assez anecdotique. C'est l'aspect folk et joyeusement païen qui en sort mis en valeur, avec notamment une apparition supplémentaire de Chris Lee qui valide l'hypersexualité de Britt Ekland; on regrettera toutefois la scène de messe anglicane du début qui perd la cohérence géographique du récit, et la disparition du carton d'ouverture et de son humour à froid. Seconds, lui, jamais vraiment distribué officiellement en France, prouve encore la modernité du cinéma de Frankenheimer, et l'actualité des thèmes de cette vague de cinéma américain parano des 60's. S'il n'est pas interdit de voir dans le film une évocation prophétique des aventures de nos plus récents stagiaires à Wikileaks, c'est la troublante vision des désirs de l'homme occidental contemporain, et son désarroi lorsqu'il se rend compte de leur vanité impersonnelle, dictée toujours par quelqu'un d'autre, qui trouble le plus durablement devant ce film d'une logique extrêmement noire et pessimiste, et le rapproche du reste de la sélection.
Délicatesses réelles et délicatesses feintes
Pour ce qui fut des nouveautés, on peut en effet dégager deux tendances très encourageantes de la sélection de films, courts et longs : un vrai pessimisme non seulement social mais quant à la condition humaine en général, et une sincérité évidente des cinéastes quant à leurs œuvres (au point parfois de tomber dans le brouillon ou la naïveté). Soit un retour à quelque chose de plus "conscient", pour reprendre une terminologie hip hop (toi-même tu sais). Après une décennie de cynisme, entre post-moderne autophile et torture-porn paresseux, il est quand même bien agréable de voir des gens à nouveau se piquer de propos discursif et esthétique, même s’ils ne constituent pas l’essentiel de l’espèce à l'heure actuelle, ou que certains de ces propos sont plus ou moins recevables.
Paradoxe inhérent aux festivals en général, et auquel celui-ci ne peut pas totalement échapper, c’est dans les compétions officielles qu’on aura fait ses emplettes au rayon bêtes de festoches et pétards mouillés (synonymes fréquents), avec des pellicules arborant fièrement tous les marqueurs sociaux de l’exercice : photo soignée tendance « démo technique de 5D», rythme lancinant, détachement clinique de la mise en scène, DA arty, musique étéhérée et/ou branchouille, et fantastique convoqué honteusement du bout des lèvres. Ainsi, malgré quelques idées intrigantes, Animals, avec son sosie juvénile de Jurgen Prochnow causant à un ours en peluche vivant, ne parvient hélas qu’à ressembler à un Donnie Darko tabassé à mort par Larry Clark… On passera de la même manière sur Love Eternal, exercice au final assez creux, qui fait passer son indécision pour de la délicatesse et ruine les matières pourtant hautement corrosives qu'il traite (suicide, nécrophilie) par son traitement timoré, qui répugne à affirmer quoi que ce soit. Les mètres-étalon du sujet de Jorg Buttgereit (celui de Der Todes King, pas desNekromantik) et Lynne Stopkewitch (Kissed), restent donc bien à l'abri. Alors qu'il paraît leur ressembler de prime abord, notamment parce qu'il ressemble parfois à un extrait de blog lifestyle de hipster, The Battery de Jeremy Gardner est d'un tout autre calibre parce qu'il déborde de ce qui fait défaut aux deux autres films : l'humanité. Parfois maladroit mais couillu dans ses partis-pris, The Battery est un film aussi attachant que son auteur, dont la présentation en exergue portait peut-être aussi à toutes les indulgences.
Au rayon éthéré, le dernier Kurosawa peine quant à lui à convaincre. Malgré de jolis moments, Real s’avère empesé dans son rythme et surtout dans son systématisme thématique vieillot : le climax ravira les tenants des jeux de salon de psychothérapeutes freudiens, avec la personnification monstrueuse du trauma du héros qu’on a soin de soudoyer aux bons sentiments pour repartir la conscience dans les pantoufles, comme aux plus belles heures du Flatliners de Schumacher… De la part du type qui nous a donné Kaïro, c’est ballot.
A l'autre bout du spectre, dans cette catégorie "voyez ma folie iconoclaste" qui se porte toujours avantageusement en festivals, on trouvait le duo McKee/Siverston repartis en visite de leur jeunesse avec un remake de All Cheerleaders Die. Outre qu'on peut s'interroger sur la pertinence du procédé (on n'a pas forcément envie de voir des réas s'adonner eux-mêmes à un tel révisionnisme sans but effectif, à part celui de se rouler dans ses vingt ans), le récit lui-même ne questionne jamais le modèle culturel de la high-school dans son ignominie : les outcasts jouissent ou souffrent tour à tour des jeux de pouvoirs et de popularité sans jamais remettre en cause le contexte même où ceux-ci ont lieu. Si l'ensemble est amusant pour un popcorn movie (avec ses pierres magiques qui volent comme dans Warlock 2 - au fait, qu'est-ce qu'il devient Hickox?), l'ensemble fait montre d'une vanité (dans tous les sens du terme) et une certaine paresse de mise en scène et d'écriture assez pénibles. Et où diable est passée Angela Bettis ?
Du court et des coulisses
Les compétitions de courts se sont montrées, comme le reste, symptomatiques de l'état du cinéma de genre actuel dans toute son inégalité. Avec ceci de particulier pour le court que ses modes de productions sont particuliers, et notamment plus impactés culturellement par Internet et ses modes de fonctionnement "viraux", ce qui rend plus difficile la tâche des programmateurs et sélectionneurs de ce genre d'évènement. Logiquement, en français comme en international, on se croirait désormais dans n'importe quel sur un agrégateur de liens ou un webzine, avec la même typologie. On aura donc en général (et cette année au PIFFF) : des films virtuoses bricolés pour rien dans un garage, dont un ou deux en animation, des machins confondants de bêtise démagogue visant les millions de clics du public de l'oxymorique "culture du lol" (bravo au PIFFF d'avoir limité la chose à la portion congrue), divers degrés de fanboyisme plus ou moins maîtrisé, de l'idée toute simple qui obéit au principe voulant que ce qui est court et bon est deux fois bon, de la poésie bien filmée mais peu offensive, tendance "frontpage de Vimeo", le film pro qui vient faire coucou sur le chemin de Clermont-Ferrand, et toujours la tendance lourde du récit en boucle si populaire dans le court métrage (paradoxe temporel, existence absurde et/ou concentrationnaire, twists à base de clonage ou de robotique...).
Ici, les grands gagnants étaient sans surprise Jiminy d'Arthur Môlard et l'australien The Man Who Could Not Dream de Burgess et Armstrong : qualitatifs et pros, mais aussi suffisamment faciles à appréhender pour avoir l'adhésion du plus grand nombre. Ce n'est pas une mauvaise chose, et Jiminy notamment mérite les éloges. Cependant quelques perles étaient bien cachées derrière la clinquance de la vitrine. On retiendra surtout Rose of The Mute Liars de Gregory Monro et Dieu Reconnaitra les Siens de Cédric Le Men, modèles de maîtrise et de sobriété, et à l'international l'étrange Unicorn Blood d' Alberto Vazquez, Habitantes de Leticia Dolera et surtout le film turc Baskin, de Can Evrenol, avec son ambiance putride et son arbitraire bienvenu pour un récit court, qui réussit en une toute petite bobine à coller une vraie pétoche.
Le documentaire Du Sang sur la Neige, rétrospective du festival d'Avoriaz montré dans une salle bien remplie, est aussi intéressant, sinon plus, par sa nature que par son contenu. Premier docu sur Avoriaz (ce qui paraît aberrant tant le festival a marqué les imaginaires), ramassé dans un format télé (70 petites minutes), le film ne peut malheureusement qu'évoquer le festival et son histoire et, de fait, effleurer les thématiques passionnantes qu'il aborde plutôt que d'en proposer une élucidation consistante. Le point fort du docu est qu'il nomme un chat un chat, et aborde frontalement l'aspect strictement publicitaire de la création de l'évènement (le franc-parler de Lionel Chouchan est précieux), mais aussi les peoples invités pour perfuser la station de leur notoriété, et pour beaucoup juste là pour les cuites et le manger gratuit tout en se moquant comme d'une guigne des cultures de l'imaginaire. Il faut voir certaines archives où nos plus illustres bêtes à cornes étalent avec délices leur mépris du fantastique, en sortant des bêtises grosses comme eux... Cette franchise roborative s'applique aussi à l'analyse du déroulé des éditions, dont les détours relationnels et les fautes de goût ne sont pas éludées. On regrettera cependant qu'avec si peu de temps, le film soit régulièrement plombé par des interventions pas toujours utiles se contentant de décrire platement les pitches des films primés, la part belle faite à l'aspect people justement (beaucoup d'extraits des Midi-Première et consorts, ou encore une Jane Birkin décrivant les soulographies de ses potes) et à une vision nostalgique qui annihile un peu cette lecture critique. Ceci dit, le sujet n'avait pas encore été traité, et son casting incroyable (il y a vraiment de quoi saliver) font passer la pilule d'un documentaire qui, certes, appelle des suites plus fouillées.
Gros morceaux ?
Deux sorties étaient quant à elles attendues au tournant : Odd Thomas et la nouvelle itération de Carrie. Ce second film étant sorti en décembre avec la possibilité pour chacun de juger sur pièce, on n'aura plus grand'chose à en dire, à part que son cul est placé si habilement entre les deux chaises de la fadeur et du suivisme qu'il en devient particulièrement inutile, à part pour démontrer aux adolescents d'aujourd'hui, cœur de cible du produit, quels butors préfacistes ils deviennent lorsque réunis en groupe (ou pas). Dans la mesure bien vraisemblable où ils n'auraient jamais l'idée de voir le De Palma, ou de lire le livre, le film de Kimberly Pierce peut au moins servir à ça... Le retour de Stephen Sommers, lui, se faisait en demi-teintes : après son quasi-exil sous les quolibets quant au gigantisme boursoufflé de ses blockbusters des années 2000, il revient logiquement avec un "petit" film dans le but évident de revenir à ses premiers efforts de B movies (Deep Blue Sea). Le résultat, charmant, évoque beaucoup les meilleurs moments campy d'un Buffy Vampire Slayer : c'est enlevé, amusant et solaire, et le postulat (un type lunaire voit les esprits des défunts ainsi que des sycophantes surnaturels qui se nourrissent de violence) est admis en un temps record. Le corollaire de cet aspect télévisuel, c'est que c'est très bavard et que le tout manque franchement d'ampleur, même au cœur de ses morceaux de bravoure (comme chez Joss Whedon donc).
Pas mal fustigé comme trop différent de Wolf Creek, survival un brin surestimé qui avait surtout fonctionné sur l'effet de surprise, Wolf Creek 2 (du même Greg McLean) améliore pourtant grandement la donne, en améliorant le rythme, et en faisant en quelque sorte le chemin inverse de Rob Zombie entre House of 1000 Corpses et Devil's Rejects : il tire le réalisme à tout crin du premier vers une sorte de surenchère folle qui vire presque au fantastique, en capitalisant à fond sur son bogeyman Mick Taylor (John Jarrat est incroyable) et sa bonhomie rigolarde à la Paul Hogan jusque dans des exactions excessives et très bien emballées, de deux poursuites folles dans l'outback à un quizz en chanson à la fois drôle et tendu. Une très belle réussite bigger, louder et, oui, better.
Mais ce sont deux vrais joyaux qui auront emporté définitivement le morceau et justifié en grande partie cette édition. D'abord le très très fort Cheap Thrills, maîtrisé d'une manière impressionnante par E.L. Katz dont c'est le premier long. Un récit dégraissé au maximum (deux anciens amis de fac se retrouvent une nuit dans une suite de "paris" avilissants pour le compte d'un couple riche) qui court bille-en-tête d'une transgression à l'autre, toujours plus loin vers sa conclusion naturelle, évidente mais pas attendue (le dernier plan est magnifique), et servi par un cast parfait (outre Pat Healy et Sarah Paxton, vous n'avez jamais vu David Koechner comme ça) et surtout une mise en scène précise et efficace sans être ostentatoire. On pourrait voir la chose comme un croisement entre les pires shows de téléréalité et les films de Ben Wheatley. Mine de rien, E.L. décrit avec acuité une version locale et clandestine des "derniers jours de Rome" que nous vivons tous quotidiennement, tant sur nos écrans (les "épreuves" consistant à s'humilier ou à se mettre en danger, la mise en compétition des êtres humains sur leur existence même) que dans la vie économique où la classe dominante dispose des moins riches par un chantage implicite et consenti par ceux-ci... Là où le film réussit son coup, c'est que le public, déjà anesthésié par des années de ce traitement, vit jusqu'au dernier acte la chose dans l'impensé de son époque, riant de péripéties pourtant glaçantes, avant de réaliser à la fin qu'on lui a mis le nez dans ses propres déjections. Grand gagnant du festival, et à raison.
Et pourtant il ne sortira qu'en vidéo par chez nous, à l'instar de Byzantium (déjà dans les bacs), le dernier et magnifique métrage de Neil Jordan, qui revient au vampirisme après Interview with a Vampire. Et pourtant voilà un film qui mérite amplement d'être vu en salles, tant par le classicisme de sa mise en scène et de son écriture, par la délicatesse de son traitement, que par une interprétation désarmante et une mythologie fascinante dévoilée juste ce qu'il faut pour enflammer l'imagination. Lavant le sous-genre vampirique des affronts scintillants et/ou vulgaires des dix dernières années, Jordan sait ce qu'il fait et le fait avec sérieux sinon avec foi, en créant des personnages épais, complexes, pour lesquels on se damnerait en un clin d'oeil (on met au défi quiconque de ne pas ressentir un frisson adolescent devant l'amour naissant entre Saiorse Ronan et Caleb Jones) et en ménageant des images d'une force évocatrice et symbolique rarement vue en ces temps de disette. Poétique, concret, sexué, émouvant et brutal, Byzantium est rien moins qu'un chef-d'oeuvre qui nous dit que non, le cynisme dans le cinéma de genre n'a pas encore totalement gagné et est peut-être même en voie de refluer. C'est globalement la leçon qu'on pouvait retenir du panorama de ce troisième PIFFF : un paysage du cinéma de genre mondial en friche, peut-être en transition, et l'intuition de désirs d'évolutions encore sous-jacents mais bien réels. Vivement.
Retrouvez l'ensemble des informations sur la programmation et le palmarès sur le site du PIFFF : www.pifff.fr
Las brujas de Zugarramurdi - Alex de la Iglesia
Que faire après Balada Triste? Alex de la Iglesia se regroupe en revenant à la comédie latine, méchante, et branchée sur des voltages qui feraient griller les transfos de nos caméras nationales. Histoire de remettre les compteurs au-dessus de 9000.
"Le royaume des cieux est la patrie des eunuques." Tertullien
Au sortir d'un casse costumé en plein Madrid où il avait amené son fils parce que c'était son mercredi de garde, Jose se retrouve en cavale avec armes, bagages, butin, complice, et otage en plus de son rejeton. Avec la police et son ex-épousée aux trousses, il mène ce petit monde vers la France en passant hélas par Zugarramurdi, bourgade rendue célèbre par les chasses aux sorcières de jadis. Ils vont vite se rendre compte que de sorcières, leur vie va être vite très encombrée, au point qu'ils pourraient laisser leur vie et leur virilité, mais aussi le petit Sergio, dans leur escale forcée en plein sabbat...
Ce n'est pas un hasard, loin de là, si de la Iglesia a pu non seulement impulser (avec le quasi-hold-up du financement d'Accion Mutante) mais aussi pérenniser et agréger une nouvelle vague de cinéma espagnol devant plus aux publics qu'à des subsides d'état. C'est précisément pour la raison, dans sa manière de pratiquer son cinéma, qui rend dubitatifs bien des commentateurs qui basent leurs conceptions de l'art sur des hiérarchisations arbitraires : sa faculté à justement se servir de tout ce qui le constitue en tant qu'artiste sans se soucier du qu'en-dira-t-on des voisins. Cultures populaires, cultures élitaires, cinéma, jeu vidéo, transgressions de carabins, tout cela est convoqué chez de la Iglesia, et souvent simultanément, au service d'un lyrisme constant. Un lyrisme distancié, organiquement intégré au sujet local de la plupart de ses films, où il n'apparaît que de manière détournée, mais un lyrisme tout de même, fonctionnant d'ailleurs sur le même mode que celui d'un Guillermo del Toro. Que le premier dise qu'il ne met peu ou prou en scène que des fêtes personnelles, ou que le second parle des films en général comme de sa seule vraie vie sexuelle, c'est un cinéma intime qu'ils pratiquent avec toute la pudeur que souligne paradoxalement la grandiloquence de leurs effets. Et pudique, de la Iglesia l'est peut-être même plus que del Toro dans la mesure où la poésie de ses sujets et de leur traitement est cachée non seulement dans les grandes qualités techniques de son écriture fortement charpentée, mais aussi derrière l'outrance apparente de ses procédés.
Ici, l'on a un film qui semble un retour en arrière thématique et technique pour de la Iglesia ; il n'en est rien. Ses trois derniers films peuvent même former un triptyque lâche où il se sera purgé d'une surdose de colère personnelle et sociale (Balada Triste en 2011, écrit seul et pendant son divorce), puis aura pris un recul inhabituellement acerbe sur son statut dans le paysage espagnol, acquis entre autres en envoyant bouler l'Académie du Film alors qu'il en était président (La Chispa de la Vida en 2012). Les Sorcières de Zugarramurdi acquiert alors une place à part dans la filmographie récente du cinéaste, en se retournant avec humour (au sens d'une distance d’avec soi-même) sur l'ensemble de la période, pour reprendre les choses là où elles avaient été laissées... Logiquement, il repart alors d'un grand rire joyeux et désabusé, et avant tout à propos de lui-même et de son divorce, en livrant à nouveau une histoire dont il a rôdé les composantes depuis 20 ans qu'il en raconte, c'est-à-dire une histoire où il n'y a peu ou prou que des méchants, à divers degrés. Des personnages qu'il juge, certes, mais sans les condamner, et cette nuance est sans doute l'une des principales conditions de l'équilibre miraculeux des efforts du bonhomme, l'un des très rares (avec Edgar Wright par exemple) capables de produire un divertissement réellement ambitieux d'un point de vue thématique sans jamais devenir réflexif ou pontifiant, notamment parce qu'ils refusent l’opposition stérile fond/forme que beaucoup s'obstinent à perpétuer sans mélange.
Impossible en effet de taxer l'homme et ses films de manichéens, sans pour autant que ceux-ci soient ni hermétiques ni cyniques. Et le sujet, ici, aurait donné une gamelle sans nom entre des mains moins impartiales ou subtiles - car si de la Iglesia n'a confiance en personne dans ses films, il y aime tout le monde inconditionnellement. Dans l'Espagne actuelle, qui par exemple vient de légiférer une grosse régression dans les droits à l'IVG, mettre en scène une guerre des sexes totale, de plus en symbolisant les parties en présence par des archétypes lourds de sens au sein du pays de Torquemada, revenait en effet à transporter de la nitroglycérine en pogo stick. A l'instar d'un Flaubert dans une veine plus rigolarde, de la Iglesia "plonge les mains dans la merde": dans Balada Triste, il utilisait l'un des grands tabou de son pays, la Valle de los Caidos, comme pivot de son récit. Ici, il oppose clairement des figures du patriarcat qu'il trivialise (Jose et Antonio sont respectivement grimés en Jesus qui brille et en figurine de soldat en plastique vert), face à un matriarcat glorifié comme païen et puissant, mais perverti car sous-jacent et réprimé. Outre bien entendu la structure empruntée à From Dusk Till Dawn (qui montre d'ailleurs lui-aussi des malfrats virilistes tombant dans les griffes d'une reine monstrueuse) ou aux scénarios d'Alex Garland (fuir un péril pour tomber dans un pire), on pourrait s'arrêter, et beaucoup le feront, à ce postulat de déchirement hommes/femmes en tant que factions plus ou moins ennemies : une sorte de version surnaturelle hardcore de Calmos, ce qui donne déjà un film assez fou pour être plus que valide en tant que pur plaisir cinéphile.
Mais voilà, de la Iglesia est plus intelligent que ça, et il ne fait comme à son habitude que feindre ce parti-pris pour mieux le dépasser, et la confrontation, dans toute sa folie (du casse au sabbat, c'est toujours confondant de rythme et de dynamisme), n'est bien entendu pas si simple que ça. Ainsi les échanges machistes entre les fuyards et leur solidarité d'éclopés du couple, tout cathartiques qu'ils soient, montrent surtout une bande de types complètement à la merci de ce qu'ils prétendent mépriser : les femmes. Les hommes, dans le film, ne sont que des enfants pour le pouvoir souterrain des femmes, qui gardent d'ailleurs un ou deux idiots comme animaux de compagnie... D'ailleurs nos héros se verront à plusieurs reprises affublés de bonnets d'ânes par leur ravisseuses. Leur ressentiment se voue bien plus à l’absence des femmes qu’aux femmes elles-mêmes. La sorcière est une femme de pouvoir qui cause de fait le ressentiment des hommes, comme en atteste le générique montrant comme telles... Angela Merkel et Maggie Thatcher. Cependant, les sorcières et leur société, dans leur bonheur à prôner le "mal" et une amoralité toute animiste (voir les répliques délicieusement scabreuses de deux sorcières jouées par... Carlos Aceres et Santiago Segura!), sont aveuglées et condamnées à l'incomplétude par le systématisme de valeurs qui ne se suffisent plus à elles-mêmes. Pourtant, leur culte est validé en soi par l'existence vérifiable de leur déesse : le climax, incroyable, mélange combats magiques en lévitation et kaiju eiga, avec une Venus de Willendorf aussi géante que grotesque et à poil, qui ridiculise le roi Goblin du Hobbit sur son propre terrain ! Et néanmoins, l'ensemble de la pensée de la congrégation se voit tronqué par le simple fait qu'il ne tire plus sa raison d'être que d'une opposition avec la société patriarcale. De la Iglesia montre bien deux factions mais les présente comme également tronquées car coupées l'une de l'autre dans un mouvement par définition stérile. La prophétie basée sur la venue d'un enfant mâle montre assez cet état de fait (on pense beaucoup au Bene Gesserit et son Kwisatz Haderach), mais la rédemption vient logiquement d'une femme, jeune sorcière tombant amoureuse de Jose (Carolina Bang n'a jamais été aussi affolante) et qui fait basculer le récit dans le grand délire de la foire d'empoigne alors que l’ex-épouse se voit assimilée par les conjurées (Macarena Gomez recolle les chocottes comme dans Dagon). Accessoirement, toute la partie se déroulant à Zugarramurdi nous montre ce qu’auraient donné certains films de genre français avec une production raisonnée, Sheitan ou La Meute entre autres. Plus que deux genres (mâle/femelle, polar/fantastique), c'est deux modes de vie qui s'opposent ici, sur un mode référentiel éclectique (wu xia fantastique, gothique anglais, actioner hollywoodien…) mais dans un esprit foncièrement européen, effet encore mal dosé par chez nous. L'espagnol nous prouve encore sa maîtrise technique et thématique, autant qu'humaine dans sa manière de pédagogiser son histoire et ses personnages, dont on serait avisés de prendre de la graine.
Ce dernier film n'atteint toutefois pas forcément les sommets de précédents efforts de de la Iglesia dans le même style (Crimen Ferpecto et surtout Muertos de Risa font toujours figure de chefs-d'œuvre du genre), la faute à un excès de générosité pour une fois pas aussi bien canalisé qu'auparavant : la love story des flics, le petit ventre mou du milieu, l'insistance sur l'infortuné client du taxi, quelques élément sont en effet, en l'état, dispensables. Mais l'on préférera toujours un péché de générosité à un excès de continence. Les sorcières de Zugarramurdi reste non seulement le film le plus fou, mais surtout le plus efficient dans sa folie, que l'on verra cette année. C'est aussi l'un des plus intelligents et des moins recommandables. Comment ne pas se jeter dessus tête baissée, alléchés par le mélange d'humanisme, de misanthropie et de malséance que nous propose inlassablement son auteur avec une ardeur et un esprit toujours plus évidents ? Entre le bon goût et le goût, après tout y'a pas photo.
The Hobbit – the desolation of Smaug
Le mètre-étalon de la fantasy cinématographique moderne est de retour pour un acte 2 plus ramassé, qui corrige le tir parfois hasardeux du premier. Cependant si le spectacle est fort et merveilleux au sens plein du terme, l'évidence propre à la trilogie originale peine toutefois encore à s'épanouir pleinement.
NB. : Cet article fait entre autres suite aux questions soulevées ici même à propos de The Hobbit – Un Voyage Inattendu.
Peter Jackson croit-il encore à la Terre du Milieu ? Désire-t-il vraiment, viscéralement, continuer à l’arpenter ? Ou alors, sachant que de toute façon quelqu’un, par l’odeur des profits alléché, s’attaquerait tôt ou tard à une “prélogie” (quel vilain mot) de son Lord of the Rings, a-t-il simplement voulu s’occuper lui-même du bébé pour le protéger de trop grands désastres? A la vue du second acte de The Hobbit, et en dépit des immenses agréments que celui-ci propose, la question taraude régulièrement.
De fait, ce Hobbit apparaît moins comme un récit, à la manière dont LOTR se posait comme tel avec évidence, que comme un agglomérat d’entreprises diverses, dont certaines ne se verront peut-être couronnées de succès que lors du troisième film, dans un an. La plus évidente de ces entreprises est aussi la plus immédiate et concluante : c'est la virilisation de Legolas, menée à grand train (regard dur, présence physique plus aggressive, voix plus grave). Bien entendu, on pointera la création ex nihilo de Tauriel, belle guerrière elfe et love interest censé balayer les blagues quant à l'inversion de Legolas sur les internets. Et au passage amorcer un triangle amoureux avec Kili pour appuyer le racisme du fils de Thranduil à l'égard des nains. C'est d'ailleurs le premier lien narratif réellement bienvenu entre les deux trilogies, qui apparaît de façon organique au service d’une trajectoire effective de personnage au long des deux récits, et pas juste un clin d’œil ou un signe de connivence (plus tard par exemple, on voit Gloïn garder une image de son juvénile rejeton Gimli dans un keepsake – c’est certes amusant, mais guère plus qu’un coup de coude complice). Ceci dit, on peut s'interroger sur les motivations profondes de cet ajout d'un personnage féminin, et surtout leur pertinence réelle vis-à-vis de l'œuvre de Tolkien, notamment lorsqu'on entend certains propos sur le sujet d'Evangeline Lilly, interprète de Tauriel ("9 heures de film sans grand personnage féminin, ce serait choquant" Sic !).
Toutes les tentatives du film ne se soldent pas par des triomphes, pour le moment en tous cas. En premier lieu les libertés prises avec le matériau d'origine pour raccrocher, justement, cette adaptation à celle de LOTR. La séparation des nains et de nouveaux orcs à leurs trousses, un proto-Grima à Laketown alors que le Maître (amusant Stephen Fry) aurait largement suffi, Beorn littéralement sacrifié, le cliffhanger affreusement abrupt, Sauron se révélant à Gandalf à Dol Guldur alors que 60 ans plus tard, tout le monde (Gandalf compris) est parfaitement insouciant vis-à-vis du retour de celui-ci (1)... Tous ces éléments posent d'une manière générale ce climat dolent et tragique un peu déplacé, dans le but de bien nous faire comprendre les enjeux mondiaux de ce qu'on a sous les yeux. Plus que ces libertés, c'est l'intention qu'elles servent - émuler LOTR - qui gène, car elle confine à nouveau au contresens mythologique. Certes, la plupart des éléments ajoutés ou déplacés viennent d'autres endroits de la geste Tolkienienne (appendices, annexes, Silmarillion, etc.). Mais plier ainsi le ton et le déroulement du Hobbit pour l'accorder au climat apocalyptique de la seconde moitié de LOTR revient, dans une certaine mesure, à trahir le projet original dans ce qu'il a de solaire. Car sans être léger, Le Hobbit est un récit foncièrement optimiste. Autrement dit, à trop vouloir coller à son illustre prédécesseur et à son succès financier, le studio force Jackson à se dédire dans une certaine mesure de la foi incroyable qui habitait sa trilogie séminale.
Pourquoi, ainsi, pourquoi diable être passé de deux films à trois, à part pour singer la structure de son illustre locomotive ? On voit de mieux en mieux, à mesure que les actes s'égrènent, comment cette décision entraîne les seuls vrais défauts (mais des défauts importants, sous-jacents, structurels) de la saga qu'on est train de suivre. Rappelons qu'à l'origine, sur deux films, la césure devait se faire de manière bien plus organique à l'issue de l'évasion en tonneaux, qui prend maintenant place à la fin du premier tiers de cette Désolation de Smaug. Ici, après un premier acte tirant gravement à la ligne et quasiment cantonné à la seule exposition (2h40 d'exposition tout de même), on en a un second qui avance bille-en-tête de climax en climax quitte à en déprécier certaines (2h40 de climax tout de même) avant de s'arrêter sur une coupure intenable (un an de suspense tout de même) sans avoir l'élégance de se suffire à lui-même avec une fin "naturelle". Autant dire que la bataille des 5 armées devra tenir ses promesses pour justifier le long métrage presque entier qui sera consacré à son confort.
Toutes réserves posées, on s’inquiètera peu à cet égard et la confiance est de mise pour le fameux numéro trois. Car la Désolation de Smaug est largement supérieur au Voyage Inattendu en termes de rythme, de générosité et de consistance dramatique. Jackson semble enfin à l’aise dans son récit et se laisse plus souvent, et de façon bienvenue, la bride sur le cou, dans le but de livrer un spectacle aussi total que possible. Ainsi, et pour revenir aux considérations du début de ce texte, on sent que l’envie de Jackson se voue peut-être plus à des morceaux isolés qu’à un Grand-Œuvre un peu écrasant. La caractérisation des nains, par exemple, se voit très largement améliorée ici parce qu'elle se fait via l'action et la mise en praxis effective des interactions et oppositions plutôt que par de fastidieuses présentation à tiroirs. De fait, les nains acquièrent enfin une identité propre et sortent de l'aspect "liste de courses" du film précédent - voir par exemple Bombur ou Fili, qui gagnent à la fois en épaisseur et en présence. La contrepartie est malheureuse : les nouveaux personnages et sous-intrigues se trouvent en comparaison trivialisés (voir Laketown et ses intrigues, qui font pour le moment l'effet d'un enjeu artificiel).
La frustration qu’on ressent devant la durée de certains morceaux d’aventure échevelée prouve l’agrément de celles-ci, le principal reproche qu’on puisse leur faire étant littéralement d’avoir un trop fort goût de revenez-y. C’est le cas, on l’a vu, de l’apparition de Beorn, mais surtout de l’attaque des araignées de Mirkwood. La désorientation dont la compagnie fait l’objet, par exemple, aurait gagné à être un peu plus longuement dépeinte afin de mieux encore perdre le spectateur. Quant aux araignées elles-mêmes, les deux séquences les mettant en scène regorgent de tant de belles idées (leurs conversations intelligibles pour Bilbo uniquement lorsqu’il porte l’anneau de pouvoir, ou la manière dont l’une d’elles baptise Dard à son corps largement défendant), et sont d’une richesse cinétique telle qu’on les quitte à regret. On peut faire, d'ailleurs, le même reproche à la sous-intrigue de Gandalf à Dol Guldur, bourrée jusqu'à la gueule de belles choses (le tombeau des Neuf, le combat d'influences magiques) qui n'ont, hélas, pas vraiment la place de s'épanouir au sein d'un programme trop serré pour elles. En comparaison, les deux très grosses setpieces, à savoir l'évasion en tonneaux et la confrontation avec Smaug, s'avèrent très détaillées, longues et bien plus riches de sens mythologique que l'ensemble des deux métrages. En termes de spectacle, on touche à l'expérimentation la plus décomplexée (plan-séquences virevoltants et interactions topographiques complexes rappellent la virtuosité du climax cuisine-grenier-hall de Braindead), et comme à l'habitude de Jackson, le spectateur n'est jamais laissé sur le bord du chemin, avec une action d'une adéquation entre lisibilité et dynamisme exemplaire, si on veut bien la comparer à la donne actuelle des blockbusters. Lisibilité telle d'ailleurs, que parfois elle confine aux saynètes explicatives que l'on utilise dans les jeux vidéos à la troisième personne pour expliciter les puzzles et énigmes (cf. la forge sous Erebor)... L'action est en outre bien plus ludique, avec de nombreuses "ponctuations", signature récente de mise en scène du néo-zélandais, parfois au prix de cassages de gueules incompréhensibles (mais que foutent là ces étranges plans d'insert à la GoPro ?).
Le combat contre Smaug est néanmoins riche de quelque chose de plus subtil, qui serait d'ailleurs la seule raison de trouver pertinente la construction en trois films à ce jour : Smaug est en effet caractérisé à l'extrême non seulement en tant que menace animale et puissante, mais surtout comme un personnage intelligent, orgueilleux autant que cruel, mais surtout très fin. D'une façon plus marquée que chez Tolkien, c'est un antagoniste plus qu'une créature, le pendant négatif de Thror et par extension de Thorin. Plus encore peut-être que l'or, c'est même la destruction des nains qui titille la vanité de la bestiole. Benedict Cumberbach insuffle une telle fatuité dans le rôle que c'est un plaisir à suivre, d'autant que l'on retrouve (intentionnellement ou non) le sel des échanges de la série Sherlock entre lui et Martin Freeman. Bilbo justement se voit affecté par l'Anneau au même moment et dans les mêmes proportions que Thorin est atteint par la cupidité qu'attise chez lui la perspective de retrouver l'Arkenstone : la noblesse d'intention qui s'est faite jour jusque là se retrouve teintée d'ambition strictement personnelle dès la confrontation avec Thranduil, ambition qui ira jusqu'à la rouerie pure et simple avec Bard, pour aboutir à une défiance, presque un mépris envers Bilbo qu'il avait pourtant accepté comme un ami, ce que d'ailleurs Jackson ne manque pas de juger via une remarque de Balin.
Le fait que le récit montre cet antagonisme sans le résoudre (la dernière réplique est éloquente), mettant ainsi sur le même pied moral ses éléments (Smaug et Thorin, Bilbo six décades plus tard), mais aussi que ce même récit commence sur un personnage polymorphe (Beorn), met en évidence les racines que plante Tolkien dans la mythologie nordique pour son œuvre, son projet étant de réactiver un imaginaire ancestral européen. Venant d'un philologue éminent du tournant du vingtième siècle, il est évident que l'histoire de Smaug fait écho à la légende de Sigurd et en particulier à Fàfnir, nain qui accapare le trésor maudit (don de Loki) de son père assassiné (où l'on trouve aussi un anneau magique) et se change en serpent géant invincible pour le garder, pour plus tard être défait par le disciple de son frère, nain forgeron qui entend récupérer le prix du sang qu'il a lui aussi versé. On voit comment les évènements dépeints ici touillent la même pâte mythique.
Reste à savoir si cette rhétorique est intentionnellement mise en avant par le film, ou si la construction en trois morceaux plutôt qu'en diptyque n'a cet effet positif que de manière aussi fortuite que les infortunes détaillées plus haut. Au risque de paraître trop confiants, on préfèrera la première option, la foi de Jackson dans son projet au long court ne pouvant pas être totalement soluble dans la fatigue de sa réalisation. Le traitement apporté à l'image et aux décors, principalement dans les establishing shots, qui s'éloigne du réalisme pour poser une ambiance nettement plus fantaisiste voire féérique (comparons seulement, en termes d'image, Erebor à la Moria, le domaine de Thranduil à la Lorien, ou LakeTown à Edoras), tendrait à appuyer cette idée. Mais l'impression domine que ce n'est que pour compenser les dégâts apportés par une production commencée sur des bases chaotiques, et souffrant d'avoir été relancée sur un régime de risque minimal avec une structure narrative inadaptée à son sujet. En bref : Jackson et ses alliés restent les patrons et il s'y entend pour déplacer des montagnes en équilibre fragile. Et bien entendu, vivement la suite, surtout avec cette diabolique dernière séquence et l'amélioration drastique de chaque nouveau volet par rapport au précédent. Mais encore une fois, que n'aurait-on donné pour voir deux films au lieu de trois, avec la vision d'un Del Toro !
1) Ces deux derniers cas devraient a priori se trouver résolus dans There and Back Again, avec notamment le Conseil Blanc marchant sur Dol Guldur. Gandalf, chez Tolkien, découvre en effet aussi que Sauron y demeure. C'est la manière, toutefois, dont cette découverte et les évènements qui la suivent sont dépeints dans le film qui gène aux entournures. Il faudra voir au prix de quelles nouvelles distorsions, ou de quel nouveau tour de force (Jackson, Boyens et Walsh nous ont habitués à ce genre miracles), le fragile statu quo du début de LOTR se verra rétabli.
Gravity
Alfonso Cuaron revient aux manettes et parvient à surpasser drastiquement la qualité déjà délirante de Children of Men. Gravity est un film incroyable, qui montre l’espace comme personne et parle de l’humain avec l’évidence des grands virtuoses. Au moins le film de l’année.
L'homme est la mesure de toute chose - Protagoras
Lors d'une mission sur Hubble à l'extérieur de la navette spatiale américaine, un syndrome de Kessler (réaction en chaîne où des débris de satellites détruits tournent en orbite à la vitesse d'une balle de pistolet, réduisant en charpie d'autres appareils pour former un nuage exponentiel de shrapnel meurtrier) frappe l'ensemble de l'orbite proche, tuant la majeure partie de l'équipage et détruisant la navette. Ne restent que le capitaine Kowalski (George Clooney) et le docteur Stone (Sandra Bullock) : dans leurs combinaisons à l'autonomie limitée en oxygène, ils décident de rejoindre la station internationale pour tenter de regagner la Terre...
Mille fois certes, Gravity constitue une date à plusieurs égards, abondamment commentée de toutes parts. D’abord avec cette manière de tourner et d'envisager la mise en scène qui touche à l'inédit complet, et ce vérisme saisissant dans la reconstitution à hauteur d'homme de l'aventure spatiale, Cuaron a clairement accompli un exploit. Disons-le sans ronds-de-jambes, la facture de Gravity relève de la dinguerie pure, tant dans l’ambition de sa mise en scène que dans la grande intelligence des moyens employés en production et postproduction : pour 80 millions de dollars, soit un peu plus de la moitié d’un blockbuster moyen, Gravity met aujourd’hui tout le monde à l’amende, y compris James Cameron (l’homme ne s’y trompe d’ailleurs pas et clame son admiration pour Gravity, ayant reconnu en Cuaron un autre « cinéaste-inventeur » proche de ses propres préoccupations). Le pseudo-débat quant à la suprématie naissante, inquiétante pour certains et désirable pour d’autres, d’un « cinéma du virtuel », est à ce titre presque parfaitement stérile puisque focalisé sur des moyens mis en œuvre et pas l’essence d’un film, qui est toujours une expérience virtuelle quelle que soient les raffinements de sa facture. Au titre de l’aspect au moins secondaire de telles considérations, on citera bien sûr les prouesses d’interprétation, dont l’incarnation ne se discute pas une seconde : Sandra Bullock prouve une bonne fois qu'elle est l’actrice de A-list la plus mésestimée à l’heure actuelle.
Ce projet se retrouve bien entendu dans la réalisation elle-même, qui rappelle finalement plus Tarkovski que Kubrick dans son évidence et son aspect factuel, notamment avec l’emphase constante sur les phénomènes d’attraction et de répulsion (entre personnages, entre objets dans l’espace, etc.). Mais c’est surtout le traitement réservé à la parole (au début du film d’ailleurs, un carton pose la non-conduction du son parmi les inhospitalités du milieu spatial) qui confirme ce trait. Ainsi des anecdotes et histoires personnelles de Stone et Kowalski qui sont systématiquement soit tronquées par le film lui-même (l’histoire du singe à la Nouvelle Orléans) ou posées comme peu signifiantes par essence (malgré son caractère colossal, le traumatisme de Stone est commenté par elle-même comme simple et bête dans ses circonstances, l’histoire - elle - ne valant pas grand-chose à raconter). Mieux encore, la parole est un repoussoir à la vie, salué de rapports paradoxaux (Stone roule au hasard, avec à la radio « n’importe quoi du moment que ça ne parle pas », mais les personnages parlent constamment à Houston y compris lorsqu’ils le font « en aveugle »), au point d’être même un élément qui par son babil même anesthésie la pulsion naturelle à la survie, sans même qu’il y ait besoin d’intelligibilité : la conversation avec Aningaaq représente ainsi le nadir de la résignation générale de Stone face à son existence. En face de ça, les paroles concises et les one liners de Kowalski sont salutaires, prônent l’action et sont suivis d’effets (« It’s an order », « You’ll have to learn to let go »).
Au delà de la métaphysique, du survival tendu qui vous fera involontairement retenir votre respiration (la puissance de l’immersion est si grande que ça), Gravity se conçoit surtout comme une réflexion sur la vie elle-même, telle que la définit Bichat : un ensemble de fonctions qui résistent à la mort. Autrement dit, vivre C’EST avoir mal, car le vivant est paresseux et doit se faire violence pour se maintenir, et seul l’admettre permet de vivre avec sens. Car la mort est toujours d’un arbitraire effrayant – on peut considérer cet état de fait comme paralysant ou le prendre comme aiguillon. En posant le docteur Stone, littéralement morte-vivante depuis un traumatisme qu’elle croit insurmontable, au milieu d’une sorte de masse critique d’adversité, Cuaron se pose en passeur qui la mène par-delà le Léthé où elle est tentée de se laisser sombrer. Gravity est l’une de ces très rares œuvres qui créent un bien-être plus ou moins durable chez le spectateur, le poussent à réfléchir plus haut et plus loin que lui-même ou mettre sa propre existence en perspective, mais fait tout cela avec un naturel et une fluidité désarmants, et donne envie de se bouger pour aller mieux et faire mieux. S’arracher de la zone de confort. C’est pour cela qu‘au delà du vertige permanent des scènes spatiales, de la beauté d’une apesanteur en position fœtale, et même de l’ambition et de la précision du tour de force, le film tend tout entier vers ce qui est, sans doute, le plus beau plan qu’il nous est donné de voir sur un écran cette année : une femme qui se relève enfin, et décide de marcher.
The Wolverine
On nous annonçait un blockbuster incarné, concret, resserré sur les enjeux humains d'un personnage dégraissé de ses scories cinématographiques, en misant en façade sur la personnalité de son réalisateur. Las, The Wolverine manque de peu son but et s'avère, in fine, presque aussi anecdotique que son prédécesseur pour une qualité intrinsèque pourtant bien supérieure.
Brisé par une trop longue vie et la perte de Jean Grey dont il ne parvient pas à se remettre, Logan vit en ermite dans une forêt américaine et y cultive son rejet de la société des hommes. C'est là que vient le solliciter M. Harada, dont il a sauvé la vie à Nagasaki : arguant vouloir l'aider, par reconnaissance, à surmonter sa virtuelle immortalité, il va l'entrainer dans des luttes de pouvoir où se croisent ninjas, mutants, grandes familles et accointances économiques. Logan, rendu à cette occasion physiquement vulnérable, affrontera ses démons autant que ses adversaires, et pourra éprouver son rapport à sa condition.
C'est en tant que comic book movie que The Wolverine pose problème, précisément là où son projet prétend redorer un blason terni par Brett Ratner et Gavin Hood (et Avi Arad, hein). Adapté (très) librement d'un des story archs les plus populaires des aventures du Wolverine, le film de Mangold semble n'avoir fait que la moitié du chemin pointé par son alléchante note d'intention. Principal élément en cause, les impératifs contradictoires de la politique cinématographique de Marvel, dont on a vu précédemment les effets sur les divers avatars des Avengers. Mangold veut rendre hommage aux 7 Samouraïs et au western classique ? On lui accorde une structure qui y empruntera avec de gros éléments de serial, mais en lui interdisant en contrepartie les meurtres hors légitime défense immédiate (voir ce politicien jeté d'un gratte-ciel, geste promptement lénifié par une coupe le montrant tombé dans une piscine, judicieusement placée en contrebas!). De même, ok pour infliger la perte du facteur de régénération de Logan, mais seulement partiellement et sans le mettre réellement en danger dans ce laps de temps, au point que par exemple ses acrobaties sur le Shinkansen, alors pourtant qu'il est diminué, pourraient avoir lieu au pic de ses capacités sans qu'on voie bien la différence... Et ainsi de suite. Cet état de fait semble de plus être au cœur du script, dans la mesure où le facteur auto-régénérant de Logan, au centre de son voyage au Japon et de ses démêlées avec les autochtones, ne fait l'objet d'aucun suspense réel : plutôt que de créer une attente quant à la perte de ce dernier, le récit ne la révèle qu'une fois avérée, joue avec pendant une bobine (Logan a une ou deux gueules de bois après des grosses bagarres et se coupe en se rasant... Quelle aventure!) puis enterre tranquillement l'incident...
On touche mine de rien au problème fondamental que rencontre le personnage au cinéma : s'il est toujours très bien servi par l'interprétation charismatique de Hugh Jackman (qui est fait pour le rôle), il est systématiquement montré au tiers des capacités de son équivalent papier, en état de faiblesse physique ou psychologique, en aporie constante et surtout sans la sécheresse qui en a fait l'icône qu'il est au sein des X Men. Le Wolverine des comic books est un animal sec et abrupt qui crache des one liners derrière un cigare constamment planté dans sa bouche, et défouraille généralement avant de poser des questions. Pas là pour faire dans le convivial, quoi. Le Logan de pellicule, lui, est parfois pas bien cool parce qu'il a eu des malheurs, le pauvre (et hop, cauchemars et sourcils en accent circonflexe), et une parole gentille ou l'effleurement d'une peau féminine sur sa main le rend invariablement plein de bénignité et de douceur pour les créatures vivantes (sauf les hommes de main, il aime pas trop les hommes de main, qui sont malpolis), qu'il protègera avant de regarder au loin plus ou moins tristement, parce que rappelons-le il a eu des malheurs. Bref, une assistante sociale avec des prothèses en adamantium, ponctuant parfois d'un rare trait d'ironie ses pérégrinations. Ce Logan-ci, disons-le, manque d'animalité, d'agression, de férocité. S'il est bien entendu nettement plus concluant d'un point de vue mythologique qu'Origins, ce Wolverine souffre du même manque d'incarnation et de physicalité que le reste des apparitions du héros. Le choix de Mangold, peut-être plus à l'aise dans une vision plus théorique et fonctionnelle de ses personnages (voir le très beau final pirandellien de Identity), semble confirmer une tendance à ne pas se confronter aux mutants en tant que tels, pour les plier à des schémas - narratifs, mythiques, fonctionnels - qui n'ont finalement que peu de dimension superhéroïque. Si l'impulsion de base de Bryan Singer a permis de faire admettre durablement l'adaptation de comic book comme un genre capable d'aborder des thématiques adultes, ce mouvement est souvent contrebalancé par une négation de l'épisme propre au médium, la notion de splash page se perdant dans les considérations "de proximité" (voir les déconfitures de trois Iron Man).
Ici, ce manque de physicalité donne un déficit d'incarnation assez dérangeant, l'ensemble des notions de caractérisation et de thématiques passant encore une fois (Marvel nous y a habitué) par des dialogues, certains d'ailleurs très bien écrits, comme la définition de Viper par elle-même. Au point qu'on resonge même parfois, avec une pointe d'envie coupable, au charisme animal époustouflant de Liev Schreiber dans l'opus précédent... Pourtant, le film prend toute sa valeur quand il cesse d'avoir le cul entre deux chaises et s'adonne à une chose à la fois : si l'on oublie que tout ceci prend place dans une mythologie X Men, certaines séquences dramatiques, notamment entre Logan et Mariko, donnent lieu à de beaux moments comme sait les faire Mangold. De même, une fois mise de côté la mise en danger presque inexistante du personnage (dont une auto-chirurgie cardiaque à main nue qui ferait passer la scène du medipod de Prometheus pour un documentaire), les scènes d'action à proprement parler font preuve d'une hargne assez bienvenue dont on aimerait voir ce qu'aurait fait un réalisateur non bridé par le classement PG-13 du projet. Certaines coupes abruptes laissent penser qu'un montage unrated se ballade sans doute quelque part... Le bât blesse bien entendu sur le processus qui amène ces scènes, et parmi les influences revendiquées de Mangold pour la caractérisation de son rôle-titre, on se demande souvent s'il n'y a pas le Snake Plisken d'Escape From New York. Comme l'illustre borgne, il est présenté comme un marginal, que l'on envoie sur une île où littéralement il va être un aimant à violences et à coups durs, quitte à n'avoir qu'à se poser pour attendre la prochaine salve lorsqu'il n'a plus d'idée. Cet accolement des statuts de lonesome cowboy et de punching ball humain, n'ayant besoin que d'être dans la pièce pour être pris à partie, à l'avantage d'alimenter un récit (ici ce sont Viper, Harada et le Silver Samouraï qui sont sur le pont, tous sacrifiés dans un dernier acte d'un vain, d'un arbitraire et d'un expéditif délirants) mais a surtout tendance à trivialiser la férocité du Wolverine de la façon exposée plus haut - comment être agressif et sec quand d'autres vous grillent systématiquement la politesse, ne vous laissant le loisir que de vous défendre ?
Du point de vue mythologique donc, ce Wolverine est au mieux anecdotique : on jurerait qu'il n'existe, du point de vue de Marvel, que pour le fameux post-générique avec sa énième promesse de nous donner enfin les Sentinelles (c'est jamais que la quatrième fois qu'on les annonce depuis le Singer), dans un dispositif qui promet un bien bel imbroglio dans la timeline d'ailleurs. Cinématographiquement, on aurait tort de s'arrêter là car Mangold nous offre un bel imagier, émaillé de visions parfois magnifiques (l'immobilisation par les ninjas qui rend enfin son caractère plus grand que nature au récit et au personnage) et qui se permet de développer des idées qu'on n'aurait pas imaginé passer le premier jet de l'adaptation (l'ours, le seppuku). Pour peu transcendant qu'il soit, The Wolverinene doit pourtant pas payer pour un hiatus dont il n'est que l'héritier. Le film qui reste ménage suffisamment de beau moments pour faire oublier certains rendez-vous manqués (on parle de toi World War Z). En espérant qu'un montage plus radical redresse un peu le nez de l'appareil en vidéo.
Star trek into darkness
Synthèse de la carrière paradoxale de JJ Abrams en même temps qu'il marque son apogée formelle, Star Trek Into Darkness se montre à la fois un blockbuster concluant et un objet filmique frustrant, qui rate son but proclamé au cœur même de ses réussites.
NB : le film étant sur les écrans depuis quelques jours, on se permet ici de ne pas le pitcher à nouveau, et de spoiler parfois certains faits de l'intrigue pour servir l'analyse. Il est préférable d'avoir vu le film, ou lu la critique d'Eric Nuevo, avant de lire ce papier.
La série télévisée n'est pas qu’un art mineur. Si cet état de fait n'est plus contesté depuis une quinzaine d'années, à l’aune de séries lancées à grands renforts de com et de surenchère de valeur ajoutée (merci HBO et Showtime), il est bien entendu plus ancien, et date clairement des années 60 et 70, où fleurirent des Prisonner, Avengers... Ou Star Trek Classic. Longtemps (et même encore aujourd'hui) frappée d'un mépris de mauvais aloi dans nos contrées, Star Trek et ses diverses itérations (Next Generation et DS 9 surtout) ont pourtant posé des jalons esthétiques et thématiques d'une exigence incontestable : politique-fiction, spéculation scientifique et philosophique, mise en perspective anthropologique (et accessoirement, le premier baiser interracial diffusé en télévision...), représentation convaincante de principes physiques nébuleux, sens de l'inconnu et de l'altérité. Autrement dit, la science-fiction en tant que genre d’écriture doit certains de ses quartiers de noblesse à la télévision. Or la SF revient comme une tendance lourde dans les préoccupations de l'époque - de nos débats bioéthiques et sociétaux aux grosses sorties cinématographiques des studios de ces dernières années. De même avec l’entrisme du télévisuel dans les salles obscures, via l’intervention des chaînes dans les financements, l’invasion de producteurs, réalisateurs et scénaristes de télé sur des projets classés A, ou le portage pur et simple de programmes télé sur grand écran.
Ceci dit, la télévision n’est pas le cinéma, elle constitue même à certains égard son opposé, en termes d’ambitions esthétiques et d’écriture séquentielle (arcs narratifs, évolutions de personnages, impossibilité virtuelle de fermer totalement un élément scénaristique donné). C’est là que se pose le problème de Abrams : bien que mené par des ambitions cinématographiques, il fonctionne en majeure partie comme un téléaste. La facture de son précédent Star Trek, et plus encore de celui qui nous intéresse ici, se ressentent de cet équilibre bancal. Basé sur une culture certaine de la mythologie trekkienne (personnages issus d’épisodes obscurs, caractérisation faisant la nique aux personnages originaux), le film de 2009 se montrait désordonné dans sa volonté d’avoir l’air cinématographique dans la forme, alors que le fond était strictement d’ordre télévisuel : à l’inflation de flare (qu'il conçoit moins comme affèterie de style que comme "preuve" de l’utilisation de pellicule en format anamorphique) répondaient mal des procédés de serial très en vogue chez le showrunner de Lost et Fringe, à commencer par l’astuce des univers parallèles, procédé aussi tarte-à-la-crème en télé des années 2000, que l’amnésie subite de personnage ou l’épisode métatextuel dans les 80's. De fait, Star Trek et sa suite sont plus conçus comme des pilotes de saisons que comme des récits de cinéma, en particulier au niveau de l'écriture. La caractérisation est ainsi basée sur le principe d'une identité brossée à quelques gros traits (Spock est en retrait émotionnel mais un peu sensible quand même, Kirk est une tête brûlée avec sens du devoir, Mc Coy est bourru mais sympa, etc.), et l'enchainement des péripéties se garde bien de résoudre l'arc narratif principal, qu'on a soin de rebalancer aux prochaines calendes à la faveur d'épilogues en forme de cliffhanger.
A cela s'ajoute un découpage très télévisuel (quel goût pour les dialogues en champ/contrechamp!) et surtout une construction séquentielle strictement binaire qui annule ses révélations à mesure qu'elle les met en place. Ainsi, le progrès d'Abrams sur ses séquences d'action pure (encore un brin surdécoupées, et retrouvant elles aussi régulièrement une forme champ/contrechamp dans les moments cruciaux, alors que leur mise en place est souvent joliment ample) ne parvient pas à cacher le "syndrome Abrams/Lindelof" : une écriture dilettante, avec des idées jetées au petit bonheur la chance et justifiées a posteriori par un twist qui ramasse les débris qu'on aura ainsi laissé trainer, et surtout structurée autour de tunnels de dialogues. Ici, les fameuses scènes d'action à grand spectacle, par ailleurs très agréables à suivre et bénéficiant d'une 3D impeccable (voir la séquence sur Kronos), sont pourtant parfaitement dénuées d'enjeu, dans la mesure où celles-ci sont systématiquement déconnectées de la trame principale et ne font jamais avancer le récit au sein de leur déroulement propre. Leur signification est toujours élucidée par un dialogue introductif (l'attaque de Starfleet) ou par un débriefing extensif (les dialogues autour des exactions de Khan et de la façon de les contrecarrer, culminant dans une conversation TELEPHONIQUE avec Scotty !). Peu importe, alors, ce qui advient effectivement dans ces séquences, que l'on détruise la moitié d'une ville, qu'on démastique des klingons fort laids d'un revers de la main, ou qu'on singe les jeux vidéos les plus marquants des dernières années (Beat-em up/plateformes à la Star Wars Force Unleashed, vol anaérobie à la Dead Space...), puisque la validation de ces actions se fera uniquement par les dialogues. Ainsi, par exemple, de la séquence d'ouverture raccrochée plus ou moins au reste par une évocation de la directive première de Starfleet.
On se retrouve devant un spectacle qui oscille entre un dynamisme très plaisant mais un peu creux et de la radio filmée, Abrams peinant de surcroît à cadrer plus large que le plan moyen. Bref, c'est de la télé en scope. Logique alors que la majeure part du plaisir ressenti à sa vision soit, comme pour une série, délivrée par le cast, avec toutefois le danger inhérent à l'exercice : éclipser les personnages récurrents avec le nouveau venu qui crève l'écran. C'est Spock, et son nouvel interprète Zach Quinto, qui pâtit le plus de l'arrivée de Cumberbatch en Khan. Difficile en effet de tenir deux rounds face à un acteur aussi magnétique, sans compter que, là encore, la caractérisation prend elle aussi parti, dans la mesure où les personnages récurrents voient leur caractérisation coudée de force en milieu de récit afin d'induire artificiellement le sentiment d'une évolution (pratique encore une fois courante en série télé : ici, Kirk deviendra humble, Spock apprendra à hurler, taper des gens et mentir, McCoy fera de l'humour...), alors que Khan jouit quant à lui d'une cohérence qui confirme son charisme et son assise dramatique.
Et c'est par ce traitement ouvertement télévisuel que le bât, finalement, blesse le plus. A priori, ce traitement télévisuel d'une mythologie télévisuelle devrait lui rendre justice, au moins dans la lettre. Mais de fait, la philosophie trekkie est de plus en plus niée au fil des films. En cause par exemple un échange entre les deux versions de Spock quant à la nature même de Khan, qui finit par dire que quelque soit l'univers alternatif d'où est issu un personnage, son caractère profond reste identique, et qu'il doit par conséquent être traité de la même manière. Une hérédité de caractères qui interroge gravement le propos entier du film. Si les épisodes dans des univers parallèles sont fréquents dans les séries Star Trek, ils montrent précisément des personnages radicalement différents dans des circonstances radicalement différentes, interrogeant ainsi le bien fondé des choix de leurs pendants alternatifs, de leurs peuples ou de leurs alliances (voir DS 9 et sa seconde Terok Nor, et en particulier le rôle qu'y joue "l'autre" Kira). Plus tard dans le film, le vieux Spock enfreindra l'autre directive fondamentale de Starfleet en influant de sa propre initiative sur le passé... Soit, déjà, une double négation des principes de base de la science fiction humaniste envisagée par Gene Roddenberry.
Il n'est, à vrai dire, pas fait grand cas de Star Trek en tant que saga de science fiction : on est strictement en face d'un blockbuster futuriste, doté d'un folklore technologique - en aucun cas il ne s'agit de SF. La réflexion métaphysique, les considérations quant à l'évolution de l'homme vis-à-vis de l'altérité, et même les spéculations scientifiques, sont purement et simplement étrangères à l'univers dépeint, puisque la technologie suffit : il suffit d'avoir une machine particulière, ou une explication pratique à un phénomène, pour résoudre tout souci qu'on rencontre face au monde. Il est loin, l'Inconnu comme force motrice de la marche de l'humanité ! Puisqu'on a le rapprochement via des références communes, on n'a pas besoin de penser plus haut ou plus loin que soi (oh, ce triste adoubement de Tchekov par Scotty...). Là où la valeur de Star Trek était justement de confronter des cultures foncièrement différentes, et d'observer des personnages apprenant de ces frictions, Abrams prétend que le salut se trouve précisément dans le gommage systématique de ces différences et non dans l'accommodation de chacun à celles-ci. Cet idéal est bien entendu le reflet de celui que prônent les auteurs pour leur relation avec le public, via des citations remaniées des séries originales ou de certains films (Wrath of Khan principalement bien sûr), sensées créer ipso facto la connivence et l'adhésion. Le procédé aboutit à un traitement qui apparaît parodique, irrespectueux même, tant on se croirait parfois devant des vannes de conventions, qu'on pourrait entendre dans un épisode de Big Bang Theory. Le cri de Spock, à ce titre, vaut son pesant de laque à cheveux de Ricardo Montalban... Pas sûr que, trekkie ou novice, le spectateur y trouve son compte s'il cherche effectivement à s'aérer le neurone à SF. Reste que ça bouge, c'est joli (à part les klingons bon sang!), globalement bien joué et bon enfant, tout en jouant sur le spectacle... Et l'esbroufe technique, dans le visuel ou le scénario, suffit manifestement à beaucoup de spectateurs pour leurs divertissements estivaux. D'autres attendent plus de l'itération censément révolutionnaire d'une saga aussi fondamentale.
Oz the Great and Powerful - Sam Raimi
Après un Drag me to Hell qui décevait par son conservatisme, et ses productions où l'on avait du mal à retrouver sa passion des premiers temps, Sam Raimi passe chez Disney pour une préquelle au classique de Victor Fleming. Entre les contraintes délirantes de la firme aux oreilles et son statut de nabab, il parvient contre toute attente à convaincre en subvertissant le projet, et de quelle manière.
Magicien de cirque itinérant et petit mystificateur minable, Oscar Diggs alias Oz le Fantastique fuit sa vie étriquée à la faveur d'une tornade. Il se retrouve dans un autre monde, pittoresque, étrange et peuplé de fééries, pour apprendre qu'il en est une sorte de messie qui doit libérer le pays du joug de la mauvaise sorcière qui le terrifie, pour finalement y régner en tant que (véritable) sorcier. Se servant d'abord de sa rouerie pour des avantages immédiats, et créant ou renforçant ses Némésis au passage, il devra apprendre à l'utiliser ce penchant pour la tromperie pour accomplir sa destinée.
A première vue, on avait tout à craindre de ce projet, et encore plus de la présence sur celui-ci de Raimi, demi-dieu du geekisme à qui on prédisait déjà, à cette occasion, l'accomplissement d'une destinée à la Tim Burton : un ancien phare des imaginaires indomptés, jadis héraut d'une certaine idée de la déviance sous-culturelle, recyclant ses motifs et ses thèmes sous des formes lénifiées, vidées de leur sens, pour l'adoubement dont l'en paieraient ses geôliers en costard. La bannière Disney, les bandes-annonces et visuels promo vomissant de couleurs criardes, la 3D comme argument de vente et l'orientation enfantine du film faisaient froid dans le dos. Et bien sûr son sacrifice à la mode du remake/reboot/préquelle/raclage de fond de Tupperware, qui tient toujours lieu de bas-de-laine autour de Burbank... Sam Raimi, dont la dernière décennie exhalait d'inquiétants effluves de renoncement (Spiderman 2 c'était déjà il y a 9 ans), semblait alors finir de gagner ses galons de fonctionnaire au prix du reniement le plus complet, comme dans la jolie chanson de Blair. Etrangement, c'est dans cet écrin parmi les moins alléchants, que Raimi parvient à retrouver toute sa crédibilité tant technique que thématique, et à marquer son vrai retour au contraire de Drag me to Hell, qui ne parvenait qu'à singer l'image et les gimmicks d'une vieille image du cinéaste, sans jamais retrouver la substance de ce qu'il avait accompli. Qui eut cru qu'au cœur du nadir cynique de l'entertainment entrepreneurial de masse, un artisan sincère et virtuose sonnerait le grand retour de son idiome, jetant le voile sur ses tractations passées tout en remplissant en apparence le contrat qu'il a signé de livrer un "film pour la famille"?
C'est précisément autour des horreurs disneyennes, imposées par le studio de manière évidente, que Raimi se love et mène à bien le dessein d'enfoncer à nouveau le clou de son propos et de sa vocation première. De fait, les quelques problèmes du film sont tous issus des habitudes de la marque : accès de mièvrerie malvenus, direction artistique bariolée et peu cohérente, morceaux de séquences au crétinisme tayloriste (la fée aquatique), environnements posés à la va-comme-je-te-pousse à la suite les uns des autres, costumes et lumières de téléfilm Disney Chanel (fichtre, cette horrible place du village). Système Disney oblige, la palanquée de noms prestigieux au casting livre des performances plus ou moins habitées, comme Raquel Weisz venue cachetonner et qui manifestement s'embête beaucoup sur le plateau. D'autres scories viennent directement du souci de jeter des ponts avec le film de 1939 : ainsi, à trop chercher le raccord avec celui de l'original, le maquillage de la Wicked Witch circa 2013, affreusement lisse et uni, paraît techniquement moins abouti que son prédécesseur, pourtant plus vieux de trois quarts de siècle...
Mais le projet de Raimi est tout autre. Il est semble-t-il tout à fait conscient du paradoxe apparent qui le bouffe : à savoir son odeur de sainteté à Hollywood parmi les décideurs, chèrement acquise car assortie d'un certain déficit d'image vis-à-vis de son identité d'artisan - quinze années de production télé lucrative, puis de productions ciné pas toujours heureuses en termes qualitatifs (à part 30 Days of Night, pas grand-chose à manger), ont un peu grevé la sympathie que l'on vouait à l'auteur de Darkman. Parallèlement, les deux premiers Spiderman (le second surtout) étaient une confirmation de l'identité profonde de ce qu'il faut bien appeler, n'en déplaise, un auteur à part entière. Les luttes pied à pied avec les exécutifs sur Spiderman 3 (notamment l'imposition de Venom) l'auront poussé, après avoir bazardé la franchise, à se refaire une virginité auprès de sa base : les "geeks" désormais consacrés en tant que marché, avec le bénéfice cinématographique qu'on sait pour les œuvres issues de l'imaginaire populaire. Drag me to Hell fut cette tentative de montrer patte blanche aux fans en leur présentant le visage de Raimi qu'ils reconnaissent le plus volontiers, mais qui n’en est qu’un reflet très fragmentaire : celui du faiseur de "petits" films d’horreur au dynamisme patent. Logiquement, ce projet trop parcellaire, doublé d’un traitement assez conservateur, peinait à convaincre, car Sam Raimi est bien plus qu’un réa qui secoue sa caméra (et/ou Bruce Campbell) avec virtuosité. Il est à ranger aux côtés de Spielberg, Cameron, Del Toro, Jackson mais aussi Méliès, Kubrick ou Walt Disney justement, c’est-à-dire qu’il fait partie de ces auteurs-artisans (et encore une fois, les deux mots sont importants) dont le travail thématique est porté par une réflexion constante sur la technologie même qui sous-tend le medium, conjointement à une croyance totale en la toute-puissance du message cinématographique. Et c’est ce discours entre tous que Raimi choisit d’embrasser à nouveau, à travers une personnalité (Oz) et un univers à la fois issu de l’imaginaire de celui-ci et prévalent à son arrivée, où les paradigmes magie/technologie et mensonge/vérité s’inversent d’abord (la technologie du monde réel acquiert le statut de magie dans les contrées d’Oz – voir la très belle séquence du pot de colle), pour finalement se révéler interchangeables en fonction du contexte par un seul catalyseur : la foi. C'est ainsi que Raimi reprend son discours, généreusement saupoudré dans une bonne partie de son œuvre, prônant le fait que technique, magie et bricolage pur et simple, animés par la passion et la croyance dans son propre art, créent de fait des mondes et les conditions de leurs victoires sur les réticences de quiconque les arpente. Bref il expose sa propre foi, celle qu'il a toujours (et cette confirmation fait chaud au cœur) dans le cinématographe et ses émerveillements.
C'est bien en cela que Sam Raimi, s'il semble à l'occasion de Oz se rouler dans les mêmes compromissions dans la grande finance cynique que l'a fait Tim Burton depuis plus d'une décade, réaffirme au contraire son identité propre plutôt que de la renier pour se faire accepter, de renoncements en auto-plagiats (voir entre autres le Alice de Burton, justement). Au point de tacler à plusieurs reprises les marques de fabrique de Disney (voir la façon dont le début de chanson des munchkins est coupé et refusé par Oz lui-même, alter-ego évident du cinéaste), mais surtout de livrer en contrebande un véritable remake déguisé de Evil Dead 3 - Army of Darkness ! Surprenant de prime abord, ce mouvement tendrait à rassurer sur ce qu'on pouvait jusque là prendre pour de l'embourgeoisement. A-t-il vu dans cet interim chez Mickey l'occasion d'oublier la frustration du budget anémié d'Evil Dead 3, ridicule à l'époque en regard de ses ambitions? Ou as-t-il décidé de faire un pied de nez aux méprisants plénipotentiaires des studios au moment où ceux-ci, croyant l'avoir définitivement harnaché, l'adoubent enfin comme un des leurs? C'est en fait assez secondaire. Le remake, lui, pour être officieux, n'en est pas moins patent : ce sont des séquences entières d'Army of Darkness qui sont d'abord recréées, des décors ou des éléments narratifs repris tels quels.
On verra ainsi le même cimetière, le même brandissement de livres du vingtième siècle dans un temps qui n'en connait pas les technologies, un même surgissement de deadite dans la même position révélatrice (les mains crochues encadrant le visage), un personnage féminin emporté loin d'un château par un monstre volant, une armée de non-humains marchant sur les remparts du même château, une amante revenant en Némésis, un véhicule customisé qui en met plein la vue dans la bataille... Ainsi que pas mal de moments où la mise en scène émule directement son modèle, en reprenant le dynamisme et les gags à la Tex Avery bien connu des éxégètes, pour changer James Franco - excellent - en simili-Ash. Mais ce travail ne se borne pas à la reprise de motifs, car c'est bel et bien le récit lui-même qui reprend le thème et la structure de son modèle. On y voit, comme dans le film de 1993, un gars ordinaire du vingtième siècle américain se retrouver dans un monde exotique où il est précipité par un vortex, après avoir mal évalué son usage du surnaturel. Ce mouvement prend dans les deux cas la forme d'un prologue clairement détaché du reste du métrage, par la voix off dans l'un, et via le jeu sur le format du cadre et le sépia (dans le but également, pour Raimi, de rendre un hommage sincère au prologue du Oz de 1939, et avec pour résultat les séquences les plus poétiques du film), mais aussi celui sur la 3D avec l'évasion de certains élément hors des bords du 1.33, qui affirme bien que le "monde réel" est un monde étriqué, où la magie n'a pas droit de cité car la parole y est cacophonique. Une fois dans ce monde, le héros joue de son anachronisme et de son charisme avec désinvolture, apprend de ses maladresses et de ses fautes, séduit une femme qui se retournera contre lui, génère un alter-ego qui sera son pire ennemi, pour enfin embrasser son statut messianique en boutant le mal hors de ce pays magique, ce qu'il fait par la ruse et l'usage de la science au profit du camp qui l'a choisi. Ce faisant, il change en force héroïque ce qui lui a causé en premier lieu ses malheurs. A la fin, il a admis à la fois ce changement de paradigme et son statut de protecteur, par les moyens de son action, et s'en sert avec aisance, l'évolution n'étant pas dans le changement des actions mais dans celui d'état d'esprit.
Bien entendu, on est chez Disney, et ces éléments ne sont pas assortis du même folklore, puisque pas utilisés dans le même genre. Mais bien simpliste l'analyse qui lira le fourvoiement dans la seule absence d'effets choc ou de traitement horrifique. L'éthique et le discours de Raimi ont toujours été autre chose que le trash qui n'en est que l'un des moyens. Il signe ici, de façon détournée, camouflée, son Hugo Cabret à lui, dans la mesure où l'histoire qu'il raconte est celle de la toute puissance du cinéma : Oz crée la magie (et devient de fait magicien) par le truchement d'un système qui n'est littéralement que fumée et miroirs, bricolé avec amour et assorti d'effets spéciaux, pour atteindre la suspension d'incrédulité qui enrichit le monde de nouvelles conséquences concrètes. Raimi nous affirme, simplement, que le cinéma est du verbe incarné, et que ça ne se prend pas à la légère, car la foi (au sens large du terme) est pour lui le moteur du monde. La sincérité avec laquelle il assène ce discours, avec la malice de le faire passer à la barbe du cynisme omnipotent de Disney, à de quoi frapper par sa cohérence avec le reste de son oeuvre.
Maniac
Capillotracté
Frank Zito résout à la dure son Oedipe en traquant des femmes pour les tuer et agrafer leurs scalps sur des mannequins de vitrines qu'il conserve chez lui. Un jour, il tombe amoureux et sa situation se complique.
Dans notre contexte de post-ante-post-postmoderniste (au moins!), où les factions se créent autour de souvenirs et d'imageries issues d'un quelconque passé donné pour nécessairement glorieux, la démarche de Maniac interroge une fois de plus l'idée du souvenir, du statut, et de la place des qualités intrinsèques des œuvres à l'aune de ces deux élément.
A New York, Time Square et la 42ème rue ont été définitivement ripolinées par l'administration Giuliani et le post 9/11. Adieu au quartier malfamé des 70's et 80's, cloaque sombre et dangereux, réceptacle de toutes sortes de miséreux agressifs. Adieu par la même occasion aux salles interlopes de cinoche d'exploitation, gore ou x, et au vivier de films tarés et incarnés qui y fleurissaient. De cette époque, ne reste peu ou prou qu'un Henenlotter esseulé mais toujours vert (voir son clip pour R.A. the Rugged Man). Muro a pété les plombs, Lustig vaguement périclité (mais édite désormais de bien beaux dvd)... Conséquence logique de cette perte (car comme l'a dit l'autre, "plus tu t'éloignes et plus ton ombre s'agrandit"), quelques uns se réclament de cet esprit hardcore et psychotronique "de la 42ème", comme d'autres s'emparèrent il y a peu du label "grindhouse" jusqu'à le mutiler au point de le rendre stérile. Le mythe de l'Age d'Or se porte toujours beau, dans le domaine de la déviance pelliculée comme ailleurs : interdiction dorénavant de toucher aux reliques filmiques du temple, désormais ointes de l'huile qui fait d'elles des chefs-d'œuvre méconnus du cinématographe à ranger entre Tarkovski et Carpenter. Ce qui apparaît tout de même comme une légère exagération. Dans le cas de Maniac, et de ce remake qui nous arrive des efforts du consortium Aja/Levasseur, on peut à ce titre pointer quelques faits tout cons.
Le statut du Maniac de 1980 est indiscutable, tant en termes de mythe (sa réputation parmi ceux qui ne l'ont pas vu est comparable à celle de Texas Chainsaw Massacre) que d'empreinte effective (le film frappe l'imaginaire de façon indélébile). Son ambiance craspec et sans espoir, sa photo granuleuse, ses crises meurtrières brutales et nauséeuses, sa noirceur et son lyrisme. Et bien entendu Joe Spinell, le cœur et l'âme de l'histoire de Frank Zito (l'idée originale de Maniac est de lui), dont il domine l'ensemble de sa terrifiante carrure, sous des yeux d'une tristesse infinie. Maniac est néanmoins considéré à tort comme seulement le sommet du shocker movie, ce qu'il n'est qu'en partie. Œuvre intrinsèquement sensitive, appuyée par la mise en scène faussement simpliste de Lustig (cf le double meurtre sous le pont), Maniac ne s'envisage presque que par la menace physique et la vulnérabilité qu'y met Spinell. L'écriture, elle, est beaucoup plus problématique, notamment au niveau de l'enchainement et de la justification des péripéties entre Zito et Anna, laborieux, abrupts et globalement incrédibles. On peut aussi, certes selon ses goûts, questionner la manière très dirigiste et démonstrative dont les traumas de Zito y sont évoqués : tantôt avec subtilité (les cicatrices et le petit mannequin), tantôt un peu lourdingues (l'apparition "Carrie au bal du Diable" dans le cimetière), ces évocations ne font que se superposer aux soliloques de Frank, autrement troublants et consistants.
C'est sur cette ligne que l'existence du Maniac de Khalfoun se justifie et le distingue in extremis de la vague monstrueuse de remakes opportunistes, paresseux et contreproductifs (c'est-à-dire : à la mode) qui fleurissent depuis un bon lustre. Le fait est que parmi les très rares remakes à avoir un intérêt dans ladite vague, Hills have Eyes et Piranha 3D figurent en bonne place, pour une raison étrangère au tout-venant de l'exercice : les zigues se lèvent le cul pour pousser la logique des originaux et leur faire cracher leur potentiel, en en améliorant les aspects qui en ont besoin tout en ayant compris leur essence. La cinéphilie qui sous-tend la démarche, pour être par définition relativement vaine (car consistant en une construction intellectuelle sur une base strictement virtuelle), n'en est pas moins d'une sincérité indéniable, et souvent intelligemment cornaquée car sans atermoiements sur ses aspects graphiques. C'est ainsi que beaucoup des partis-pris du présent film séduisent par leur pertinence, tant technique que thématique.
En particulier, l'écriture séquentielle est bien plus équilibrée et ramassée, et gagne énormément en cohérence narrative : l'arrivée moins tardive d'Anna dans le récit permet de mieux graduer la relation qu'elle instaure avec Zito, mais surtout d'accélérer mécaniquement l'enchainement arc narratif / tueries par un rythme proche du montage en parallèle. De fait, d'un point de vue thématique, le film en sort fluidifié et plus crédible dans son déroulement. Il est notamment très intéressant, alors que dans l'original Zito était présenté comme éjaculateur précoce et affublé d'une mère prostituée qui le battait, de suggérer ici plutôt une impuissance, due à la "simple" négligence d'une génitrice junkie et nymphomane. Le ressentiment de Zito, et la forme qu'il prend, s'en trouvent crédibilisés et gagnent en force : son trouble résulte alors d'avoir été posé littéralement en eunuque face à sa propre vie.
L'idée de la caméra subjective est plus discutable, en cela qu'elle révèle in fine l'artificialité du projet. En effet, le procédé permet de rendre très (trop?) clairement le délire dissociatif de Zito par divers artifices, comme des points de montage a priori incongrus, ou l'entretoisement dans le "réel" de phases à la troisième personne (souvenirs, moments de climax lors des meurtres), voire d'instants proprement hallucinatoires comme le moment de transitivisme dans le resto ou les passages du vivant au mannequin et inversement. Cependant, ce processus concluant en première lecture revient à forcer l'empathie avec Zito : sommé de compatir au plus vite avec le protagoniste, le spectateur rechigne naturellement à le faire pour finalement avoir une lecture globalement distanciée de l'action, ne sortant jamais du postulat hypothétique posé au départ ("alors on dirait que c'était toi Frank Zito"). C'est alors l'ensemble de la démarche qui apparaît comme artificielle puisqu'au lieu de poser un pacte de communication avec le spectateur (la suspension d'incrédulité n'existe que consentie), le film cherche à abuser celui-ci en misant sur des réponses-réflexes. Sans compter que les signes d'intelligence (dans les deux sens du mot) jetés régulièrement à la face de la caméra réduisent de façon drastique l'impact émotionnel et sensitif du métrage - voir par exemple le Good Bye Horses de Q Lazzarus, coup de coude référentiel pataud et méprisant (certes, le traitement de Buffalo Bill dans le film de Demme doit entre autres beaucoup à Frank Zito), en plus de rappeler autant Clerks 2 que Silence of the Lambs... Et la salle de ricaner. Les citations, trop pince-sans-rire, et la DA, surlignant inutilement l'action (putain, l'expo dans la galerie) se retrouvent de fait à avoir l'air de singer platement une idée des années 80 que se feraient les instigateurs du projet : là un reflet dans une carrosserie qui reprend l'affiche de l'original, ici une description du physique de Spinell, et encore là l'appareil photo troooop vintage de la hipster insupportable qu'est devenue Anna. Jusqu'au contremploi d'Elijah Wood, mis en avant avec trop de jubilation pour apparaître, au final, bien honnête : pourtant, il faut reconnaître qu'outre le fait qu'il a des burnes en marbre (passer derrière Joe Spinell sur un rôle aussi compliqué, l'angoisse), l'interprétation de Wood est sans doute la grande réussite du film. S'il ne parvient jamais à faire oublier la constante menace qui émanait de son prédécesseur (on parle de Spinell quand même), Wood parvient, mais toujours dans les séquences anodines comme le coup de fil de la fin, à être réellement glaçant. Paradoxe pour un schocker movie : les meurtres eux-mêmes, pourtant efficacement emballés et servis par des trucages saisissants, ne font que tomber dans une veine parodique de Grand-Guignol, tant par leur élaboration alambiquée que par leur démonstrativité. Pourquoi diable, alors qu'on crie sur les toits sa volonté d'émuler une ambiance malsaine et oppressante, rendre ludiques les actes de violence sensés la propulser ? Le premier meurtre, ainsi, est carrément grotesque, avec une mutilation qui aurait plutôt eu sa place dans Piranha 3D. Un seul meurtre provoque finalement un semblant de trouble, et sans surprise il s'agit du plus crédible, celui du parking, parce qu'il est SIMPLE et qu'il n'est pas parasité par le sourire en coin de l'équipe (cf la bande son sur l'étranglement de l'adorable rousse). De fait, voilà le gros écueil sur lequel s'est jeté le film de Khalfoun : son manque d'incarnation, d'où découle son absence de malaise. Quand on voit ce que Friedkin, définitivement revenu d'entre les morts, parvient à faire la même année avec une simple cuisse de poulet frit, on déchante.
Le soucis est d'ordre socio-culturel, et il est hélas structurel : les parties en présence n'ont aucun ancrage dans ce monde réel et déplaisant des très petites gens qu'ils prétendent autopsier ici. Aja (fiston d'Arcady), Langmann (rejeton de Berri), et Levasseur dans une moindre mesure (disons que son choix d'ami d'enfance a été judicieux), mènent depuis plus longtemps qu'ils ne s'en souviennent des vies qu'on qualifiera de protégées en raison de facteurs socio-économiques disons très favorables. Si leur sincérité est patente, si leurs désirs de cinéma ont une réelle noblesse voire un courage qu'il convient de saluer, leur culture du vrai monde des vraies gens est pour le moins discutable. Si les films précédents du duo Aja/Levasseur se sont avérés concluants, c'est précisément parce qu'ils restaient dans leur champ d'expertise thématique : cinéphilie, désir d'une Amérique cinématographique fantasmée dans les 80's et 90's, champs référentiels exigeants, refus du chemin thématique recommandé par le milieu germanopratin. Sauf que Maniac, c'est une autre bière que des délires d'ados sur des VHS de Dante et Craven (ce n'est pas péjoratif, j'ai le même type de délires d'ado et je vous emmerde). Le fait que les zigues aient excellé dans des projets qui tenaient de l'abstrait (films construits comme des rides, plantés sur des fondations purement cinéphiliques), s'il les limite, ne les rend pas illégitimes dans leur taf. Il y a simplement des objets qui se prêtent à ce genre d'abstractions "légères", et d'autres qui se rebiffent.
Encore une fois, ce n'est pas tant se frotter à Lustig qui était périlleux, mais s'attaquer à Spinell, qui exsudait l'incarnation par tous les pores : voilà qui requiert un sens du "réel" qui ne s'improvise pas, même dans une logique postmoderne. Au vu du nom du site de rencontres de ce Maniac 2012 (Cupid's Rejects), les mecs connaissent Rob Zombie, mais ne l'ont pas nécessairement compris en termes de contenu - on reverra les making of de ses films pour se souvenir que ce genre de thématiques ne s'investit pas à la légère, et que la street culture ne suffit pas à faire une streed crèd. Autrement dit, quand les gosses de riches se piquent de réalité sociale, la bouffonnerie est souvent au coin de la rue. Ce trait se retrouve dans la caractérisation même des personnages, en particulier Anna qui devient une hipsteuse à baffer, sortie d'études de beaux arts, fréquentant un microcosme de pubs ambulantes pour le retour de Robespierre, et friendzonnant tout ce qui se trouve à portée de battements de cils. A ce propos, l'adjonction du méchant petit ami est parfaitement vaine, uniquement là pour forcer un peu pus l'empathie avec Frank, dont le soliloque permanent finit lui-même par rembrunir. Quoi qu'il en soit, cette caractérisation est symptomatique de l'imaginaire typologique des rapports humains qu'ont nos petits amis aux manettes : au-delà du Périph', il y a L.A., mais entre les deux, on sait pas trop ce qu'il y a (remember Maïwen dans Haute Tension?). Il n'est pas question de fustiger d'hypothétiques légions de nantis - leur présence et leurs travaux sont légitimes dans l'industrie qui nous intéresse. Il ya des contextes, toutefois, où il est inutile de se balader en Berlutti... Ou en Reebok vintage en édition limitée. Passque là, on serait presque pas surpris de voir débarquer les BB Brune pour un caméo.
Peut-être qu'avec effectivement Aja et/ou Levasseur derrière la caméra, le résultat eut été différent : la foi incroyable qu'ils ont dans leurs sujets et surtout dans le medium cinéma sublime leurs efforts, même dans les élans de puérilité qui les traversent. La grosse erreur, c'était sans doute de cumuler un film à l'identité trop sérieuse pour eux, et de mettre à ses commandes le réa de P2, clairement trop propret et pas assez ambitieux pour la tâche. Sous la houlette de Aja/Levasseur (comme cela était d'ailleurs prévu à la base, le film devant être le premier long de Levasseur, et celui-ci étant hostile au tout-caméra subjective), on aurait peut-être eu un film un peu plus crasseux, un peu plus malsain, ou alors carrément plus ludique. En tous cas on aurait eu sous les yeux un objet doté de plus d'aspérités zarbi, ou d'un commentaire plus féroce. Si ici, tout semble prétexte (à commencer par les deux-trois plans de psychotiques clochardisés au début, reflets de la réalité sociale de Downtown L.A.), c'est sans doute à cause d'un modèle de prod qui ne permet pas au film d'être plus que la somme de ses parties, parties qui ne comprennent pas, au sens fort, l'essence profonde de ce qu'elles cherchent à émuler (voir par exemple la photographie, d'une propreté désolante malgré l'inflation d'effets de lentilles...).
On peut toujours prendre cette itération de Maniac comme un addendum à l'original, une variation sur le thème, un peu sur le mode médiéval où un même texte se voyait attribuer des variantes locales ou temporelles, voire des versions au tons radicalement différents les une des autres. En soi, le film ne manque pas de qualités, mais alors pourquoi ne pas avoir bu la coupe jusqu'à la lie et fait un film original, plus affranchi de l'ombre géante de Joe Spinell ? Cet hommage, trop servile dans la lettre et trop éloigné dans le propos, laisse en l'état une impression de gâchis qui minimise sa valeur réelle.
fl
Videogame wasteland ?
-Historiette d'un médium en forme de générique de Soleil Vert.
Moyennant quelques sautes d'humeur et découragements quant à l'espèce occidentale, ainsi que le lâcher de quelques grommellements sombres en passant par le salon où piaille une quelconque chaîne info, il est très intéressant d'observer les pubs Nintendo de ces dernières années. Pas tant pour les produits qu’elles vantent que pour ce qu’elles disent effectivement de leur public-cible.
La construction des spots est rodée : dans des intérieurs tout à fait stepfordisés, une gentille personne tout à fait stepfordisée (ou un groupe de figurants de saison 10 de Friends, dans le cas de pubs pour la Wii) prend un peu de temps sur sa journée de loisirs CSP+ tout à fait stepfordisée, histoire de casualgamer un brin sur une quelconque itération de Mario ("maintenant avec pilote automatique et vies illimitées !"), un party game de type tapis d’éveil pour adultes, ou un puzzle en flash indigne d’ArmorGames. Le jeu lui-même vanté par le spot est réduit, en termes de temps à l’image, à une portion plus que congrue : dans les meilleurs cas, la moitié de celui-ci, plus souvent trois plans brefs abondamment paraphrasés par le prescripteur aux commandes. Le discours ainsi entendu emploie force "ahh, c'est trop bien !" et autres "ohhh Mario-Tanuki, trop mignooonn " (sic), lorsqu’on ne met pas en scène des gages donnés IRL entre les joueurs (faire des pompes, se déguiser dans la rue) comme dans un quelconque bizutage ou stage BAFA, l’alcoolisation massive en moins. La console et le jeu qu’elle fait tourner, à ce moment-là, n’ont au sens premier plus de fonction et sont relégués au packshot. Le message est clair : le jeu en tant que jeu est au mieux secondaire, il s'agit avant tout de flatter mon narcissisme infantile ; celui-là même qu'aiguillonne une époque toute de personal brandings aussi permanents qu'approximatifs sur des réseaux sociaux (peu) variés, et de starisations sur le futile télé-réalistique. Quant au jeu en tant que médium ou simplement comme bien culturel, il est carrément nié. Cette manière de présenter le jeu vidéo en tant que pratique culturelle est symptomatique de la vision contemporaine du médium, et de la façon dont celle-ci s'intègre dans les injonctions générales de l'époque. Elle éclaire donc aussi sur lesdites injonctions.
Bien entendu, le jeu vidéo ne se définit pas uniquement par le prisme du média narratif. A part comme fable édifiante très simple (ne nous apprennent-ils pas que les succès disparaissent tandis que les échecs s’accumulent ?), Tetris ou Pacman ne racontent à peu près rien (les cutscenes sommaires après certains highscore, on va dire que ça compte pas.). C'est que dans "jeu vidéo", il y a avant tout "jeu", et que la dimension narrative n'est ainsi pas la première qui entre en ligne de compte. On peut certes voir du drame dans le déroulement effectif d'un jeu quel qu’il soit (ce que les commentateurs sportifs ou Roland Barthes ont fait à longueur de pages ou de retransmissions), mais ce n'est pas sa première raison d'être - voir à ce titre l'ensemble des jeux de cartes traditionnels. Cependant, le temps des Pongs et Galagas, avec le scoring pour seul horizon, s’est vu progressivement supplanté par la notion d’histoire et d’univers vidéoludique (d’abord avec les jeux textuels sur PC, puis avec les avancées thématiques entre autres de Miyamoto sur NES, ou de Kojima sur MSX), dont l’exploration était sa propre récompense. C’est bien entendu à cause de cet état de fait, conjoint avec l’entrée de la pratique vidéoludique dans les foyers (les activités de leurs rejetons n’inquiétant les parents que lorsqu’ils les ont sous le nez), que le dénigrement de ce nouveau monde commença à se déchainer : pendant vingt ans, on taxa le jeu vidéo de pervertir la jeunesse, de la pousser au suicide ou à diverses maladies (de la tendinite chronique à l'épilepsie), tout en l'isolant du monde des vraies gens, dans le même temps qu’il agrégeait le pauvret en culottes courtes avec toutes sortes de malfaisants (remember Wolfenstein 3D qui poussait soi-disant au néo-nazisme, ou les débats sur la couleur du sang des jeux superNES ?).
Petit à petit néanmoins, les jeux vidéos ont eu l'heur d'enrichir LE jeu vidéo, en empruntant la voie la plus évidente : tendre soit vers le cinématographique en termes de narration, soit vers le télévisuel en termes de gameplay. Bien entendu, l'âge d'or de l'art vidéoludique devait alors, encore, se faire par la bande. Sur PC et sur les deux premières Playstation notamment, les chiffres de ventes faramineux de grandes franchises et de simulations sportives clonales servirent à la fois de ciseau pour pénétrer les rayons des grandes surfaces, avec la libération hors des cages transparentes où dormaient jadis les cartouches diaboliques, et de camouflage pour les auteurs qui enfin se faisaient connaître en tant que tels. On ne citera qu'Amy Henning avec les Legacy of Kain, modèles d'écriture et d'évocation qui en remontrent à bien des saga littéraires de fantasy, Kinji Mikami dont le travail sur les Biohazard tira le médium vers la cinématographie de façon fameuse, et bien entendu Hideo Kojima, encore lui, dont les ésotérismes ont amené la rhétorique vidéoludique vers une philosophie presque Flaubertienne (voir l'incroyable crachat au visage du joueur qu'était Metal Gear Solid 2). Le jeu d'épouvante devenait enfin adulte (Silent Hill, plus récemment Bioshock), le jeu "bac à sable" enfin déviant et transgressif (GTA), le jeu d'aventure enfin incarné (avec notamment ceux de la team ICO, Shadow of the Colossus en tête), et les rôles s'étaient plus ou moins réagencés entre plateformes pour enfants (Nintendo), pour adolescents (chez Microsoft), et à destination des grandes personnes (sur PC, ou chez Sony). Dans le même temps, la pression médiatique retombait, partie guerroyer vers l'imaginaire au cinéma, les dangers de l'Internet et la célébration des téléphones mobiles. Car les joueurs vieillissaient, et continuaient néanmoins à jouer : ils sont maintenant, au moins pour partie, un marché à part entière, un marché "d'adultes" (l'âge moyen des consommateurs de jeux vidéos dépasse désormais les trente ans). Bien entendu, une observation plus large de notre occident tendrait à indiquer que c'est l'humanité qui, autour du joueur, a décidé de retomber en enfance (relisez Muray et Bruckner, on n'a pas la place de détailler toute la tératologie de notre quotidien en ces pages), et en chemin de rencontrer ce drille à l'endroit où elle avait jadis prétendu le repousser du pied : une méta-adolescence généralisée, notion passée de péjorative comme épithète, à désirable en tant que mode de vie physique et psychique.
Evidemment, le jeu vidéo moderne et sa réception ne sont qu'un symptôme ; ce mouvement est général et se retrouve dans ce que Muray nommait "infanthéisme" et irrigue l’ensemble de nos comportements culturels et de consommation. C’est ainsi que sous couvert de la flatterie d’egos prétendument individuels, l’indifférenciation et l’attrait du même pour le même se retrouvent aussi au niveau du jeu vidéo. Largement admis en tant que marché - quoique régulièrement stigmatisé à sa marge pour faire bon poids, par exemple avec la fustigation des MMORPG – il ne restait plus au jeu vidéo qu’à flatter les niches qu’il avait jusque là négligé pour être pleinement accepté dans notre imaginaire culture/conso/loisir : Il fit alors force coups de coudes complices à Tata Jacqueline. L’on voit dès lors fleurir les party games/tapis d’éveil susmentionnés (où il s’agit par exemple de reconnaître des cris d’animaux de la ferme ! Les jurés de télé-crochet invités pour la pub semblaient en tous cas s'amuser comme des petits fous), des jeux-médicaments promettant de rajeunir nos cerveaux ou de nous faire maigrir sans vraiment se fatiguer, et même des conseillers d’orientation virtuels à usage des petites filles (la terrifiante série des Léa Passion)… Et ça marche. C’est ainsi précisément lorsqu’il nie ses précédentes avancées thématiques, celles qui confrontaient le joueur à un propos (c'est-à-dire à un auteur, soit sur le plan thématique, soit sur le plan cybernétique), ou simplement à lui-même (à part quelques exceptions, la difficulté des jeux mainstream est pensée pour ménager le plus malhabile des lightgamers), que le jeu vidéo gagne ses galons de respectabilité dans le monde de droit commun, en lui offrant un plus petit dénominateur commun à hauteur de ses préoccupations. Au scoring si représentatif des années 70 et 80, les années 2000 substituent son équivalent, à mille lieues de toute progression dramatique interne ou construction thématique complexe : le multi-joueur (où affronter des kevins sur des arènes devient l’horizon ludique indépassable) et les trophées et achievements partageables en ligne pour frimer auprès de… Auprès de n’importe qui.
Bref, le jeu vidéo est considéré à part entière lorsqu'il n'est plus que l'ombre du jeu vidéo. La fameuse expo chapeautée par l'asso MO5, en 2011 au Grand Palais, montrait bien ce paradoxe: censée célébrer la reconnaissance de l'art vidéoludique dans le monde des grandes personnes, elle ne parvenait qu'à nier toute sa noblesse au medium en en faisant un faux-nez supplémentaire pour amateur de Gloubi-Boulga Nights : la boutique/librairie vendait toutes sortes de gadgets régressifs et de semi-catalogues de jouets, tandis que le contenu éditorial insultait l'intelligence, avec notamment des vitrines remplies de figurines de Schtroumpfs... Nous voilà donc traités dans cette pratique culturelle comme partout ailleurs désormais : comme de grands poupons nourris à la seringue. C'est l'ultime twist que notre époque apporte à la théorie de Karl Kraus voulant que l'Apocalypse, c'est ici et maintenant, à savoir la création par nos habitudes, notre conformisme et notre manque de sens critique, d'un monde en apparence intact mais totalement mortifère. Ce monde mort, peuplé de fantômes ignorants de leur état, c'est une gigantesque garderie/centre aéré/hospice. Heureusement pour le bien-être des pensionnaires, l'infirmière pasteurienne assermentée y a placé des Ipad et des Wii, dans des coins prévus à cet effet et capitonnés de frais pour éviter les accidents.
Juste devant l’Enfer, Dante décrit le Vestibule des Lâches comme un lieu où sont parqués les neutres et les indifférents systématiques, c’est-à-dire l’immense majorité de l’humanité passive : «Cet état misérable est celui des méchantes âmes des humains qui vivent sans infamie et sans louange et qui ne furent que pour eux mêmes […] Les cieux les chassent, pour n’être moins beaux et le profond enfer ne veut pas d’eux, car les damnés en auraient plus de gloire». Les gentilles gens de l’époque, qui adhèrent si pleinement à ses mots d'ordre permanents de lustprinzip forcené et sans autre perspective que lui-même, acceptent pour leurs loisirs vidéoludiques, comme pour tout le reste, des fadeurs dont on leur a dit qu’elles étaient agréables. Elles ne réclament même plus de sel avec. Il suffit pour s'en convaincre de lire n'importe quel papier de la presse spécialisée depuis 15 bonnes années, et leur notes délirantes pour n'importe quoi qui sort (il est rare qu'un produit de studio doté de gros contrat, ou juste un jeu attendu - i.e. marketté en amont - obtienne moins de 80% de la note maximale).
Et bientôt, avec l’avènement du dématérialisé, ces bonnes gens ne demanderont même plus d’assiette. Car en bonne société de béta-moins (il est - trop - souvent pertinent de ressortir Huxley et son Meilleur des Mondes pour parler du nôtre), l'on accepte avec joie tout ce qui sort de la seringue de gavage, ça demande moins d'effort que questionner ladite; en l'occurrence l'application du modèle économique de l'App à la Apple qui interdit toute vie parallèle au produit (gratuite par exemple, ou créant une économie alternative, comme le marché de l'occasion) et force à passer à la caisse pour toute activité(1). Autrement dit, c’est l’autonomie de destin, bref l’âge adulte, qui est ainsi explicitement refusée. A ce propos on ne résiste pas au plaisir d'évoquer encore le bouquin d'Aldous, où un personnage explique que l'on a instillé in utero l'amour des sports de plein air aux Epsilon, car le simple goût "gratuit" de la nature qu'on induisait auparavant ne les poussait pas à une saine consommation en numéraire...
Mais paradoxalement, ce sera peut-être l'occasion de revenir au début du cycle, à ce moment des années 80 où le jeu vidéo devenait timidement, à force de victoires chèrement remportées, un médium à part entière. Pour commencer, le jeu "qui fait avancer le bousin" existe encore, bien que marginal en termes de nombre de titres; il suffira de citer le dernier Batman (Arkham City). Mais surtout, l'émergence des petits studios permet un bouillonnement qu'on ne connaissait plus depuis les Molyneux ou les Chahi qui faisaient tous seuls des Another World dans leur garage. Des jeux parfois basiques mais très bien menés en écriture ou en concept (the Binding of Isaac par exemple), ou alors des essais dont le statut a priori trop petit pour inquiéter les gros acteurs du secteur leur confère une réelle licence poétique. Ce sont des Flower, From Dust, Journey, voire même I Am Alive, qui pour se trouver sous le radar de l'économie d'échelle n'en volent pas moins bien au-dessus du tout-venant de la bouillie vidéoludique moderne. Doit-on y voir le germe d'un nouveau cycle de vingt ans, avec pléthore à venir d'ouvrages matures et qualitatifs, et où nous verrons à terme un Angry Videogame Nerd se foutre de la gueule de Passion Babysitting sur DS et d'Angry Birds ? Peut-être. Mais l'humanité, elle, sera sans doute encore plus sénile et infantile qu'aujourd'hui : les exercices de sudoku du docteur Kawachima auront échoué à la guérir de sa confusion mentale naissante, marque d’un alzheimer métaphysique qu’elle revendique déjà comme un droit. Le présent perpétuel semble à ce prix ; loué soit Notre Ford.
F Legeron
(1) Cette politique du tout payant systématique, alliée à des effets d'annonce intenables en production, a dores et déjà institutionnalisé le modèle des DLC (contenus additionnels téléchargeables en ligne) obligatoires, tels que les patchs correctifs ou les niveaux supplémentaires. Ce qui permet de sortir "en physique" des jeux partiellement terminés, puis d'en vendre les dernières phases de débuggage au joueur, considéré ici comme ailleurs comme un cochon payeur.
The Hobbit
Film le plus attendu de l’année, devant Prometheus, Dark Knight Rises et même Télé Gaucho, The Hobbit n'enthousiasme pas autant qu'on l'espérait. Si le plaisir des retrouvailles est réel, et le spectacle encore à cent lieues du tout-venant de ces dernières années, on regrettera de ne pas voir Jackson aller plus loin que son postulat de base, posé il y a tout de même dix ans.
A lire la presse française depuis la projection unique de jeudi dernier (malheureusement en 24 IPS), il semble de bon ton de descendre en flammes le dernier projet de Peter Jackson, comme d'ailleurs il y a onze ans avec Fellowship of the Ring (au bout de trois film et d'une pelletée de prix, le bonhomme avait mis tout le monde à l'amende, il est bon de le rappeler). Si le procédé agace autant qu'il ennuie (l'imaginaire reste l'épine dans le flanc de notre sphère culturelle), c'est pourtant plus par le petit corporatisme qui le sous-tend, que par l'impertinence de l'attaque elle-même. En bref, si nos sycophantes lancent leur habituel tir de barrage pour les pires raisons, ils tombent hélas parfois juste pour peu qu'on élague leurs excès. Car ce Bilbo soulève un certain nombre de problèmes, dont beaucoup tendent vers le constat que la personnalité même de Jackson semble brimée par son récent statut de nabab.
La carrière de Jackson est marquée par un constant mouvement en avant, hors de la zone de confort, vers des travaux d'une ambition délirante vis-à-vis du contexte qui les voit naître. C’est un saut constant en dehors de la boîte des habitudes, effectué pour se jeter dans le vide, avec sa bite et son couteau. Un couteau fait à la main à partir de la défense d’un mammouth qu’il a lui-même débusqué et tué à mains nues - un nouveau à chaque fois. D’un court amateur qui gonfle en long mondialement distribué, à une saga gigantesque de dix heures tournée hors Hollywood tout en montant un empire qui rivalise avec ILM en moins de cinq ans d’existence, Jackson a atteint un statut comparable, dans une certaine mesure, à celui d’un Orson Welles en son temps – se payant à l’occasion son propre canular réussi à l’échelle d’un pays entier avec Forgotten Silver. Tout ça en fabriquant quasiment tout tout seul, dans une optique d’artisanat qui est la vraie marque de ce qu’on désigne par le terme impropre de cinéma "geek". Jusqu’à Lovely Bones. Il semble en effet qu’une fois atteint un certain pinacle dans sa carrière et son art, Jackson (et avec lui ses alliés de longue date, Walsh, Boyens, Taylor…) ait bouclé la boucle en livrant sa version du film qui avait fondé sa vocation (King Kong donc), puis qu’il se soit retrouvé les bras ballants, sans challenge démesuré à relever à l’horizon. Il s’essaie alors à la production de films qu’il ne réalise pas (District 9, Halo, Tintin), avec, encore, une ambition patente. Pour ses projets personnels cependant la machine apparaît sclérosée sur ses méthodes et/ou ses thématiques, la prochaine inaccessible étoile à conquérir n’ayant manifestement pas encore été repérée (le combat pour imposer le HFR, à l'instar de Cameron pour la 3D ?). Tout ce pouvoir, et si peu d’applications. Premier film rebutant de Jackson, Lovely Bones inquiétait par son itération d’Heavenly Creatures, dont il semblait être un quasi-remake grossier et insincère, passant le rouleau compresseur sur l’ensemble de ses enjeux, travestis à coups de textures seventies criardes et de pedo-moustache.
Conscient peut-être de cet état de fait, il refusa longtemps de réaliser lui-même cette préquelle, en laissant d'abord le soin à Guillermo Del Toro. Après que deux ans de circonvolutions financières (faillite de MGM en tête) et de divergences artistiques eurent poussé le mexicain vers son prochain kaiju eiga, Jackson eut donc à prendre ses responsabilités vis-à-vis de son travail colossal d'adaptation. Les options de productions que subit aujourd'hui Bilbo ne sont pas étrangères à celles qui ont façonné l'incroyable trilogie néozélandaise d'il y a dix ans. Ainsi de son souci principal, à savoir son état forcé de préquelle. Rappelons que The Hobbit était envisagé dès le milieu des années 90 comme un préalable à l'adaptation de Lord of the Rings, projet initial qui devait donc préserver l'ordre chronologique des évènements en Terre du Milieu, mais périclita pour des affaires de droits. Il n'empêche que de fait, en 2012, cette prélogie tombe dans un contexte où la préquelle est devenue pour le meilleur et le pire un sous-genre en soi, générant des codes pour beaucoup aberrants, et de plus marqué au sceau du saccage par les efforts d' un certain George Lucas. Ce qui est à l'origine un premier acte, voire un prologue, est posé en effet (de par la préexistence effective de l'adaptation de LOTR) comme une préquelle, sans pour autant que cette donne semble prise en compte dans sa narration. C'est là que la logique de fidélité maximale de l'adaptation voulue par Jackson, par ailleurs louable, fait se mordre la queue au projet.
En premier lieu, l'évidence veut que l'épopée implique le péril. Or dans le cas d'une préquelle, le sentiment de péril est rendu caduque par définition, dans la mesure où la perte ou la destruction présumée d'un objet, ou encore la mise en danger d'un personnage, se trouve d'emblée infirmée par des éléments "de l'original" (ici LOTR) qui attestent de leur présence ultérieure. En clair, et même en évacuant le fait qu'on a bien entendu déjà lu les livres, on ne tremble jamais pour Bilbo, Gandalf, ou les elfes présents à Rivendell puisqu'on les sait bel et bien vivants 60 ans plus tard. Restent les nains, "nouveaux venus" dans la mythologie cinématographique, qu'on n'a malheureusement pas le temps de suffisamment différencier pour s'inquiéter réellement de leur sort (nous y reviendrons). Le même mouvement se retrouve pour les diverses Nemesis dont on se doute bien, n'en entendant plus parler dans LOTR, qu'elles seront promptement défaites (au moins provisoirement, dans le cas du nécromancien de Dol Guldur...). Plus gênante est la teinte que prend de fait la caractérisation des personnages déjà connus du spectateur, du fait d'acquis encore une fois préalablement posés : lors du conseil d'Elrond auquel il participe, impossible de voir en Saruman le magicien blanc et pas le traître inféodé à Sauron qu'il n'est pas encore à ce moment. De même, lors de la séquence-clé de la bataille de devinettes avec Bilbo (LE point de basculement du Tiers-Age), Gollum apparaît auréolé de son statut de hobbit, d'interlocuteur, qu'il n'acquerra qu'à partir de la seconde moitié de la saga déjà existante. Dans cette séquence on ne voit pas une présence menaçante, cachée dans l'obscurité et dont on ne connait que les yeux, alors que c'est pourtant la manière dont il apparaît dans la Moria, lors de Fellowship of the Ring. Le découpage même de cette séquence déçoit dans sa manière de rationnaliser Gollum qui, malgré ses effets d'annonce constants, ne véhicule jamais une menace tangible. Il ne passe, au mieux, que pour un pauvre hère qui se parle à lui-même, le Paul Préboist amaigri et pas si méchant que ça qu'il semble être durant les trois quarts de Two Towers. On fantasme une séquence mettant, peut-être, moins en avant la personnalité de Andy Serkis, iconisant plus Gollum en tant que créature des cavernes, ne montrant pas comme ici la seule figure de Smeagol. Plus loin, un regard lourd de soupçon de Gandalf à Bilbo laisse à penser qu'il se doute de sa possession de l'anneau (ou d'un des anneaux de pouvoir), ce qui constitue pour le moment un contresens malvenu dans l'économie du récit global.
Rançon du délirant succès artistique de LOTR, The Hobbit se retrouve ainsi écrasé par contraste avec un modèle qui devrait lui servir de tremplin. Car il est impossible de faire abstraction de l'illustre modèle. Principale conséquence de ce souci, l'attente que suscite le projet le rend d'autant plus sujet à déceptions, ce que pourtant le film est très loin de mériter. La stratégie employée pour circonvenir à cela semble avoir été de jouer la cohérence à tout crin, soit à coups de clins-d'oeil à la trilogie existante via l'évocation pas toujours utile de lieux ou de visages connus, soit en en calquant des motifs mémorables. Smaug apparaît à la manière des Nazgul, Gandalf casse un roc de son sceptre ou fait grandir son ombre chez Bilbo... Le procédé gêne souvent plus qu'il ne plaît, à la manière de l'appel aux aigles : la séquence paraît étrangement grossière, expéditive, alors que sa contrepartie dans Fellowship... est d'une évidence et d'une poésie gracile totalement désarmantes. De même pour beaucoup de séquences-miroirs de LOTR, qui souffrent de la comparaison, moins fluides, plus forcés.
Plus généralement, l'écriture séquentielle et certaines options de réalisation et de production apparaissent étranges, voire contreproductives. Lancé à contrecœur dans sa réalisation, Jackson semble régulièrement rechigner à la tâche, se confire à l'occasion dans la redite pure et simple, voire dans la dérision de l'univers qu'il sert, via des répliques irrespectueuses de leur contexte. A ce titre, le roi Gobelin s'avère carrément embarrassant, notamment lors d'une punchline parfaitement incongrue qui lénifie l'ensemble de la séquence des grottes. Son goitre glougloutant, associé à son design entièrement virtuel et à la configuration générale des lieux, finit alors par évoquer la cité Gungan de The Phantom Menace... L'option du tout-CGI pour lui comme pour Azog paraît en effet aberrante, notamment comparée aux maquillages prosthétiques qui confèrent à d'autres ennemis illustres de la saga (Lurtz, Gothmog) leur physicalité, leur dangerosité, et une bonne part de leur charisme, ici, même dans de très beaux moments comme les attaques des wargs. Les voilà réduits à des ennemis génériques en images de synthèse, à l'instar de la forme initiale du nécromancien tout droit sortie d'un générique de série HBO sous After Effects. De même pour Smaug qui semble un dragon parfaitement générique (on se souvient des options proposées par Del Toro, autrement excitantes), ou pour certains nains dont les looks confinent à la boufonnerie.
Par ailleurs, le rythme du film apparaît moins maîtrisé, plus haché selon un découpage de jeu de rôles (un lieu, une tâche, un obstacle), notamment en ce qui concerne le récit de Radagast : alors que la narration aurait gagné à se faire d'une traite lorsqu'il rencontre Gandalf, voilà l'épisode artificiellement coupé en deux pour ménager un montage parallèle, censé accélérer le récit. C'est que l'adaptation tire à la ligne, trilogie oblige. Ainsi nous voilà devant 2h40 de premier acte, sans réelles confrontations, guerrières ou dialoguées, à part des amuse-bouche (les trolls, l'évocation de batailles passées). L'option de faire une trilogie d'au moins 9 heures à partir d'un livre pour enfants de 300 pages renvoie bien entendu à ces stratagèmes, là où, encore, la concision et la rigueur d'adaptation d'un texte de la touffeur de LOTR forçait le respect. Est-ce pour ménager une place importante à la bataille des cinq armées et à d'autres épisodes du livre à l'épisme, lui, échevelé? Espérons. Car beaucoup de lourdeurs du récit sont imputables à l'écriture de Tolkien lui-même, ne l'oublions pas, surtout au moment de l'écriture de Bilbo où son style et son sens de l'unité n'étaient pas encore rôdés.
Insistons sur ce point : si l'on enrage sur les défauts réels de The Hobbit, ils sont somme toute mineurs et ne dérangent que parce qu'on en attend plus de la part de Peter Jackson. A la manière dont les derniers films de Miyazaki (avec qui Jackson entretient bien des rapports thématiques et esthétiques) s'avéraient décevants venant de Miyazaki mais abattaient à plate couture 90% de la production animée mondiale pour encore quelques années. De même qu'il n'est pas facile de passer après Mononoke Hime et Chihiro, l'ombre de LOTR et de King Kong est terrifiante, elle implique des attentes presque intenables. The Hobbit n'en reste pas moins l'un des meilleurs films de Fantasy depuis au moins 5 ans. C'est une chanson de geste d'une richesse indiscutable, souvent magnifique, peuplée de morceaux de bravoure que bien des cinéastes devraient étudier, dont l'univers dépeint sonne presque constamment juste. L'interprétation y est en tous points exemplaire (chez les nouveaux venus, Freeman EST Bilbo, et Armitage confère une noblesse gigantesque à Thorin). La voix du conteur reste prégnante, et fait passer les plus improbables chimères pour des évidences. Jackson n'est sans doute pas au sommet de son art (encore qu'il faudra voir la trilogie dans son entier pour se prononcer à ce sujet), mais même la tête ailleurs, il atteint des sommets que bien d'autres ne verront jamais fût-ce de loin. The Hobbit exalte, émeut, amuse et terrifie, parfois les quatre à la fois. Parvenir par exemple à faire passer autant de sentiment d'aventure dans le récit du sauvetage d'un hérisson par un vieil homme lunaire couvert de fientes d'oiseaux est rien moins qu'un exploit. Radagast, personnage casse-gueule par excellence, s'avère ainsi d'une légèreté incroyable, alors que certaines séquences touchent carrément au sublime comme celle des géants (sans doute un concept hérité de Del Toro tant la scène fait penser à l'elementaire de Hellboy 2), la dernière attaque des wargs ou la bataille de la Moria, qui semble avoir été arrachée telle quelle de l'imaginaire même de Frazetta.
Bien entendu que ce film est indispensable. La principale déception devant ses quelques scories, c'est de devoir attendre deux ans pour se voir prouver qu'on a sans doute tort de douter. En attendant, on savourera les retrouvailles en espérant que Jackson retrouve vite l'inertie et la rage d'il y a dix ans.
Looper
Du haut de son statut paradoxal de blockbuster/bête de festoches, l'attendu Looper surprend agréablement car sans être parfait, il réussit là où beaucoup échouent, en parvenant à introduire du cœur dans une approche postmoderne plus généralement propice au cynisme le plus mortifère.
La vie de tueur pour la mafia de Joe est bien réglée : il abat des hommes, envoyés de trente ans dans le futur par ses employeurs. En effet, on aura alors trouvé le moyen de remonter le temps, mais cette activité hautement dangereuse pour le monde tel qu'on le connait, est si illégale que seuls les "loopers" s'occupent de la réguler pour la garder sous le boisseau. Ils prennent une retraite anticipée lorsqu'on leur envoie leurs alter ego assortis d'une prime, qu'ils ont soin d'éliminer dans une forme inédite d'assurance-vie rétroactive. Certaines de ces "boucles fermées" parviennent pourtant parfois à s'échapper, amenant de terribles conséquences sur le tueur imprudent. Un jour, c'est ce qui arrive à Joe.
Qu'apporter de nouveau au récit de boucle temporelle ? Rien que ces trente dernières années, on a en effet à peu près fait le tour des implications de ce type d'histoire avec pêle-mêle Back to the Future, les trois quarts de Doctor Who, Butterfly Effect, Prince of Darkness ou Donnie Darko (le premier qui dit "et Camille Redouble" se verra lapidé à coups de figues molles)... Les constantes thématiques du sous-genre, désormais rôdées, l'amènent dans ses meilleures occurrences à moderniser le folklore de la tragédie classique en en conservant le principe moteur, l'impuissance de personnages face à l'inéluctabilité du destin. L'exemple le plus frappant en serait La série vidéoludique Legacy of Kain, où les actions intriquées de Raziel font plus que servir cette inéluctabilité (cf. l'incroyable final de Soul Reaver 2). Proche en cela de la tragédie racinienne, c'est un sous-genre qui sous ses atours séduisants (qui n'a jamais rêvé de retourner dans le passé pour conseiller son pendant d'alors, ou lui coller une bigne bien sentie?) se montre d'un conservatisme bien encombrant, montrant finalement, de façon presque invariable et assez moralisatrice, des personnages prisonniers d'un cercle qu'ils doivent in fine accepter sous peine d'annihilation non seulement d'eux-mêmes, mais de l'univers entier... Dans les rêves déviants des amateurs d'imaginaire, l'approche générale de Rian Johnson, qui a déjà montré son iconoclasme notamment dans le plaisant Brick, était amenée à relancer l'intérêt dans ce jardin trop bien entretenu.
Pari tenu. C'est que Johnson effectue ses pas-de-côté vis-à-vis des genres qu'il investit via une connaissance érudite de leur codes (techniques, esthétiques, thématiques), et mieux encore par une manipulation effective mais respectueuse de ces derniers. Dans cet esprit et tout au long de Looper, il s'amuse à ironiser sur les éléments constituants de l'actioner de sf, et mieux, sur la manière dont pas mal d'éléments périphériques du genre se sont retrouvés statufiés au fil du temps, en particulier Bruce Willis. C'est ainsi que Johnson tire d'abord son concept de base plus loin que ses prédécesseurs, en jouant notamment la carte de l'utilisation de souvenirs et de messages dans l'édifice causal de son récit : d'un côté l'un pourra donner rendez-vous à son futur lui-même en se scarifiant pour qu'il se découvre des cicatrices évocatrices, de l'autre (lors d'une séquence d'une limpidité et d'une brutalité confondante), d'autres pourront punir un fuyard du futur en mutilant sa jeune version pour qu'il en ressente des effets dont il ne se souvient pas avant de les constater sur lui-même. Pour n'être pas totalement nouveau (encore une fois, une telle scène de réminiscence se retrouve dans Soul Reaver 2, ponctuée par la réplique "Janos must stay dead!"), le motif du souvenir, et des conflits entre celui-ci et l'altération d'évènements, est très rarement utilisé dans le sous-genre, et acquiert ici une force particulière dans la mesure où il sert le conflit jamais résolu entre les deux versions de Joe. En effet, aucun des deux ne veut laisser tomber SA version du monde (et la femme qu'il aime) ni les carrefours platoniciens qui y mènent, et le fait qu'ils sont la même personne ne fait que les énerver un peu plus au sujet de leur antagonisme. Johnson introduit ainsi l'idée, passionnante, de paradoxe temporel métaphysique plutôt que physique. A ce propos, il est plaisant de voir enfin Joseph Gordon-Levitt grimé en autre chose qu'un sosie officieux de Heath Ledger : le trouble induit par sa ressemblance forcée avec Willis, cet autre lui-même venu de temps étranges, est patent et savoureux.
Mais comme dit plus haut, le sérieux de l'entreprise n'entraîne pas le manque de perspective et d'humour dans son traitement. Bruce Willis donc, qu'on n'avait pas vu aussi inspiré depuis Hostage, est visiblement conscient de cette perspective sur sa carrière et son statut d'action hero vieillissant, qu'il interprète ici avec toute l'aridité d'une résignation amère. Cependant Johnson n'est pas Tarantino, il sert avant tout son récit, et l'ironie du ton (ou le fait de se montrer malin) n'est pas pour lui une fin en soi. C'est ainsi que l'aspect bigger than life de la composante science-fictionnelle du récit joue le rôle de commentaire, ce qui permet à son aspect humain à fleur de peau de se développer sans entrave. Car on pense souvent, avec l'argument sf, à ce qu'à pu faire Verhoeven dans les années 90 : les motos volantes, pétoires ridiculement surdimensionnées et dons de télékinésie réduits à des fanfaronnades de bar, mais aussi l'esthétique de film noir du futur qui renvoie à toute une tradition post-Blade Runner (voir le commentaire acerbe d'un Jeff Daniels impeccable sur les cravates de ses hommes de main), sont là pour désamorcer l'incrédulité (tout le fatras technologique est montré avec un sens du quotidien qui crédibilise immédiatement l'univers), et poser la dose nécessaire d'adrénaline. Mais ces avatars de la post-modernité servent aussi à encapsuler les perspectives anticipatoires de l'histoire, dont le cœur s'est toujours trouvé ailleurs, dans des éléments et des décors nettement chargés de sens, prosaïques et intemporels : une montre à gousset, un fusil de chasse chargé de gros sel, des lingots d'argent et d'or, un coffre fort. Et c'est dans l'opposition de ces prosaïsmes que le film touche le spectateur bien plus que dans une pétarade par ailleurs exaltante (voir Willis nettoyer tout un immeuble à l'arme lourde reste un plaisir de gourmet). C'est clairement dans le troisième acte, avec la découverte de l'enfant amené à peut-être devenir le terrible RainMaker du futur, une force presque surnaturelle qui cherche à détruire tous les loopers, que Johnson pose ses revendications de conteur. Le traitement des relations entre les personnages dans cet acte se montre aussi subtil qu'impitoyable, l'enfant en lui-même - à la fois terrifiant et attendrissant - refusant tout manichéisme dans sa représentation.
On pourrait même voir toute cette partie comme une brillante adaptation officieuse de Charlie, le roman de Stephen King tournant autour d'une petite fille capable de pyrokinésie, et en particulier tout l'épisode du siège de la ferme des Manders par les agents de la Boîte. La simple terreur d'une mère face à la force effrayante de son propre gosse transpire de ces séquences et constitue la plus grande réussite du film, précisément parce qu'il ne se résigne jamais à donner dans l'action auto-centrée (à la manière de The Island par exemple) ou dans le clin d'oeil post-moderne comme seule fin en soi (tout Tarantino), mais cherche à faire avancer les codes d'un genre en se basant sur une connaissance complice tout en portant des enjeux humains incarnés et crédible. C'est, soi dit en passant, ce qui caractérise la science-fiction bien plus que le folklore technologique auquel on la réduit trop souvent. D'ailleurs, Johnson en semble conscient dans sa manière d'expédier les destins futurs et/ou potentiels de ses personnages, en quelques ellipses abruptes. C'est pourtant à cause de son coeur gros comme ça qu'ultimement, le récit semble se mordre la queue justement sur sa logique évènementielle. Sans spoiler, on dira simplement que la résolution du noeud gordien de l'histoire paraît manquer de logique, ce qui est meurtrier pour une histoire de voyage dans le temps (remember le Planet of the Apes de Burton?)... Ici, la résolution expéditive du récit tend, pour ce qu'on en sait au lancement du générique de fin, à l'annuler purement et simplement, voire à détruire l'univers ou se récit prend place. Cette réserve est néanmoins à prendre avec des pincettes : étant donnée la qualité hallucinante d'écriture dont Johnson fait preuve jusque là, il y a fort à parier qu'il ait une suite cataclysmique à Looper dans sa manche. On ne peut pour le moment que fantasmer un monde déchiré de part en part par la colère du RainMaker, des poches de temps aberrantes et contradictoires apparaissant au hasard, ou le simple détricotage du réel autour de ce nœud d'évènements désormais insoluble. Cette apocalypse temporelle, agitée d'habitude comme une menace intangible dans les autres récits de paradoxes temporels (Nom de Zeus !) pour justifier leur conservatisme de base, pourrait donner une histoire franchement excitante à suivre. Espérons.
Total Recall de Len Wiesman
B.O. d'article : Squirrel Nut Zippers - Suits are Pickin' up the Bill
Il en est de Len Wiseman un peu comme il en fut de Stephen Sommers. D'abord très bien reçu avec des premiers films très ludiques (respectivement Deep Rising et the Mummy pour Sommers, les deux premiers Underworld pour Wiseman), bien troussés et dont les prétentions de divertissements étaient servies par une certaine absence de prise au sérieux qui laissait penser à de l’humilité, le voilà bientôt conspué comme un tâcheron, un faiseur indigne, et bientôt une sorte de social-traître du cinoche de genre. Statut en grande partie mérité pour nous avoir niqué John McLane à la fois dans Die Hard 4 et les grandes largeurs. Le voir s'attaquer au remake d'un film aussi apprécié par la communauté que Total Recall relève donc, dans une mesure certaine, soit du masochisme soit de l'inconscience pure.
Qu'il y ait un gros problème, à Hollywood, avec le modèle économique du remake/reboot/sequel/prequel/remix/accommodation des restes de la veille, c'est désormais à peu près acquis. On en est quand même à nous y refaire les Three Stooges cette année. Et Spiderman. Le temps où on pondait des The Thing en faisant un remake semble loin, tant ce sous-genre est désormais un strict véhicule de producteurs. Ceci posé, il faut tout de même remettre le film original en perspective vis-à-vis de son statut flatteur. Verhoeven est en 89 à ce moment de sa carrière où il se fait une place à Hollywood à force de combats homériques contre les exécutifs, volant de projets avortés en scénars à moitié traités. Cette place, il se la fait en subvertissant les genres vendeurs du mainstream, en premier lieu l'actioner science-fictionnel, de consommation courante des années 80 ; il obtient de fait de beaux scores au box-office, et en y incorporant son commentaire d'européen sur la culture nord-américaine, avec à la clé de beaux scores au box-office. Cette manière de travailler perdurera tout au long des années 90, pour culminer dans Showgirls (film massue totalement incompris) et Starship Troopers (film massue presque totalement incompris chez nous). C'est ainsi qu'il fait de Robocop un pauvre hère émasculé qui bouffe des petits pots et affronte crime et corruption dans une vision de l'économie américaine qu'on ne trouve alors pas dans les films de série A, et ce avec une outrance dans la violence graphique qui ne vise qu'à choquer (dans la série remake qui fout les jetons, celui-ci sent encore moins bon que Total Recall d’ailleurs). Loin d'être le joyau de la carrière de Paulo, Total Recall lui sert pour autant de véhicule à ces expérimentations de propos et de commentaire, en lui permettant de prendre un sous-genre en pleine gloire, à savoir la baston tous flingues dehors avec Schwarzie (le film est une prod Carolco, CQFD), et de profiter de la pétarade pour passer derrière le spectateur de base, l'attraper par le col et lui plonger le nez dans son propre caca socio-culturel. Forcément, en tant que sommet de mauvais goût agressivement conçu, le film est encore un bonheur à revoir, bourré de one-liners débiles et d'idées complètement géniales/connes (l'implant de narine, les trois nichons, Johnny Cab), servi par une DA volontairement infâme (les décors très moches sous des lumières peu flatteuses, Rob Bottin qui s’en donne à cœur-joie dans le grotesque irréaliste), et un script qui brode sur son principe schizo de base sans vraiment s'y frotter, histoire de rester léger et de faire de l'humour grinçant.
Cependant, tant au niveau de l’adaptation de la nouvelle d’origine que de la qualité scénaristique et plastique, le film reste assez basique si l’on veut bien le confronter aux autres efforts de son auteur. De son image forgée a posteriori de monument du film subversif, il faut retenir surtout la réalité d’un film extrêmement subverti, ce qui n’est pas la même chose (et n’enlève rien de sa valeur au film). Qu’en reste-t-il dans ce remake ? Par nature, rien. Et ce ne sont pas les quelques clins d’œil patauds à l’original, que dissémine Wiseman pour faire postmoderne, qui feront illusion sur ce point (la poitrine multipliée par un et demi, une référence méprisante à Mars dans un dialogue…). Ce faisant, il tend d’emblée le bâton pour la fustigation, dans la mesure où au lieu de montrer allégeance à l’original (le but de cette manœuvre étant clairement de montrer sa street cred’), ces références mal amenées passent pour des moqueries, voire des marques de mépris. Ainsi, de par sa nature et sa facture, un film qui aurait tout à gagner à se singulariser le plus possible de son prédécesseur se place irrémédiablement dans son ombre gigantesque. Grand mal lui en prend, puisque sur la plupart des aspects où il est attendu au tournant, ce Total Recall circa 2012 souffre évidemment de la comparaison. Précisément, bien sûr, si on compare les deux films sur le sujet de leur personnalité.
Alors ce sera quoi ? Bah ce sera pas de quoi se la prendre et se la mordre. En effet, le trait le plus marquant de ce film est son manque presque complet de personnalité - trait de caractère, si on ose employer ce mot, encore accentué par contraste avec le film de Paulo, qui en avait jusque dans les trous de nez, de la personnalité.
Non pas que nous ayons affaire à un si mauvais film en soi, ni même à un produit mensonger comme l’illustre pétard mouillé de Christopher Nolan sorti quelques semaines plus tôt. Total Recall n’est qu’un blockbuster d’action science-fictionnelle estival (ce que prétendait aussi être l’original à la base), pas une bête de festivals, un "film culte", ni une prise de position quelconque. L’argument en lui-même est astucieux et plaisant (le concept de la Chute, ascenceur géant qui traverse la Terre de part en part pour relier l’Angleterre et l’Australie, seules parties encore viables du globe, est séduisant et pas mal utilisé dans le climax), et les scènes d’action dynamiques à défaut d’être particulièrement originales, à part le très bon gunfight en plan-séquence au siège de Rekall – gâché ensuite immédiatement par un simili-siège du SWAT assez mollasson. En revanche, le récit lui-même est d’un linéaire et d’une platitude confondants, laissant loin derrière lui toute ambiguïté et même toute notion d’idiome quel qu’il soit : les rebelles, qui ne sont plus ni martiens, ni mutants, ni télépathes, ni vraiment renégats, ne sont du coup plus grand-chose, à part des mecs dans une station de métro qui se la jouent Hellgate London. Le reste suit cette lignée : Cohaagen par exemple n’est plus qu’une sorte de über-Charles Pasqua sans la folie qu’y insufflait autrefois Ronny Cox. Sans doute pour essayer de compenser, Bryan Cranston cabotine comme un malade et en devient parfois carrément embarrassant à regarder… Bill Nighy, quant à lui, cachetonne comme d'hab en mode "devinez quel type de parpaing j'imite" (ça commence à plus être amusant, réveille-toi mec), et Farell s'obstine à tenter de croire à son rôle qui ne fait pourtant pas grand-chose. Est-il besoin de dire de Jessica Biel n'a pas la place de respirer là-dedans, fait donc logiquement du Blade 3, et qu'il est donc nettement préférable de la voir dans le Laugier qui vient de sortir ?
A part ça, et en vrai écologiste, Wiseman continue sa croisade pour le recyclage des esthétiques des 15 dernières années. Vous ne verrez pas la queue d'un élément nouveau dans la DA ou les péripéties, même si le résultat est parfois joliment agencé (la ville à la Blade Runner est agréable à regarder, en plusieurs niveau comme dans Macross, et avec des robots pas mal comme dans I Robot, et puis les voitures magnétiques sont sympatoches comme dans Minority Report, et puis... Enfin vous voyez, quoi.)... Donc voilà, c'est parfois meugnon (le piano), parfois très pénible (les flares horizontaux à la JJ Abrahams), et à quelques moments carrément énervant (le plagiat pur et simple de la séquence de la pilule), mais la plupart du temps juste vaguement plaisant pour peu qu'on n'ait pas payé sa place. Il reste cependant un élément vivant dans ce fatras trop bien rangé. Kate Beckinsale (affolante), filmée avec un amour évident et qui a fait ses devoirs d'un point de vue entrainement physique. Cette gonzesse est faite pour jouer des méchantes et des tueuses d'élite, d'autant quand ces tueuses ne sont pas moulées dans du latex et hélitreuillées à chaque fois qu'elles sautent sur place. Là elle a une présence physique et un charisme qui éclipsent tout ce qui se trouve autour. Mais c'est bien la seule bonne surprise du film, et d'ailleurs, la seule surprise tout court.
Tiens, on a plus parlé de l'original que du remake dans ce papier. Remarque, c'est normal.
fl
The Dark Knight Rises
Emporté par sa fatuité et son statut, Christopher Nolan refait The Dark Knight comme un élève appliqué, l'inspiration supplantée par un paquet de certitudes. Ce qui nous donne un remake expéditif, pompeux, confus, sans souffle ni surprise, et qui annule les acquis du précédent.
Troisième semaine de juillet 2012, à l'une des nombreuses avant-premières de TDKR. Tels des chimpanzés dans une expérience de comportementalisme des années soixante-dix, les spectateurs réagissent aux stimuli de la manière prévue, par des applaudissements satisfaits à chaque action ou nom de personnage connu (Robin, Talia Al-Ghul...) que le film leur lance à intervalles réguliers, ou à chaque révélation attendue à la faveur de fuites savamment orchestrées de ces derniers mois. C'est ce qu'on appelle, de nos jours, du fan service. Au vu du plan médias de l'année passée, et surtout à la comparaison d'icelui avec le film que l'on a maintenant sous les yeux, il conviendrait plutôt d'appeler ce barnum pavlovien de l'hypnose collective. S'il ne surprend plus (rien que cette année, on aura observé le même schéma sur Prometheus et Spiderman), le phénomène devrait tout de même étonner, non? Cette absence induite de questionnement critique a priori est si admise qu'elle a même empêché, suite à la triste tuerie d'Aurora, le tombereau habituel de crétinismes journalistiques qu'on entend généralement dans ce type d'occasions. Ainsi (pour le moment) le contenu des films n'a pas été mis en cause; ce qui est à peu près la première fois depuis une trentaine d'années dans de telles circonstances, qui plus est pour une série de métrages réunissant les tares d'être à vocation populaire, à forte composante imaginaire, et de surcroît adapté d'un comic book. Suite logique du statut, en partie créé par les studios (Syncopy en tête), d'auteur tout-puissant, indiscutable et visionnaire sur lequel trône désormais Christopher Nolan.
Hors c'est bien le principal problème des films de Nolan que Nolan lui-même, c'est-à-dire son approche de ses sujets, de ses thèmes, de sa mise en scène et surtout de lui-même en tant que cinéaste. Pour résumer, on dira que le loustic est extrêmement scolaire dans son travail. Un bon élève, propre, les dents bien brossées, tirant une grande fierté de sa place de premier de la classe, et en conséquence aussi prévisible que les résultats d'une élection russe. Aussi mortifère également, passée la clinquance de ses efforts à leur sortie. Ce TDKR représente, après un Inception déjà bien engagé sur cette voie décomplexée, une sorte de quintessence de cette autosatisfaction du philologue planqué, et de cette suffisance du petit con de fayot qui se sait protégé. C'est que depuis Batman Begins, Nolan ne bosse plus que sous la bannière de Syncopy, la boîte qu'il dirige avec son épousée, et qui lui assure de ne rendre compte virtuellement à personne de ses choix artistiques, des plus petits aux plus colossaux. Cette toute-puissance est à double tranchant : travailler "pour soi" permet de préserver l'intégrité artistique d'un film, protégeant celui-ci des assauts d'exécutifs castrateurs, avec les avantages que cela engendre, comme de pouvoir imposer des choix que ceux-ci considèrent comme risqués (tournage en pellicule, absence de 3D, refus de formatage family-friendly). Mais c'est surtout à terme le risque de travailler en vase clos, d'abord dans son clan qui devient une cour, puis dans ses méthodes qui se sclérosent en routine, et enfin dans son image de soi qui se confit dans l'idée de son génie. Beaucoup tombent dans le piège pour quelques films, mais se relèvent de cette passe. Nolan y est pour le moment plongé jusqu'à la racine des cheveux.
A ce titre, TDKR porte les symptômes de cette chronicisation du cinéma de Nolan. Plastiquement, on retrouve tout ce qui agaçait auparavant, à commencer par l'incapacité (ou le manque d'appétence?) à filmer ses actrices avec la moindre sensualité, même si étrangement Anne Hattaway, d'habitude horripilante, se sort assez bien de sa Catwoman. Seuls les acteurs, tous impeccables (enfin, sauf Cotillard, inutile et caricaturale) , semblent d'ailleurs croire à ce qu'ils font. Beaucoup plus problématique est la difficulté du réalisateur à traiter l'action de manière dynamique ou même simplement incarnée. A ce titre, étant donnée l'insistance avec laquelle on nous a vanté les bastons prétendument homériques dont devait s'acquitter Bane, il y a ici de quoi crier à l'escroquerie : les actions les plus brutales sur des civils (un bris de cervicales, des pendaisons sommaires, etc.) sont chastement reléguées à des plans larges ou hors-champ, quand les combats aux poings avec Batman sont carrément filmés uniquement en plans moyens ! Ce n'est pas une métaphore : on parle bien de combats entièrement cadrés à hauteur de pelvis DANS UNE SEULE VALEUR DE PLAN. Certes, Nolan n'y brise pas les règles du champ-contrechamp, mais c'est bien tout ce qu'on peut en dire. Pour la brutalité, ou même simplement pour la présence physique des protagonistes, on repassera. C'est embarrassant après les scènes d'action d'un The Raid (fait pour l'équivalent du budget photocopies de ce Batman), et leurs gunfights et combats découpés avec un sens de l'action et de l'espace à cent lieues de cette succession de passes de salon de thé. Le reste de la mise en scène est à l'avenant, et mises à part quelques séquences plus amples montrant les véhicules (les réussites du film), on ne se départit pas de l'impression de regarder un téléfilm friqué tourné par moments dans de beaux décors. Sentiment renforcé par une énorme poussée de LA fièvre récurrente de Nolan, celle qui consiste à faire passer toutes les informations narratives et thématiques exclusivement par les dialogues, et de répéter chacune trois fois histoire que tout le monde comprenne bien le message. Chaque action ou situation se voit ainsi systématiquement paraphrasée par un personnage dans la minute, ce qui dit assez la confiance qu'à Nolan dans les capacités de raisonnement de ses spectateurs (1). Un peu plus et on se croirait devant l'audiobook de la novélisation du film, tant la narration ne se fait presque jamais par le biais de l'image ou du découpage, et quelque pétaradante que soit cette conclusion "épique".
De verbeux précédemment, ce TDKR devient ainsi carrément logorrhéique. Les auteurs semblent d'ailleurs si contents de leur discours et de leurs dialogues qu'ils sont pressés de mener chaque séquence aux deux ou trois répliques qui la résolvent, déséquilibrant ainsi chacune en la rendant d'abord extrêmement expéditive, puis en la laissant mourir de sa belle mort quelques plans plus loin, vidée de sa substance, les personnages se retrouvant quasiment les bras ballants en attendant de passer à la suivante. Dans le même esprit, chacun y va de sa grande scène du trois tous les quarts d'heure, y compris lorsque cette grandiloquence est mal placée dans le récit (la grande explication avec Alfred, expédiée en milieu de premier acte et en quatre phrases). Et ce n'est pas l'inflation de nouveaux personnages secondaires parfaitement vains et aux actions absurdes (la protégée de Selyna, l'inspecteur joué par Matthew Moddine, le gosse de l'orphelinat...), qui arrange cette donne... Tout le monde raconte tout ce qu'il voit dans le dessin, ou tout ce qui lui passe par la tête, pour la gouverne du spectateur, assénant un propos qui peine par ailleurs à être crédible, au vu de la précipitation dans laquelle les nœuds successifs du récit sont escamotés : la résolution du fameux arc Knightfall, qui voit la colonne vertébrale du chevalier noir brisée par Bane (toujours en plan de demi-ensemble d'ailleurs), se fait littéralement en deux temps et trois mouvements (...Un coup de poing thérapeutique !) assortis de deux très courtes scènes de convalescence. Un vrai bonheur pour les kinés rééducateurs du monde entier. D'autant que ce temps ne semble avoir été "gagné" que pour permettre de faire trainer en longueur l'entrainement et l'évasion de Wayne, en étirant un suspense artificiel pour réajuster tout ça dans la temporalité de l'histoire (trois tentatives encapsulées de considérations philosophico-pouet pour en arriver à la solution qu'on avait tous déduite avant même l'échec de la première)... Ce n'est qu'un exemple parmi de nombreux autres similaires, résolus tout aussi vite, et sur des prétextes tout aussi fallacieux, dans de beaux tunnels de radio filmée avec flashes-backs muets : le monologue révélateur de Miranda en fin de métrage, ou celui du "bouh, je sais que c'est toi Batman" que sert l'agent Blake à Wayne au bout de trois bobines, valent leur pesant de rebondissements de Plus Belle la Vie.
Pour la première fois on sent une certaine négligence dans l'écriture, qui ne laisse d'interroger quant aux ambitions réelles de conteur de Nolan. Plus précisément, c'est le récit qui est négligé au profit du sous-texte, dont son auteur est persuadé qu'il était génial. Cette négligence est comparable, toute proportion gardée, à celle dont fait preuve le tueur en série après quelques meurtres sans se faire prendre : le sentiment de toute-puissance le mène à commettre des actes de barbarie de plus en plus révoltants, et à moins bien cacher les corps après coup. C'est en général là qu'il se fait attraper, ou devient une icône de la culture populaire. A en juger par la pignole hystérique qui entoure la sortie de TDKR, on devine quelle sortie prend Nolan. Il aurait sans doute tort de se priver de se sentir un demi-dieu, dans la mesure où tous ces mouvements de poignets autour de sa personne pourraient alimenter en énergie une petite ville pendant un an.
Le script est à vrai dire couvert d'autant de trous béants qu'un pied diabétique, état de fait qui tourne presque à l'insulte via la volonté manifeste de fermer toutes les écoutilles ouvertes par les deux précédents films - TOUS les arcs narratifs de la trilogie sont fermés à coups de boutoir, de force pour certains qu'il faut réouvrir préalablement comme celui de Ra's Al-Ghul. Bien entendu cela se fait via une teratonne d'incohérences grossières qui se contredisent les unes les autres. Et Nolan de recroqueviller le récit sur lui-même plutôt que d'accompagner son ouverture naturelle vers de nouvelles perspectives (2), ce que montre assez le motif récurent de l'insularisation de Gotham dans la trilogie de moins en moins subtilement. L'écriture, et par effet de dominos la mise en scène, sont d'une confusion qu'on n'avait encore jamais vue chez Nolan, qui assumait jusqu'ici un rôle de Grand Architecte de ses histoires leur permettant, au moins, d'être logiques dans leurs déroulements. A trop vouloir nous asséner sa vision du monde-post-9-11-qui-vit-dans-la-peur (ambition revendiquée de cette trilogie), bref à vouloir jouer les essayistes plutôt que les réas, Nolan finit par trébucher et flinguer l'histoire qu'il nous raconte dans les grandes largeurs. Le ridicule achevé de l'explication des origines de Bane achève le travail.
Là où cette confusion générale des enjeux et de l'écriture est foncièrement contre-productive, c'est précisément dans le traitement des thèmes de la trilogie. A force de vouloir jouer la subtilité, Nolan finit par dire tout et son contraire, mais surtout l'inverse de ce qu'il prétend exposer, et ce dans l'exacte proportion inverse de sa véhémence à le faire. Par exemple, utiliser la réplique "On ne négocie pas avec des terroristes" à des fins rhétoriques, dans un film, EN L'AN 2012, alors que 127 cinéastes ont déjà fait ricaner leur public avec, n'enjoint pas nécessairement l'interlocuteur à vous prendre au sérieux quant à votre clairvoyance sur l'actualité géopolitique. Mais c'est la caractérisation et l'iconisation des personnages, et partant de là les archétypes qu'ils sont sensés défendre, qui en prennent un sacré coup. Le traitement de Bane, surtout, est une négation fortuite de l'édifice mis en place dans les films précédents.
Aucun des adversaires de Batman n'est attirant dans la mythologie revue par Nolan, à part dans TDKR. Les hommes de la pègre, Crane, Ra's Al-Ghul, le Joker et Double Face sont charismatiques, ils possèdent même une classe énorme, mais en aucun cas le spectateur ne se trouve en position d'avoir envie de s'engager à leur côté. Parallèlement, dans ces mêmes films, l'on s'identifiait de fait à Wayne et sa suite même en tenant compte de ses faiblesses et maladresses. Dans TDKR, on a envie d'applaudir Bane et de le soutenir dans un combat dont on sait pourtant qu'il n'est qu'un prétexte à un massacre gratuit et inhumain. Son discours lancé à Gotham, prônant une praxis tout droit sortie d'Octobre, sonne comme de l'héroïsme pur et simple face aux ridicules de Wayne et sa caste, de ses caprices d'ado mal dégrossi à Alfred et Lucius, à sa phase Howard Hugues du début du film (un exil d'ailleurs escamoté en quatrième vitesse, comme s'il fallait le plus vite possible s'affranchir de l'héritage trop lourd du métrage précédent, peut-être trop qualitatif pour être assumé), en passant par sa manie de dévoiler son identité secrète à tous les passants à la moindre occasion. Depuis Batman Begins, la rhétorique de la saga consiste à opposer un symbole positif aux périls engendrés par les constructions d'un bellicisme multipolarisé, le terrorisme sauvage amenant au terrorisme des états sur leurs propres ressortissants. La figure du Joker dans Dark Knight, synthèse quasi-parfaite du personnage et fruit de la construction conjointe de David Goyer et Heath Ledger, poussait cette théorie encore plus loin en réfutant le chaos liberal via un chaos idéologique, volontairement nihiliste, qui créait ultimement une masse critique suffisante pour faire ressortir l'humanité de Gotham. Ce Joker (et son extension dans l'univers du film en la personne de Double Face) portait TDK sur ses épaules, précisément parce qu'il échappait au contrôle totalitaire que Nolan exerce d'habitude sur ses films : c'est qu'il avait eu l'intelligence de laisser cet élément, qu'au sens fort il ne comprenait pas, aux mauvais garçons de la classe pour qu'ils le gardent en vie. Pénétré de son intelligence suite aux discours laudatifs à son égard susmentionnés, Nolan a décidé de recombiner les éléments de ses deux premiers Batman d'une manière conforme à sa propre lecture rationaliste du monde. La mort de Ledger a bien entendu entrainé cette reconfiguration de ce troisième épisode, mais le bât blesse dans la manière dont cette reconfiguration a eu lieu.
Voilà en effet que Bane passe par défaut de Tyler Durden à Pancho Villa : on n'a le choix de l'identification qu'entre lui et un gros bambin porphyrogénète pleurnichard, qui fait une tête d'adolescent fugueur jusqu'au cœur de ses exploits sacrificiels (3) ! L'adoubement par le prolétariat, sous la forme de deux bisous d'une wannabe personnage à la Dickens (Catwoman donc, caractérisée en petite fille aux allumettes montée en graine) n'y changent pas grand-chose, et même, le traitement de Wayne dans ce métrage jette une lumière nouvelle sur les agissement du milliardaire au fil de la saga, le posant en gosse de riches capricieux et égotiste. Car que valorise Nolan dans le reste du film ? La nécessité de sauver les rentiers qui se sont terrés dans leurs sièges sociaux, pour échapper à une insurrection ? Ou un groupe déterminé, organisé, dont la volonté de sacrifice au service d'une cause est manifeste ? Les deux morceaux les plus épiques et solennels de la mise en scène montrent ainsi un gosse qui chante le Stars and Stripes, et une charge de flics façon Braveheart. Dur alors de ne pas balancer du côté des terroristes (vous avez envie d'applaudir une charge de keufs, vous?). De fait, le pari discursif de Nolan est perdu puisqu'on prend parti pour le "méchant" contre les "bonnes gens" (présentés comme un tas de clampins apathiques qui obtempèrent devant la moindre démonstration de force), et étant donné que ce pari n'était assuré que par une hypothèque exorbitante sur la cinégénie et la cohérence narrative de son sujet, tout est perdu. D'un propos passionnant, on est passé à un discours de café du commerce. Et la planète applaudit tout de même, elle crie au génie comme quand on lui sort une tablette numérique avec de grandes publicités en Helvetica sur fond blanc ; eh quoi, on s'est excités pendant un an et demi, on en veux pour notre argent au moment de la conférence de presse. Et puisqu'on ne peut plus idolâtrer feu le génie autoproclamé d'Apple, trouvons-en un autre, cette fois-ci dans le monde du cinéma - l'identité de l'idole est secondaire tant qu'on a la célébration. Dans un monde affranchi de cette hystérie publicitaire, TDKR aurait peut-être effectivement tenu ses promesses.
Dans son précieux Dictionnaire du Diable, Ambrose Bierce définit ainsi le terme d'accomplissement: "Accomplissement - n. La mort de l'effort et la naissance du dégoût." Hélas, Christopher Nolan est aujourd'hui un cinéaste accompli.
(1) - On se souviendra par exemple du début de The Dark Knight, avec l'interruption du deal par de faux Batmen. Bien que la copie soit flagrante, la séquence se fend tout de même d'un plan où le docteur Crane déclare à voix haute "That's not him".
(2) - L'univers du chevalier noir se prête de plus tout à fait à des traitements audacieux et ouverts, et peut même en sortir grandi comme l'ont prouvé les instigateurs des deux jeux Arkham Asylum et Arkham City, avec certains arguments scénaristiques similaires.
(3) - Sacrifices d'ailleurs niés eux-mêmes dans l'épilogue, la maison ne se refuse rien.
F Legeron
Prometheus
BO d'article : "You're a trendy fucking pussy" - Anal Cunt
N'y allons pas par quatre chemins : Prometheus est pour le moment LA PURGE INFAME de l'année. Pourquoi donc? Evidemment, il y a la 3D inutile, les idées pompées d'un vieux Fleuve Noir, le pire maquillage de vieillissement de ces vingt dernières années, l'équipe de scientifiques la plus con du monde, l'opportunisme crasseux de la fin "ouverte" sur une ou deux séquelles de plus, le symbolisme de pacotille, le psychologisme à la Plus Belle La Vie, le réalisateur de Une Grande Année et un scénariste de Lost. Certes, il y a tout ça. Mais le crime est plus grave et plus profond, et il est perpétré en premier lieu sur le tissus mythologique que ses instigateurs avaient contribué eux-mêmes à fabriquer jadis. Et ça, ça c'est pas cool.
Prometheus, donc, n'a rien de ce qu'en a dit la gigantesque pignole de communication qu'on a eu à bouffer depuis un an. C'est surtout un monument de dilettantisme et, passé une première séquence prometteuse, un bordel thématique et narratif sans nom. Un fourre-tout qui crache sur tout ce qui fait l'aura du film illustre sur lequel il appuie sa hype surdimensionnée. D'abord dans la logique élémentaire du récit, bien entendu, nous donnant à admirer l'expédition scientifique la moins scientifique possible, qui parvient en deux jours à refaire Lascaux, le projet Manhattan et Thyphoid Mary, comme ça pour les lolz : et que je te respecte aucune règle d'asepsie, et que je te contamine des atmosphères en ouvrant toutes les portes sans réfléchir, et que je te fais aucune mesure avant d'aller tripoter des tissus vivants soit précieux, soit hostiles... ça la fout mal sur une expédition dont on nous bassine avec son prix exorbitant et sa valeur scientifique et spirituelle inédite. A part à être pressé, l'androïde n'aurait a priori même pas besoin de contaminer un des gars, ils y arrivent très bien tous seul ces cons. Plus largement, c'est le symptôme de la manière dont l'intelligence du spectateur est insultée tout au long du métrage par des gens qui tentent par ailleurs de lui faire croire qu'il va trouver à réfléchir, attends attends, la scène d'après c'est trop philosophique tu vas voir. Le script et la mise en scène papillonnent ainsi de sous-intrigues en bouts de séquences, apparemment par caprice.
On passera donc rapidement sur des conneries grosses comme soi qui parsèment ce gros port-fuckin-nawak : l'auto-césarienne avec un matos extravagant qu'on ne verra plus jamais dans la saga, même des siècles plus tard, opération de chirurgie grotesque après laquelle Noomi Rapace (qui devrait mieux choisir ses rôles) cavale comme si de rien n'était dans tous les coins. Les comportements de crétins des géologues, "eh une bestiole qui me menace, je vais aller la papouiller tiens". Les multiples infections et bestiaux balancés au petit bonheur la chance au cas où y'en aurait un qui marche, dont la terrible pieuvre géante/chatte de l'espace qui sort d'on ne sait quel brainstorming sous MDMA. Les allées et venues complètement erratiques sans contrôle cohérent, et le robot qui fait tout et n'importe quoi selon l'humeur du moment, jusqu'à retourner sa veste dans un final revanchard à la Resident Evil 2 ("maintenant, on va aller leur peter la gueule!"). Final qui raccroche à la va-vite quelques wagons pour qu'on croie à une cohésion in extremis avec Alien.
On passera aussi (c'est cadeau, c'est pour la maison, tant qu'on y est) sur les vagues procédés de série télé pour tenter de conférer une épaisseur aux personnages : un accent cockney ou écossais ici, un accordéon là, deux-trois dialogues où les persos se racontent ce qu'ils savent pertinemment pour la gouverne du spectateur - genre "bouhou, je suis stérile", "bouhou, je suis ta fille", "bouhou, je suis un robot qui kiffe un vieux film", etc.. La plupart de ces "éléments scénaristiques" sont d'ailleurs parfaitement convenus, routiniers, voire complètement cons - en tous cas à cent lieues de n'importe quelle vie que vous avez vécue. On en revient au fait que le scénariste vienne de Lost et on est tout de suite moins surpris, tant toutes les recettes de la telenovella hypertrophiée susnommée se retrouvent dans le traitement de ce Prometheus : en gros, prendre un argument de base et larguer dessus un tapis d'idées décousues et à peine réfléchies dans l'espoir qu'une ou deux tombent juste ; puis combler les lézardes avec des cliffhangers capillotractés et des backgrounds de personnages bien quotidiens pour l'équilibre. C'est ce qu'on appelle une écriture moderne. C'est comme l'ancienne écriture, sauf qu'on enlève la grammaire élémentaire, la rigueur dramatique et la cohérence, sans doute parce que ça coûte trop cher, la seconde année de formation des plumitifs.
Bon, on va reparler de Lovecraft les amis. Pas particulièrement quant au rattachement, officieux mais communément admis, du premier Alien avec la geste lovecraftienne, mais plus largement vis-à-vis de la constitution même de ladite mythologie, telle que la recommande entre autres le reclus de Providence lui-même dans son Livre de Raison, et telle qu'il l'a mise en place d'un point de vue narratif au long de son grand-œuvre. Autrement dit, on cause moins ici du Lovecraft poète que du technicien: en gros, ce qui fait la robustesse et la vigueur encore belle des ouvrages de Howard Phillips et tout ses gentils amis, c'est qu'en tant que système de récits il s'agit rien moins que d'un grand mythe agglomérant, qui intègre au fur et à mesure du temps de nouveaux éléments narratifs mais aussi toutes les notions qui passent à portée : folklore, science, légendes préexistantes... Bref, une mythologie au sens antique du mot, plein, fier, solide, aux contours suffisamment souples pour s'enrichir des apports successifs plutôt que s'en voir fragilisé. Bien entendu, si ça fonctionne c'est pour trois grandes raisons : de bonnes idée à la base, le sens de la suggestion et de l'allusion, et de la rigueur (à défaut, de la jugeote fera l'affaire). C'est pour ça que la mode des préquelles surexplicatives est la plupart du temps si dommageable aux illustres souvenirs de cinéma sur lesquels elle surfent : pour rester dans le lovecraftien on citera The Thing, circa 2011. En cherchant à tout expliquer, contextualiser et ranger dans un tiroir, on circonscrit et on étouffe toutes les virtualités du récit d'origine. On voit bien ce que ça a de gênant quand on inflige ce traitement à un film dont le sujet même est l'inconnu...
A ce titre le projet Prometheus, au début s'entend, soulevait des excitations et de la curiosité précisément parce qu'on se demandait ce qu'il en serait par exemple du concept de reine pondeuse, introduit à partir de Aliens dans une lecture très rationnelle de la créature de Giger : Dans le premier cut du film de 1979, une séquence (coupée avant la sortie salles, et dont Cameron ne devait rien savoir pour Aliens) laissait penser que la créature avait un mode de reproduction nettement plus étrange que celui d'un insecte social. Ses victimes étaient stockées vivantes et se changeaient lentement en œufs, tels qu'on les trouvait dans le vaisseau abandonné sous une mystérieuse membrane immatérielle. Allait-on revenir vers ce type de lecture bizarre, moins vivipare, moins terre-à-terre que le tout-venant de la SF extraterrestre moderne ? Scott allait-il donner dans l'inédit cinématographique, c'est-à-dire ré-élargir une mythologie plutôt que de continuer à la circonscrire dans un cercle conceptuel de plus en plus restreint ? Car tout, dans Alien, participait d'un état de grâce où l'inconnu et l'exotisme cosmique s'appuient sur une cohérence si robuste, qu'elle n'a besoin d'être que sous-jacente dans le récit. En ce temps, ces enfoirés-là (Shusset et O'Bannon, Scott, Giger) savaient parfaitement comment ne pas trop nous tenir par la main en tant que spectateurs tout en nous fournissant un sol stable sur lequel nous tenir, et miracle les mecs! On marchait apparemment tous seuls dans l'univers proposé, sans voir où on allait, et on arrivait à bon port! Où est cette époque? Manifestement, loin.
C'est que ce Prometheus, qui tourne hypocritement autour du pot de la préquelle qu'il prétend n'être que partiellement (comment on appelle ce genre d'objet bâtard d'ailleurs? Une demi-préquelle? Une semi-suite? Un baril de lessive ordinaire?), manque précisément de discernement et de savoir-vivre non seulement dans sa facture, mais dans son projet même. Répétons-le : Alien fonctionne par sa rhétorique sur l'inconnu et le mystère et sa cohérence à toute épreuve, fruit d'une synergie de talents encore frais, et aussi de moyens limités qui forçait un Ridley Scott pas encore mégalo à être rigoureux dans sa mise en scène et sa rhétorique thématique. Or la rigueur, le père Scott, il s'en bat autant les steaks que Gérard Baste du qu'en-dira-t'on des voisins, depuis que son seul nom lui permet de débloquer des centaines de millions pour des films oscillant entre "meh", "bof" et "au journal on m'a dit que je devais le voir". On parle tout de même du mec qui se vante de "savoir en 30 secondes où placer la caméra quand j'entre dans une pièce" et en fait la base de son cinéma depuis quelques lustres déjà - voir les découpages de plus en plus réduits au fonctionnel, au strict illustratif, voire à la description la plus plate possible de l'action, des films du "maître" depuis au moins Gladiator. Ce dilettantisme est aussi la marque d'un cynisme que les errements de son dernier effort transpire par tous les pores, du sacrifice de la pourtant belle direction artistique (le gros bon point du film) au recyclage de tous les vieux designs de Giger qu'on avait dans les tiroirs, notamment les Eggsilos, dans des contresens parfois grossiers (le "vrai" visage des ingénieurs est d'un ethnocentrisme sidérant comparé aux multiples formes foutraques que prennent les autres créatures - quand celles-ci ne sont pas bâclées comme le proto-alien de la fin). Les personnages et le jeu afférent des acteurs (qui se démerdent comme ils peuvent dans bordel, certains avec classe comme Elba, Sean Harris ou Theron) sont bien entendu les premiers sacrifiés sur cet autel. Quant à la dramaturgie elle-même, elle ne sert au mieux que de support aux amphigouris de terminale philo de la com. Ainsi, l'explication de tout ce bordel, en plus d'être très peu imaginative et encore une fois très ethnocentriste (une installation militaire d'armes biologiques? C'est tout ce que vous avez trouvé?) se voit expédiée en trois lignes de dialogue littéralement débitées entre deux portes! Pour se faire raconter une histoire, même pas forcément une bonne histoire mais une qui tienne au moins debout toute seule, on repassera. Mais après tout, on n'est là que pour bouffer du pop corn en se persuadant de voir un nouveau 2001, et lécher la pastille d'un cinéaste qui vit dans son propre colon en faisant croire à l'industrie que celui-ci sent encore la rose.
A un moment du dernier spectacle d'Alexandre Astier, on voit J-S Bach qui engueule ses élèves sur leurs cantates : "C'est marrant, je vous demande de faire simple et beau, et vous faites tous compliqué et moche". Ridley, faudrait que t'ailles causer avec Astier. Avant de nous massacrer Blade Runner de préférence.
fl
Cosmopolis
Cronenberg est capable du meilleur quand il s'oublie un peu au profit de son film. Pas de bol, ici il nous refait son poseur et accouche logiquement d'un pensum démonstratif et creux, traversé parfois par de belles traces de vie.
Comme il semble loin le temps où Cronenberg faisait effectivement des films neufs et stimulants, aptes à bousculer et ravir le spectateur en lui offrant de quoi frotter du sel sur des plaies dont il n'avait souvent même pas encore conscience. Bien entendu la vie était moins rose alors, notamment du point de vue critique. Traité à tours de bras de pornographe, de dégénéré ou d'analphabète cinématographique (relire les critiques d'époque de Videodrome et mourir de rire en les comparant avec celles plus récentes, du même film et dans les mêmes journaux), le monsieur faisait son beurre (et ses bons films) du côté de la "sous-culture" et des amateurs déviants de video nasties. Mais voilà ! David est un garçon instruit et intelligent, ce qui en soi est très bien ; le problème c'est qu'il en est un peu trop conscient pour le bien de ses films. C'est qu'il veut qu'on le sache aussi bien que lui, qu'il est instruit et intelligent. D'où une bonne moitié de carrière vouée à la pose intellectualiste de festivalier, où frayer avec la Grunberg connection lui permet certes de mousser plus que précédemment (encore que), mais avec des bulles nettement moins chatoyantes.
En bref, il y a eu le Cronenberg qui se souciait d'être un cinéaste intelligent plutôt que de se contenter de se donner à voir comme tel, et ce jusqu'à Naked Lunch. Depuis, combien deCrash, d'Existenz ou deSpider, à la fois abscons, inutiles et arrogants, ou Cronenberg ne fait que redire en moins percutant ce qu'il exposait par avant avec brio ? Pourtant on a cru à un retour vers quelque chose de plus incarné, avec History of Violence et Eastern Promises qui étaient clairement d'un autre tonneau... Et voici Cosmopolis qui confirme, après un Dangerous Method déjà bien masturbatoire, le retour à la tendance canno-berlino-vénitienne de l'ex-auteur de Scanners.
Or donc, on suit ici Eric Packer, jeune magnat de la finance, qui part dans sa limousine/tank/bureau/tour d'ivoire se faire couper les cheveux à l'autre extrémité de New York. Ce faisant, il se désintègre progressivement au fil d'évènements boursiers et de tensions sociales diverses qui ont lieu autour de lui, tout en discutant avec toutes sortes de courtisans de sa perte de repères, et alors qu'une menace sur sa vie flotte dans l'air.
On le voit, Cosmopolis reprend un certain nombre de motifs qui irriguent la filmo de son auteur: mutations, secte étrange (ils balancent des rats sur les gens), intrigues corporate complexes et floues, menaces autour du corps et de ses intérieurs, dégénérescence et interpénétration du psychique et du physique. La question n'est pourtant pas de compter les lignes de forces, mais de se demander ce qu'elles servent.
Le mode opératoire du film, qui cause une irritation si patente, est de fait très similaire à celui qui préside aux autres métrages de ce "cycle mondain" de Cronenberg : devant l'opportunité de servir le récit (c'est-à-dire de raconter l'histoire), fuir et se contenter d'expliquer in extenso la note d'intention, assortie de l'ensemble de ses notes bibliographiques. C'est bien, ça fait sérieux, et les cultureux adorent les bateleurs qui flattent leurs références, d'où des plébiscites critiques qui ne se font plus attendre vingt ans (à l'inverse, encore, des cas de Videodrome, Shivers, the Brood, etc.). Sauf que pendant de temps-là, le film en lui-même ne parvient pas à exister. En toute logique, il n'y a donc pas grand-chose à dire de la majeure partie du récit, qui prend place dans la limousine et à ses abords, et où Eric Packer rencontre divers autres personnages avec qui il devise de la vie la mort et - littéralement - la coiffure. Une alternance de séquences parfaitement désincarnées, où les personnages se balancent des références universitaires d'un air détaché pour la gouverne du spectateur, dans une mise en scène parfois si abdiquante qu'elle en devient imbitable. Il faut voir les champs/contrechamps des scènes de resto, avec leurs cadres dégueulasses et leurs gros plans de visages au grand-angle, pour s'en convaincre. Le reste est fort proche d'un Existenz en termes de rendu, de scènes de cul mécaniques et artificielles et de pignole universitaire à la connaissance strictement théorique. Quant aux dialogues monocordes, ils rappellent les Godard des années 80 (ce n'est pas un compliment), avec mention spéciale aux conversation avec l'épouse dans divers restos. On ne peut pas se sortir de l'idée les probables grattages de têtes de snobinards très contents de voir Robert Pattinson subir un toucher rectal ou Juliette Binoche se rouler par terre (quelle subversion ! Il y a même du full frontal à un moment, c'est bien le signe qu'on est dans un film intelligent, non?), et encore plus heureux de se faire tripoter le neurone à citations savantes toutes les trois minutes, tant cette loooooooongue heure dix de métrage ne fait qu'en appeler ostentatoirement auxdits squatteurs de cocktails, dans un découpage qui confine souvent à de la radio filmée. Même quelques images fortes (émeutes, confrontation physiques, rats), situées à l'extérieur de la voiture, proclament tant leur prétendue subversion qu'elles se diluent d'elles-mêmes dans un ridicule cotonneux. Par exemple, on mettra au défi le spectateur de remarquer le type qui s'immole par le feu avant que le fait soit commenté d'un ton égal par les androïdes assis dans les sièges en cuir, entre deux considération sur la poire et le fromage.
Dans le contexte économique et social actuel, placé sous le signe double de la courbe de Laffer et du Fort Chabrol, Cosmopolis semble à première vue pertinent. Pourtant il apparaît affreusement daté, en premier lieu parce que l'analyse arrive un peu tard pour être intéressante (le roman est sorti en 2003, soit juste à temps pour taper dans le mille, lui), mais surtout parce que l'ensemble de ses thèmes à déjà été traité par Cronenberg dans ses films précédents, et avec suivant les cas plus de fraîcheur ou une finesse d'analyse supérieure : la sexualité maladive (Shivers, Rage, etc. ), les flux virtualisés d'information (Scanners), la peur de voir le corps et/ou la technologie se retourner contre soi (The Fly, Dead Zone), les guerres souterraines de corporations occultes (Videodrome, Naked Lunch) l'isolement de l'individu dans ses propres aspirations (the Brood), etc. . On pourrait néanmoins voir dans la construction même du film l'autoanalyse que fait peut-être le cinéaste, lorsqu'il nous montre justement un homme qui a tout obtenu sauf ce qui l'intéresse, au prix de son âme, et qui est tellement perdu dans le ciel des idées qu'il est réduit à regarder de loin la vraie vie sans pouvoir la fouailler comme autrefois. Est-ce lui-même qu'il dépeint dans cet homme respecté mais bien moins que vivant, sans prise sur un monde qu'il est sensé tenir dans sa main, et qui finit par devenir incompétent dans le domaine même qui a fait sa renommée ("Je n'ai pas anticipé le Yuan") ? Le troisième acte le laisse penser, avec pour effet un petit espoir quant à la lucidité du jeune loup aux dents longues devenu rentier à dentier.
Car le film décolle lors de son dernier acte, alors qu'on ne l'attendait plus. (ATTENTION SPOILER) Successivement, Packer y perd son épouse, puis sa superbe via l'intervention d'un entarteur, se sépare de son garde du corps, renoue avec le vrai monde en partageant les souvenirs prolétariens de son chauffeur et de son coiffeur et vieil ami, lors d'une séquence qui semble faire directement écho avec ses plus récents "écarts de conduite", ces retours dans le monde des vivants qu'étaient ses deux premières collaborations avec Viggo Mortensen. Accessoirement, il obtient une arme, abandonne la limousine et affronte sa Nemesis. Il n'est pas interdit d'y voir un voeu pieux de la part de Cronenberg, peut-être même un aveu ou un choix philosophique. Quoi qu'il en soit, cette dernière partie ne suffit pas à sauver le film, mais constitue un court métrage magnifique, tendu de lyrisme et de sauvagerie, et qui retrouve la majesté et le trouble des meilleures séquences de Videodrome et de Naked Lunch. Et si Pattinson y est émouvant (saluons l'exploit), c'est Paul Giamatti qui y règne , maladif, désespéré, au charisme bouffant l'écran jusque dans les bords du cadre. Il tient toute la séquence finale sur ses épaules, en soliloque virtuose, dans un dispositif théâtral qui lui sied magnifiquement. Et malgré tout ce qui précède, Cosmopolis est in extremis un film à avoir vu, rien que pour cette explosion de vie sale et souffreteuse qui en sort à son corps défendant. En espérant un nouveau sursaut prochain de Cronenberg loin des salons ouatés des quartiers cossus. C'est dans les ruelles dégueulasses et les bâtiments insalubres qu'il s'épanouit.
FL
Wrath of the Titans
B.O. : "I don't care" par Black Flag.
Y'a-t-il encore quelqu'un à Hollywood qui veuille se lever le cul pour faire un blockbuster qui se tienne? Ou assurent-ils uniquement le service minimum, en sachant que les cochons payeurs continueront d'acheter des cartes illimitées, et en comptant sur Christopher Nolan pour relever le niveau et compenser la misère une fois tous les deux ans? On se pose la question quand on voit coup sur coup des MIB3, des Prometheus, des Avengers et des Wrath of the Titans.
Les bandes-annonces, l'absence de projos-presse (comme pour le dernier Ghost Rider - ça c'est pour situer), et la sortie à la fois au sein d'un creux de programmation et dans l'angle mort des mensuels ciné (soit dans la courte période juste après les bouclages), et néanmoins dans une grosse combinaison de salles... Ces indices permettaient de subodorer le coup en chien, le film bâclé posé discrètement comme une galette honteuse dans les géraniums de la voisine, au sortir d'un soir de cuite. Mais l'ampleur du ratage mou a largement dépassé les estimations : de fait, le seul phénomène spectaculaire du film est encore l'ampleur du hijacking commercial mis en place (quand même pas très loin des trois quarts de million d'entrées/France). On se retrouve ici devant un pur film de studio, de producteurs, et dans le mauvais sens du terme. Film d'exécutifs est sans doute plus approprié.
Tu imaginais, ami(e) lecteur(euse), qu'un jour tu regretterais le film de Leterrier? Liebesman accomplit cet exploit. Faut dire que le pauvre garçon a quasiment achevé sa transformation en yes-man servile depuis son expérience cauchemardesque sur Darkness Falls en 2003, transformation qui devrait se solder l'année prochaine dans le fameux reboot des Tortues Ninjas ou les rôles-titres ne seront plus des mutants mais des extraterrestres. Or un yes-man, ça fait ce que lui disent les costards-cravate du studio qui ne pinent rien au cinoche. Ce WOTT est à cet égard un monument de je-m'en-foutisme à tous les niveaux de sa fabrication: écriture indigente (on oublie complètement les règles édictées auparavant, tout en fabriquant de nouvelles au hasard des scènes), DA et péripéties entièrement pompées de God of War (on s'étonne souvent de ne pas voir de Quick Time Events à l'écran), options de prod complètement pourries (certains plans de photo secondaire pas tournés dans le même format que la photo principale, des money shot qui se répètent), personnages unidimensionnels et réduits à des fonctions, mise en scène à la ramasse, ainsi qu'une interprétation cabotine digne d'un gros boulevard ("let's have fun!", déclare Zeus dans une posture on le voit digne d'un dieu antique).
L'histoire? Tout le monde s'en fout. Les personnages? Tout le monde s'en fout. La nouvelle coiffure de Worthington? Te fous pas de ma gueule. Les SFX? Ah, pour le coup ils tiennent la route, pour peu que la réalisation ne les castre pas outre mesure : du surdécoupage sur les chimères (comptez voir les têtes) ou les doubles guerriers (comptez voir les bras), à la confusion spatio-temporelle sur l'île (comptez voir les cyclopes) ou lors des batailles, les interrogation quant à l'implication du réa se posent clairement. Encore une fois, s'est-on dit que de toutes façons, les plans impressionnants seraient déclinés sur les supports promos pour attirer le chaland, et qu'une fois les spectateurs dans la salle ils suffirait d'assurer un emballage rapide desdits plans pour pas que ça se voie trop, mais sans faire de zèle? A voir l'absence TOTALE de direction d'acteurs, par exemple (putain mais Bill Nighy quoi), ou la tronche des climax (le labyrinthe inextricable qui se traverse en six minutes chrono sans vraiment bouger, et contenant un pauvre streum fabriqué à base de chutes de moulages), la question fait plus que persister. Leterrier, au moins, essayait de déniaiser ses enjeux et d'iconiser ses créatures, il y parvenait même dans un final plus fluide que le reste. Ici, deux-trois ralentis et mouvements d'appareils amples sont les seuls moments qui passent pour de la fluidité, au service d'actions d'une gratuité qui confine parfois à la bêtise pure (le revirement soudain d'Hadès qui débouche sur un numéro de cirque télékinétique à la DBZ, l'ensemble des scènes de Agenor), et surtout sont systématiquement annulées en dix minutes, sans que leur résolution apporte un quelconque changement.
Reste pas grand'chose. Rosamund Pike gagne en charisme et en meugnonitude dans son arnachement belliciste, Toby Kebbel est amusant en barbu, il n'y a pas trace de Mouloud Achour, et Worthington tire une maigre épingle d'un jeu dont les rares moments spectaculaires ont, au moins, le bénéfice de la beauté picturale. C'est quand même dommage que cette épingle soit partie d'un jeu de mikado, et que l'équipe du film en ait autant appliqué le principe sur l'ensemble de la narration : le premier qui fait bouger le truc a perdu.
fl
Carpenter et Lovecraft - la Trilogie de l'Apocalypse
- Retour sur The Thing, Prince of Darkness et In The Mouth of Madness
Où l'on verra que les destinées de Big John et du père de Nyarlathothep sont plus entretoisées qu'on ne le croirait en les prenant strictement à la lettre.
Mouvement paradoxal du brouillage des codes: le geekisme est passé de particularisme vu de haut à marché porteur, puis de marché à identité sociale à la mode, et enfin de mode à culture dite "alternative", "alternatif" étant bien entendu le terme qui désigne le fait d'avoir rejoint le mainstream le plus moutonnier. Par la grâce de ce glissement de terrain culturel, Howard Philips Lovecraft se voit frappé d'une notoriété aussi parcellaire que trompeuse. En effet les tombereaux de Cthullus en peluche vendus sur Internet ne font pas bouger les lignes (ou de manière si marginale qu'elle en devient négligeable) quant à la reconnaissance réelle due à un auteur qui n'est pas appréhendé à sa juste valeur littéraire et culturelle, voire qui reste purement et simplement ignoré par l'immense majorité de la population ainsi que des sommes critiques. Pourtant, Lovecraft est sans aucun doute l'un des auteurs capitaux du vingtième siècle occidental. Oui, au même titre qu'un Hemingway, un Neruda ou un Céline, n'en déplaise. Pas tant pour le style (encore que cela se discuterait âprement, viens-y donc) que pour la construction narrative et le caractère mythologique de l'œuvre qu'il a instigué.
Le terme de mythologie relatif à la construction d'une telle œuvre est évidemment à considérer loin de l'abâtardissement qu'il a subi ces trente dernières années dans les sphères médiatiques; d'un côté avec le comic book et la bande dessinée, où toute timeline complexe (et par extension tout arc ou concept de récit original) se voit affublée du mot "mythologie", et surtout dans le monde de la série télé qui emploie le mot comme un présupposé de modèle narratif par épisodes, c'est-à-dire en n'en prenant que l'acception de compilation de petites histoires au sein d'un gros récit. La notion de mythologie réactivée dans les jeunes années du vingtième par le reclus de Providence est bien plus classique et pleine que cela, notamment dans son acception ethnographique telle que la définit Lévi-Strauss. C'est-à-dire la mythologie telle qu'elle fonctionne en Grèce antique, selon la notion de méta-mythe agglomérant, qui n'encapsule pas des sous-intrigues un arc narratif, mais comme un nuage thématique aux bords non définis et mouvants, dont l'atomicité de mythes (de récits) qui le constitue assure la cohérence et la robustesse de l'ensemble. Ce pouvoir d'agrégation ne s'arrête pas aux mythes eux-mêmes mais intègre virtuellement toutes sortes de savoirs et de dynamiques, sociales, politiques, scientifiques ou conceptuelles dans une direction philosophique donnée (Ici, la mythologie tend vers un grand principe : l'univers est infiniment plus vaste et plus étrange que nous ne pouvons même le concevoir). C'est précisément ce travail que Lovecraft a mené au sein de sa propre œuvre qu'il intégrait dans une continuité, entre autres celle de Dunsany et Machen (mais aussi Borellus, Haggard, Füssli...), en y intégrant toutes sortes d'éléments scientifiques, philosophiques ou culturels variés (et pour certains inédits dans leur dimension cosmologique), mais surtout en n'en étant pas le seul dépositaire. Certes, son panthéon d'outre-mondes est de l'ordre de l'inouï, la profusion d'entités, de lieux et de phénomènes est propre à un système mythique riche, mais les mythes lovecraftiens ne sont pas gravés définitivement dans l'onyx, et la mythologie s'enrichit sans cesse avec les ouvrages d'autres auteurs. Ces apports ont d'abord pris place dans la littérature avec les correspondants et les continuateurs de Lovecraft lui-même, et se retrouvent depuis dans la musique, le jeu vidéo, et surtout le cinéma, ce médium si propice à la mythologie. Ce qui nous mène à John Carpenter et ce qu'il nomme lui-même sa Trilogie de l'Apocalypse.
Les mythes lovecraftiens, par leur nature conceptuelle même (indicible, écriture extrêmement allusive, rapport à la temporalité et à la matière proprement inconcevevables concrètement), posent un gros problème pour être transposés ou traduits en termes cinématographique. On dénombre les tentatives d'un cinéma du lovecraftien au sein de deux grandes approches, des adaptations de récits existants (voir les films de Stuart Gordon, et en premier lieu l'excellent Dagon) et des récit originaux se rattachant à la mythologie qui nous intéresse, ajoutant leur pierre à l'édifice de manière plus ou moins affichée. C'est dans cette logique que se situe John Carpenter dans ce qu’il nomme lui-même sa Trilogie de l’Apocalypse : des films qui travaillent des thèmes et des imageries lovecraftiens, ce dont le cinéaste ne se cache pas le moins du monde, mais sans jamais mettre explicitement en avant cette approche. Jamais on n’y parle des Grands Anciens, du Necronomicon ou de Yuggoth, et pourtant il serait inconcevable d’aborder la notion d’un cinéma du lovecraftien sans évoquer The Thing, Prince of Darkness et In the Mouth of Madness, tant ces films touillent la pâte de la mythologie pour en tirer des récits inédits mais pratiquement inenvisageables autrement que par le prisme de celle-ci. Carpenter, peut-être plus par persévérance que par dessein, s’est attelé sur plus de quinze ans à donner sa dimension cinématographique au mythe lovecraftien. En effet, si In the Mouth of Madness est considéré généralement comme l'un des films lovecraftiens définitifs à l’heure actuelle sa réussite formelle et conceptuelle s’est construite sur les acquis de ses deux prédécesseurs qui, en se colletant moins frontalement avec Lovecraft (ou plutôt d’une manière moins visible, reprenant plus l’esprit que le folklore, nous y revenons plus bas), en ont exploré des aspects qui font problème pour qui veut traduire le matériau avec les seuls moyens d’image, de son et de découpage dont dispose le cinéma : une imagerie de l’indicible d’un côté, et la traduction d’une hostilité cosmique, supranaturelle, d’entités non matérielles, de l’autre. Tout porte à croire que Carpenter aurait utilisé les deux premiers films de sa trilogie officieuse pour apprivoiser ces enjeux, afin de rendre au mieux un univers lovecraftien non tronqué avec le troisième. On pourra envisager alors la construction que constituent ces trois métrages comme une voûte, dont la clef est In the Mouth of Madness. Parlons de celui-ci en premier et allons à rebours de l'évident au diffus, d'In the Mouth... qui cite ouvertement les Grands Anciens à The Thing qui fait passer Lovecraft en contrebande.
In the Mouth of Madness
C’est ainsi que John Carpenter évoque son film le plus ouvertement lovecraftien : « Je n’avais pas dix ans que je lisais déjà The Dunwich horror dans mon lit. (...) J’ai d’ailleurs carrément cité Lovecraft texto. Quand Linda Styles lit des passages du nouveau livre de Cane, passage que Trent va voir se matérialiser devant ses yeux, elle lit en fait des citations presque exactes de livres de Lovecraft, Des rats dans les murs notamment. » Carpenter ne cache pas (ici dans une interview-carrière pour Mad Movies) sa passion pour Lovecraft, ni le désir qu’il a depuis le début de sa filmographie de se colleter directement avec le matériau lovecraftien, comme il en trouve l’occasion sur In the Mouth of Madness, qui démarque avec une grande efficacité l’univers et les préoccupations de la mythologie. Pourtant, In the Mouth of Madness n’est pas, à la base, un script de Carpenter mais de Michael de Luca, un temps président de New line films et depuis devenu producteur au sein de Dreamworks. Un script qui, d’ailleurs, n’a rien de lovecraftien dans sa mouture originale. C’est un récit qui participe de ce mouvement ouvertement méta-textuel, qui s’affirme dès le début des années 1990, de films et de romans traitant de l’irruption du fictionnel dans le réel : on citera à ce titre la saga La tour sombre de Stephen King, A vos souhaits de Fabrice Colin, Des nouvelles du bon dieu (1996), Candyman (1992) ou même Fight Club(1999). Le récit en lui-même se présente comme une longue prise de conscience où John Trent, enquêteur pour une compagnie d’assurances, part à la recherche de l’écrivain d’horreur à succès Sutter Cane. Ce dernier s’est retiré dans une ville qui s’avère être sa création, Hobb’s end. Trent finit par apprendre qu’il est lui aussi une création de Cane et que sa fonction est d’amener dans le monde réel le dernier livre de celui-ci, destiné à causer l’apocalypse. La fin du film le voit, en pleine fin du monde, s’échapper de l’asile où il a été interné, pour retrouver, au cinéma, le film de ses propres aventures (en fait une adaptation du roman de Cane).
Carpenter n’accepte ce film en 1994, après deux refus, qu’à la condition explicite de pouvoir le remanier dans un sens lovecraftien. C’est-à-dire, y ajouter une dimension panthéiste et des éléments directs de la mythologie (en l’état, Cane étant aux ordres de ce qui apparaît comme les Grands Anciens, Hobb’s end en tant que lieu fictif coupé du reste de la Nouvelle Angleterre, ainsi que diverses citations qui caviardent le métrage : Mme Pickman en référence au peintre de ghoules d’une nouvelle éponyme, les couvertures des livres de Cane bourrées de clins-d'oeil). Carpenter, très cartésien, en profite aussi pour faire de Trent son alter ego officieux. C’est ainsi, bien que le film développe sa propre storyline, indépendante totalement des écrits de Lovecraft ou des autres auteurs du mythe, que In the Mouth of Madness constitue sans doute le récit lovecraftien au cinéma le plus concluant en termes de rendu d’ambiance, d’imagerie et de structure narrative. Ainsi la construction même du récit, son arc narratif, se fait sur une base éminemment lovecraftienne : Le protagoniste, John Trent, est placé en psychiatrie et raconte son histoire à un visiteur.
Car ici, on ne badine pas avec la mythologie, et le moindre des défis que relève le film n’est certes pas la mise en place d’une réalité alternative qui permet une visualisation concluante du folklore lovecraftien. En effet, toutes les tentatives en ce sens, et a fortiori celles évoquées dans cet opuscule, mettent au jour le même problème plastique et structurel : la visualisation physique, c’est-à-dire le fait de conférer une existence cinématographique à l'écrasant jeu de références de l’imagerie lovecraftienne (peuples, créatures, divinités, mais aussi lieux, péripéties ou modes narratifs particuliers comme l’extension ou la contraction de la temporalité) est une difficulté cruciale. Ici, la construction même pose d’une manière très efficace le caractère fugitif et parcellaire de l’apparition de l’élément surnaturel : Ainsi l’argument de base de l’histoire contée est le retour de divinités occultes (on reconnaît les Grands Anciens sans que leur identité soit explicitement déclinée) via les créations d’un auteur qui leurs servent de ciseau pour pénétrer notre plan de l’univers. C'est une reprise du motif, cher à Lovecraft, d'une menace hors d’âge qui revient en s’annonçant par des créations ou des activités humaines (on pense bien entendu aux sculptures et aux cultes de L’appel de Cthulhu, aux peintures de Pickman (Pickman’s model, 1926) dans la nouvelle éponyme, mais aussi dans une certaine mesure aux expériences scientifiques diverses qui ont pour effet de permettre une pénétration plus ou moins prolongée des déités dans notre monde : Les chiens de Tindalos par exemple, ou encore le diptyque de nouvelles Celui qui hantait les ténèbres et L’ombre du clocher).
En termes d’imagerie pure, Carpenter pose une singulière et pertinente troisième voie entre inflation des effets numériques et suggestion totale : il utilise de manière quasi exclusive les effets spéciaux sur plateau (effets mécaniques, prothèses, miniatures, animatronique, marionnettes) du studio KNB, ce qui confère aux créatures, notamment, une présence physique tangible dans l’univers dépeint (et une menace mécaniquement plus prégnante via la possibilité d’une interaction corporelle "réelle" avec les personnages), mais dose leur monstration en les ramenant à la portion congrue : ainsi les déités sortent du trou dans le "réel" pratiqué par Cane (c’est le seul effet numérique ostensible du métrage, ce qui souligne bien la virtualité de ce réel dans l’économie de la narration du film : Ce réel est envisagé comme une surface plane, et de l’autre côté, on voit ce qu’il est réellement, c’est-à-dire le texte d’un livre. L’univers auquel appartient ce livre, est posé comme invisualisable au sens métaphysique du terme), mais on ne les voit pas au sein de cet ailleurs, à la faveur d'un contrechamp par exemple. Ils ne sont visibles, lorsqu'ils poursuivent Trent dans l'espace de la narration (après avoir passé le trou dans la page), qu’à travers de très bref plans de coupe, très parcellaires et cadrés en longues focales, et un seul plan large de moins d’une seconde. L’aspect fugitif de ces visions constitue un choix qui émane strictement de la mise en scène ; revoir la séquence de l’effrayante transformation de Mrs Pickman en monstre tentaculaire armé d’une hache : cinq plans y suffisent, alors que le story board original prévoyait une scène plus longue où Mrs Pickman tentait d’attraper Trent. Cette fugacité les rend d’autant plus efficaces qu’elles participent d’une crédibilisation globale de la menace innommable : ce qui a été montré ne peut plus être nié (la visibilité directe confère une réalité dans l’économie du film), mais son contour conceptuel reste peu défini du fait de sa brièveté et, de fait, contamine le reste du récit par son caractère "partiellement innommé", selon ce principe de la mythologie lovecraftienne qui consiste à esquisser un univers dont la crédibilité de l’ampleur - et le caractère intrinsèquement inquiétant de cette ampleur - vient du fait de n’en décrire qu’une infime fraction qui évoque plus qu’elle ne montre, car ce qu’elle montre implique un certain nombre de conjectures.
Ici, c’est par les diverses péripéties se déroulant à Hobb’s end, et dont Trent et Styles sont alternativement témoins, que l’univers (celui de Cane, de Carpenter, des Grands Anciens) est esquissé de la sorte. Certaines de ces péripéties font explicitement l’objet de récits précédents de Cane. Mais c’est surtout leur intervention apparemment décontextualisée qui jette la confusion quant à la temporalité et au hors-champ. Car l’intervention des éléments se fait toujours avec un sens de l’évocation à la fois fluide et prégnant : les enfants courant après le chien au ralenti, ces mêmes enfants zombifiés accompagnés du chien ayant entre-temps perdu une patte, le cycliste vieilli et sa phrase sibylline « J’peux par partir, ils veulent pas que je parte », le motif de l’éolienne, filmé de manière à souligner une signification lourde d’un sens qui nous échappe (et qu’on imagine sortie des livres de Cane), Styles qui embrasse passionnément un Sutter Cane affublé d’un homoncule monstrueux dans son dos, ou encore l’intense confrontation entre les villageois et Sutter Cane à l’église ; l’un des villageois réclame son fils à Cane, mais ni ce villageois, ni l’enfant, ni la raison de la rétention de l’enfant, ni même Cane d’ailleurs, n’ont été introduits physiquement au préalable à ce point du métrage . Lorsque de telles séquences sont introduites, cela ne fait qu’augmenter à l’impression de prendre en marche le train d’une histoire plus vaste que celle qu’il nous donné de suivre : Styles désignant les villageois et assurant Trent qu’ils sont armés avant même qu’ils soient descendus de voiture, le père de famille qui se suicide dans le bar (cet acte extrême prouve à Trent que ce qui se passe dans cette ville ne relève pas de la supercherie), la sous-intrigue de Mrs Pickman qui séquestre son mari avant de le démembrer et qui possède un bien étrange tableau montrant ce que deviendra le genre humain suite au retour avéré des Grands Anciens (cette intrigue est même contextualisée de manière explicite dans le film puisqu’il y est dit clairement qu’il s’agit de la Mrs Pickman de Horreur à Hobb’s end)… Une telle mise en abyme thématique crédibilise un univers fantasmatique tout en jetant le doute sur le statut de cet univers par rapport à la réalité, quelle qu’elle soit.
In the Mouth of Madness constitue une étape importante dans la symbiose entre la mythologie lovecraftienne et les media audiovisuels, en particulier le cinéma. Ici, c’est par cet art intelligemment dosé de la suggestion thématique et plastique, un art du partiellement montré et non du caché, que Carpenter reprend la même musique, avec des instruments techniques (le cinéma) et conceptuels (le questionnement dickien du réel en tant qu’entité et que notion, la meta-textualité, mais aussi des éléments plus anecdotiques comme l’ajout de données économiques dans la thématique du récit), différents de ceux qui ont vu la naissance de la mythologie lovecraftienne (la littérature) : celle d’un monde plus vaste et plus étrange qu’on ne le perçoit, ampleur et étrangeté qu’on ne peut appréhender, de manière prospective, que par la théorie intellectuelle (par l’extrapolation scientifique et philosophique) et la poésie (ici, l’association d’idées par un découpage, une imagerie, et un montage séquentiel à la fois évocateurs et déroutants). Le film de John Carpenter prolonge ainsi la mythologie de manière respectueuse mais sans faire l’économie de partis pris affirmés, qui posent un pont avec des procédés narratifs modernisés (on y évoque d’ailleurs nommément Stephen King, grand rénovateur de la littérature dite de genre). Un film sans aucun doute parmi les plus lovecraftiens de l'histoire du medium, au sens où le folklore de la mythologie y est rendu de manière très convaincante, mais surtout parce qu’il offre de ressentir le fameux effroi des espaces extérieurs cher au rêveur de Providence, sans qu'on puisse ignorer la réelle identité du passeur.
Prince of Darkness
Le cas de Prince of Darkness, réalisé huit ans auparavant, est pourtant tout aussi éclairant et ne laisse lui non plus aucun doute quant aux intentions lovecraftiennes de son auteur, bien qu'on n'y trouve ni tentacules ni phrases imprononçables proférées par des moins qu'humains au service d'entités opérant d'un ailleurs nébuleux. Pourtant cette menace cachée, occulte, est l’enjeu tout lovecraftien au centre de Prince des ténèbres. Le film tourne autour d’une église contenant dans une crypte au sous-sol un mystérieux container ou tournoie un fluide vert. A la mort de son gardien, un prêtre convoque le scientifique iconoclaste Birack et ses étudiants pour investiguer sur l’objet et un grimoire ancien. Il s’avère que le fût a sept millions d’années et contient rien moins que le fils d’un principe maléfique primordial, sorte d’anti-Dieu résidant dans l’antimatière et cherchant à infiltrer notre monde via les miroirs. Un mal ancien qui cherche à prendre le contrôle du monde, des écrits occultes, des sectes millénaires (à l’instar des cultistes de Cthulhu, les clochards de la ville sont organisés en sorte de secte. Ils assiègent l’église, y maintenant les chercheurs coûte que coûte, dès que l’activité reprend dans la crypte), un supra-univers inconcevable autrement qu’en pure théorie, et la convocation de la science, voilà un film qui reprend à son compte les thèmes récurrents de la mythologie lovecraftienne pour les acclimater au cinématographe dans un récit par ailleurs peu chiche en action. L’argument de base, ainsi, reprend le début de L’appel de Cthulhu : à la mort d’un vieil homme, le savoir qu’il détenait ouvre des perspectives effrayantes. Et c’est par la convocation des faits, et l’accolement du folklore et de la science, que la prise de conscience devient inévitable.
En effet, les étudiants convoqués par Birack opèrent dans des domaines en apparence non connectés les uns aux autres : biologie moléculaire, physique quantique, mathématiques, radiologie (discipline qui permet de se rendre compte que le fût est fermé de l’intérieur) mais aussi traduction de langues anciennes et théologie. Ainsi, le mal est ici un fait réel, tangible, et même vérifiable de manière expérimentale, une entité appréhensible par plusieurs prismes de la connaissance ou de la prospective. Il est toutefois encore envisagé comme profondément indicible : la première phrase traduite du grimoire le désigne par le terme de "chose" (procédé déjà utilisé dans le film éponyme, en 80), et l’on n’en verra au final pas plus qu’une main, griffue et massive. L’indicible, pour rester non dit (non décrit), est montré à la caméra via ses effets sur les humains, puisque le liquide, après s’être écoulé du container pour se répandre au plafond, va investir les chercheurs les uns après les autres, commençant par la radiologue, avant que le mal se transmette d’individu en individu selon un schéma de contamination, de contagion du mal, cher au cinéaste. Certains se zombifient, quand d’autres sont instrumentalisés de manière plus, une chercheuse se voyant l’hôte du démon lui-même via un étrange hématome qui s’avère être une marque cabalistique utilisée dans des rites magiques médiévaux.
Malgré la structure de film de siège, les implications du récit sont étonnamment globales en termes cosmologiques : le réveil de l’entité coïncide ainsi avec l’observation d’une supernova précambrienne, et la prophétie écrite, une fois traduite, révèle que le Diable lui-même est une création de cette entité qu’on pourrait qualifier de Grand Ancien. L’intégration mythologique est lieu d’une phagocytose pure et simple de traditions extérieures au mythe, ici le christianisme envisagé comme guère plus qu’un jeu de l’esprit destiné à détourner l’attention du véritable Mal, mais aussi des éléments comme les équations différentielles, trouvées dans des écrits datant d’une époque bien antérieure à la démonstration de ces dernières (un procédé qu'on retrouve souvent chez les sorciers de Lovecrfat).
C’est sans doute dans Prince of Darkness que la concordance scientifique, composante essentielle de la mythologie lovecraftienne, est poussée le plus loin : utilisation des mathématiques, physique des fluides, théorie des quanta (les équations qui s’affichent sur les divers écrans d’ordinateurs ont été rédigées par un chercheur en physique, et font référence à la mécanique des fluides, à l’électromagnétisme et à la physique quantique), mais aussi des théories plus exotiques, comme le message vidéo envoyé du futur par le principe des tachyons, qui conditionne la prise de conscience effroyable des dernières minutes du métrage (le récit qui tend vers une révélation affreuse est aussi l'une des marques de fabrique de Lovecraft), ou ce principe dérivé de la relativité et énoncé dans les années 1930 de la réalité créée par l’observateur… Le mal est envisagé scientifiquement, ce qui rend sa nature et ses manifestations d’autant plus inquiétantes : l’utilisation des insectes s’explique ainsi par le rayonnement électromagnétique de la force qui se met en branle, et leurs apparitions marquent une gradation de la répulsion et de l’étrangeté, sur le mode de l'infection et de la contagion par vecteurs : avec d’abord des fourmis qui grouillent à l’extérieur, sur le campus, puis dans la télévision qui parle de la supernova, avant d’assiéger littéralement l’église (les vitres se couvrent de vers) et finalement les êtres humains (les clochards couverts de fourmis ou d’asticots, mais aussi le chercheur occis qui sert de porte-voix à l’entité).
Cependant, si la science permet de corroborer les faits inquiétants, elle ne permet en rien de les arrêter. C'est encore une fois éminemment lovecraftien (voir par exemple la nouvelle The Whisperer in Darkness). Les messages du futur montrent que les tentatives de circonscrire le Mal dans le monde de l’antimatière ont échoué, et surtout le Mal se manifeste comme une entité dont la nature peut être à la rigueur définie mais non circonscrite, en ce sens que ces manifestations vont à l’encontre des lois naturelles les plus élémentaires : le container est fermé de l’intérieur, le liquide vivant s’écoule vers le haut, la mort ne semble pas un état spécialement gênant, une éclipse étrange semble conditionner le réveil d’une entité pourtant enfermée dans un sous-sol sans vue sur le ciel, et les miroirs se traversent littéralement.
Comme dans les premiers mots de la nouvelle Call of Cthulhu (« Un jour, cependant, la coordination des connaissances éparses nous ouvrira des perspectives si terrifiantes sur le réel et l’effroyable position que nous y occupons qu’il ne nous restera plus qu’à sombrer dans la folie » ), la connaissance est ici non seulement effrayante, mais dangereuse, puisque ce sont des scientifiques venus étudier le container qui s’avèrent les instruments de la libération ultime du Mal. Mal qui, lui-même, rend sa sentence quant à l’utilité ultime et de la religion, et de la science, dans une sentence lapidaire tapée par une de ses marionnettes humaines : « Vous ne serez pas sauvés par le Saint-Esprit. Vous ne serez pas sauvés par le Dieu Plutonium. En fait vous ne serez pas sauvés du tout. » On le voit, les deux "traditions" s’avèrent inopérantes, face à quelque chose de foncièrement autre, et peut-être plus vaste et important que notre réel. A la fin du film, et à l’instar des Grands Anciens (rien ne prouve d’ailleurs que ce mal absolu n’en soit pas un - ou plusieurs), l’avènement de l’entité, ou des entités, SERA, tôt ou tard, lorsque les étoiles seront dans une configuration favorable : ici le motif de la supernova lointaine et l’éclipse de soleil reprennent ce rôle cyclique. Et le motif de la main approchant de la surface d’un miroir reprend symboliquement cette dynamique cyclique, lorsque Brian Marsh, réalisant l’erreur faite par Catherine qui s’est jetée dans le miroir de l’église pour enrayer la venue de ce qui se trouvait de l’autre côté, approche sa main, lentement, du sien. Un plan qui reprend de manière inversée celui de la main du Mal s’approchant, dans le monde de l’antimatière, de la ligne de démarcation entre les mondes. La coupure au noir du générique intervient juste avant le contact. Un final basé entièrement sur la suggestion, que Carpenter, qui pourtant aime aussi pousser ses effets, maîtrise avec un art consommé. En effet ce qui est horrible, au sens fort, n’est qu’une manifestation de ce qui se cache (chairs corrompues, meurtres, violences), alors que ce qui cause ces effets est foncièrement autre, ce qui le confine dans un hors-champ physique (ce qui n’est pas dans le champ de la caméra) et thématique (l’antimatière, l’autre côté du miroir). Tout ce qu’on sait avec certitude, c’est que ce qui est de l’autre côté ne doit pas être beau à voir, s'il est seulement, par nature, supportable par l'esprit humain.
The Thing
Car qu'est-ce que la notion d'Indicible, telle qu'elle est construite par Lovecraft et ses zélateurs, si ce n'est l'affirmation d'un esprit humain par nature étriqué, handicapé conceptuellement, face aux virtualités d'un méta-univers plus vaste, plus étrange, plus terrifiant et recelant plus de beautés que le reflet tronqué que notre monde salue du terme de réalité ? Pour sa première prise de champ dans les fins du monde, et dans les concepts lovecraftiens qu'il se met en demeure de traduire au cinéma, Carpenter s'attaque directement à cet Indicible ou les autres se sont cassé les dents avant lui (et beaucoup après), soit le nœud du problème. En livrant du Lovecraft plein pot sous un camouflage habile.
A priori, La chose d’un autre monde de Christian Nyby (en fait une réalisation "occulte" d’Howard Hawks, ce qui est l'une des motivations de Carpenter, grand amateur du cinéaste), histoire d’une plante extraterrestre intelligente qui imite alternativement des chercheurs scientifiques en arctique pour conquérir le monde, n’est pas lovecraftien pour deux sous, pas plus que la nouvelle originale de John Campbell, Who goes there ?. Basé sur la paranoïa (Untel ou Untel est-il la créature ?), le récit est surtout une parabole anti-communiste comme il en pullule à l’époque. Pourtant Carpenter remanie le script du remake, écrit par Lancaster, pour y flirter constamment avec le lovecraftien en termes esthétiques et méta-textuels. Le film, dans sa contextualisation, apparaît en fait, non pas comme une adaptation officieuse de At the mountains of Madness (le récit se développe sur sa propre ligne narrative), mais comme un récit qui reprend et réarrange ses éléments : la menace fossile qui s’éveille, le shoggoth, les chercheurs en Antarctique, la découverte d’un camp ravagé et d’un site antédiluvien, preuve d’une civilisation non humaine venue de l’espace. La trame générale du script, en tous cas, reprend peu ou prou le canevas chronologique de At the mountains of Madness : une civilisation non-humaine s’éteint en Antarctique à cause d’une espèce protoplasmique. Des millions d’années plus tard, des chercheurs scientifiques découvrent des fossiles de l’époque sur les lieux, ainsi qu’un site de cette civilisation. Leur camp est décimé. Une seconde équipe constate les dégâts, mène une enquête qui revêt une menace pour l’avenir de l’humanité et rencontre le protoplasme. Il ne restera de cette rencontre que deux survivants.
Outre cette révision, à la manière des récits médiévaux, d'une histoire et d'une trame existantes, Carpenter adopte une narration dans une temporalité seconde (la chronologie de la narration n’est ici pas la même que celle des évènements) : l’on revient ici, à l’instar de la construction du récit lovecraftien (voir à cet égard les conseil de Lovecraft au début de son Livre de Raison), à une narration subjective, au travers des yeux de l’un des personnages (d’abord Blair, le docteur, puis McReady, le pilote), référent du spectateur au fil d’une découverte des éléments du récit sous la forme d’une enquête. Ici, l’intérêt premier est bien entendu de faire partager la paranoïa qui s’empare de l’équipe au spectateur, comme le titre de la nouvelle, Who goes there ?, en donne le ton. Tout est en effet basé sur le fait que, à partir de l’assimilation de Bennings (dont Windows a été le témoin avant qu’elle soit complète, ce qui confère à la contamination humaine sa réalité dans cette narration subjective où le spectateur n’en sait jamais plus que les personnages), tout un chacun peut être la Chose. Rafik Djoumi remarque à ce titre très justement que Carpenter brise même la règle de l’identification en jetant le doute sur MacReady lui-même, soupçonné d’être la Chose, et représenté alors par la mise en scène de manière très ambiguë, via notamment un plan de poignée de porte actionnée lentement (visualisation classique de la menace à l’écran) ou quasiment zombifié par le froid. Il faudra attendre la réanimation de Norris (et la mythique séquence de sa transformation) pour que ce sentiment se dissipe… Un peu. Privé de référent puisqu’il l’a soupçonné lui aussi, le spectateur est mis en position de paranoïa active, subissant les mêmes effets que les personnages : le doute qui ressort de la séquence finale (après une ellipse, deux survivant se font face, l’un d’eux est-il la Chose ? Et si oui, lequel ?) entérine cette peur globale de l'Autre.
Logiquement, comme tout au long de la Trilogie de l’Apocalypse, Carpenter s’y emploie à filmer la peur : celle de John Trent dans In the Mouth of Madness, celle du groupe d’étudiant et du prêtre dans Prince of Darkness, et celle des chercheurs de The Thing. Un grand nombre de plans de fins de séquences nous montre ainsi la consternation et la terreur sur les visages : après la neutralisation des diverses manifestations de la Chose (l'horreur dans le chenil, l’incinération de Bennings, la tête-araignée), mais surtout suite aux diverses phases de compréhension de son fonctionnement, qui se closent sur un plan du visage fermé et inquiet de Blair, à savoir l’autopsie et la simulation informatique. Cette monstration de la peur participe bien entendu du principe du récit lovecraftien qui choisit l’empathie en montrant les effets de l’horreur sur le ou les personnages référents du lecteur/spectateur, amené à partager la détresse face à ce qui est au sens fort inconnaissable. Si la paranoïa est le point nodal du film, l’indicible est ainsi son point focal, bel et bien au centre des préoccupations esthétiques. Le choix du titre est en soi éloquent à cet égard : "La Chose", c'est-à-dire une entité qu’on ne peut définir par quelque terme plus précis. Ici l’indicible EST visible, ce qui ne l'empêche pas d'être conceptuellement fuyant. Cela tient grandement à la nature même de la menace : elle n’a pas de forme multicellulaire propre (en tous cas, pas qu’on le sache dans le métrage) et imite les formes de vie qu’elle absorbe, en convoquant des organes suivant ses besoins, dans une sorte de cauchemar darwinien accéléré. La profusion de formes identifiables, mais provenant d’espèces animales différentes, accolées au mépris de la logique de cohésion organique crée des adversaires successifs incompréhensibles au sens fort. Ainsi la séquence, classique dans le film de monstre, de l’autopsie d’un spécimen (ici la "chose-chien"), est dévoyée de son but : là où une telle séquence permet généralement d’objectiver la menace (voir The Brood de Cronenberg), ici, elle jette encore plus le doute quant à la nature de ce qui est donné à voir ; telle incision permet de mettre au jour quelque chose à l’intérieur de la bête, certes, mais quoi ? Cela semble avoir un squelette, être organique, mais sa forme est foncièrement inidentifiable, confusion renforcée par le fait qu’on devine, ailleurs sur le cadavre, plusieurs têtes de chiens contrefaites, mais aussi des excroissances ouvertement insectoïdes dans un magma de chairs, d’yeux et de gueules. C’est en effet en termes de design que la Chose se montre la plus intrigante. En effet, le travail tant technique que conceptuel de Rob Bottin explose complètement les cadres esthétiques de la créature classique (on sort du "guy in a suit"), et l’homme peut se targuer d’avoir accompli un travail de référence, une date dans l’histoire de l’effet spécial, qui utilise toutes les techniques de plateau connues lors de séquence proprement incroyables.
Lors d’une défibrillation cardiaque, le torse entier de Norris s’ouvre sur une gueule emplie de dents, qui dévore les bras du docteur Cooper. Ensuite il en sort un gigantesque panache de chair, bordé de tentacules fins et couvert de membres humains rabougris, qui s’accroche à une gaine d’aération par un jeu de membres articulés et montre au bout d’un cou ophidien une tête aux dents pointues qui est une réplique de celle de Norris. La "première" tête de Norris, elle, s’échappe en se désolidarisant de son cou, puis fuit sous un bureau en sollicitant un tentacule généré pour l’occasion, avant de se munir de six pattes d’insecte et d’yeux pédonculés. On le voit bien ici, l’innommable n’est pas, loin s’en faut, l’immontrable. Donner à voir ne tue pas nécessairement la peur dans l’oeuf, si la chose est faite avec une mise en scène appropriée. Ici l’innommable ne vient paradoxalement pas d’une absence d’analogie avec quelque chose de connu, mais d’une trop grande profusion d’analogies qui se parasitent entre elles. L’horreur ne peut pas plus être niée que définie. Ici, par exemple, la Chose n’est jamais montrée dans son entier, qu’il soit spatial ou temporel ; en effet la créature reconfigure constamment son apparence physique suivant ses besoins immédiats, ce qui en fait une sorte de shoggoth "évolué", tel que ceux décrits par Lovecraft comme « certaines masses protoplasmiques multicellulaires susceptibles de façonner leurs tissus en toute sorte d’organes provisoires » dans At the Mountains of Madness ; la Chose est ainsi un organisme en constante évolution morphologique, ce qui ne permet pas de la circonscrire d’un point de vue conceptuel, dont le fait de la voir ne fait qu’apporter plus de confusion, dans un sentiment très lovecraftien encore une fois. Et c’est, d’une certaine façon, bien pire lorsqu’elle se cantonne à une forme pour se cacher sous l’apparence d’un animal ou d’une personne: elle constitue alors une menace cachée, un danger plus grand encore, hors-champ, ce qui la rend virtuellement omniprésente, comme dans la scène d'ouverture (les norvégiens et le chien) où mêmes les mises en garde sont inintelligibles et anxiogènes.
Et après ?
Autre grand vainqueur des combats avec les défis conceptuels du lovecraftien sur écran, Stuart Gordon, après Dagon et Dreams in the Witchhouse, a entamé une seconde carrière passionnante mais plutôt rangée du fantastique. On ne se frotte peut-être pas à telle mythologie sans séquelles. Si John Carpenter est encore vivant et exempt de folie (une chance incroyable si l'on en croit les récits de Lovecraft !), difficile de ne pas faire une lecture à charge des dernières années de sa filmo, qui tirent de plus en plus la tronche depuis In the Mouth of Madness... Sa Trilogie de l'Apocalypse, par capillarité, semble avoir irrigué l'ensemble de sa filmographie, en termes thématiques (contagion et persistance du mal, exotisme profond, solitude du protagoniste face à l'inhabituel) mais aussi narratologiques (allusions, ellipses, adoption presque systématique du point de vue des personnages, mise en oeuvre explicite du récit à l'écran en montrant quelqu'un en train de raconter). Après In the Mouth..., il se fait certes plaisir (une suite, un remake de film qu'il admire, deux westerns déguisés...), mais avec une mise en scène de moins en moins précise, voire carrément démissionnaire (voir la profusion de séquences découpées en fondus enchaînés mollassons de Vampires et Ghosts of Mars, ou The Ward truffé de rustines de montage, ou les gros soucis de rythme de ses segments de Masters of Horror). Est-ce à penser qu'après son Grand-Oeuvre au sein de son oeuvre, le bonhomme aurait à peu près tout dit en tant que cinéaste ? Les gageures du lovecraftien cinématographique, relevées haut la main dans sa Trilogie (et ce n'est pas un mince exploit), doivent alors d'autant moins être sous-estimées si elles ont réussi à vider un cinéaste de cette trempe.
Sherlock Holmes - Jeux d'Ombres
Même équipe et même relecture postmoderne des mêmes enjeux et des mêmes personnages. En résulte un film qui émule strictement les mêmes traits de caractère que son prédécesseur, qualités comme défauts.
Des attentats apparemment sans lien, peut-être politiques, créent un climat de défiance en Europe qui pourrait bien mener à une guerre mondiale. On accuse notamment les anarchistes, mais Sherlock Holmes, lui, subodore que le brillant professeur Moriarty perpètre des meurtres ciblés d'hommes influents, qu'il cache habilement derrière ces exactions, dans un but mystérieux. Il mène donc son enquête, qui lui permet incidemment de subtiliser un peu plus longtemps Watson à sa toute fraiche épousée. Pour son usage personnel
La question "que dire de Sherlock Holmes 2 ?" revient dans une grande mesure à en poser une autre : "que dire au juste d'un film de Guy Ritchie ?" Hélas, toujours pas grand-chose. Grand chantre d'une certaine esbroufe à la cool, celle qui habille son je-m'en-foutisme des oripeaux d'un iconoclasme à la mode, le garçon fait inlassablement le même film depuis Arnaques Crimes et Botanique. Passé l'effet - relatif - de surprise de sa première lecture de Sherlock Holmes, les composantes du cinéma de Ritchie remontent à la surface du brouet coloré qu'il a à nouveau mijoté : facture technique plaisante, vitesse d'obturation rapide pour donner un sentiment de précision du découpage, scripts fonctionnels à défaut d'être réellement bien écrits (les déroulés temporels sont souvent confus, l'intensité dramatique retombe invariablement dans les climax, les séquences s'annulent les unes les autres), esprit festif claironné par la musique et des dialogues se voulant plein d'ironie, bons acteurs jouant avec morgue des personnages unidimensionnels de Vaudeville, implication émotionnelle nulle.
Sherlock premier du nom, dans cette configuration, montrait toutefois un vrai saut qualitatif dans la filmo du loustic : pour la première fois, on avait devant les yeux un film de Guy Ritchie qui supporte une deuxième vision. Pour peu qu'on oublie un peu Peter Cushing, les aventures de Holmes et Watson (respectivement Kirk Lazarus et Gigolo Joe) ne manquent pas d'agrément, à défaut de faire avancer le propos. En trahissant la lettre, Ritchie retrouvait une part de l'esprit des romans de Conan Doyle, cet aspect serial à la Chéri Bibi qui est aussi l'apanage d'un auteur qu'on avait trop légèrement enfermé dans la respectabilité guindée. Grossir le trait pour refaire du détective un Indiana Jones victorien, après tout pourquoi pas ? Le tout fonctionnait en tous cas très bien, se suivait avec plaisir bien que l'aspect aventureux l'emporte largement sur l'attraction principale chez Holmes, à savoir la logique de l'enquête. Celle-ci rebondissait avec trop de vélocité et dans des trajectoires trop suspectes pour être vraiment concluante. Ceci dit, Ritchie contournait efficacement ses démons avec roublardise (voir les séquences d'action, expéditives, anticipées par Holmes au ralenti et en voix off pour rester lisibles ; soit du surdécoupage compensé par de la radio filmée), mais ne les combattait pas pour autant. Et la lecture très crypto-gay du couple Holmes/Watson, se chamaillant sur des chiffons, se faisant des crises de jalousie quant à leur rupture et la garde du chien, se lançant des insultes féminisées parmi d'autres croquignoleries et regards lourds de sens, n'était pas le moindre de ces démons (la filmo de Ritchie est à ce propos une véritable orgie de corps masculins mi-nus et en sueur, côtoyant des moqueries à la limite de l'homophobie beaufarde tendance Grosses Têtes)...
Vendu, comme d'habitude, comme une suite louder and bigger (bizarrement, les discours promo ne brandissent que très rarement un éventuel better), ce Jeu d'Ombres reprend le flambeau, en plus gros donc. Le commentaire n'en sera que plus succinct. On considèrera la mise en scène d'abord, plus clinquante, pour le meilleur (bien belle direction artistique, cadres plus rigoureux qu'auparavant, découpage plus fluide) et le pire (ralentis ostentatoires voire parfaitement foutraques comme la fuite dans la forêt, montage séquentiel monotone alternant arrivée dans un lieu/énigme/action pétaradante/départ vers le lieu suivant). L'écriture ensuite, qui peu passer pour virtuose dans ses mots d'esprits (certains dialogues sonnent très agréablement) mais complique inutilement sa narration par des circonvolutions artificielles. A ce titre, le désir un peu trop ardent d'arriver à certaines "belles scènes" (la partie d'échecs, la rencontre de Ravache, l'attaque du train, le bureau de Moriarty) imprime des torsions contre-nature au récit si fortes que celui-ci ne soutient plus un examen un peu poussé. Cette histoire eut-elle été un pont qu'elle n'aurait pas été avalisée par les commissions de sécurité... En guise de paravent, un torrent de musique et de pyrotechnie noie ce capharnaüm avec un enthousiasme certes communicatif, mais tout de même assez vain. Ce qui mène à un dernier point, la caractérisation et par extension la notion d'enjeu, paradoxale dans sa collusion de grandiloquence et de dilettantisme.
Car d'un côté on nous enjoint à nous fendre la poire comme à la foire, tandis que de l'autre on nous fait les gros yeux bien régulièrement pour nous rappeler que attention, c'est la guerre mondiale au coin d'la rue mon petit, t'es dans une histoire sérieuse, c'est bien qu'on est dans du drame de douze s'il y a des attentats tous les quarts d'heure. Tout cela est bel et bon, mais à aucun moment on ne ressent de réelle urgence, de véritable danger, ou simplement l'importance des virtualités du récit, quelque gros que soient les canons en lice. La faute au détachement systématique de Ritchie, qui annule avec obstination l'enjeu dramatique de chaque séquence dans la suivante, et préfère nettement nous faire ricaner d'un air complice devant le wagon de coming out (de moins en moins) masqués entre Holmes et Watson... A aucun moment un personnage ne gagne le droit à sortir du statut de stricte fonction (mention spéciale à la pauvre Noomi "je sers juste de taxi gitan" Rapace), voire de simple bouche-trous de zapping thématique (Stephen Fry qui s'ajoute à la collec de messieurs tout nus de Guy). Moriarty en fait les plus gros frais, juste à côté de madame Watson qui ne sert plus que d'aiguillon à la seule relation amoureuse de la saga. Reste Holmes, de plus en plus n'impeux : de génie bagarreur doté de mémoire eidétique, il devient carrément une sorte de super-héros dont les facultés d'anticipation confinent soit à la divination, soit à la télépathie pure et simple (le "dialogue" avec Moriarty au soir du troisième acte), et les aptitudes physiques si capillotractées que le spectateur à le choix entre rester interdit (et donc hermétique, ce qui s'accorde à l'esprit général où même la mort d'un personnage capital ne fait pas plus d'effet qu'une contrariété passagère), ou s'amuser sans se poser la moindre question. Ritchie à en effet, au moins, le mérite d'avoir remis le fun au centre des divertissements d'actions qui se prenaient beaucoup au sérieux ces dernières années. Mais ce qui fait le charme de son dernier ouvrage, à savoir l'affectation d'esprit, d'aisance et de détachement crânement mais agréablement assénés, marque aussi la limite, indépassable, de son projet. Un peu comme Lord Henry Woton, le dandy charmant et spirituel du Portrait de Dorian Gray, dont les bons mots et la décontraction lui assurent beaucoup de succès dans la bonne société, mais ne parviennent pas à cacher son aspect creux, vain, et finalement irritant et mortifère. Sinon, au rayon modernisation du détective, Steven Moffat fabrique en ce moment même une excellente série (qui en est à sa saison 2), et si on est en manque de Downey sapé en drag, le tumblr PinupRDJ est tout aussi amusant...
Rare exports
Dire qu'on avait appris à se méfier des bêtes à festoches du fantastique scandinave est sans doute un bien grand mot, mais disons qu'on avait appris à ne pas trop s'enthousiasmer d'emblée. Une fois l'exotisme retombé, le schéma était souvent le même : concepts initiaux de ouf, belle facture, de bien jolies qualités qui s'essoufflaient irrémissiblement au bout d'une heure de métrage, lorsque les scripts perdaient leur inertie initiale. Et le spectateur de rester sur la touche en compagnie de personnages à l'abandon (voir Morse ou Dead Snow, ou mieux encore Troll Hunter). Voilà enfin un film qui prouve que l'alchimie amour du genre traité/iconoclasme/écriture rigoureuse peut prendre en ces terres enneigées (Cold Prey l'avait déjà démontré, mais sur un autre mode) et remporter l'adhésion complète, de celle qu'on n'achète pas par des coups de coude référentiels à un public de connoisseurs branchés, mais qui vient du cœur d'un récit et des personnages qui y évoluent.
Et c'est bien, avant tout, de cœur qu'il est question dans Rare Exports. Peut-être parce que ses auteurs se sont débarrassés, dans les deux courts métrages préparatoires à ce long, de l'aspect "petit malin" d'un préalable convenu (le concept de "méchant Père Noël" qui fait toujours ricaner les post-ados de tous âges), d'ailleurs développé à la base sur un mode publicitaire dans le cas qui nous occupe. De l'ironie et de l'iconoclasme, Rare Exports en regorge pourtant, notamment dans ses divers climax pas piqués des vers, d'un escadron de vieux messieurs qui courent à poil dans la neige à la poursuite d'un hélico, au vol des radiateurs et séchoirs à cheveux de tout un village pour décongeler le Krampus, en passant par la gestion de la situation avec les moyens du bord ou les consignes de sécurité surréalisantes de l'entreprise minière. De telles idées, très bien distillées tout au long du métrage, ont le mérite de pousser le concept au bout de sa logique de récit astucieux, et le film est réellement amusant dans son inversion d'imagerie, parce qu'il ne s'en contente pas. On sent beaucoup plus un travail sur la mythologie, au sens plein du terme, comme celui qu'on a pu trouver chez Del Toro dans Hellboy et sa suite, dans la mesure où le traitement caustique d'un mythe dont la vision moderne est abâtardie n'a pas besoin de tourner à la parodie pour garder son sel (ici le Père Noël "Coca Cola", chez Del Toro les tooth fairies ou les trolls). Et le film est bourré jusqu'à la gueule d'idées excellentes, toutes poussées jusqu'au bout de leur potentiel iconique ou nawakesque. Mais la ressource principale de Rare Exports, qui permet de faire fonctionner l'ironie des situations, c'est la tendresse. Une tendresse bourrue, maladroite et virile entre les personnages du film (à part quelques figurations, le cast est intégralement masculin) et qui sous-tend l'ensemble de l'histoire racontée.
Le jeu des relations entre la poignée de gars qui vivent, coupés du reste du monde, de la chasse de rennes pour l'exportation, est LE liant du récit, là où beaucoup se concentreraient sur le concept (i.e. l'élément perturbateur) pour faire valoir une originalité plus immédiatement visible. Il est de fait logique (et heureux) que le ton du film abandonne le cynisme de façade à la mode, qui nous a pourri dans une certaine mesure les deux derniers lustres de cinématographie fantastique. En effet, le film est ouvertement solaire dans son traitement, jusque dans l'optimisme de son épilogue. La relation entre Pietari et son père, d'autant plus sincère qu'elle est traité subtilement, permet de servir non seulement de marqueur d'échelle pour le spectaculaire des évènements, mais surtout elle soutient la trajectoire du gosse dans sa croissance symbolique. D'abord mis à l'écart et surprotégé, traité sur un mode différent des "hommes", Pietari est un gamin lunaire, qu'on croit peu dégourdi, qui garde un doudou au bout d'une ficelle et à qui son père empêche de voir ses activités de boucherie pour lui éviter sans doute des cauchemars. Pourtant, bien entendu, c'est lui qui va progressivement prendre l'ascendant sur les autres adultes à mesure qu'il grandit symboliquement : la narration met en parallèle le calendrier de l'avent de Pietari et le déroulement des évènements, notamment en le montrant en agrafer dans un premier temps la porte centrale (parmi d'autres dispositifs amusants à base de pièges à ours dans la cheminée), puis en lui faisant ouvrir lui-même sa version réelle, celle du hangar où se cache le Krampus. A cette occasion il abandonne son doudou, qu'il trimbalait alors en même temps qu'un fusil plus grand que lui, pour définitivement prendre l'initiative. L'artifice narratif peut sembler grossier, il n'en est pas moins limpide.
La limpidité du récit (c'est très bien écrit), mais celle aussi des cadres et de la photo (ça a coûté deux millions, ça?), et la mise en avant de l'enfance, le tout dans un fantastique du conte et de l'émerveillement, sous la neige en plus, font bien entendu penser à Amblin Entertainment. A cet égard Rare Exports n'est pas le premier à sortir botté et casqué du crâne de Steven Spielberg cette année, mais c'est indéniablement celui qui le fait le mieux, sans doute parce qu'il lorgne plutôt du côté de ce que Joe Dante y faisait à l'époque en subvertissant un feel good movie de Capra sans en tordre l'essence (remember l'extrait de It's a Wonderful Life dans Gremlins?). Ainsi, exit les premiers chatouillis de muqueuses avec jeune fille de l'entourage, qui conditionnent dans les Spielberg des eighties le passage à l'âge d'homme ; le chemin de Pietari est personnel et se fait vis-à-vis de l'image que celui-ci veut renvoyer à son père. Contrairement aux autres films qui ont émulé récemment la Amblin Touch, le propos ici est moins d'exalter l'image de l'enfant en tant que prescripteur tout-puissant , détenteur en soi d'un absolu ou d'une vérité supérieurs à ceux des adultes (voir Real Steel). La valeur cardinale est ici la croissance (l'apprentissage, l'abandon du statu quo, la prise de risque, la saisie d'opportunités, l'assomption de soi), et mine de rien ça fait une grosse différence, puisque ce qui sous-tend un discours est plus intéressant que le discours lui-même. Autrement dit l'un détermine l'autre, et la noblesse du propos se retrouve dans la tendresse palpable du conteur pour ses personnages, et celle plus picaresque, entre les personnages eux-mêmes. La rudesse de l'univers (il fait froid, on est taiseux, on dépèce des bestiaux pour vivre, etc.) appelle cette tendresse tacite en contrepoint, certes, mais il y a un monde entre simplement sacrifier au motif, et gérer celui-ci comme le cœur même de l'histoire racontée. C'est toute la différence entre un essai filmé tendance CV de petit malin, et un film sincère, honnête et exigeant. Assurément issu de la seconde famille, Rare Exports est le meilleur divertissement de Noël depuis... Ben depuis Gremlins, tiens.
F Legeron
Salut les ptits clous
Ah ça on nous aura bassinés avec le retour des eighties au cinoche cette année, comme il y a quelques temps avec celui des seventies, qui était toutefois plus justifié. Vivement le revival de la semaine dernière, je retrouverai peut-être mes clés.
D'un point de vue phénoménologique, le monde, ou sa réalité pour parler vulgairement, est en soi moins intéressant à observer que les discours qui sont badigeonnés dessus pour le justifier, qu'ils soient culturels, idéologiques, commerciaux ou tout ça à la fois. Par exemple, mettons, le retour des années 80, créé complètement ex nihilo, et à plusieurs reprises, tout au long de la décennie passée.
Or, si c'est avec les grosses prods à budgets pub colossaux qu'on a le plus entendu gloser sur ledit "retour" (mais retour d'où?), par exemple un Super 8 sitôt vu sitôt rangé distraitement dans un tiroir, avec le betamax, la colec de 45 tours et les badges Touche Pas à Mon Pote, les vrais avatars de cette tendance se trouvent sans doute plus près de nous. Dans des films qui, plutôt que de hurler sur tous les toits leur allégeance à Amblin ou Carolco, vivent comme en stase dans la vieille décennie de Ronald Reagan et Jean-Pierre François. Ce qui somme toute semble logique, dans la mesure où les acteurs des sphères culturelles sont dans une proportion croissante les enfants de la décade, basiquement des gens qui ont grandi avec les Ewoks pour ne découvrir l'Exorciste que dans leur adolescence, et en vidéo. C'est-à-dire ayant intégré avant toute chose, au cinéma, le format du blockbuster* : apparemment simpliste dans son discours, à la technique prépondérante, au découpage emphatique et à la construction morale élaborée, pleine de mots d'ordre subliminaux sur ce qui fait un comportement vil ou honorable (on tape pas une femme sauf si c'est une méchante et qu'elle a frappé ta gonzesse, les mecs cool ne se retournent pas sur une explosion, etc.).
Ce revival se trouve servi, ou utilisé selon les cas, de manières diverses et intéressantes du point de vue de la sociologie des médias et du consulting macroéconomique, pour causer respectivement comme à Sorbonne III ou à la COGIP. Globalement on peut tracer une ligne entre deux catégories . Des films qui utilisent le folklore de l'époque, (vêtures, musiques, références explicites) mais pas nécessairement pour en faire un décalque fondamental. L'un des meilleurs exemples de la tendance est bien entendu Donnie Darko, qui réussissait l'exploit de faire du neuf, voire du visionnaire, avec du Tears for Fears. Et d'autres qui se parent d'oripeaux modernes pour émuler directement les recettes et idéologies de la période, pas pour le meilleur la plupart du temps. C'était récemment le cas de Paul, naveton lucassien dans la droite lignée de Howard the Duck (on ne le dira jamais assez!), né des amours contre-nature d'une nostalgie utilisée à mauvais escient et d'un cynisme tout thatchérien. A vrai dire, que ce soit en mode, en musique ou au cinoche, cette tendance va le plus souvent du pas bandant au saignement des organes sensoriels incriminés : entendre Lady Gaga, voir les sapes des gens à Châtelet les Halles (l'impression d'être au milieu d'une planche de Ranx!), ou se retrouver devant un film de Nispel, c'est un peu kif-kif ; on a un peu envie de dire à tous ces gens que les eighties sont censées être aussi mortes que Freddy Mercury, et qu'exhumer ad nauseam des cadavres pour en revendre des succédanés, uniquement parce que ces succédanés se vendent aussi bien en boutiques de créateurs que chez Auchan, ne fait pas particulièrement avancer la galère.
Deux sorties du mois représentent les faces de cette médaille de dupes. En premier lieu, c'est bien entendu Drive, de Refn, qui attire l'oeil, et plutôt six fois qu'une. Dès le départ on se retrouve accueilli par un titrage de boulard (fausse calligraphie de néon, rose Miami Vice certifié iso 2315) et un festival de musiques qui fleure le Roland 303 à plein nez. Un héros au look soigneusement retrohypeux (vous n'avez pas pu échapper aux commentaires de légions de n'importe-qui journalistiques concernant le blouson qui brille, comme s'il n'y avait que ça à dire du film). Un rythme à la Michael Mann, qui évoque très souvent Manhunter. Sauf que tout cela ne sert à Refn que de substrat, comme dans ses précédents films, pour faire pousser autre chose dessus. Le folklore sur lequel il oeuvre ne l'intéresse pas en lui-même, mais bien en tant que folklore, ou imagerie si le terme peut paraitre plus clair. Refn travaille toujours sur les mythologies, il les casse en petits morceaux pour les séparer les uns des autres et les ranger sous forme d'éclaté, comme ces modèles d'entomologie très beaux et très chers devant les quels votre serviteur regrette la petitesse de son pouvoir d'achat. Les histoires de vikings, de taulards ou de voyous n'étaient que des prétextes à fabriquer du mythe "générique", à étudier la mythologie comme une mécanique. Ici, c'est pareil, sauf que l'imagerie est celle d'Hollywood, où se mêlent le business du cinéma et celui du crime organisé (et étant donné que la Californie est le premier producteur de porno, les cartons de boulard ne sont sans doute pas fortuits non plus), c'est-à-dire un univers qui résulte de la sédimentation d'imaginaires successifs. Soit par définition un système mythologique. On est donc censé se foutre un peu du pitch (mi-cascadeur mi-chauffeur sur des casses pour la mafia, un homme tombe amoureux de sa voisine, qu'il va protéger lorsque leur situation se complique) pour surtout apprécier la construction elle-même. C'est abstrait, mais ça marche pour peu qu'on accepte le principe. Le procédé est très moderne - c'est le même que pour Valhalla Rising - et rencontre en conséquence beaucoup d'incompréhensions, toujours amusantes qu'elles soient positives ou négatives : d'un côté, le dépôt de plainte de spectateurs pour publicité mensongère (ces cons croyaient aller voir un équivalent de Fat and Foirous, pas une déconstruction maline d'une figure de héros, on imagine la déception), de l'autre les nuées de chroniqueuses télé et de gribouilleuses de quart de colonnes qui se pâment devant Ryan Gosling, sans se rendre compte que c'est son personnage en tant que construction qui les séduit, et ce que ça révèle de leur conception collective de l'homme idéal.
Car son personnage du Driver n'existe qu'en tant que créature mythique : il n'a ni nom, ni passé, ni réelle identité (voir la déco monacale de son appartement). A l'instar des héros grecs il n'existe, littéralement, que par des hauts faits et des attributs : une voiture, un cure-dent, un marteau, un scorpion sur une veste, un tabassage dans un ascenseur, des échappées spectaculaires... Le parti-pris est poussé encore plus loin lorsque le type se défait carrément de son propre visage au détour d'une péripétie. Il est au delà du personnage fonctionnel ; il EST une fonction, qui ne fait que ce dont a besoin l'élue de son cœur sur le moment, en ne lui demandant jamais rien, en la protégeant de manière parfaitement inconditionnelle, et même en effaçant par sa simple présence l'ombre d'un homme, trop réel celui-ci, en la personne du conjoint de ladite élue (Oscar Isaac toujours parfait en paumé toxique). Bref, le prince charmant pour une certaine population de citadines aimant à se voir en femmes indépendantes tout en réclamant à être traitées en enfants surdimensionnés. Le personnage du Driver est une itération presque parfaite de celui de One-Eye : pas causant, se prenant d'amitié pour un enfant vulnérable, capable d'habiletés prodigieuses et de déchaîner une violence aussi instantanée qu'excessive (putain, cette séquence dans l'ascenseur!), à la fois sans réelle présence et le point focal de l'attention, et personnifiant l'idée même de sacrifice désintéressé. Pour peu qu'on oublie les histoires balisées de surhommes ultra-individualisés dont on se bâfre à longueur de séances, et qu'on se laisse porter par le découpage très simple, précis et hypnotique de Refn, l'approche vaut vraiment le détour et fait carrément avancer le bousin, sous ses allures de trip à l'ancienne. Malgré un peu de pose, le cinéma de la décennie qui vient se trouve sans doute dans cette direction. On peut s'en réjouir: ça veut dire qu'il y'aura de plus en plus de Bryan Cranston dedans! Plus sérieusement, il s'agit réellement là d'un cinéma VRAIMENT novateur, de celui qui a intégré le post-modernisme pour le dépasser, laissant derrière lui les pusillanimes qui n'y pineront rien et les petits malins qui feront semblant d'y piner quelque chose. Bref, celui trop rare qui caractérise les années 2000 et suivantes dans ce qu'elles ont d'intéressant à apporter sur la table.
A l'autre extrémité du spectre, on trouve Real Steel. De la SF cybernétique (adaptation d'une petite nouvelle de Matheson), un peu de contexte social, des effets spéciaux irréprochables et qui ont de la gueule, Hugh Jackman, une DA qui émule Apple à fond les ballons, tout cela dénote a priori un récit englué jusqu'aux oreilles dans l'ici et maintenant. Nenni point les amis, c'est précisément là, bien cachées, que les eighties se planquent et exhalent leur odeur méphitique. C'est là que les impuretés se déposent. Tout, dans Real Steel, a 25 berges de retard. A commencer par sa structure, qui est un décalque quasi-parfait d'Over the Top, ce gros gâteau au sucre qui sentait fort le cambouis, la tendresse et la sueur virile. Le pitch? Le monsieur en tête d'affiche il était très fort, il a raccroché et vivote dans un lumpenprolétariat indéfini, mais il redécouvre son humanité et sa gnaque avec son fils nouvellement entré dans sa vie, et alors ils prennent la route ensemble, et ils refont de la compète et ils sont trop super potes et à la fin ils gagnent sur fond de rock fm, arrêtez-moi je vais lâcher un renard.
Et oui, Real Steel est en premier lieu un putain de buddy movie avec enfant, peut-être le sous-genre le plus emblématique des années 80, avec ses variantes allant du buddy movie avec animal au buddy movie avec extraterrestre en passant par le buddy movie avec handicapé mental : un personnage expérimenté et bourru devant interagir avec un trickster tout mignon et candide. De là découle son parcours parfaitement balisé, les films qu'il singe en termes de style, de péripéties ou de discours (Any wich way you can, l'Ours, La Relève, Futur Immédiat Los Angeles 1991, Rain Man), discours constituant sa tare numéro un dans son formatage et son infantilisme militant : l'enfant détient la vérité, une vérité nécessairement toute pleine de licornes et de bisounours, et c'est lui qui éduque l'adulte forcément cynique donc dans l'erreur quant à la vie, l'amour et la coiffure. Et ceci n'est pas un effet pervers - c'est un projet de société qui a si bien pris que nul ne le remet plus en question, au point de réactiver régulièrement de vieilles esthétiques en se persuadant très fort qu'elles sont neuves (le gosse arbore par exemple un T shirt à l'effigie de Van Halen, ET une coupe à la Justin Bieber, tout ça dans les années 2030...), dans un jeu d'imitation constant que les pédopsys connaissent bien**. Un jeu d'imitation qui fait ici partie intégrante du discours du film, dans la mesure où la figure de la rédemption et de la victoire est un robot sparing partner dont l'atout en combat est une fonction miroir, c'est-à-dire un mimétisme parfait du comportement immédiat...
Cette émulation se retrouve dans la forme même des combats entre robots, qui va logiquement chercher du côté des Rocky, mètre-étalon (-italien!) de la boxe cinématographique (avec Raging Bull, certes, mais sur un mode plus arcade, moins seventies), mais de ceux des eighties, encore, le 3 et le 4, soit les plus proustiens pour beaucoup d'entre nous petits déviants, mais aussi les plus discutables idéologiquement. Mais dans la manière dont les rencontres successives sont articulées en road-movie, on retrouve surtout un petit film pionnier du placement produit, autre buddy-movie avec enfant (avec cette fois un jeune autiste dans le rôle du candide), The Wizard (Videokid chez nous). Y'a même un adversaire avec un Powerglove ! C'est dire si ce que Real Steel cherche à faire est de faire passer la mythologie (le badigeon de discours sur le monde) pour la réalité des enjeux humains, là où Drive prend justement des enjeux humains forts pour les montrer comme étant une mythologie. Si on était dans une publication plus marquée politiquement, on parlerait de propagande destinée à faire en sorte que les veaux continuent d'aller au pré... Ou à l'abattoir.
Pourtant, le film est plaisant, attachant même dans sa facture, au même titre que ses modèles, et son discours, pour être formaté, a néanmoins toutes les chances d'être sincère dans ses intentions affichées : l'équipe de prod (Zemeckis en tête), d'écriture et de réa vient en grande partie du film familial et/ou de la télé - il y a fort à parier qu'ils pensent réellement promouvoir une belle histoire de relation père-fils qui permet au papa de revenir un homme bon (et d'emballer le meuf). Les noirs desseins de l'époque n'ont plus besoin d'un cerveau central, ils sont parfaitement internalisés par les agents économiques, pardon, les veaux, pardon, les gens***. C'est d'ailleurs la différence entre la dureté des années 80, et celle de leur copie plus pâle, moins consciente d'elle-même, que sont nos années 2000/2010. Et en effet, on aura du mal à bouder son plaisir : les robots déchirent et son bien filmés, Jackman est très bien, la lumière est magnifique et on se surprend à avoir huit ans très régulièrement au long du métrage (la casse, le combat contre le robot à deux têtes, celui contre le taureau, le méchant escroc). On serait tenté de dire que c'est précisément là qu'il faut se méfier, mais ce serait prendre le spectateur pour un crétin incapable de dissocier un spectacle et le discours qui le sous-tend, et obligé d'adhérer au second s'il prend plaisir au premier... C'est sûr qu'à côté de la cohérence et de la puissance d'un Drive, Real Steel fait un peu petit bras, mais on n'est pas forcé de bouffer que du caviar - un bon McDo, ça se mange très bien aussi.
*Oui le blockbuster comme base de nos cultures gé, gamin, même si ça fait moins raffiné. Tu matais des Rivette, toi, ou même simplement des Larry Cohen, quand t'étais môme ?
**Par exemple en traitant comme récemment la mort d'un PDG comme celle d'un leader religieux.
***Voir la seconde note.
The Thing.
Une préquelle explicative, pour un chef-d'oeuvre qui fonctionne entièrement sur l'idée d'inconnu? En voilà une mauvaise idée !
"Let's find a shovel"
Un camp abandonné, gelé, partiellement incendié. Les véhicules sabotés, un grand cercueil de glace éventré dans l'appentis ouvert aux quatre vents. Des notes, photos et bandes vidéo énigmatiques. Un homme mort assis devant la radio muette, un rasoir dans une main et des stalactites de sang au poignet. Une créature indescriptible, d'un composite délirant, au visage humain presque dédoublé, calcinée, à l'extérieur. Dans The Thing, c'est tout ce qu'il faut à John Carpenter pour évoquer les évènements du camp de scientifiques norvégiens, d'où deux hommes apparemment fous et un chien de traineau ont atteint les lieux de son récit à la première bobine. La force d'évocation de la séquence, soutenue par un sens de l'allusion tout lovecraftien (cf la redécouverte du camp de base dans les Montagnes Hallucinées) et un découpage au cordeau, place d'emblée ce qui va suivre dans une optique mythologique écrasante en en décuplant les développements. Plus tard, deux mate paintings et trois bouts de métal suffisent pour figurer un vaisseau spatial fossile. Sans montrer quoi que soit d'autre qui explique la nature profonde de la Chose.
L'incertitude est souvent le prétexte des fanfictions, ces objets bâtards et la plupart du temps parfaitement vains qu'on trouve sur des forums internet datant de 2002. Le schéma de Alien VS Predator s'est manifestement répété ici : comme si toute zone de flou ou d'allusion dans une histoire était une source de frustration insupportable, l'on s'est jeté sur l'objet du problème (le camp norvégien pour The Thing, naguère la salle des trophées de Predator 2) pour en éclairer tous les aspects sous un projecteur de mirador. En terme de narration et plus largement de construction mythologique, l'idée est pour le moins discutable, en cela qu'elle réduit l'univers auquel elle touche en le circonscrivant dans un cercle toujours trop petit pour ses potentialités*. Cette mauvaise idée, c'est précisément celle qui préside à ce reboot/remake/préquelle (ou n'importe quel terme qui sera à la mode le mois prochain pour désigner cette logique créative de planqués qui fait rage depuis quelques années à Hollywood).
Des scientifiques norvégiens trouvent un vaisseau spatial enfoui depuis la préhistoire au milieu de l'Antartique. En tant que pays sous-développé et dépourvu de la technologie adéquate (ça doit être ça), ils amènent une biologiste américaine pour analyser son occupant. Celui-ci s'avère être un métamorphe hostile, qui absorbe les êtres vivants pour les imiter et remplacer à terme la population endogame. La résistance pour le confinement de la menace s'organise, dans une chaine d'évènements qui mènera à ceux du film de 1982.
En l'état il n'y a pas beaucoup à dire sur ce The Thing de 2011, pour peu qu'on l'envisage indépendamment de celui de Big John. Un huis-clos fantastique typique de ce qui se faisait dans les années 80 et 90, ou un groupe plus ou moins hétéroclite fait face à une entité quelconque qui bien entendu le décime un par un. Devant cet objet on pense beaucoup à ces petits métrages post-Alien, ou mieux aux productions sous-marines d'après Abyss, comme l'inénarrable Leviathan de chez de Laurentiis. Et en effet ce n'est pas un compliment. Et, en effet, c'est mérité. Globalement, The Thing pourrait être honorable pour une première réalisation de long pour le cinéma, ou pour un DTV luxueux complètement hors de l'ombre d'un grand film. Au nombre des qualités du film, une bonne interprétation (pour peu que Winstead ait quelque chose à jouer, elle est bien plus qu'un joli visage) et une bonne idée : l'organisme étranger ne pouvant apriori imiter que des matières organiques, la chasse aux prothèses, boucles d'oreilles et plombages dentaires constitue le meilleur moyen de tester l'humanité de ses petits camarades. Pas une purge complète, mais certainement pas un très bon film non plus, tout au plus un produit de consommation courante sans grande personnalité. Les défauts de son exécution, néanmoins, deviennent pires que rédhibitoires étant donné que par nature, ce téléfilm augmenté est accolé à l'un des chefs-d'oeuvre du cinéma d'horreur (du cinéma tout court) aussi cavalièrement que lors d'une saillie de chiens de race.
Car le bât blesse méchamment précisément aux entournures qu'il tente de gratouiller avantageusement chez l'admirateur de l'original. Et à s'appuyer sur le statut de classique du film de 1982 pour faire passer le cochon payeur à la caisse, mais sans JAMAIS se donner la peine de réfléchir à ce qui fait l'essence dudit classique, ce The Thing passe rapidement d'erroné à embarrassant, avant (mais sans doute fortuitement) de carrément nier son modèle. On se désole donc devant un jeu des sept erreurs qui revient à identifier les cibles d'un autre jeu, de massacre celui-ci.
La plus évidente de ces négations est bien entendu le rôle-titre et clou du spectacle, la Chose elle-même. Et d'abord le choix systématique de l'imagerie de synthèse, de surcroît de qualité plus que moyenne : textures à la traîne, intégrations hasardeuses et surtout un design quelconque, un comble pour une telle créature et une véritable insulte à Rob Bottin. Quand Carpenter faisait tout pour échapper au syndrome du "guy in a suit" pour son monstre, The Thing 2011 se vautre à grands délices dans son équivalent actuel, le machin-en-CGI-on-verra-ça-à-la-post-prod. C'est bien simple, à grands renfort de bras cavaleurs, de bestiasses qui sautent partout, de surgissements incongrus, de visages factices foutus à la va-comme-jte-pousse sur des corps zarbis comme dans un Stephen Sommers, la Chose n'est plus l'incroyable protoplasme agressif de 1982. Elle n'évoque au mieux que les nécromorphes de Dead Space. Son comportement et ses manifestations sont d'ailleurs raccord avec cette analogie ; attaques opportunistes et indépendantes du contexte, comme un prédateur de base, alors que dans l'original (soit seulement trois jours plus tard dans le scenario) le mode opératoire du même organisme consiste à n'attaquer que lorsqu'il est seul avec sa proie, ou à ne se révéler qu'acculé par le groupe (la réanimation de Norris, le test sanguin). Moins maline, la Chose d'aujourd'hui est aussi nettement moins inquiétante. Mais surtout, sûrement pour relancer régulièrement l'intérêt d'un spectateur qu'on a supposé gavé de zapping, les séquences d'attaques sont d'un spectaculaire absolument disproportionné : il faut voir la créature bâclée s'extirper d'un bon de son bloc de glace, et traverser le plafond dans le même mouvement, pour mesurer le point auquel ce projet est côté de la plaque. Tout est de la même eau, à commencer par les péripéties obligées par le statut de préquelle, celles qui doivent correspondre aux dégâts que les protagonistes du film de 1982 vont découvrir. La créature calcinée dans la cour se retrouve ainsi justifiée par une fusion à la va-vite (presque un morphing!), la hache dans la porte est placée là par un prétexte honteux, d'autres actions ne bénéficiant même pas de ce traitement expéditif pour être purement et simplement passées sous silence. Quant aux survivants qui poursuivent le chien en hélico, l'ensemble de l'action est reléguée en plein générique de fin (!), avec un nouveau norvégien qui se pointe en hélico comme le beau deus ex machina qu'il est. Jamais séquence aussi fondamentale (c'est quand même la raison d'être du film) n'avait été expédiée de la sorte. Belle cohérence.
Des actions prétextes quand elles ne sont pas strictement fausses dans l'économie du récit : Pourquoi diable mettre le vaisseau spatial sous la glace alors que les vidéos vues dans l'original montrent sa découverte à ciel ouvert, puisqu'il est remonté suite aux mouvements millénaires du permafrost ? Avait-on réellement besoin d'entrer à l'intérieur du vaisseau, et de le remettre en route histoire de montrer des installations qu'on jurerait sorties de Cowboys vs Aliens ? Encore une fois, adieu mystère, angoisse et inconnu - adieu, donc, toute la parano métaphysique qui faisait l'intérêt de l'original - ne reste qu'un festival d'incohérences pour stimuler le neurone esseulé. Idem des quelques plans ou scènes qui émulent maladroitement ceux de Carpenter, comme un traveling dans un couloir, un plan de l'unique chien dans son enclos (un seul chien, est-ce bien sérieux?), ou la séquence de confrontation entre les deux survivants en fin de troisième acte, qu'une simple comparaison confine au ridicule : aucune ambiguïté, on sait précisément qui est qui et la séquence se résout au lance-flammes sans soucis aucun. Ouf, chacun sait à quoi s'en tenir et les veaux iront au pré. Était-il possible de moins comprendre l'essence de The Thing?
Ajoutons à tout ceci une caractérisation incroyablement floue et fonctionnelle servie par un cast transparent (à part un roux et le chef, les seuls persos un peu développés sont les américains, les autres sont une masse scandinave indifférenciée dont manifestement tout le monde se fout), un découpage certes étanche mais ne véhiculant strictement rien (à nouveau, quand on passe après Big John au sommet de sa forme, ça la fout mal) et un score anecdotique, et on comprendra l'absence complète d'enjeux thématiques et dramatiques du film: d'ailleurs, la compréhension de la Chose et des implications de son fonctionnement se font en trois répliques débitées sur le ton d'une conversation de salon de thé. Ce qui est problématique pour une histoire d'apocalypse... Autant rester chez soi et remater son vieux DVD, en tous points plus tangible, plus lovecraftien, plus intéressant et plus consistant artistiquement que cette classe de neige qui tourne mal. Pff, même la suite sur PS2 rendait mieux justice à son modèle.
*Voir par exemple les successives explications des origines de la configuration de Lament dans l'univers de Hellraiser, dont le film original avait l'intelligence de se prévaloir.
Cowboys and Aliens
Comme d'à peu près tous les films de John Favreau, il n'y a pas grand-chose à dire de Cowboys and Aliens. Un concept de base sympatoche bien qu'un peu enfantin ("ouais mais à ton avis, c'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant?") et vain une fois le titre prononcé à voix haute (vous vous souvenez VRAIMENT de Snakes on a Plane vous?). Un affrontement viril entre ganaches charismatiques, du perso secondaire balisé, du perso féminin qui sert pas à grand-chose. Le tout emballé dans une facture technique très propre, parfois même enthousiasmante, avec des péripéties de serial dynamiques en dépit de leur aspect mécanique et de leur quasi-absence de suspense général.
Selon des critères communément admis parmi les posteurs de commentaires sur l'interweb cinéphile, Cowboys and Aliens est donc un bon film estival, pas méchant pour deux sous et qui ne fait sans doute de mal à personne. Seulement voilà, l'été touche à sa fin, et il nous a donné X men First Class et Planet of the Apes, le bougre, alors on a un peu des goûts de luxe en termes de divertissement qui se sort les doigts. On aura donc soin de laisser son mauvais esprit (ou simplement ses exigences) à l'entrée de la salle, pour se concentrer sur l'aspect au premier abord bien agréable du film lui-même ; on a tous besoin de futilités, et celle-ci au moins est honnête.
Principale attraction du spectacle : Daniel Craig, impeccable. Favreau ne s'y trompe pas et nous le met le plus possible à l'image, du début à la fin. Presque mutique ("What do you know? _English."), classieux, altier, sec et animal dans ses mouvements, le type bouffe l'écran comme jamais depuis Munich. Le reste du cast en pâtit, bien sûr. La "Number 13" de House M.D. en tête, manifestement foutue à l'affiche juste pour faire joli. Son personnage justifie dans une certaine mesure son aspect peu crédible en gonzesse de l'Ouest (on va pas spoiler, mais en même temps le twist de second acte ne vous retournera pas le cortex préfrontal non plus), mais franchement, à ce point de tronche de mannequin et de manque de charisme, elle mériterait un Razzie. Ou une couv de Vogue. Disons qu'on est très loin de Juliette Lewis dans Blueberry.
Cet effacement de fait face à Craig est un poil plus dommage pour les seconds couteaux qu'on a toujours plaisir à recroiser, Sam Rockwell et Clancy "donnez-lui un premier rôle" Brown, qu'on aurait bien aimé voir un peu plus longtemps. Harrisson Ford, définitivement devenu une vieille ganache, assure le service minimum mais a quand même l'air de s'emmerder un peu dans ce qui se veut une variation moderne de la Vallée de Gwangi, avec des extraterrestres tout méchants à la place des animaux préhistoriques partouzeurs de droite. Faut dire que son perso est encore plus linéaire que les autres: au début il est pas cool, mais en fait après il est sympa et à la fin ils sont potes, et gna et gna. Bref. Les autres aspects du récit sont à l'avenant... Découpage fonctionnel, cadres lisibles mais pas à se la taper au sol, évolutions de persos tellement éculées que même ton chat les connait par cœur (ah, ce connard de fils à papa qui décide de devenir gentil à la fin), effets spéciaux pas révolutionnaires mais classieux quand même, et euh... Joli générique? Accessoires rigolos? Indiens pas dégueux?
Bon ben voilà, que dire d'autre? Les aliens du titre sont amusants en dépit de leur design absolument approximatif et peu défini : on pense à la manière dont George Lucas avait créé certaines créatures de sa prélogie, en collant entre elles, au petit bonheur la chance, des parties de corps de plusieurs designs différents ; ici c'est pareil, pour exotique que paraissent à première vue les bestiaux mineurs d'or (et encore, on sent l'influence de la Guerre des Mondes de Spielberg ainsi que celle de... Independance Day!), à aucun moment leur univers ne semble cohérent, tant en termes biologiques que sociaux ou techniques. Cependant, une fois accepté l'illogisme global du monde dépeint, illogisme d'ailleurs accentué par une vision du far west très séduisante en comparaison (on pense parfois à Open Range), on appréciera des scènes d'action gentiment troussées, dont une attaque de village bien brutale et un assaut final assez bordélique. Le reste, ben on s'en fout, parce que si on commence à y faire attention, on s'énerve. Eh les mecs, c'est un film de Favreau, faut pas trop creuser.
Deux options pour voir ce film : être indulgent et s'amuser - un peu - ou espérer un film un peu plus évolué et s'énerver - beaucoup. Restent l'action, les effets, et Craig. Et on peut aller pisser à peu près quand on veut, en revenant à son siège on sera pas perdu...
X Men First Class - M. Vaughn
A une période où le film de superhéros est devenu un genre en soi, avec quelques locomotives et des brouettées de tout-venant allant du moyen-moins au honteux, l'un des plus illustres instigateurs de la vague reprend en main son bébé, y engage les bonnes personnes et leur fait faire un vrai film. Ça y est, ils ont compris !
Matthew Vaughn n'est pas Brett Ratner, ce qui n'est pas la moindre de ses qualités. Dis comme ça, ça semble évident, et pourtant, X Men 3 avait tristement confirmé la malédiction des derniers actes de trilogies dans le monde du comic book filmé (Blade Trinity, Spiderman 3), devenue depuis peu une malédiction des seconds actes (Iron Man 2, le Hulk de Leterrier). Le cœur du problème? Le mépris du médium adapté et sa réduction à la seule notion de franchise commerciale, corrélable à une simple équation comptable résultant d'une formule à reproduire sans réfléchir. Pusillanimité crasse de la narration, négation des enjeux thématiques, infantilisation des enjeux humains dans le but de simplifier au maximum la mythologie de base, et partant de ratisser large pour engranger du pognon rapidement et durablement (i.e. garder ses positions sur un terrain financièrement juteux). On citera en exemple le projet Avengers, dont les films préparatoires tirent méchamment la tronche par leur absence quasi-totale d'enjeux dramatiques et physiques, dans le but évident d'économiser les cartouches d'une saga surestimée. Autrement dit, on construit une série au détriment strict de ces éléments constitutifs essentiels. Marvel et Fox tâtonnent depuis quelques années à ce titre, dans les séries susnommées mais aussi avec les X Men, qu'elles ont failli détruire irrémédiablement en raison de choix scénaristiques, esthétiques et cinématographiques calamiteux (Last Stand et Origins : Wolverine, dont il serait fastidieux de détailler la tératologie), niant souvent les acquis des efforts précédents en termes de caractères et de propos.
L'ironie est bien sûr plaisante, après qu'il ait été "démissionné" de Last Stand (encore une fois, ici n'est pas le lieu de refaire le feuilleton, cent fois exposé ailleurs, de cette production dont le chaos et le je-m'en-foutisme ont donné le résultat qu'on sait), de voir Matthew Vaughn imposé sur First Class par un Bryan Singer qui tient à réinstaller ses mutants de pellicule dans les standards qualitatifs qu'il avait jadis imposés. C'est aussi qu'entretemps, le très rentable Kick Ass est passé par là et a impressionné son monde précisément sur tout ce qui fait défaut au Ratner et à Origins : une écriture envisagée comme telle (c'est-à-dire pas comme un collage tayloriste de séquences débilitantes), des enjeux dramatiques effectifs (les personnages encourent de réels dangers), des ruptures de ton maîtrisées et des personnages traités avec le respect qui sied, formule reprise ici scrupuleusement. Le retour de Vaughn, mais aussi le synopsis du film, montrent assez la volonté de faire non pas table rase des errances passées (le numéro 4 est en projet, la suite de Wolverine sur le feu), mais de revenir ostensiblement à une sorte de pureté originelle du concept : un temps, pour les X Men, "d'avant la chute" si l'on peut dire (celle de Magneto, mais aussi de la franchise). Nous sommes ici en 1962, autant dire que tout est à nouveau à construire tant narrativement que thématiquement. Le terme à la mode de reboot, pour le coup, est justifié et permet de partir d'acquis indéniables dont la familiarité et l'investissement du public pour l'univers et les personnages, tout en laissant sous le tapis certaines erreurs embarrassantes ("I'm the Juggernaut, bitch !!!").
Effet positif indéniable de l'opération, le relâchement des contraintes intenables d'une franchise trop lourde libère enfin le potentiel thématique du projet. Joie : on ose enfin aborder frontalement les enjeux idéologiques, politiques et anthropologiques de la mythologie X Men, ne se contentant plus de simplement les placer dans un arrière-plan nébuleux, ou de les circonscrire dans un seul personnage de méchant fatalement lénifiant (même si Stryker fait une apparition dans le film). Le film cite directement le premier de Singer en reprenant en ouverture la séquence du jeune Magneto dans le camp de concentration, et construit de là sa dramaturgie en faisant d'emblée entrer en scène Sebastian Shaw pour le faire deviser sur l'eugénisme nazi. Les prérogatives du Hellfire Club, dont il est plus tard présenté comme dirigeant, sont ainsi un peu éludées (sur papier, le club est réservé à une certaine aristocratie, son idéal est avant tout basé sur la réplication sociale et l'influence occulte) pour être redirigées vers la notion d'évolution darwinienne et sa lecture biaisée par les suprématismes. Les années 60 sont ensuite utilisées à plein régime pour continuer à fouiller dans les plaies de cette rhétorique des luttes raciales. Le récit prend donc place à une époque où les manichéismes ne font pas que s'opposer, mais se justifient et s'entrecroisent les uns les autres : oppositions raciales, économiques, politiques et culturelles se rejoignent sous la même bannière rhétorique (pour simplifier, une notion globale de lutte héritée du XIXeme siècle), les différences ne portant in fine que sur les folklores utilisés en effigies.
Ainsi l'opposition de caractères et d'idéal politique entre Lehnsherr et Xavier transpose celle, bien réelle, entre Malcom X (prônant la guerre civile et armée) et Martin Luther King (non-violent systématique), ce que faisait déjà le comic book dès 63. Là où le film fait fort, c'est qu'il interroge à l'égal ces deux démarches en caractérisant "à charge" aussi bien Xavier que Magneto : adieu l'attitude monacale de super-gentil en fauteuil roulant, bonjour le gosse de riches qui drague avec sa télépathie et son gros QI dans les swingin' sixties de la Nouvelle Angleterre. Son discours de respect et d'intégration entre mutants et humains, Xavier le tient avant tout parce qu'il peut se le permettre, contrairement à une Mystique dont la condition est visible. Elle constitue d'ailleurs l'un des enjeux de sa joute idéologique avec Lehnsherr, dont le romantisme radical du discours cache mal sa rigidité, son manque de perspective, et l'égoïsme de ses motivations (S'il poursuit Shaw, c'est par vengeance - il ne conteste en aucun cas son discours d'extermination des sapiens qu'il reprend à son compte). La crise des missiles cubains catalyse à point nommé les cataclysmes à venir (guerres entre nations, entre espèces, entre factions de mutants), dont l'idéologie est à la fois la force motrice et le simple alibi. Les relations entre des personnages pour la plupart finement caractérisés explorent plus avant toutes ces notions, avec toujours ce soucis d'aller voir plus loin qu'un discours simpliste : la seconde mutation de Beast, malgré son aspect "fable édifiante", illustre bien la situation dans laquelle se trouvent les mutants désormais communautarisés. Il est d'ailleurs à la base "outé" par Xavier (certes par inadvertance)...
La mise en scène prend assez brillamment le relai de ce discours sur une époque, en en émulant l'ambiance particulière, toute de high tech suranné et de candeur insouciante, sur fond d'horreurs et de dangers idéologiques multiples. On glose ici et là sur le talent de Vaughn à s'approprier les imageries, et en effet le bonhomme s'y entend pour nous ressortir les bonnes vielles fragrances d'un On her Majesty's Secret Service, d'un In Like Flint, et surtout d'un Diabolik. Il faut voir Magneto traquer d'anciens nazis (pour son propre compte) dans une taverne argentine, ou attaquer le yatch de Shaw en combinaison de plongée (on pense souvent à John Philip Law ou à George Lazenby) pour avoir une idée du travail sur l'évocation des 60's, mais surtout sur leur appropriation par un projet qui en fait son essence même. Les bémols habituels sont bien entendu présents, certains mutants assez insignifiants ou réduits à la figuration (Riptide, Havok, les jeunes mutants en général...), quelques dialogues ne sonnent pas très bien ("Neeeeiiin!"), mais le principal est là : de vraies scènes d'action bigger than life et narratives, des mutants charismatiques, bien joués et beaux (Azazel, Mystique, et un Kevin Bacon absolument visqueux en Shaw), des trajectoires de personnages complexes et émouvantes (James McHavoy est décidément à suivre, Michael Fassbender est incroyable) et une mythologie respectée par son adaptation, ce qui est rarissime. Vaughn est en constant progrès, Singer a repris la barre, et d'autres feraient bien de s'en inspirer. Car First Class réussit là où le récent Thor échouait : c'est un film réellement intelligent avec un récit réellement épique (des personnages meurent, tuent, vivent des évènements), des personnages réellement attachants, des situations crédibles, un spectateur respecté et même des cameos réellement amusants. Et le tout a le bon goût de ne pas être en 3D.
Balada Triste de Trompeta
"un clown avec une machette, ça va leur foutre les jetons à ces connards"
Alex de la Iglesia est le meilleur réalisateur espagnol en activité. Alex de la Iglesia a la mégaclasse et ne s’en laisse pas conter, comme le prouve son dernier coup d’éclat en date : président depuis deux ans de l’académie du film, il est parti avec pertes et fracas pour ne pas cautionner l’Hadopi locale promue par tous ses petits camarades (Almodovar en tête), et a foutu un beau bordel comme on rêverait d’en voir chez nous. Pourtant Alex de la Iglesia a déjà été pris au collet de la conformité avec Oxford Murders. Il faut comprendre ce demi-échec artistique pour apprécier pleinement la résurrection anar que représente ce Balada Triste. Il faut en fait remonter au moins à Perdita Durango, qui devait ouvrir toutes sortes de portes internationales (notamment américaines) à son auteur. Trop fou, trop agressif, trop cul, trop stylisé, trop baroque, et faisant surtout trop peu de concessions à la bienséance, le film s’est banané en beauté par faute d’une distribution décente. Alex (vous permettez que je vous appelle Alex ?) a ceci de particulier qu’il fabrique des boulets qui ne correspondent pas au diamètre des canons les plus répandus, où s’engouffrent sans peine tant d’autres cinéastes pourtant considérés comme iconoclastes. Au passage, il met en évidence l’effet pervers d’un certain mode de production et de distribution, où un film peut être sanctionné de la sorte précisément pour excès de qualité et d’originalité.
Diffusé donc de manière très très confidentielle par ses propres instigateurs (bonjour la prod Canal + qui le sort en France en putain de DTV plusieurs années après sa sortie officielle), son ticket pour Hollywood lui est passé sous le nez : de retour en Espagne, le sieur s’est employé à faire des comédies plus ou moins noires qui comptent parmi les meilleures des 15 dernières années, en rodant ses effets et son discours. Paradoxalement (car il s’agit de films complexes avec des thématiques riches et multiples), leur caractère plus identifiable, plus propice à être rangé dans un genre, a permis à ces films de lui valoir le succès qui lui avait été refusé lors de Perdita Durango – et le sésame de se rouvrir. Lorsque l’occasion s’est à nouveau présentée, on peut comprendre que de la Iglesia ait plutôt joué la carte de la démo technique en mettant ses idiomes dans sa poche. En résulte le film qu’on sait, très bien fait, bien écrit et bien joué, mais étouffant d’immobilisme, platonicien jusqu’à la caricature, aussi plat qu’un encéphalogramme d’écureuil mort et inoffensif comme une révolte de Stéphane Hessel. Entre deux propositions dont on se contrebranlait (Elijah Wood qui baise, des discussions philosophiques déjà entendues dans La Corde et mille fois depuis) et de timides saillies misanthropes qui rappelaient parfois qui était aux commandes (le bus d’handicapés), on s’emmerdait quand même un brin en se disant que s’il fallait qu’il fasse ça pour continuer, c’était un mal nécessaire.
Heureusement (ce qui est malheureux à dire), et en dépit de qualités réelles, Oxford Crimes est passé un peu inaperçu et a renvoyé notre Alex à ses droogies (la réconciliation avec Santiago Segura semble consommée) et sur ses terres (on peut d’ailleurs se demander si ce film très sage n’a pas joué comme patte blanche pour l’Académie suscitée). Face à cette déconvenue, le type réagit intelligemment : il pète la gueule à tout, déclare l’enfer au monde et à son propre cinoche et colle avec plus d’ostentation qu’auparavant des nez rouges aux cavaliers de l’Apocalypse. Accessoirement, il met tout, absolument tout, dans son dernier effort en date, dans une esthétique de collage dont l’accumulation elle-même devient une violence systématique, volontaire et dirigée. A l’opposition de celle, intransitive et nivelante, de l’époque actuelle qui mélange tout dans un magma où plus rien n’a de spécificité et où tout avatar culturel se retrouve annihilé dans le relativisme et l’inculture indifférenciée (le premier qui a reconnu la pseudo-inventivité gloubiboulguesque saluée chez une Lady Gaga par exemple, on lui offre une sucette). Ici, les collisions de référents, d’ambiances, de sentiments et de motifs artistiques ont pour vocation de provoquer la fission avec suffisamment de masse critique pour que tout pète, fort et sur tout le monde. L’incroyable générique d’ouverture, qui accole brutalement visions et personnages de l’histoire espagnole franquiste et figures de la culture populaire, artistique, cinématographique et télévisuelle (dont un hommage discret à Paul Nashy) donne le ton d’une négation de la hiérarchie culturelle sur une prétendue noblesse qu’auraient certaines de ses occurrences par rapport à d‘autres. De la figure de Dali à un club Kojak, du Ghost Rider à Goya ou à la Valle de los Caidos, tout élément de la vie physique ou mentale dépeint ici a potentiellement la même importance dans la construction subjective et pathologiquement hallucinatoire d’un monde monstrueux appelé à n’engendrer que des monstres. L’hétéroclisme forcené du film n’est pourtant pas désordonné, et encore moins gratuit – il est excessif. Il reflète surtout très précisément la vie de Javier et celle, à travers lui, de l’Espagne du vingtième siècle et de ses paradoxes.
La vie de Javier d’ailleurs, parlons-en : c’est le personnage typique de de la Iglesia, inapte, inepte, par moments magnifique, vu avec autant d’empathie que de mépris, et condamné à échouer dans ce qui lui tient à cœur, ou dont les rares victoires ne peuvent être que d’une amertume délirante. Car si le monde que voit le cinéaste crée des monstres parce qu’il est monstrueux, ce n’est pas pour autant à ses yeux une excuse pour les monstres. Misanthropie et humanisme (à l’instar des tatouages love et hate du pasteur Powell) sont les deux éléments indissociables de la personnalité de de la Iglesia, qui semble constamment à deux doigts de crever sous la pression de cet Ouroboros oxymorique. Trop retenu dans son précédent film, il s’est en réaction gavé de ses propres motifs et les régurgite tels quels, dans un désordre simulé où chaque coup porte où il le doit. On trouvera, entre autres éléments déjà vus dans les films de de la Iglesia : Santiago Segura défiant le diable, le protagoniste à proximité d’un fauve dans une séquence prégénérique, un drap qui glisse sur un cul surnaturel de perfection, un personnage secondaire suspendu dans les airs en un comic relief récurrent, des clowns tristes, de l’uniforme franquiste, une image de film à la fois rédemptrice et pathogène, un épilogue réduit à presque rien, se coupant net sur un deuil paroxystique, un couple de persos défigurés et clochardisés, qui se détestent mais ne peuvent pas se lâcher, un climax qui démarque Vertigo, King Kong et Freaks dans le même mouvement, des coups de marteau dans une fête foraine, des véhicules de police sur une route vus d’hélicoptère… Qu’on ne s’y trompe pas ; de la Iglesia convoque Cooper/Schoedsack, Browning, Hitchcock ou Jodorowski, mais ne parle que de son art, dont il synthétise avec ce film une vision très stylisée et magnifiée, pour peut-être le résumer avant d’aller plus loin, de faire plus fou, moins rangé, plus contondant.
Pas étonnant alors que Balada Triste soit son film le plus anarchiste, le plus nihiliste et le plus irrespectueux des usages : dès les premiers cartons, chaque organisme de financement dont le nom qui apparaît se voit salué par un torrent de rires moqueurs. Plus tard, Javier donne un coup de pied dans un crâne tout en admettant qu’il pourrait s’agir de celui de son père ; plus tôt, il aura mordu Franco lui-même, tué ses brefs geoliers, se sera défiguré et aura – entre autres – foutu le souk à la mitraillette dans un restoroute, avant de menacer un gosse en lui déclarant « Tu ne me fais pas peur ! »… Bref, il ne respecte rien parce rien n’est digne de respect – les deux fois où Javier se montre respectueux de quelque chose ou quelqu’un (d’abord son père, puis la trapéziste Natalia), son existence s’en est retrouvée détruite, ainsi que celles de plusieurs personnes autour de lui, et il a sombré dans une forme de folie pire que la précédente. Cette négativité intrinsèque à l’auteur explose régulièrement dans le récit en véritables crises clastiques complètement jetées (la défiguration à coups de saxophone) ou en surgissements parfaitement arbitraires (le trou à gibier dans la forêt). Mais l’hétéroclite, le bizarre et le foutraque sont encapsulés dans un tout cohérent qui possède sa propre logique, à la manière dont les membres du cirque au début du film (homme fort, femme à barbe, nains, clowns, acrobates) se retrouvent dans la même bataille contre les hommes du Generalissime. Si bien qu’à une époque où presque tous les films qui sortent sont narrativement sur des rails, de la Iglesia est quasiment le seul cinéaste avec Stuart Gordon à signer des métrages dont il est réellement impossible de savoir ce qui va s’y passer plus de cinq minutes à l’avance, mais qu’on ne peut jamais prendre en défaut quant à leur écriture séquentielle. C’est pas forcément un hasard si la structure de Balada Triste évoque aussi souvent celle de King of the Ants.
Dans le même mouvement, l’empathie est totale entre l’auteur et son film : il s’y dévoile (en tant qu’artiste hein, on n’est pas là pour nier l’œuvre des gens en la réduisant à leur strict vécu personnel dans un psychologisme de bon ton) de la manière la plus explicite qu’il ait osée à ce jour, au détour de deux répliques de ses alter ego. D’abord Javier qui déclare que « personne ne m’aimera si je ne fais pas rire », puis Sergio qui avoue carrément s’il n’était pas clown, il tuerait des gens… L’année 73, son attentat réussi, le début du réveil politique pour sa nation (et de son propre aveu, de la prise de conscience comme le dit un autre perso lorsqu’il affirme que ce pays est devenu fou), son contexte social et politique, est bien entendu un catalyseur de la dinguerie des antagonistes. Le film lui-même prend à son compte tous ces éléments, et le montage séquentiel très heurté est manifestement pensé pour, encore, malmener le spectateur avec pour effet ultime de le cueillir émotionnellement (ce putain de dernier champ/contrechamp !), mais pour effet intermédiaire de l’empêcher de s’investir complètement dans le récit : pas mal de plans semblent avoir été coupés un poil trop tôt, limite castrés, pour ne pas ménager de jolies images (a priori existantes dans le découpage de base) ou idées qui auraient pu dévier le propos de la baffe suivante. Procédé dont de la Iglesia abusait naguère par excès de pudeur. On peut y voir, encore, la volonté de se refaire une virginité anar en envoyant tout chier, ce qui semble le plus sain des comportements. Mais le rhéteur est peut partial en disant cela.
Alors, certes, la charge est parfois un peu fluctuante justement à cause de ce montage heurté et elliptique. Ce qui n’empêche pas le bonhomme de signer rien moins que le film de l’année précisément en affirmant sur 1h45 qu’on ne l’y reprendra plus, à faire les pieds au mur pour des interlocuteurs qu’il préfère nettement secouer comme des pruniers. Paroxystique dans l’émotion, la négativité, l’humanité et le cinoche pur et simple, Balada Triste de Trompeta est tout bonnement un chef-d’œuvre de péloche luddite (cf. la fin du climax). Et même complètement fou, volontairement défiguré, habillé de guirlandes de Noël et ostracisé de tous sauf de ses ennemis théoriques, Alex en a encore grave sous le pied. Au risque d’avoir l’air maso disons-le tout de suite : Vivement les coups suivants, et qu’ils soient forts.
F Legeron
Thor - K. Brannagh

Synopsis : Présenté comme un Kratos chevelu à marteau, Thor se fait piéger par Loki et déclenche le fait de guerre de trop pour le royaume d'Asgard, dont Odin le bannit pour lui apprendre l'humilité. Là il croise la route d'une astrophysicienne et du SHIELD, tandis que le chaos menace en Asgard.
Marvel Zombies
Bon, on va pas se le cacher, Thor sentait le roussi dès les premières images rendues publiques. On avait beau être curieux de la présence de Brannagh sur le film, y’a pas, les trailers et les photos foutaient les jetons. D’un Thor franchement pas très charismatique à un Asgard kitchouille comme un bateau de richard de Dubaï, on dubitait comme des malades. Ben on avait raison les mecs, car sans être une purge ignoble, Thor 2011 laisse très perplexe. Et sur sa faim aussi.
Après trois films maintenant (le Hulk de Leterrier, le deuxième Iron Man, et ce Thor) que les studios Marvel nous vaselinent en vue de nous introduire The Avengers en 2012, si l’on peut s’exprimer ainsi, on commence à pouvoir esquisser une tendance globale, un schéma de la stratégie du projet, des efforts épars qu’on a déjà pu voir et que Thor confirme mollement. Ainsi, une toute petite place y est laissée aux divers réas et scénaristes parmi les intenables et très flous impératifs du Grand-Œuvre sus-cité, pour jouer un peu avec leurs propres motifs – quand ils en ont, car pour le moment, on avait surtout du gros yes-man prompt à une technicité propre mais creuse (Leterier et Favreau donc, mais on est peut-être en droit d’attendre mieux de Johnston sur Captain America, car lui a une personnalité moins soluble dans les bureaux d’exécutifs – vous vous rappelez Rocketeer?). Le problème, c’est que The Avengers est peut-être en train de tuer les Avengers. Le projet de Whedon et de la Marvel (qui vole aux instruments si on s’en réfère au chapelet de décision hasardeuses ou carrément grotesques prises sur l’ensemble du bousin – voir à ce titre Iron Man 2 – la totalité d’Iron Man 2) semble tout faire pour économiser ses cartouches en vue de 2012, et les films sensés présenter les Vengeurs tirent franchement la tronche, car ils sont de fait réduits à des premiers actes pas super bien écrits et étirés sur deux heures. Résultat : on crève la dalle. Iron Man est ainsi plus concluant qu’Iron Man 2 parce qu’il était envisagé comme un standalone – il n’est d’ailleurs pas anodin que d’un film à l’autre Stark décide subitement (et mièvrement) de devenir « responsable ».
Thor est construit de la même manière que ses deux prédécesseurs : un perso avec un gros passif qu’on nous balance en vrac de manière très confuse (ici les intrigues en Asgard, ailleurs les conneries pseudo-zen de Bruce Banner ou le pôpa de Tony Stark), quelques minuscules clins d’œil pour laisser à penser que le projet est cohérent (l’apparition de Hawkeye, clignez pas des yeux si voulez pas le rater, et deux vannes sur Stark et Hulk), des tunnels de dialogues explicatifs à tout bout de champ, une D.A. à la mode c’est-à-dire moche la moitié du temps, une caractérisation à la tronçonneuse et des scènes d’action sans aucun enjeu physique ou dramatique. C’est d’ailleurs ce qui frappe le plus à la vision de ce Thor, cette confirmation des acquis (et quels acquis) des précédents en termes d’action. L’action est, ici comme ailleurs, singulièrement molle et tournant apparemment de manière volontaire le dos à l’épisme potentiel de ses situations… Après avoir goûté à la bataille contre les Jotuns, plutôt bien troussée et citant allègrement les scènes d’ouverture de God of War 2 et 3 (oui oui, avec en bonus le même plan de surgissement de Kraken que dans le jeu), mais expédiant déjà la moitié de ses bonnes idées, faudra faire ceinture et se contenter de quelques coups de poings, d’une armure autonome de quatre mètres de haut qui pète deux voitures, ainsi que d’un ou deux types qui volent en arrière quand on les tape (ah, l’industrie des câbles et treuils à Hollywood…), mais se relèvent trois minutes après sans même une mèche de cheveux déplacée. De toutes façons, étant donné que rien ni personne n’encourt de danger réel à aucun moment (contrats de chaque acteur pour six à neuf métrages obligent), rien de ce qu’on voit n’ayant donc aucune espèce de conséquence dans ce récit, l’absence totale de drame est chose entendue.
Il est donc pour le moins surprenant qu’on soit allé chercher Kenneth Brannagh pour emballer le segment Thor de la saga, bien sûr pas au sens où les cinéphiles proclamés le chouinent à longueur de papiers snobinards, option « bouhou mais que fait ce grand cinéaste dans le sous-monde des comic books« , mais bien du point de vue de la geste dramatique et du propos narratif lui-même. Certes, le background à base de mythologie nordique laisse de prime abord une prise certaine à un fan de Shakespeare pour faire du gros tragique élisabéthain comme il aime, mais l’analogie entre ce projet bancal par nature et le bon vieux William s’arrête à une ressemblance de formes et de folklores. Le cœur est, lui, opposé en tous points dans la mesure où ce qui caractérise techniquement l’écriture de Shakespeare est la dramatisation à l’extrême des enjeux (genre, des hurlements sur la lande) et l’irréversibilité des actions, alors qu’ici, on ne peut même pas casser définitivement des objets au cas où ceux-ci serviraient plus tard. Dans ce cadre restrictif et moins-que-vivant, Kenny se console et laisse libre court à tous ses penchants à faire du Shakespeare. Et de même qu’il y a des bons et des mauvais cosplay, il y a des bons et des mauvais Brannagh. Thor fait de fait partie des mauvais Brannagh, ceux où il « fait du Shakespeare » en oubliant d’être shakespearien. Autrement dit, oubliez les belles batailles d’Henry 5 et dites bonjour à une grosse meringue à la Much Ado About Nothing. Car Kenneth est surtout une grosse midinette qui rêve de théâtre depuis qu’elle a lu son premier Musset (on en a tous connu). Peu surprenant dans ce cas que soit flanqué là un bretteur à petite moustache blonde et un faux Falstaff qui servent à rien, que Freïa fasse de la figu et qu’Odin (Hopkins cachetonne) fasse tout et son contraire avant de jouer les Deus Ex Machina pendant que, seul, Loki se taille la part du lion des enjeux dramatiques en bon fils jaloux et séditieux qu’il est. Loki étant un trickster, et donc une menace, c’est paradoxalement le seul personnage libre du récit, le seul aussi à faire bouger un monde par ailleurs tout à fait statique sous les frondaisons d’Yggdrasil… En ce qui concerne Odin, tout est risible ou pour le moins mal amené, ses motivations, ses revirements, son malaise et son monocle qui brille. A cet égard la D.A. est à l’avenant : totalement abdiquante sur Terre et en Jotunheim (en gros, c’est des déserts), dès lors qu’on est en Asgard elle se répand en débauche de décors cyclopéens d’opéra subventionné, agrémenté d’afféteries technologiques de spectacle de danse (subventionné lui aussi). Dorures, grands escaliers, armures en toc, Bifrost scintillant et couloirs muséifiés. On se croirait dans un rêve humide d’architecte mitterrandien. Pour se convaincre du ridicule et du peu de cohérence d’Asgard avec le reste de la dramaturgie, il suffira de regarder le rendu des maquillages d’asgardiens quand ils sont éclairés par un simple soleil tout con lors des – rares – séquences où ils combattent sur Terre. Bref, Brannagh s’amuse comme une petite folle en Asgard et se fout du reste, à une exception près : le personnage auquel il s’identifie, et c’est pas le héros.
En ce qui concerne le cast, à part les conneries grosses comme soi à base de quotas raciaux (un japonais en pleine mythologie scandinave?) c’est plutôt la tendance grosse molasse qui prime. On doit toutefois reconnaître à Chris Hemsworth qu’il campe un Thor pas si infâmant que ça, et même assez crédible en regard du perso papier, il est vrai l’un des moins intéressants de Lee et Kirby. Mis à part un Loki assez habité de temps en temps, tout le monde se fait ostensiblement chier dans le film. Il faut dire que c’est pas la caractérisation qui donne aux acteurs quelque chose à bouffer : tous les persos sont parfaitement unidimensionnels (mention particulière à la trajectoire de Thor que l’humilité prend littéralement comme une envie de pisser en début de troisième acte). Les seuls qui gagnent un peu en épaisseur le font strictement via des attributs : ainsi le marteau Mjölnir a plus de présence que Thor lorsque celui-ci le porte (il est même à plusieurs reprises présenté comme la condition de la validité dramatique du personnage!), Heimdall ne sert à rien sans son épée, on ne reconnaît Hawkeye que parce qu’il a un arc, etc., etc.. Et là-dedans, il y a notre petite héroïne, jouée de manière « plus pupute tu fais une grossesse spontanée » par une Natalie Portman redevenue insignifiante. Difficile, tant la mise en scène nous donne d’indices, de ne pas voir dans le personnage de Jane Foster l’alter ego avoué de Brannagh sur ce projet. Résumons voulez-vous ? On a donc une physicienne de génie qui tombe par hasard sur un grand mec tout musclé et se retrouve en pâmoison devant lui pendant tout le reste du métrage (festival de sourires bouche ouverte à la Trey Parker), en se laissant trimballer dans une action sur laquelle elle n’a de prise qu’occasionnellement et par la bande, et dont elle n’interroge jamais les enjeux. Kenneth Brannagh, cinéaste de grand talent, s’est retrouvé un peu à la va comme je te pousse sur un projet tout en ostentation devant lequel il mouille sa liquette comme une pucelle devant un chanteur à mèche (voir le nombre non pas de cliffhangers, mais d’annonces de cliffhangers dans tout le métrage, et par extension dans tous les films de la saga), aux muscles financiers saillants et au verbe haut (3D approximative, effets d’annonce multiples), et tout excité comme naguère sur Frankenstein avec le résultat qu’on sait, il se laisse trimballer de conneries en approximations, de ridicules en bonnes idées sporadiques, et oublie son travail en chemin : faire un film. Putain Kenny, le ripoff de chez Asylum a l’air de plus péter que ton film. Vilaine, va.
Parfois amusant, souvent ennuyeux, à voir pour deux séquences-clé et leurs Jotuns fort jolis, Thor se laissera suivre sans effort et sans passion. Un pas de plus vers des Avengers dont la destinée cinématographique évoque de plus en plus celle des Gentlemen Extraordinaires. A se taper, à la rigueur, pour les lulz, jusqu’à la fin du générique pour un gros fou-rire, et impérativement en 2D pour simplement voir ce qui se passe. Mais on n’est pas obligé hein. C’est cher le cinoche.
Scream 4
Wes Craven et Kevin Williamson se retrouvent pour faire leurs smart-asses aux dépends d'une bande d'acteurs télé, et du spectateur qui se sera (à nouveau) laissé abuser par la clinquance de leurs sophismes. Le cynisme se porte beau.
Dix ans après les évènements de Scream, Sidney revient à Woodsboro faire la promo d'un bouquin où elle glorifie son statut de "survivante" (c'est-à-dire de victime triomphale dans la plus pure tradition du pays d'Oprah). A cette occasion elle retrouve une petite cousine qui la loge, ses anciens compagnons de survie (ceux qui restent), et bien entendu de nouveaux meurtres autour d'elle (sa famille, les amis de sa cousine), perpétrés par un nouvel avatar de Ghostface. Kikitu, kikivamourir? Oulalasuspense!
Évacuons tout de suite cette Valda encombrante : Scream 4 est une insulte, une purge bien pire que ses prédécesseurs (même le 3!) et cet échec est dû en premier lieu à la personnalité de ses instigateurs, Wes Craven et Kevin Williamson, avec l'assentiment enthousiaste de ses producteurs, les éternels frères Weinstein (ah tiens et Craven aussi. Tiens.). Un peu de contexte : Wes Craven est, à vrai dire, un cinéaste relativement surévalué en termes de propos, et dont l'ensemble de la carrière aura consisté, plus ou moins selon les occurrences, à prendre la posture du type qui se met à l'écart de la mêlée et toise ses petits camarades qui n'ont pas compris le monde aussi bien que lui. En somme un gros malin. Quelques très bonnes intuitions (Shocker, le premier Freddy, Last House on the Left et The Hills Have Eyes, mais aussi avoir autorisé à Aja et Levasseur à en faire un remake supérieur - moyennant l'absence de Michael Berryman), une fantastique habileté à se vendre et des qualités de conteur indéniables ont conféré à Craven l'aura qu'il a encore. Le soutien, pendant le quart de sa carrière, de Sean Cunningham, son vieil ami de l'époque où ils tournaient vaguement des boulards, n'y est pas non plus étranger. Pourtant, la filmo du bougre montre assez la posture de réflexivité ostentatoire qu'il tient - de la mise en abyme en veux-tu-en-voilà et à toutes les sauces, selon une formule déjà dosée par Tarantino pour ramasser les bénéfices avec le moins d'effort possible, comme ces sandwiches élaborés au gramme près dans les snacks franchisés : 60% de discours et références accessibles pour créer l'empathie avec les spectateurs, même les plus béotiens ("je me mets à ton niveau, tu as l'impression d'être intelligent et cultivé, tu es heureux"), 20% de références très obscures pour marquer sa supériorité intellectuelle ("oui mais bon, je suis quand même pas de la piétaille, tu peux m'admirer") et 20% de bas morceaux dévolus à l'histoire, sinon ce serait trop flagrant. phénomène flagrant depuis New Nightmare mais déjà visible auparavant (le flashback du clébard dans Hills Have Eyes 2!). Logique qu'il se soit trouvé comme larron en foire avec Williamson, petit gars astucieux (ce n'est pas un compliment) qui vend depuis 15 ans des scénarii-coquilles remplis de citations plus ou moins pataudes, qui cachent mal la puérilité de ses préoccupations (toutes ses histoires sont peu ou prou des histoires d'adolescents capricieux - y compris lorsque ceux-ci sont adultes sur le papier), lui ouvrant après le coup d'éclat Scream les portes de la teenage angst tv show où il s'est épanoui plus sûrement qu'au cinéma. Le personnage ressemble à notre inénarrable François Bégaudeau à nous : seulement occupé de se montrer comme intelligent depuis les nineties (mais on ne l'aura remarqué que plus tard, car à l'époque le contenant paraissait frais), échouant de ce fait dans les arts nobles où il s'était rêvé nouveau génie, et s'achetant finalement un peu de gloriole dans un milieu qui feint de ne pas remarquer sa cuistrerie : la télévision.
Et des dégâts, Williamson et Craven en ont fait, avec Scream premier du nom qui presque à lui tout seul plongea le cinéma de genre américain dans un âge des ténèbres qui dura un à deux lustres, et où plus rien, imagerie narration ou mythologies, n'avait droit de cité si on ne les foulait pas au pied par la parodie systématique. Le pastiche annulait le récit, vu alors comme un artefact obsolète dans une mer de coups de coude complices. Puis vint la surenchère de cette tendance (les Scream suivants, les films des Wayans, Cursed, les Bee Movies de Canal+, Cursed, Halloween Resurection...), et enfin l'enterrement de ce règne du ricanement par une vague en réaction très sérieuse, trop même dans la mesure où on peut voir le torture porn comme une conséquence directe, un ras-le-bol de cet irrespect généralisé.
Et quinze ans après? Les Weinstein (via le système Dimension et son illustre ambassadeur Quentin T.), mais aussi et surtout Craven et Williamson, sont restés bien au chaud dans leurs années 90. Au point de tourner en rond et de faire dégénérer leur recette, qui est devenue rustique puis grossière, ne donne même plus le change, ne fait plus que s'auto-congratuler sans même faire l'effort de proposer de vrais récits ou même des jeux de références exactes (pourtant le fond de commerce du sous-genre post-post-moderne et de la franchise Scream), à l'image d'un Inglorious Basterds et de ses balourdes incohérences historiques (la carte de la Zone Libre, certaines affiches de films, etc.). Le travail sur la référence de Scream 4 est carrément grotesque. Le film dans le film dans le film du début (où le caméo d'Anna Paquin, ici ravalée à son statut d'actrice de série - elle affiche le look de son perso de True Blood -, parodie jusqu'à l'annulation celui de Drew Barrymore dans le n°1) annonce clairement la couleur : rien n'a de valeur en soi, tout est le faire-valoir d'un immanent métadiscours si brillant qu'il chapeaute toute réflexion antérieure ou ultérieure. Au passage, on tacle la série des Saw, dont l'excellent premier opus fut l'un des renverseurs du trône de la Wiliamson Connection en 2004. L'érudition ne sert d'ailleurs plus à rien pour Scream 4, il suffit d'affecter d'avoir de l'érudition et le tour est joué : une victime putative répond à un quizz surprise du tueur en annonant sans réfléchir des titres de films; la culture, c'est juste une liste de noms, c'est bien connu. A ce titre, LA bonne idée de la tétralogie, la série de slashers fictifs Stab, subit le même traitement et dédouane elle aussi les auteurs - plus besoin de références solides, on va faire référence à notre propre référence, trop comment on est trop intelligents on se kiffe trop. Ainsi l'un des tueurs (le très convenu twist de troisième acte, qui ne surprendra que ceux qui se seront endormis en seconde bobine - ou n'ont pas vu All the Boys Love Mandy Lane) est un fan de Stab qui organise des Stab-athon pompés sur le concert de l' Halloween 2 de Rob Zombie... Les clichés ne sont ainsi plus des sujets de jeu, mais un idéal en soi qu'il convient d'embrasser pleinement (voir ce plan d'écrivain qui sèche devant un traitement de texte arborant un gros "Chapter One"...). Quant à l'histoire et le whodunit, ben on s'en fout au point de caler des fausses pistes sans même les exploiter, pour remplir semble-t-il (la sheriff adjointe, qui a manifestement joué dans le premier Stab, et dont on ne fait strictement rien), et de créer des personnages unidimensionnels joué par des tanches issues de vacantes séries à jeunes (même si Emma Roberts s'en sort un peu mieux), dans un univers si faux et carton-pâte que toute cette vacuité fait couleur locale. Le tout est si prévisible que le film ressemble à son propre remake.
Là-dedans surnage une thématique intéressante, celle de la motivation du cerveau de ces nouvelles tueries: totalement absorbé par soi, vivant un imaginaire de hype Internet, de télé-réalité et de notoriété factice, le but de l'entreprise est uniquement de devenir connu, en arborant le statut de victime absolue pour recueillir les suffrages sans plus d'effort ("Voyez mes blessures! Elles me rendent inattaquable, sympathique et indiscutable!"), dans une vie totalement déréalisée oû meurtre et automutilation sont quantité négligeable face au nombre de clics/jour. Les personnages d'ados, tous insupportables et vissés à leurs smartphones (beaucoup de péripéties tournent autour d'appareils de communication), volent ainsi la vedette aux briscards (Campbell-Cox-Arquette, tous affreusement tapés), cadavres de vieillards qui traversent le film comme des zombies. Seulement, offrir avec tant de dirigisme (TOUT passe par les dialogues) l'image d'un cynisme qu'ils prétendent fustiger, ne suffit pas à cacher chez les auteurs leur propre cynisme qui consiste à se faire mousser en disant tout haut qu'ils sont intelligents. Au passage, pour camoufler cette froideur effrayante, en se réclamant de Shaun of the Dead, projet complètement opposé à celui-ci de par son honnêteté et son respect des sujets et contextes qu'il traite. Scream 4, lui, est une insulte à l'intelligence et au sens critique du spectateur pris pour un sectateur du génie de Craven/Wiliamson, qui plus est affublé d'un QI de 80. C'est aussi un crachat au visage du genre qu'il prétend promouvoir avec brio, et une vraie brimade à l'égard du cinéma lui-même, ici simple écuyer pour des chevaliers intéressés seulement d'eux-mêmes, et qui confondent mépris affiché et hauteur d'esprit. Ils n'essaient même plus.
Sucker Punch
Alors voilà le problème du jour, sortez vos copies doubles.
Soit l'attitude, très française (au sens culturel), du faux détachement, de l'affectation du blasé, et du mépris ostensible à titre préventif. Celui qui consiste à feindre croire que le sarcasme est un substitut de l'intelligence, et l'ignorance claironnée d'un sujet la meilleure manière de se prévaloir d'un ridicule. Voici des temps où l'on toise bien plus volontiers les enthousiasmes que les défectionnismes, et où dans le doute, mieux vaut être le premier à montrer du doigt en ricanant, de peur d'être pris en flagrant délit d'appréciation d'un truc qu'il faudrait pas. Fausse astuce, mais vrai cynisme, cette attitude allie les très riches heures du "Risque Zéro" et les pires avanies de la normativité la plus crasseuse. Le critique qui pine rien à ce qu'il voit/lit/observe et prétend traiter, et qui en tire fierté dans ses petits cercles, est bien sûr la face la plus spectaculaire de ce réjouissant comportement social. Parce qu'ensemble tout devient possible, n'est-ce pas.
Soit maintenant Zack Snyder. C'est-à-dire un inverse strict de cette tendance bien-mise des planqués socio-culturels, et en conséquence une cible quasi-systématique de moqueries ou d'attaques a priori, là où des plus mauvais que lui, voire de parfaits cuistres, passent eux sous les vivats pour peu qu'ils livrent des produits en conformité avec l'époque du whatever, man triomphant. Car à maintenant cinq longs métrages, on peut esquisser un portrait à peu près pertinent des caractéristiques artistiques du bonhomme. Bonhomme qui montre dans ses travaux beaucoup de sincérité, de virtuosité, et un vrai respect pour ses sujets qui le pousse à chercher à les traiter le mieux possible et via l'angle le plus fécond du point de vue dramatique (voir ses projets pour déniaiser Superman à l'écran). Un type aussi qui s'entoure de talents assez phénoménaux pour servir de tremplin à ce propos mythologique et narratif, dans une optique finalement assez humble pour des projets menés par ailleurs avec des partis-pris très radicaux. Un type, enfin, fasciné par John Milius et partageant son goût pour les armes - mais dans l'optique, suspecte pour tant d'ethnocentristes européens, de la garantie d'une idée de la démocratie aux États-Unis (pour situer, le goût des flingues n'a jamais gêné personne de la part de Robert E Howard par exemple). Bref, un cinéaste avec des couilles en marbre, mais surtout profondément humain, et plus complexe qu'il n'y paraît. Tout ça se retrouve bien entendu dans l'aspect excessif à tous les niveaux de la filmo de Snyder : son aspect fétichiste (de l'image, des jolies femmes), sa grande sophistication visuelle, la finesse de certaines prises de position (les écarts d'adaptation de Watchmen) et la grossièreté de certains de ses effets (l'inflation de ralentis et plans d'inserts gorasses), ainsi que la gloire esthétique de la violence. Pas là pour faire dans le social, Zack, ni dans le subtil. Sauf que non, même pas. Car les principaux défauts de Snyder ne viennent pas d'une bêtise ou d'une beauferie intrinsèque - c'est tout sauf un crétin - mais plutôt de tentatives mal canalisées de marcher dans les clous et de donner des signes de bonne volonté envers le public ou l'industrie. Naturellement porté vers un certain hermétisme, ou une trop déroutante célérité, il croit ainsi utile de surligner régulièrement ses propos, via des chansons sur-mixées et sur-signifiantes foutues au pilon sur de pauvres séquences innocentes (la séquence d'apprentissage dans Ga-Hoole, le 99 Luftballons dans Watchmen) ou des tunnels de dialogues plus ou moins bien fondus dans des intrigues qu'ils alourdissent de fait. Ses élans de grossièreté (sentences ronge-tête, pose parfois excessive, montages séquentiels erratiques ou sous-rythmés) sont eux aussi pas mal imputables à ce trop grand désir de montrer patte blanche.
Le problème qui se pose, bien entendu, découle du paradoxe de Snyder, qui arrive à imposer par paquets de seize des idées trop bizarres ou trop sombres pour le prime time, sur des films à budget confortables lancés à grands renforts de pub et de combinaisons de salles extravagantes, au prix de ces infortunes de l'intelligibilité. Or, si en tant que premier film de Snyder qui n'est pas une adaptation, Sucker Punch va lui permettre pour une fois de ne pas se faire taper dessus pour crime de lèse-geekisme ("T'as pas mis ça où il faudrait!" "Romero serait pas content!" "Le Docteur Manhattan a un trop gros nœud!" "J'aime pas tes habits!"), mais ouvre une fenêtre plus large sur son univers à la fois personnel et référentiel, ses obsessions thématiques et esthétiques, et l'expose sans filtre à de nouvelles attaques frontales de foules qui lui en veulent de ses quelques maladresses mais surtout de ses nombreuses audaces...
Alors qu'en est-il de ce premier film original de Snyder? Comme on pouvait s'en douter, libéré de toute contrainte (il est probable que le PG-13 soit un choix artistique), le garçon se lâche et appuie plus fort sur ses effets et ses préoccupations, dans une expérience disons totale de son cinéma spécifique. Sucker Punch c'est du Snyder extrémiste, du überSnyder, Dark Phoenyx mais avec Snyder dedans. Et du coup tout ce petit monde va pouvoir camper sur ses positions respectives. Les détracteurs vont voir un film complètement fou, ils enrageront. Les défenseurs verront un film complètement fou et vont exulter. Les milliers de curieux, attirés par le tapis de bombes publicitaire, seront comme d'habitude à la fois exaltés par un film virtuose et foutrement bien torché, et dubitatifs face à des alternances de volapuk amphigourique (ça c'est pour faire des putains de scores au Scrabble) et de cucuteries pataudes calées entre des gros morceaux de gloire adulte, brutale et intelligente.
Ce film c'est donc du Snyder puissance 7, à commencer par sa structure. Un récit dans un univers clos qui en laisse voir un plus large en découverte (ici on remonte d'imaginaire en imaginaire dans une perspective de plus en plus large, à divers niveaux d'intrication), où le narrateur effectif (celui qu'on entend en off) passe pour le point de vue du réalisateur, alors qu'un autre personnage assume en fait ce rôle: comme la narration de Rorchach faisait passer en contrebande le fait que le point de vue mis en avant sur les Watchmen était celui de Manhattan, ou que l'omniprésence de Leonidas camouflait le point de vue de Delios qui était le vrai vecteur du spectateur dans 300, le personnage que l'on suit ici n'est pas celui qui nous prend à témoins. Thématiquement, on creuse aussi le même sillon, Sucker Punch continuant à affirmer la foi totale qu'à son auteur dans la toute-puissance du récit en général et du cinéma en particulier ; c'est ainsi le plus souvent des plans sur les regards qui font le lien entre les différents univers dépeints (travelings autour de Babydoll jouant le champ/contrechamp du bordel à l'univers imaginaire d'une danse en particulier), et en particulier un plan-séquence circulaire démentiel qui traverse les miroirs des coiffeuses lors d'une conversation où Rocket parvient à convaincre sa sœur du bien fondé du plan d'évasion... En lui faisant le récit de son sauvetage par Babydoll. L'imaginaire et le conte sont comme toujours chez Snyder les valeurs tutélaires suprêmes, qui motivent l'individu à se prendre en main et à s'affirmer en se confrontant à une adversité, le plus souvent en se battant purement et simplement. Ici, la symbolique est pour le moins appuyée, puisque Babydoll et ses camarades doivent, par leur capacité à maîtriser leur(s) imaginaire(s) pour appréhender le réel, prendre le contrôle de leur environnement et de leurs geôliers. Elle s'extirpent du statut d'objets subissant le monde (traumas, drames, crapuleries, désirs déplacés des hommes autour d'elles) pour devenir sujets par cet exercice de responsabilité vis-à-vis d'elles-mêmes (agir avec volontarisme pour, par exemple, voler un objet) et des autres (la part belle est encore ici faite à la glorification du sacrifice, notamment dans la très jolie relation entre les deux sœurs). Il est logique qu'avec une telle philosophie (le mot est intentionnel), les personnages favoris de Zackie soit les adolescents, et en particulier leur version la plus évidente : l'adolescente. Cible rêvée des vilains messieurs plein de corps caverneux et de mains crochues (le motif de la violence aux femmes est l'un des fondamentaux du cinéaste), devant se bagarrer contre elle-même, ses impulsions, ses peurs et le désir de ne pas évoluer pour devenir une femme à part entière, c'est toujours dans les films de Snyder par l'affirmation de soi et de sa faculté à la fois à nier le monde donné et à assumer des responsabilités que la jeune femme s'émancipe. Socialement mais surtout spirituellement. On pourrait à cette aune voir Sucker Punch comme un effarant étalage fétichiste de fantasmes de proto-pedobear : imagerie de bordel, coulisses de cabaret, faux cils de quatre centimètres, lingerie, jarretelles, résille, bodies moulants, bottines en cuir et à hauts talons, panoplies d'écolières ou de guerrières de RPG jap... Et on ne boude clairement pas son plaisir. Cette érotisation exponentielle se fait cependant à mesure qu'on entre dans des univers entièrement inventés - donc contrôlés - par les héroïnes, et est plutôt à voir comme un signe de prise en mains d'elles-mêmes, de leur dimension adulte, et donc du passage d'une sexualité subie (peur de leurs pulsions et de celles des autres) à une construction narcissique complète par appropriation de la rhétorique de la séduction. On notera pour appuyer ceci que c'est dans les morceaux de bravoure et scènes d'action "virtuelle" que l'on retrouve la seule figure masculine positive du film en la personne du vieux sage très paternel et bienveillant (Scott Glen tout droit extirpé de The Keep), qui est d'ailleurs avec le fiston de Snyder qui fait de la figu, un personnage du "réel" qui n'est pas injecté dans les séquences imaginaires, par Babydoll, mais par la vraie narratrice qu'on va pas spoiler ici. Un gosse et un vieux chauffeur de car, soit deux figures d'hommes sans sexualité agressive, au contraire des flopées d'enflures croisées par ailleurs dans le film et qui sont eux-mêmes des caricatures de méchants sur lesquels le contrôle doit être pris.
Car le film est tellement trop plein de tout qu'il en est presque sa propre caricature, mais on a vu des caricatures nettement moins classe que celle-ci car ce "trop" est dirigé, canalisé en un tout cohérent. Le fétichisme qui transpire du métrage est avant tout celui de l'image (pas mal de plans sont incroyables, de véritables enluminures qui empruntent tant à Frazetta qu'à Kawajiri ou Howe) et de l'épopée dans tous les sens que revêt le terme aujourd'hui au cinoche. Les séquences où sont visualisées métaphoriquement les danses qu'exécute Babydoll sont remplies jusqu'à la gueule d'episme et d'iconisation - imaginez 300 condensé en dix minutes. La célérité et la virtuosité de certains passages sont proprement extravagantes (avec en tête une séquence de démantibulation de robots dans un train, en un plan-séquence de quatre bonnes minutes qui ferait ressembler Speed Racer à un film d'Isild le Besco). Et sur chaque élément esthétique ou rhétorique s'en empilent trois ou quatre de mieux, et ainsi de suite jusqu'à atteindre, sur la base assez simple du scénario, une profondeur et un jusqu'au-boutisme qui pousse le récit au point où il en devient carrément abstrait et où rien n'est surprenant, puisque tout peut arriver, d'un avion de guerre dans un conflit médiéval-fantastique contre des orcs à des méchas contre des nazis steampunk dont le Kaiser grand brûlé cherche à fuir vers un zeppelin (Yeah !). Le trip est à voir comme abstrait, au sens où les comédies musicales de l'Age d'or hollywoodien sont des objets abstraits. Snyder assume complètement cet état de fait, comme le prouve un générique de fin entièrement construit en morceau de burlesque, en s'autorisant absolument tout ce qui fait sa culture pour le plier à un système très cohérent. Ce système glorifie l'imaginaire en tant que tel mais surtout en tant qu'outil d'action sur soi et son environnement, dépassant en cela la rhétorique de prédécesseurs plus ou moins illustres (en vrac, Juliette ou la Clé des Songes bien entendu, ou encore Heavenly Creatures ou le pénible Tideland, ne montrent l'imagination que comme une base de repli face à un "réel" aliénant). Dans cette optique, dire que Sucker Punch dépasse dans son projet un Inception, ça en fera bondir certains mais c'est assez évident, dans la mesure d'abord où il réussit là où le Nolan échoue ou ne va pas assez loin : en premier lieu, le défaut principal de Nolan est sa gestion des rôles féminins et de ses actrices qu'il a beaucoup de mal à rendre désirables à l'écran (que quiconque n'a jamais ri au "You are beautiful" lancé à une Maggie Gyllenhal fagotée en gros tromblon dans Dark Knight nous lance la première pierre); or on a envie de se frotter à la jambe de toutes (toutes) les gonzesses de Sucker Punch, même si les deux brunettes sont clairement en retrait. Ensuite et surtout, là où Inception se bornait à décrire un dispositif - certes passionnant - par des tunnels de dialogues confinant parfois à de la radio filmée, et s'en tenait à n'être qu'un brillant premier acte, Sucker Punch pose ses imaginaires intriqués (deux à trois niveaux de fantasmagorie emboités voire même quatre, dépendant du point de vue qu'on aura sur le récit), leur règles de fonctionnement et leurs implications, par les seuls moyens de la mise en scène, d'une manière limpide et dynamique, et qu'on ne questionne pas plus de trois minutes au début du métrage. Il ne se contente pas d'explorer ses systèmes imaginaires, il les utilise comme moyen d'action (encore une fois, la métamorphose du réel par refus du monde donné) pour mener ses personnages plus loin que leur statut de départ. Mais c'est la manière dont le récit s'articule qui est intéressante, en cela qu'il rappelle la construction de Ghosts of Mars, autre film sur la toute-puissance du récit et l'a prévalence du point de vue, dans le fait de montrer un imaginaire lui-même interne à un autre imaginaire, ce dernier imaginé par une autre personne après les faits. On en vient donc (le lever de rideau du début est éloquent) à visualiser non pas les faits, non pas leur dramatisation, mais la fantasmagorie qui colore cette dramatisation, le tout via une extrapolation elle-même sujette à caution car se faisant au sein d'un imaginaire, ce qui est rien moins que vertigineux en termes purement narratologiques: que penser ainsi du flashback qui ouvre le film, sur le destin très "chanson réaliste" de Babydoll ? Et le tout sans éluder, c'est le moins qu'on puisse dire, le caractère franchement sombre de l'histoire des filles, qui (SPOILER) est loin de n'évoquer Brazil qu'avec ses samouraïs géants (FIN DU SPOILER).
Alors oui, tout ça est imparfait: la voix off est très dispensable dans sa moralisation ampoulée et son aspect "dis tout ce que tu vois dans le dessin", les reprises de standards par des voix féminines et des remixes agressifs surlignent parfois beaucoup l'action (la reprise des Pixies, putain), mais au moins il n'y a pas de grosse faute de goût musicale. Certaines scènes d'action sont assez expédiées et, comble pour des danses qui subjuguent leurs auditoires, on n'en verra pas la queue d'une, sauf lors du générique de fin, et encore. La caractérisation est également très flottante quant aux antagonistes, il est vrai soumis à une vision au sein d'un imaginaire... Globalement, Snyder se laisse piéger par son propre dispositif : si son but est de montrer subjectivement l'essence des danses de Babydoll, il ne peut en effet pas montrer lesdites danses; mais c'est frustrant - ce qui prouve au moins que le film crée du sentiment.
Au premier degré, Sucker Punch est une tuerie : ça pète, c'est élégant, sombre et bien construit. Au second degré, c'est parfois maladroit, mais les scories font aussi le charme d'un cinéaste qui ne se prend les pieds dans le tapis que lorsqu'il est sommé de baisser les yeux pour être poli. Et puis on sort de la salle, on digère ce qu'on nous a raconté, et ce troisième degré remporte l'adhésion. Ce putain de film est extrêmement ambitieux tant philosophiquement qu'esthétiquement et techniquement et, loin d'être une boursouflure dégénérée comme beaucoup le diront pour faire bien, c'est non seulement le film le plus intéressant de Snyder, mais aussi l'un des plus attachants de l'époque. Pour peu qu'on aime être pris par la main par un conteur, et être amené à penser plus haut et plus loin que soi. Mais de toutes façons, le coup qu'on prendra viendra de la direction d'où on ne s'y attend pas, et à ce niveau, l'accroche anglaise a raison : You will be unprepared. Une telle proposition, c'est excitant non ? Allez, avoue, personne nous regarde.
Le rite
Synopsis : Fils d’un croque-morts bien jovial, Michael Kovak fuit son destin de thanatopracteur en s’inscrivant au séminaire. Il compte bientôt quitter la vocation où il s’était lancé à reculons, mais son prof de théologie l’envoie se prouver sa foi incertaine à Rome, au cours d’exorcisme du Vatican. De là on lui fait suivre le père Trevant, exorciste de talent aux méthodes fantasques, avec qui il se verra prouver par la pratique que houlala, oui alors.
Oui, bon, pour le même prix on peut se payer le dernier Electric Wizard.
Voir un « inspiré de faits réels » sur la note d’intention d’un film fantastique, c’est aussi mauvais signe que de trouver un logo LJN sur une cartouche de jeu NES. Quand c’est sur un film à contexte religieux, là c’est carrément la tasse : le spectre de la propagande bondieusarde plane toujours autour de l’innocent spectateur, et les préoccupations des plus passéistes badernes ratzingeriennes s’exsudent le plus souvent du récit. Le Rite ne fait malheureusement pas exception, comme le prouvent trois éléments pas tout à fait piqués au hasard. Le contenu même des séances d’exorcismes voit ainsi toujours une sur-représentation de cul démonstratif (limité au mime – habillé – et au langage, on reste PG13) comme élément de choc censé horrifier le chaland. Alors oui, la lubricité est un élément incontournable des satanismes, mais après Sade, Apollinaire ou Clive Barker, et à l’heure de la Rule 34* accessible sur l’Internet à toute heure, se contenter de parler pipe, sodomie et viol pour choquer Mémé c’est tout de même petit bras en termes de cul maléfique… Sans compter que le héros ayant toiletté des morts pendant plusieurs années, et ayant aidé son père à embaumer sa propre mère, y’avait un boulevard pour tout démon qui se respecte, pour balancer de la vanne à base de nécrophilie et d’inceste. Pourquoi diable (hu hu hu) l’imaginaire de la subversion sexuelle est-il aussi frustre, aussi peu élaboré, aussi bourgeois, chez les faiseurs de films de possessions démoniaques ? Et surtout en 2011, rougit-on encore pour si peu?
Autre séquence qui loupe spectaculairement le coche, celle de l’extrême onction de la cycliste accidentée, sous les yeux du gentil prof qui en parlera plus tard comme de la performance scénique d’une rockstar… On jurerait voir, mais dans un premier degré un peu consternant, les scènes de Team America où les persos se sortent des situations en jouant la comédie « comme tu n’as jamais joué, petit! »… Ah c’est sûr, la liturgie du catholicisme décomplexé, on entend nous la rendre hip et trendy, sexy même via le perso de la journaliste qui regarde le jeune prêtre avec des grands yeux respectueux, tout en fondant pour lui, z’avez vu les enfants, engagez-vous, toutes les gonzesses aiment l’uniforme. Le summum de ce discours peu subtil est bien sûr atteint dans les deux derniers cartons, dignes d’un courtyard drama, nous éclairant après l’exorcisme final sur le fait que les deux prêtres sont désormais de gentils et productifs membres de la sainte église pour laquelle ils extirpent victorieusement de vilaines bestioles staniques de gentilles adolescentes aux heures de bureau. C’est dire si on sort de la projo mal à l’aise, avec le sentiment de s’être fait vaseliner l’entendement pendant une heure et demie. On sera aussi circonspect face à un script qui cherche à nous faire croire à la réalité et au danger des entités infernales, mais qui semblent n’avoir comme raison d’être que celle de prouver l’existence de Dieu (et du bon, de préférence) aux clampins en crise de foi qui passent à proximité. Rappelons que beaucoup de démons du panthéon de la chrétienté sont des divinités antérieures à son existence, intégrés par celle-ci lorsqu’elle est devenue dominante dans certaines régions, et que les cultes rendus par exemple à Baal sont encore considérés dans certains pays comme des religions à part entière…
Le film en lui-même se suit pourtant avec un plaisir distrait, comme un bon vieux Hollywood Night qu’on connait par coeur avant même de l’avoir vu. Y’a pas de quoi se les taper au sol, mais on s’ennuie peu, comme Hafstrom nous y a habitué. La mise en scène est agréablement classique, et même élégante par moments, les visions démoniaques, à défaut d’être originales (l’âne aux yeux rouges dans la neige), sont joliment faites et évocatrices, et le tout est servi par un cast solide, à défaut d’être très habité (à part Rutger Hauer mais ce type est d’une autre planète de toutes façons). Mis à part une scène de pleurs désespérés où on entrevoit sa vieille gloire, Hopkins est en revanche sur pilote automatique, c’est-à-dire qu’il cabotine en mode Hannibal Lecter la plupart du temps, ce qui a certes le mérite d’être dans le ton, notamment au troisième acte, mais commence quand même à être agaçant quand on sait le talent du bonhomme. Quelques éléments d’imagerie sont amusants, comme les grenouilles ou les chats, ou encore les clous ou l’importance de pousser l’entité à se nommer pour la combattre. A part ça? Tout est soigneusement balisé, on est à l’abri de toute surprise importante : l’incrédule oppose des théories psy aux arguments théologiques, un premier exorcisme s’avère être un échec, le dernier déchaîne des phénomènes indiscutables, etc, etc. Hé les mecs, tout ça c’est bel et bon, mais l’Exorciste, c’était y’a bientôt 40 berges.
Au final, un film pas enthousiasmant mais pas désagréable, sympathique tout au plus, qui ne sera à voir que si on est mort de faim niveau imaginaire traditionaliste, et si on ne s’énerve pas trop face à son discours ronge-tête, sous-jacent mais bien présent dans un filigrane très très marqué. Il marque néanmoins, si besoin était (putain, Last Exorcism…), que la possession démoniaque est un beau sujet, mais qu’il est urgent d’arrêter de la traiter à la Papa.
*If it exists, there’s porn of it.
Paul
Synopsis : Clive et Will, geeks anglais un-peu-inadaptés-mais-on-leur-en-veut-pas-trop-c'est-des-geeks, se font le Comic-Con et un circuit des sites phares de l'ufologie du sud des États Unis. D'amusements bon-enfant en déconvenues minimes ils font leur bonhomme de chemin jusqu'à ce que, par une incroyable facilité de scénario comme disent les Gars en T-shirt, ils tombent sur Paul, alien gouailleur échappé du centre gouvernemental le plus proche. Une cavale s'engage alors pour échapper a des simili-men in black, à la police, à des rednecks, à un fondamentaliste dont ils ont embarqué la fille, etc., tout en contactant les compatriotes de Paul pour lui permettre de rentrer chez lui, en en apprenant plus sur eux-mêmes car sinon tout serait vain et on sortirait déçus.
Non, je vais faire caca chez Paul.
George Lucas. Avi Arad. Stephen King dans les années 90, avant de se réveiller pour finir la Tour Sombre. Mocky après vingt ans de carrière. Les mort-nés de la Nouvelle Vague dès 1965, le Nouvel Hollywood dès 1975, Metallica après le Black Album, Amy Henning après qu’elle ait lâché les Legacy of Kain, ton petit frère qui foire sa seconde après avoir eu 17 à son BEPC, le studio Ghibli depuis cinq ans, et désormais une grosse frange du cinoche dit « geek ». Le point commun des ressortissants de cet inventaire hétéroclite et potentiellement infini, c’est le gâchis. Le gâchis par choix de la facilité, du gimmick vidé de sa substance, du repos à deux oreilles sur les lauriers d’un marché porteur qu’on croit acquis quoi qu’on en fera. Et à peine baptisé donc, le cinéma geek suit cette pente et se scinde en deux franges, l’une très réduite qui tente de faire avancer le bousin plus loin que la simple reconnaissance critique et publique, l’autre, pléthorique, qui sourit béatement à l’aventure du vedettariat, comme disait un illustre vieil anar qui ne se renia jamais (lui). Dans cet ordre d’idée, Paul n’est pas tant un film que de la pêche à la ligne. L’appât, c’est Pegg et Frost, dans leur rôle habituel (et très attachant) de Laurel et Hardy nerds, enrobés dans un fan service frileusement irrévérencieux. ça vous plaît hein ? Ben ouvrez grand pour l’hameçon parce qu’il est très gros et que, si vous êtes entrés dans la salle, vous avez déjà été ferrés, sortis et vidés par les faiseurs, extrêmement cyniques, d’un produit incroyablement méprisant de son public-cible sous un vernis de connivence.
En gros, Paul c’est que du réchauffé, jeté à la va-comme-je-te-pousse à même une assiette en carton que tu boufferas avec ta spork achetée sur Thinkgeek. Une pincée de Dumb and Dumber, un peu d’ET et de Men in Black, une grosse structure tirée deStarman, deux bonnes cuillers de Galaxy Quest et une motte de Hot Fuzzpour masquer l’amertume, en ayant pris soin de bien l’égoutter pour en enlever toutes traces d’Edgar Wright jugées indigestes par la FDA. On touille pas trop, malheureux, les grumeaux donneront l’impression d’une texture. On saupoudre de culture geek bien mainstream (franchement, Star Trek Classic, y’a plus pointu), quelques millions de polygones (très bien faits par ailleurs) qui font des sourires d’affiche Dreamworks, puis on place les hameçons de 22 suscités et on obtient… Bravo, un bien beau remake déguisé d’Howard the Duck. Il ne reste plus qu’à jeter l’infâme brouet obtenu et à se faire livrer une pizza. Et à votre serviteur d’arrêter avec les métaphores culinaires.
Évidemment, avec une telle recette, le film en lui-même est gavant comme un Shrek, c’est-à-dire bourratif tout en laissant sur sa faim (on avait pas dit qu’il arrêtait avec ses histoires de bouffe le plumitif? NDA), et avec ça dramatiquement daté. Basé entièrement sur l’indulgence du spectateur qu’on caresse dans le sens du poil, le film entend bien bénéficier de la mansuétude que ce dernier aura à oublier la totale absence d’originalité de sa facture. Le premier problème de ce principe du moindre effort tient dans la dramaturgie, bien entendu : il résulte en un gros effet de patchwork au niveau du montage séquentiel. En l’état on ne voit, peu ou prou, qu’un empilement de séquences indépendantes les unes des autres, toutes ayant le même découpage plan large/plan serré/plan moyen/champ/contrechamp/plan large/plan moyen, et ayant la même structure interne se résolvant systématiquement à la fin de chaque saynète, ce qui rend le tout extrêmement monotone à se fader. En gros, c’est comme se mater une cinquantaine de courts métrages se suivant vaguement, à la suite, pendant une heure et demi. Il y a bien quelques fils rouges comme l’identité de la taupe qui a aidé Paul, ou celle du mystérieux patron des agents fédéraux (si on ne sait pas reconnaître la belle voix profonde de Sigourney bien entendu), ou encore la relation entre Pegg et Frost teintée de triangle amoureux, mais franchement on est très loin d’une narration tenue. Ne reste donc plus qu’à se laisser porter par le contenu lui-même de ces séquences éparses, et là presque tout est non seulement à côté de la plaque vis-à-vis de son sujet (on se fout complètement du sort de l’extraterrestre), mais surtout en contradiction frontale avec le folklore que par ailleurs le film fait semblant de revendiquer.
Geek, tu veux croire quePaul est un film qui te parle, qui veut rire avec toi en te taquinant gentiment; et ben non, Paulte roule dans la boue, te fait pipi dessus, se moque de toi comme si t’avais la gale, et filme le tout pour te google-bomber avec la vidéo en affirmant dans les mots-clé que t’as adoré ça, lol. En ce sens, il fait exactement le contraire de ce que faisaient justement des Galaxy Quest en leur temps ou Edgar Wright avec l’ensemble de sa filmo, Scott Pilgrim en tête. Car leur démarche cherche à ennoblir la culture populaire qui leur sert de toile de fond aux yeux des réfractaires, mais aussi aux « partisans », à partir d’une vraie érudition sur celle-ci, et en usant d’un vrai respect pour leurs personnages et leur spectateur. Ce respect passe entre autres par le fait, sans s’en prendre à l’individu lui-même, de mettre en perspective les notions qu’il prend pour acquises dans le cadre de ses pratiques culturelles (notamment l’esprit de clocher). Dans ce cadre le fait de tendre au spectateur un miroir parfois désagréable (Scott dans Scott Pilgrim vs the World, ou Syndrome dans The Incredibles) est une marque de respect et même d’évolution thématique. Le principe de Paul est tout différent de ça. Il consiste à profiter d’une connivence facile, à partir de quelques drapeaux blancs destinés à faire croire qu’on est respectueux (les présences de Seth Rogen et Pegg/Frost, les caméos et références à la SF populaire), et d’une irrévérence qui camoufle sous son second degré proclamé le vrai mépris qui se cache derrière.
Attention toutefois, le tout se suit souvent avec plaisir, Pegg et Frost sont parfaits (faut dire,eux sont sincères vis-à-vis de leurs persos, mais alors pourquoi diable ce traitement de leur univers ? Sont-ils perdus sans Wright ?), et même quelques vannes sont vraiment amusantes, comme la version country du groupe de la Cantina, ou l’universalité des réactions quant au dessin de la gonzesse à trois nichons (tout le monde, extraterrestres compris, trouve ça génial, et en même temps c’est vrai que trois nichons c’est assez génial). C’est précisément ça qui pose souci, car ce plaisir immédiat fait passer en contrebande, sous la bannière du « mais non j’déconne tout ça c’est pas sérieux », un discours qui foule au pied toute cette culture geek. Ne t’y trompe pas mon amie, ma soeur, mon grocoupin, mon camarade, mon presque moi, « tout ça c’est pas sérieux », ça s’applique ici en premier lieu aux cultures de l’imaginaire elles-mêmes. L’exemple le plus fameux de ce discours (tout le reste est à l’avenant) est le traitement réservé à Steven Spielberg, dans la séquence où il se fait littéralement dicter au téléphone le pitch de ET par Paul, lui-même assis dans le hangar de Raiders of the Lost Arch. Voilà donc l’un des plus gros bosseurs d’Hollywood, un homme qui a influencé l’imaginaire de plusieurs générations de cinéphiles (geek ou pas), qui a redéfini à plusieurs reprises le média cinématographique tant d’un point de vue technique qu’économique ou thématique, le voilà donc ravalé d’une pichenette au rang de copiste servile sans une once d’imagination. Et qu’on vienne pas dire que c’est une interprétation parano, le film lui-même confirme ce propos en le répétant sur le sous-pitch du bouquin de Clive, qui ne devient un succès artistique et commercial que lorsque celui-ci se borne à raconter sa rencontre avec Paul… L’imaginaire, les enfants, ça sert à rien, ça fait même de vous une pauvre cloche. La foi au sens large aussi d’ailleurs : une simple imposition de la main de la mascotte sur le front et on est inondé de connaissance, doué de la science infuse (sans aucun effort d’apprentissage, ça aussi c’est pour les cons) et abandonnant en toute logique toute velléité de penser plus haut et plus loin que soit (i.e. l’imagination) puisqu’on est soi-même le pinacle de l’esprit. Bien entendu le film fait passer ça par le mépris ostensible, en ridiculisant sans distinction la notion même de fait religieux (l’une des localités de l’imaginaire) via des figures de fondamentalistes redneck, qui ne manquent pas de provoquer moult ricanements entendus. Et, dernier tour de passe-passe cynique en diable, une poignée de séquences-émotion clé-en-main, tellement tayloristes et mécaniques qu’elles donnent envie de décrocher le fusil du râtelier, emballent le tout pour lui donner, manifestement, du sens. Sens qui aurait manqué, sinon, hein, on n’allait pas faire que de la SF quand même.
La salle, elle, feint de ne pas s’en rendre compte, se laisse flatter d’une main gantée pour éviter la contagion, et rigole. Un extraterrestre qui fume des blunts et dit fuck, c’est suffisant pour se croire subversif, malin, et aussi iconoclaste que, disons, Philippe Manoeuvre. Eh, ça tombe bien, il fait la voix française.
Faire la promotion de Paul sur GeekCulture, ce serait comme filer des DVDs de Tom-Tom et Nana à un gamin en lui disant que c’est amusant et éducatif : un gros bol de FAIL.
Black Swan
Nina ou les infortunes de la vertu
La valeur d'un film est-elle réductible à la manière dont il est vendu, aux réflexions plus ou moins pertinentes qu'il suscite dans la critique, à ses prix, ou encore à son box office ? Le supplément de valeur qui fait les grands ouvrages est-il, d'ailleurs, seulement corrélable à ces valeurs faciales ? Avec Black Swan, incroyable réussite artistique qui connait les aléas thématiques à la fois d'une distribution à la catapulte et d'une grosse frange critique qui ne pine rien à ce qu'elle a sous les yeux, l'occasion est trop belle de se pencher sur ce type de phénomène, et le paradoxe d'un traitement a priori bienveillant et profitable financièrement à l'œuvre qui en est l'objet, mais qui risque de la déprécier par des soins trop approximatifs. Car beaucoup sont déçus de ne pas voir le film à Oscars avec bonnasse proprette qu'ils pensaient confortablement trouver, sur la base d'éléments certes très lacunaires. Et cette déception les empêche d'apprécier ce qui fait justement la valeur de ce poème funèbre, sexué, élégant et brutal. Parce qu'à force de croire qu'on pense à la place du public, on ne fait plus que de la désinformation par défaut.
Comme tout ouvrage imaginatif mais donnant des signes suffisants de conformité avec le monde des gens sérieux, bref toute œuvre "de genre mais heureusement acceptable en société", Black Swan, ben vous allez en bouffer. Ils ont beau professer leur peu d'intérêt pour ce qui n'est pas la Nouvelle Cuisine dans leur partie (ou le Nouveau Roman, ou la Nouvelle Vague, ou les Nouveau/Nouvelle quoi que ce soit depuis 60 berges), ils sont morts de faim pour ce qui présente un peu de consistance, les cuistres. Et autant vous dire que si ici le plat est plus qu'excellent, les condiments que divers bougres professionnels de la profession critique vous serviront avec, seront toujours ceux qui se trouvent sur l'avant de l'étagère à aromates. Autrement dit, n'attendez pas les épices lointaines aux saveurs exotiques, relevant la réflexion de dizaines de senteurs itératives. Sel-poivre pour tout le monde, car niveau culture, on est plus que jamais la patrie du steak-frite avec juste ce qu'il faut de verdure autour pour le vendre 30 euros. Surtout si vous allez manger dans les cantines les plus étoilées, les publications les plus sérieuses, les télés les plus franchisées. Faut dire aussi que le menu est singulièrement plat en regard de ce qu'il vante, l'ensemble de la vente du film se basant sur trois éléments au mieux anecdotiques du film d'Aronofsky. Les rivalités dans le monde de la danse classique sont ainsi sur-représentées dans la com (la bande annonce est éloquente, à croire qu'on n'a pas vu le même film avec les mecs du marketing), au point que pas mal de mainates médiatiques sont persuadés que le film ne parle que de ça, ce qui est aussi pertinent que de prétendre que Lost Highway est une étude sur les conditions de travail des saxophonistes. Les deux autres axes de communication sont carrément hors sujet puisqu'il s'agit de 1) Natalie Portman qui gagne des prix parce qu'elle fait elle-même ses cascades (on est en droit de s'en foutre un peu), et 2) le carnet rose de la prod qui voit Natalie Portman enceinte du chorégraphe du film (là on est en devoir de s'en foutre beaucoup).
Première très grosse baffe de 2011 (Harry Brown a déjà un an et demi alors bon), Black Swan vaut bien évidement beaucoup mieux que ça. d'abord parce qu'il constitue une synthèse scrupuleuse de tout ce qui précède dans la filmo de son auteur. On se demande à ce titre avec gourmandise ce qu'aurait donné son Robocop s'il n'avait pas périclité, rebalançant ce projet-ci au premier plan. Ensuite parce qu'il se permet le tour de force de taper précisément dans les préoccupations de l'époque, d'avoir un nombre de niveaux de lecture extrêmement riche tout en étant constamment accessible quant à son propos artistique et son sujet mythique, d'avoir une plastique à se damner qui sert l'art du conteur et seulement celui-ci, ET d'utiliser tous ses acteurs au meilleur escient en leur offrant leur meilleur emploi depuis (au moins) cinq ans. Toutes les qualités des films d'Aronofsky se retrouvent ici avec le cran qualitatif supplémentaire que le bougre parvient à passer à chaque métrage (message perso: t'es une enflure Darren). Et de fait, il creuse thématiquement les mêmes motifs et le même pitch : des personnages enfermés dans un hubris qui consiste en partie au dépassement même de cet hubris, et qui se détruisent précisément là où ils se transcendent. Le lieu du travail est encore le catalyseur de ce paradoxe, la scène - et la salle d'exercice située à l'arrière - remplaçant ici le ring (Wrestler), le bloc opératoire (the Fountain), le tableau noir (Pi), etc. . Qu'on ne s'y trompe pas (et surtout pas pour cause de petites statuettes remises entre pingouins), Aronofsky signe des films d'action dans sa forme de base, au sens où l'action est par définition la transformation du réel par refus du monde donné. D'où la réelle portée mythologique de ses récits pour peu qu'on se penche sur cet aspect des choses. Mythologique, oui Madame : Black Swan est un film fantastique pur et dur basé sur la subjectivité exacerbée de son sujet et la viscéralité de son récit, et tirant beaucoup plus du côté de Suspiria et Ginger Snaps que vers un docu sur Pietragala, et n'en déplaise, avec un art de la narration qu'on ne retrouve pas chez beaucoup de faiseurs des biopics nobiliaires qui, prétend-on, doivent déplacer les foules en ces débuts d'année. Enfin, les foules qui ne sont pas forcées d'aller voir le Danny Boon par manque d'écrans libres.
La meilleure preuve de cette fluidité entre moyen et propos est que même en plaquant des analyses toutes faites, révélatrices de la compartimentation dont la notion même de culture est victime dans les cercles germanopratins, bref quand ils se plantent dans les grandes largeurs, les zélateurs s'engagent souvent sur les bonnes pistes d'analyse du film. En n'y marchant que quelques mètres toutefois. Vous en entendrez donc des bien pataudes, en premier lieu sur la mise en scène à base de caméra portée, jetée au cœur de l'action, selon un procédé déjà rôdé sur Wrestler (La simple apparition de Rothbart sur scène justifie cet artifice de mise en scène au service de la subjectivité de son héroïne, en nous surprenant autant qu'elle-même l'est). Aronofsky envisage d'ailleurs lui-même les deux films comme un diptyque, ce qui apparaît de toutes façons évident à les voir l'un et l'autre. Black Swan est donc construit comme un miroir de Wrestler, son image inversée, notamment au niveau des séquences de préparation (étirements, petit matériel, voir par exemple les lames de rasoir d'un côté et la mise en condition des chaussons de l'autre), mais aussi dans la description des relations hors-scène, la cruauté des coulisses du ballet répondant à la tendresse de celles du catch. Et bien entendu, les personnages principaux que tout oppose en apparence, mais qui ont la même recherche de transcendance qui confine au suicide collatéral. Une notion de suicide d’ailleurs très relative, voire strictement métaphorique, si on considère l’ambigu fondu au blanc qui clôt l’un des deux films, et la sortie de champ toute aussi ambiguë qui termine l’autre en conférant à son personnage de ne jamais avoir à mourir. En toute logique, le miroir est repris par la mise en scène comme un motif omniprésent d'un bout à l'autre du métrage. Mais là où sur le papier on aurait pu craindre un effet grossier, systématique ou simplement redondant (il est impressionnant le nombre de connards qui foutent des reflets à tout bout de champ pour se prendre pour Spielberg depuis le début des années 2000), la chose est constamment amenée, justifiée par le contexte (loges, salles de répétitions et d'exercice), en y ajoutant une note vaguement anxiogène. De ce mouvement, le miroir devient naturellement moteur de l'action, via le plus souvent des glaces multiples ou morcelées occasionnant coupes ou dédoublements lourds de sens sur les visages (voir la scission du cadre lorsque Thomas parle des deux cygnes), puis de manière carrément opératique dans le dernier acte où on le brise pour le faire participer directement aux évènements dans la tradition la plus phallique des armes blanches du giallo. Cette notion est encore appuyée par la franche opposition des formes et couleurs tout au long du récit (blanc et rose contre noir et vert, changements brutaux d'éclairages, etc.), et l'analogie entre les personnages et les protagonistes du ballet.
Il n'empêche, s'il n'y avait que ça ce serait somme toute banal, à peine suffisant pour provoquer les bâillements polis que suscitent d'ordinaire les programmes de courts métrages subventionnés sur les chaines publiques. Oui, la petite musique freudienne se fait entendre, et souvent même de manière (très) appuyée : toute la rhétorique des automutilations, fantasmes lesbiens et scarifications qui émaille le film, fait dores et déjà jubiler des tripotées de sous-lacaniens qui y recensent (quelle audace! Quelle intelligence!) les analogies aux premières règles et montées d'hormones chez l'adolescente-type. Toute l'histoire de doppelganger qui motive le récit, et en fait, avec le thème de la transmutation en animal, un vrai film fantastique (la statue du hall qui fait toujours face à Nina, et les diverses transformations physiques, ne sont ni des symboles ni des métaphores, ce sont de vrais épisodes de l'histoire, des faits avenus et tangibles strictement connectés aux autres), ramène bien évidemment au Polanski du Locataire. Pas de Répulsion, mais bien du Locataire : ce dernier est lui aussi un faux film de folie et un vrai film d'horreur surnaturelle, car certaines de ses péripéties sont impossibles à rationaliser par le simple délire de Trelkovski. La parano grandissante de Nina à l'égard de Lily, son transitivisme qui lui fait apposer son visage sur d'autres personnes, et les impressions de mutations /dégradations physiques évoquent bien entendu la schizophrénie, mais son syndrome de Stendhal envers le ballet de Tchaïkovski et la plénitude ressentie lors de sa transformation complète en cygne noir (Dieux! Ce plan!) participent beaucoup plus d'une imagerie propre au loup-garou(1) ou au vampire tendance Bram Stoker, capable de se changer en diverses bêtes et dont les reflets (dans un miroir par exemple...), par leur absence ou leur apparence, révèlent sa véritable nature. Comme en atteste le plan qui suit cette transformation, ou les spots sur une Nina à nouveau humaine projettent deux ombres nettement moins anthropomorphes.
Dans le domaine de la psy on regardera donc, à nouveau (promis c'est la dernière fois), un peu plus loin en direction du conte de fées classique et des théories de Bettelheim. A l'instar du ballet qui lui sert de trame, Black Swan pose ainsi ses personnages dans des rôles archétypaux, au sein d'un univers imaginaire qui incarne une vision du monde réel et de ses enjeux, notamment psychologiques et sociaux. Ainsi le récit voit une jeune héroïne virginale (Portman donc, dont l'aspect désespérément propre sert son personnage de vieille fillette), maintenue en servitude par les soins de sa marâtre (une Barbara Hershey flippante et sirupeuse en mère abusive), qui s'en va vivre une vie pleine d'aventures dans des lieux variés (donjon/salle de répétition, geoles/loges, une forêt pleine d'attrait et de dangers dans le bar et le club - ou soit dit en passant Aronofsky met à l'amende la carrière entière de Gaspard Noé en trois plans) et affronter un double maléfique (Mila Kunis qu'il faut décidément se mettre à suivre de plus près), survivre - ou pas - à des sorts qui la changeront en animal, conquérir ses propres pulsions et un prince sorcier (l'orgueil démesuré de Vincent Cassel est enfin pleinement utilisé par un metteur en scène) pour finir sur le trône à la place de l'ancienne reine, déchue dans le même mouvement (Winona Ryder, qui visite de manière à peine masquée sa malédiction personnelle : rester à jamais une jeune fille, de ce fait jamais prise pleinement au sérieux sauf dans des comportements d'autodestruction). Or, si d'ordinaire ce type de conte montre des jeunes gens quittant l'influence parentale pour se créer une identité propre -donc devenir adultes, une distinction s'opère entre héros et héroïnes: pour schématiser, le personnage masculin doit affirmer sa puissance en brandissant un artefact qui lui confère sapience et virilité (épée, amulette...), alors que le voyage initiatique de la jeune fille se fait en se confrontant aux assiduités de divers prédateurs, c'est-à-dire se situer par rapport au(x) désir(s). Cette distinction est évidemment d'ordre culturel, une cristallisation de la répartition traditionnelle des rôles en fonction du genre.
Transposée à l'ici et maintenant du monde de la danse classique (et de l'ensemble de représentations plus ou moins pathologique qu'on y appose), dans l'occident de ce début de millénaire, cette rhétorique de conte permet à Aronofsky de creuser son sillon, en termes de thèmes mais aussi de mise en scène et de montage séquentiel (l'épuisant final qui s'étire sur une bobine et demi comme celui de Requiem For a Dream). Il lui permet aussi de s'inscrire - et c'est pas la première fois - dans ce qui constitue peut-être le début d'un courant discursif dans le monde du cinéma contemporain. Car Nina ne se débat pas simplement avec une part maléfique dont elle constituerait l'hypothétique contraire vertueux. Sa part d'ombre, c'est surtout l'âge adulte avec la négativité et la libido qui la caractérisent et ne sont, certes, ni rose ni bleu pastel (l'âge adulte quoi, pas l'illusoire adolescence prolongée devenue notre mode idéologique dominant). Elle est montrée comme foncièrement asexuée, inhibée dans son développement en tant que femme (c'est-à-dire en tant que personne) par une mère qui se vit à travers elle, dans l'illusion d'un temps qui ne passe pas et où elle aurait encore sa jeunesse devant elle par simple réplication de caractères, à la manière de l'immortalité chez les Tleilaxu : la décoration de la chambre dénuée de verrou (Nina a 28 ans tout de même), la vie fusionnelle dans l'appartement, les affreuses peintures faites en chialant pour se persuader qu'on a aussi une vie artistique... La mère, vieille petite fille vouée à contrarier dans l'œuf toute croissance excessive de sa progéniture (voir les scènes de contentions, ou mieux la séquence de masturbation coupée nette par la découverte de la mère endormie - c'est aussi le premier contrechamp sur la chambre, qui révèle l'inflation de peluches dans la pièce), est une parfaite fabrique à Norman Bates comme en crée notre époque par tombereaux entiers. Nina, constamment ramenée à la préadolescence qui la caractérise (on l'appelle "Sweet girl", son trouble vis-à-vis de Thomas est qualifié "crush for the teacher", et bientôt elle deviendra "Little princess"), évoque au départ le Marc Stevens de Calvaire: une page blanche, une coquille lisse mais vide, un simple réceptacle du désir des autres. Les interventions du corps et de la sexualité sont toujours vus, par Nina, sous l'angle d'une violence faite à sa "sphère d'intimité" qui participe d'une idolâtrie de l'innocence supposée de la figure de l'enfant. Les exemples sont innombrables, des avances de Thomas à la séance de kiné en passant, surtout, par le vieux dégueulasse dans le métro (un moment pour le coup directement sorti du Locataire). C'est d'ailleurs moins la chance qui lui est donnée d'interpréter les deux cygnes, que l'irruption de la vraie vie via le personnage libéré de Lily, qui lève le couvercle sur les 300 bars de pression dans la tête de Nina. Pas étonnant alors que Nina investisse Lily de tout ce qui fait la vie adulte : désir de suprématie, sexualité, indépendance, violence, exploration des limites. Ce n'est d'ailleurs qu'à l'état de Cygne Noir que Nina s'autorise à prendre des initiatives (vis-à-vis de Thomas, d'elle-même ou de Lily). Le monde du ballet, très refermé sur lui-même, statique, hiérarchisé à l'extrême, constitue une métaphore idéale de l'infantification dont on est désormais témoin au quotidien. A bien des égards, on pense à la contrainte culturelle presque sadienne, et protéiforme, des jeunes filles dans l'Amérique moderne, par exemple dans les concours de mini-miss.
A ce titre, Black Swan peut être vu comme un contrechamp de Splice, la vision lyrique, du point de vue exclusif de Dren/Nina, d'un contexte et d'évènements assez similaires à ceux montrés dans le film de Natali par les yeux des parents pathogènes. Cependant un détail porte à penser que l'ensemble du film se déroule peut-être exclusivement dans l'imaginaire de Nina : les raccords en fondu. Le premier surtout est intéressant. Le film démarre sur une séquence de rêve où Nina danse avec le prince, qui se change en un Rothbart qui a la même apparence que celui, pas encore à l'état de projet à ce moment-là, de la mise en scène que fera plus tard Thomas du Lac des Cygnes. A l'occasion de cette métamorphose, Rothbart arbore brièvement les yeux de Nina. Cette scène est raccordée, par un fondu enchainé tout con, à un plan de Nina dans son lit, au sortir du rêve. Seulement elle a déjà les yeux ouverts et ce seul détail (bientôt suivi par une foule d'indications données par le script, la réa, la DA et la musique), en gommant d'emblée toute différenciation entre les séquences "réelles" et "oniriques", jette le trouble sur l'ensemble de ce qui suit : peut-être est-ce un long rêve éveillé, ce qui n'aurait après tout pas de grande différence avec l'aspect déréalisé de l'ensemble de sa vie dans les girons conjoints de sa mère et de la compagnie. Black Swan s'inscrirait par là dans un courant, pas encore tout à fait identifié mais caractérisé par des préoccupations fortes : un cinéma inscrit dans le "genre", prônant l'exploration de l'imaginaire ou des représentations mentales d'un personnage de manière plus ou moins masquée esthétiquement, et plus ou moins radicale d'un point de vue narratif, affirmant la nécéssité du passage d'un état spirituel et social d'imago à la condition d'adulte par un exercice de volonté, en décrivant des personnages pas franchement présentés comme sympathiques ou admirables. ça commence même à se multiplier, avec des exemples fameux dans des imageries variées : Splice, Scott Pilgrim, Shutter Island, Inception, Valhalla Rising, le prochain Sucker Punch, Hellboy, KickAss, Shaun of the Dead, dans une certaine mesure la trilogie Matrix qui ne parle que de l'émancipation d'individus qui s'extirpent d'un utérus sociétal géant... Certes, les attaches entre ces films sont assez lâches, mais cette injonction à se sortir le pouce du rond, jeté vers une société de vieux bambins, semble trop uniformément reprise pour être tout à fait involontaire de la part d'ouvrages qui cherchent tous à parler d'une façon ou d'une autre au spectateur en tant qu'être humain différencié, concret et sexué.
Pfiou, ça en fait des choses pour un film dont beaucoup n'attendent qu'un remake des Chaussons Rouges. Pas étonnant qu'ils mordent alors la main qui a l'outrecuidance de vouloir les nourrir avec des mets intéressants et nouveaux qui les changent, trop à leur goût sans doute, des plats cuisinés totalement conformes à ce qui est vanté sur leur emballage.
(1) La transformation à vue reste d'ailleurs l'enjeu principal de tout film impliquant des lycanthropes, même à l'heure du numérique.
Aronofsky revient donc, avec encore un film quasi-parfait sous le bras. Et comme d'habitude, il ne ressemble qu'à lui même tant sur le fond que sur la forme, tout en mettant tout le monde à l'amende dans bien des domaines (photo, musique, effets spéciaux et direction d'acteurs, tout est au cordeau) et tout en incitant à penser plus loin et plus haut que soi. On est bien loin du produit routinier attendu par certains, qui pourront toujours se consoler la semaine d'après devant une inoffensive comédie un peu cul avec la Portman. En attendant, c'est ici qu'on ira s'en prendre plein les yeux, les oreilles, la tête et le coeur.
Law Abiding Citizen, Harry Brown
Anomie contre déviance sous-culturelle
Le vigilante movie, et plus largement le film de vengeance, semblent bien se porter depuis le début des années 2000, époque policée et culturellement hypogonadique qui, dans son désir de châtier tout ce qui en dépasse, voit souvent ses agents en proie à la tentation de l’expéditif, voire de la barbarie à usage personnel « parce que je le vaux bien » en oubliant le principe de monopole de la violence légitime à la base des systèmes républicains, lorsque qu’une tragédie (ou un simple inconfort) les touche personnellement. Le genre se tenait en effet en hibernation depuis le milieu des années 80, après avoir connu un âge de grande popularité dans les années 70, d’abord dans l’Italie des années de plomb puis plus largement dans un occident effrayé par l’insécurité domestique, qui passait du statut de sentiment à celui de fait social par la grâce conjointe de l’horreur économique et de la surmédiatisation de la violence. C’est ainsi que sur le terreau redevenu fécond des Deathwish de la grande époque, fleurissent désormais diverses tentatives plus ou moins concluantes. Des peu convaincants (et manquant clairement de recul sur leur sujet) Plus Jamais ou The Brave One, au plus intéressant Death Sentence qui avait le mérite d’interroger la pulsion de belligérance, mais aussi avec les adaptations risibles du Punisher, la trilogie de Park Chan Wook et bien des charretées de DTV post-Saw, la vengeance personnelle se porte beau. Pour preuve ces deux « nouveaux » venus qui sortent quasiment coup sur coup, alors qu’ils ont été produits en 2009 pour l’un et en 2008 pour l’autre (merci les politiques de distribution, chapeau les mecs) : le thriller pur jus Harry Brown et l’actioner assez conventionnel Law Abiding Citizen (titré Que Justice Soit Faite de par chez nous, c’est dire si la com du film se met au diapason du climat ambiant).
Mine de rien, le motif de la vengeance de l’individu envers la société (ou envers des occurrences corrélables à l’état de ladite société) irrigue toute la culture populaire depuis le début d’une pensée sociale articulée, c’est-à-dire déconnectée de la politique ou des notions de gouvernance. Schématiquement, depuis les prémices de la sociologie moderne. Est-ce à penser que dans des systèmes qui tendent à prendre en charge leurs ressortissants dans toujours plus de domaines de la vie intellectuelle voire métaphysique, l’irruption de l’envers du décor, ou simplement du monde réel, est vécue par ces derniers comme un affront personnel qu’il convient de laver, là où la culture classique mettait plus volontiers en scène des individus occupés à affronter directement ledit monde réel ? Il s’agirait d’un jugement de valeur qui n’a pas sa place ici, d’autant que les jugement moraux ou politiques forment très vite une piste merveilleusement glissante quand on prétend traiter du sujet du vigilante, fut-ce au sens large. On peut néanmoins esquisser, peut-être, un parallèle flou mais intéressant entre le phénomène de généralisation – et de sacralisation grandissante – de la propriété individuelle, de la tertiarisation et de la montée des classes dites moyennes, et la résurgence de l’antique peur du loup, un loup nouveau, à tête d’homme (délinquant, nomade, marginal, lumpenprolétaire, forçat évadé…), qui rôderait dans des « zones de non-droit » ayant avantageusement remplacé les bois d’antan. Et qui attaquerait, plus ou moins gratuitement, les croquantes et les croquants – forcément innocents, eux – comme un mauvais souvenir des âges farouches, appelant supposément des réponses drastiques à la mesure de leurs incartades.
Le comic book (d’un bon vieux Judex à Batman en passant par des palanquées de Punishers plus ou moins chamarrés), le slasher (le plus souvent basé sur un ancien trauma du tueur), tout un pan du polar, du krimi et du film de gangster fondent sur la vengeance (ou sur une justice débarrassée du droit commun) leurs principes moteurs, sans parler de la réactivation des antiques fantômes asiatiques aveuglément vindicatifs. Pour ce qui est des deux films qui nous occupent, la manière dont cette vengeance est posée, son objet, son contexte et ses conséquences immédiates posent méchamment problème. De fait, la question de l’adhésion au propos d’un ouvrage de fiction pour en évaluer la qualité et l’agrément devient la seule réellement valide, et rend d’autant plus intéressante la vision des deux films dos à dos. Car bien entendu on va en entendre des vertes et des pas mûres, notamment concernant Harry Brown et ses partis-pris politiques partouzeurs de droite, de la part de critiques parlant plus de morale et de politique que du contenu réel des films. Ce qui est intéressant ici, c’est que le meilleur film des deux est aussi le moins « valide » politiquement, alors que le plus acceptable sous nos latitudes est aussi assez faible d’un point de vue cinématographique. Esspicassion.
Dans le coin de gauche (haheum) on trouve donc Law Abiding Citizen, qui mise sur les qualités (relatives) d’emballeur de grands spectacles de F. Gary Gray (Italian Job, Negociator, A Man Apart, bref des divertissements honnêtes mais pas de quoi se la prendre et se la mordre non plus) et sur son casting qui ratisse large : Jamie Foxx, la version K-Mart de Denzel Washington, et surtout Gerard Butler qu’on va tous voir à chaque fois, même dans d’effrayants films pour lectrices de Biba, tirés en avant qu’on est par le souvenir ému de Leonidas. Quelques vieilles ganaches et une Leslie Bibb toujours plus transparente de film en film complètent le tableau, pas désagréable mais peu folichon donc. Partant d’un home invasion totalement gratuit où un bon père de famille (qui est ingénieur de génie dans le domaine des machines de mort, so they fucked with the wrong guy and this time it’s personal, tout ça) perd sa femme et sa fille avant de voir l’un des méchants éviter les sanctions légales via un arrangement à la NYPD Blue, le film nous narre donc une vengeance du papounet envers les deux tueurs, puis l’avocat responsable de l’arrangement honni, puis le cabinet d’avocats, le juge, l’administration de la ville… Une joute s’engage alors entre l’avocat, qui défend entre autres sa famille à lui (où ne manque plus que le gentil labrador), et l’homme de la rue devenu méchant qui a ourdi un plan de ouf pour se faire justice. Bref, si une ou deux petites péripéties ont le mérite de surprendre (le coup du portable, les circonvolutions carcérales), on se retrouve dans une version light de Die Hard With a Vengeance, notamment dans le crescendo proclamé des exactions et de leur ingéniosité, mais McTiernan en moins, notamment dans la mise en scène très télé de l’ensemble. Amusant, le film reprend en fait dans son principe le libellé de Saw 3, le plus intéressant de la série car il posait Jigsaw en pédagogue hardcore plutôt qu’en tueur en série, avec un jeu de piste basé sur la vengeance contre une décision de justice. Ici, le but ultime de Clyde n’est pas tant de faire pleuvoir son courroux (coucou) sur les criminels et le système qui les a trop mal sanctionnés, que d’éduquer son alter ego et néanmoins adversaire quant à sa politique : il l’enjoint donc à choisir l’absolu de l’esprit de la loi plutôt que les magouilles ayant cours dans les arcanes de la justice effective. Il le fait en se posant lui-même en méchant, en poussant jusqu’à l’absurde la logique des arrangements avec des coupables avérés, c’est-à-dire lui-même dans une démonstration ab absurdo. C’est de loin l’idée la plus intrigante, car elle est tout de même fort discutable derrière son aspect simplificateur, et le film ne décolle logiquement que dans les séquences centrées sur Butler. Manifestement le seul à y croire à mort, il s’amuse visiblement beaucoup et on retrouve enfin la lueur de folie dans son œil qu’on attend de revoir depuis les Thermopiles. ça permet de tromper un ennui qui ne se dément que dans des séquences joyeusement nimpeuses, dont une de torture dont la retransmission arrache un sourire. Mais tout ceci est, on l’aura compris, hautement inoffensif mis à part l’évocation des injections létales : quelques boum-boum-pan-pan-ouais-j’l'ai-eu plus tard, chacun rentrera chez soi la conscience dans les pantoufles, le mal mordant la poussière et les gentilles familles souriant de toutes leurs dents blanches.
Il va sans dire que Harry Brown possède une tout autre carrure cinématographique, et ce d’abord parce qu’il a compris un principe de base : là où un bon vigilante movie est forcément un peu malsain, un grand vigilante movie s’envisage comme un film d’horreur pur et simple.
Ancien militaire tendance Orwell dans Burmese Days, Mr Brown vit dans une crasse cité londonienne marquée par le délitement social et économique, sans même le passage occasionnel d’une Rolls Royce princière à saccager pour se défouler. Alors on fait comme on peut, quitte à taper sur l’ensemble des petites gens du coin. Dont le meilleur ami de Harry, qui meurt sous les coups de divers sauvageons pires que les autres alors qu’il allait innocemment les menacer d’une baïonnette. Qui plus est nouvellement veuf, Harry pète les plombs et part en croisade contre la racaille, troquant sa vie tranquille contre des armes à feu et ses vieux reflexes de commando médaillé jusqu’aux chaussures.
Du point de vue strictement cinégénique, Harry Brown est un fist avec une mitaine cloutée. Sans la moindre trace d’humour ou de distanciation avec son sujet, le film vogue bille en tête du cafardeux au glaçant pour mieux revenir vers le cafardeux. Londres, à ce propos, continue de remplir son rôle de ville officielle des fins du monde dans le cinoche récent, sans doute pour sa personnalité fin-de-siècle, sa part victorienne qui reste prépondérante. Harry Brown évolue dans un monde d’après l’apocalypse, une apocalypse qui a eu lieu non dans une explosion mais dans un soupir. L’anomie totale y est accomplie. Les agresseurs, délinquants et sauvageons acculturés qui tiennent les quartiers y sont d’une certaine manière déjà retournés à l’animalité, vivant un présent perpétuel fait de consommations (drogues, artefacts du consumérisme, autres êtres humains) d’esprit de meute et de dominance purement gratuite, avec la procréation comme seule perspective métaphysique (voir la trajectoire décrite par Noel Winters, la plus saillante des petites frappes : le père était une petite frappe, flambeau qu’il a depuis repris et risque de repasser aux résidus de ses putatives grossesses adolescentes). Un monde en apparence intact mais peuplé de fantômes qui s’entredéchirent par la griffe et la dent. La mise en scène, au 2.35 très statique, semble attester de ce monde spirituellement mort. Dans cet univers, Harry oppose le passé, les vieilles éthiques (on le voit tantôt exhumer des souvenirs, tantôt inhumer des proches, ce qu’il est le seul à faire, ses victimes crevant littéralement comme des chiens, à même le sol et sans sépulture), un sens presque anachronique de la responsabilité dans un tel contexte. Ayant tout perdu, il se permet de réactiver le passé pour se changer en spectre et hanter les fautifs. Il suffit de voir le gunfight dans le passage souterrain, où il se cache dans l’ombre et frappe de là, ou les divers surgissements et ouvertures de champs dans le dos de protagonistes pour voir définitivement le personnage comme un croquemitaine. L’ambiguïté du traitement de Harry se situe là : placé d’emblée comme seul être humain à part entière (avec une histoire, un discours prééminent à l’action, etc.) du métrage avec la jeune inspectrice, il est aussi posé comme une force primaire qui s’abat sur les coquins de manière quasi-surnaturelle (voir la rapidité de ses reflexes, ou ses résurrections successives). Le jeu incroyablement nuancé de Caine, qui passe de l’émotion la plus empathique à une froideur de machine à tuer parfois dans le même plan, brouille encore un peu les pistes.
La police ? elle joue strictement un rôle de choeur antique, montrée comme presque parfaitement impuissante à faire évoluer la situation, que ce soit dans les enquêtes successives (sur la mort de Len puis celles des voyous) ou l’opération armée de démantèlement de la criminalité dans la cité, qui se solde sur une émeute à grande échelle. Le « bon » ne peut donc compter que sur lui-même contre les « mauvais », dans un système strictement binaire qui pose un gros problème. Impossible de cautionner le discours du film, qui tend à justifier les milices de proximité et l’autodéfense : Harry ne sera jamais puni de son hubris (il n’est frappé ni de mort ni de folie – il aura tout de même commis quelques homicides en chemin) et est même validé in extremis dans ses actes par la voix off qui en fait carrément un porte-parole de la « majorité silencieuse » qui aurait lavé le monde plus blanc par ses exactions ! La trop grande volonté de boucler le récit sur lui-même, en entretenant des relations qui confinent au deus ex machina entre les persos principaux, implique la théorie de l’hérédité des caractères, le criminel n’engendrant, ici, que le criminel… Cette manière de subvertir la construction du vigilante interroge. On finit le film avec un goût métallique dans la bouche, mais qui n’est pas dû qu’à cette vision, disons, peu nette des enjeux politiques du récit. Car c’est avant tout la qualité de ce qu’on pourrait appeler un film d’épouvante sociale qui fait cet effet. Caine est majestueux comme à son habitude et le lien qu’on développe avec son personnage dans certaines séquences résulte d’une caractérisation solide et d’une mise en valeur de l’univers très opératique et maitrisée : la longue scène des trafiquants d’armes est d’un putride qu’on ne voit pas si souvent. On s’y sent presque poisseux, on y sent presque les odeurs, et c’est tout le prix de ce film, dont l’implacabilité force l’admiration que s’aliènent les thèses qu’il développe.
Bien entendu, s’il faut n’en choisir qu’un, ce sera Harry Brown haut la main. Nombre de spectateurs, perdus devant un discours pas assez lissé pour eux, traiteront le film de réac et par conséquent de navet. Si le premier argument peut à la rigueur s’entendre, s’en servir pour justifier le second sera la marque d’imbéciles, ni plus ni moins. Doit-on adhérer pleinement au discours d’un film pour en apprécier les qualités ? Ou ne va t-on au cinoche que pour se voir remettre des certificats de bonne pensée citoyenne ? Your Call.
Un monde de machines et Astroboy à Roboland
Début, donc, du cycle "Un monde de machines" qui se tient au Forum des Images (de Paris, en France, c'est-à-dire le pays qui, bien qu'il soit celui de de la Mettrie et Verne, s'obstine néanmoins à affirmer que la fiction à préoccupation scientifique n'est qu'un sous-produit américain et japonais), depuis le 2 mars et jusqu'en mai.
Une programmation éclectique. Pour le moins.
Bien calé sur ses deux bons mois, le programme du cycle en profite pour pousser très loin, et même parfois à la limite de l'intelligible, l'éclectisme dont on a pourtant déjà l'habitude avec les cycles du Forum. Dire que la programmation part dans toutes les directions est la moindre des assertions : en effet, la notion de machine a été envisagée sous toutes ses acceptions, physique, sociale, mécanique, biomécanique, systémique et même sexuelle (de loin la sélection la plus discutable, mais encore une fois, le contexte prévaut). Pour un sujet aussi large (ou vague), le panel de notions qu'on peut y rattacher est virtuellement infini, et avec un peu de rhétorique, on peut faire entrer n'importe quoi dans le corpus. C'est la limite que rencontre, a priori, le cycle tel qu'il se présente.
Si on peut imaginer le cheminement de pensée qui justifie l'apparition de la trilogie Bourne ou de Salo de Pasolini, la présence carrément capillotractée d'un Thelma et Louise, par exemple, ou même d'un Orgazmo,qui par ailleurs fait bien plaisir, a de quoi laisser dubitatif quand dans le même temps on n'a droit qu'au premier Tetsuo ou au secondGhost in the Shell. On regrettera principalement que des films importants, voire essentiels de la thématique cybernétique soient absents du cycle en raison des circonvolutions de droits d'exploitation : adieu 2001, trilogiesMatrixet Star Wars, Blade Runner et même MetropolisouLe Golem... En revanche, la thématique de l'aspect social du monde du travail, qui va jusqu'au film d'entreprise ou la publicité d'électroménager est très bien vue et apporte un regard moins stéréotypé sur le sujet, même si on ne coupera pas au sempiternel Les Temps Modernes.
L'équation programmation un peu trop maline sur les bords + public à forte composante germanopratine se retrouvait dans la soirée d'ouverture, notamment lors du raout d'après-projection, où passaient à portée d'oreille points Godwin mal dégrossis ("tout de même, toutes ces machines, ça fait très homme parfait nazi"... Sic !), inculture revendiquée comme un étendard de bon goût (les considérations entendues sur le doc de Caro, notamment quant à la culture du manga, valaient pour la plupart leur pesant de Bégaudeau) et autres amphigouris bien-mis n'ayant aucun rapport avec le sujet mais sans doute beaucoup avec les préoccupations immédiates de ressortissants d'arrondissements périphériques à l'Île de la Cité, capables de tout ramener à Freud, Debord et BHL (encore une fois, sic !) à une vitesse qui force l'admiration.
Il était, avouons-le, savoureux lors du pré-programme de la soirée, d'entendre ricaner sur le kitsch de vieilles publicités d'équipements ménagers, une salle remplie à au moins 75% de possesseurs d'Iphones ! Cet ethnocentrisme tant culturel que temporel, très bien porté manifestement, confirme l'idée très en rapport au demeurant avec la thématique du cycle qui nous intéresse, que nous vivons moins dans le futur vu par l'Orwell de 1984 (d'ailleurs programmé dans le cycle), que dans leMeilleur des Mondesimaginé par Huxley : une stricte société des loisirs dont on n'imagine même plus qu'elle puisse avoir des frontières ou des manquements, et où chacun est très content de la place qu'il occupe dans une société/époque dont il n'a ni les moyens ni le désir de penser autre chose que du bien... Quitte à ne pas voir dans le ridicule de l'autre (ici, les ménagères des années 50) le strict miroir du sien (il serait intéressant de mettre en regard les publicités d'époque et le marketing contemporain), et à se contenter de montrer du doigt. Bref.
Astroboy à Roboland
Étrangement, le documentaire réalisé il y a deux ans pour Canal + par Marc Caro est bien dans cette tonalité gourmande mais partielle qui semble caractériser la programmation du cycle.
A priori sympathique, le film pèche tout de même par son incapacité à choisir entre le documentaire de création, voire d'ambiance, et la vulgarisation la plus pédagogique et terre-à-terre que sans doute on lui réclamait. Sur ses très (trop) courtes 52 minutes, le film tente de survoler l'impact culturel, puis effectif, de la science-fiction robotique du vingtième siècle nippon sur la technologie qui voit le jour sous nos yeux à l'heure actuelle, en prenant comme fil rouge la figure d'Astroboy. Pas anodin quand on sait l'importance du personnage dans la caractérisation même de son pays, comparable à celles de Superman pour les États-Unis ou d'Astérix pour nos rivages. A peine esquissé, ce motif cède la place, via un chapitrage pas idiot autour de l'anatomie du personnage, à un survol des avancées technologiques en matière de locomotion, sensorialité, préhension, etc., des robots modernes.
Par-dessus tout ça, est saupoudré au petit bonheur une assez vague évocation des enjeux culturels sur la semblance que l'on réclame de nos robots et les émotions investies dans ceux-ci. Beaucoup trop de sous-sujets pour un 52 minutes, dont le projet de base n'est en aucun cas d'offrir des spéculations pointues sur son objet. On restera donc sur sa faim sur tous les sujets abordés, en ayant le sentiment de n'avoir rien appris sur aucun. Frustrant, d'autant que plastiquement le même sentiment d'entre-deux se fait jour : des plans très bien construits, troublants dans le brio qu'a parfois Caro à filmer les machines comme si elles étaient vivantes (de son propre aveu, il a construit quelques séquences comme un docu animalier), côtoient des interview assez platement cadrées, voire des séquences entières où la réa semble avoir abdiqué. Trop ambitieux pour sa durée, et surtout trop brouillon pour son propos, le documentaire noie les pistes passionnantes qu'il ouvre et les constructions thématiques qu'il met en place sous cette impression, partiellement fausse, de demi-échec.
Cette dispersion semble malheureusement l'apanage de Marc Caro réalisateur ; directeur artistique de génie (on regrettera d'ailleurs de ne pas voir Vibroboy dans la programmation du cycle), développeur d'univers visuels d'une rare cohérence de par chez nous (il suffit de voir les films de Jeunet depuis qu'il a arrêté de collaborer avec lui), faisant preuve d'une grande rigueur éditoriale dans la distribution de DVDs il y a quelques temps, Caro est un réalisateur perfectible. Dès qu'il est derrière une caméra pour raconter une histoire, on le sent peu à l'aise et pour tout dire encore peu solide – Astroboy à Robolandconfirme ce que Dante 01laissait supposer. Il y a peu à douter que dans des conditions de production optimales, lui laissant vraiment les coudées franches pour créer à nouveau des univers-mondes, le monsieur donnera sa mesure (dans le cas de Dante 01, adapter du Bordage n'était peut-être pas non plus l'idée du siècle pour un premier long). On attendra beaucoup plus de ses interventions diverses, toujours plaisantes et intéressantes, que de ce documentaire qui ne lui rend pas assez justice.
Mâche bien, c'est plein de boulons mais ça tient au corps
Attention, qu'on se comprenne bien : le cycle« Un Monde de Machines » est concocté par une équipe qu'on devine très motivée, sympathique et tout à fait louable dans ses intentions. La politique du Forum des Images vis-à-vis de la culture cinématographique est exemplaire en ce sens qu'elle n'opère jamais de hiérarchie dans les films montrés (ce qui est moins le cas de la Cinémathèque, par exemple), et certainement pas en fonction de leur pays de production ou du "genre" où ils évoluent ou n'évoluent pas. Ce qui est bien trop rare.
On aura donc, ici, quelques levés de sourcils sur l'apparition de certains films, ou même thèmes, dans un cycle qui semble n'avoir rien à voir avec eux (une thématique sur le zombie, dans son acception haïtienne, aurait par exemple été pertinente). Cependant, c'est l'envie boulimique de films qui pousse, on le sent, l'équipe à cette pléthorique programmation. Et puisqu'on n'a pas d'examen de fin de semestre à passer sur le corpus présenté, on n'aura pas à s'inquiéter de son aspect un peu boursoufflé. On n'aura qu'à se réjouir de pouvoir voir certains films qu'on n'avait jusque là que l'occasion de voir en vidéo, ou qui n'avaient eu que des carrières ridicules en salles dans de bonnes conditions. Pêle-mêle, les bonnes nouvelles se nommentMoon, Orgazmo, Tetsuo, Innocence, le Géant de Fer,les films de Fleisher, Screamers, Avalon ou encore A Scanner Darkly. On redécouvrira aussi 1984,Monsters Inc,Pi,Christine (un Carpenter en salle !),Cable Guy, Terminator 2,Total Recall (la conférence sur K. Dick sera aussi un must-see), Frankenstein, et I Robot, qui vaut bien mieux que ce qu'on en a dit à l'époque, et bien entendu Demolition Man, l'un des meilleurs blockbusters des années 90, injustement conspué depuis, pour la perspective Huxleyienne dont nous parlions plus haut...
On pourra aussi sauter les passages obligés par Chaplin, Vertov, Godard ou Tati. A cet hétéroclite mais pantagruélique buffet, on en a tant à goûter qu'on peut se passer de graissins.
starship troopers
Starship Troopers, c'est la quintessence de la face trublionne de Verhoeven (qui contrairement à ce qu'en disent d'aucuns n'est pas la seule), l'horizon vers lequel tendrait cette partie de sa carrière qui est portée sur l'iconoclasme. Accessoirement, c'est l'un des films-phares des années 90, mélange d'ironie politique, de virtuosité technique et de prophétie polémiste, baignant dans un esprit campy qui témoigne de la malignité de ses auteurs. Littéralement une annonce d'un certain cinéma des années 2000/2010, celui qui connait ses codes et ne ramasse pas sur le bord de la route les retardataires qui ne le comprennent pas. Ce qui ne manque généralement pas de lui attirer des ennuis.
"Oui ben vous foutez pas de la gueule d'Himmler; il pourrait revenir."
Pierre Desproges
Ereinté par une critique rétive à ses efforts, notamment Spetters et Soldier of Orange, Paul Verhoeven quitte sa Hollande natale en claquant la porte avec autant d'élégance que de fracas : il fomente De Vierde Man, film léché mais volontairement totalement creux, bourré de symboles astucieux et stériles aptes à faire illusion dans les cercles d'influence des phagocytaires culturels. Le film est conçu comme un piège à Tartuffes, et fonctionne parfaitement : les critiques visés sont dithyrambiques. C'est le moment choisi par le monsieur pour publier un communiqué dévoilant la supercherie et partir vers d'autres horizons censément plus cléments. Pas assagi pour deux ronds (il suffit de voir Flesh + Blood) le Filming Dutchman entame une carrière mouvementée à Hollywood, enchaînant des métrages dans une logique similaire, à savoir basés sur une subversion systématique de leurs principes de façade. Il passe ainsi du thriller à script très moyen (même routinier) où il impose une grande classe de mise en scène et attire toute l'attention sur un plan célèbre d'entrejambe (Basic Instinct) à l'actioner science-fictionnel devenant réflexion sur l'identité et le libre arbitre (Robocop, Total Recall), en passant par le film "sexy" qui dynamite tout un pan des valeurs américaines de la libre entreprise et de la bonne moralité (Showgirls, encore incompris, qui se permet de mettre à poil et de faire se friter une inoffensive égérie de sitcom), le tout doublé d'odes au mauvais goût propres à interroger le sens même des images montrées (Total Recall encore et sa direction artistique volontairement hideuse, la violence démentielle et craspec de Robocop). Peut-on y voir l'une des raisons d'une filmographie assez peu prolixe aux Etats Unis (1) ?
Starship Troopers semble une bonne réponse à cette question, et on se demande encore quelle mouche a piqué les exécutifs de TriStar, leur insufflant assez de courage pour confier une telle fable guerrière et politiquement chargée, précisément au type le plus susceptible d'en faire exploser le potentiel pamphlétaire. Le récit original n'est déjà pas anodin en soi. Etoiles, garde-à-vous, publié en 1959 par Robert Heinlein, est bien entendu une réaction de son auteur envers une certaine désaffection de la chose militaire au sortir de la guerre de Corée. Le roman, avec sa forme alternant action cathartique et incises démonstratives (nombreuses discussion politiques et morales), sert surtout de véhicule à un discours très marqué à droite, de son anti-communisme sans nuance (les arachnides forment une société collectivisée à l'extrême et contrôlent littéralement, physiquement, les esprits humains via des sondes organique) à sa défense, pêle-mêle, de l'embrigadement des jeunes gens dans l'armée, des conscriptions, de la peine capitale, et globalement d'une méritocratie très teintée de nietzschéisme ou seuls les vétérans ont le droit de vote. Cette optique, très populaire dans la science-fiction américaine de l'époque où les paraboles anti-communistes fleurissent mais se contentent souvent de gloser sur le seul péril rouge, s'y voit donc appuyée par une idéologie du volontarisme que n'auraient pas renié les grands totalitarismes européens dont les cadavres sont encore fumants. Ce type de discours se verra d'ailleurs repris par les Etats Unis lors des conscriptions pour le Vietnam et de la lutte idéologique avec une jeunesse plus marquée à gauche.
A la fin des années 90, la donne semble différente, du moins à la surface des choses. Car à la réflexion, dans un contexte de Pax Americana (2) pas encore assombri par le scandale du syndrome de la Guerre du Golfe, le patriotisme se porte beau à Hollywood, et Etoiles, garde-à-vous vient d'être officieusement adapté dans son idéologie sinon dans son libellé, en l'occurrence du film Independance Day. Propagandiste, anthropocentré, ethnocentriste, belliciste, le film d'Emmerich entretient plus que des accointances idéologiques avec le coeur de la pensée que relaie Heinlein, dont le roman Etoiles, garde-à-vous figure encore sur la liste des lectures recommandées par le corps des Marines et celui de la Navy...
Penser que Paulo va marcher dans ces traces semblait pour le moins malavisé. En effet, plus tard dans la décennie Emmerich se défendra en déclarant qu'ID4 était ironique, un commentaire subtil à côté duquel le monde serait passé... Ce qui apparaît tout de même nébuleux au rayon excuse facile. Dans l'optique de jeter une salubre lumière sur ce qu'il conviendrait d'appeler un contexte politique et culturel préfasciste, l'adaptation de Starship Troopers fait justement le pari de restituer l'esprit du roman original, apparemment sans filtre. La polémique qui a fleuri à la sortie du film, criant sur les toits que Starship Troopers était un film fasciste, était ainsi paradoxalement dans le vrai : Starship Troopers est, dans sa construction et son premier niveau de lecture, un film fasciste au sens où le film fasciste peut être vu comme un genre à part entière, dans la mesure où il utilise et même reprend à son compte des éléments constitutifs des films de propagande des régimes totalitaires (du Triomphe de la Volonté aux courts métrages pétainistes en passant par les films italiens et soviétiques de l'époque). Là où les loups ont hurlé faux, c'est bien entendu dans le fait de penser que le film était, pour cette raison précise, fascisant (3). Il est amusant d'observer à ce titre que nombre de cinéastes ont été frappés d'anathèmes, accusés de fascisme (le mot jouit depuis 40 ans d'un effet de mode médiatique dans certains cercles culturels bien mis qui ne semble pas devoir se démentir), de nazisme rampant même, précisément lorsque leurs films font appel à l'intelligence du spectateur sur de tels sujets : Tinto Brass pour son Caligula, Ferreri pour La Grande Bouffe, Tobe Hooper pour Texas Chainsaw Massacre (4), ou Hirschbiegel pour Der Untergang (ah, cette inénarrable critique de Wim Wenders!) ont fait les frais de telles polémiques. Verhoeven ne fut bien entendu pas épargné. Ce qui est intéressant dans le phénomène, c'est que des cinéastes dont les sympathies pour l'extrême droite étaient notoires (Zefirelli, Autan-Lara) n'ont jamais été inquiétés par ce genre de saillies... Il est évident que ces "débats" sont la plupart du temps totalement creux pour peu qu'on jette un oeil sur les films incriminés. Le simple fait que le scénariste Ed Neumeier apparaisse dans le film en tant que condamné à mort dans l'un des clips de propagande d'état infirme de telles spéculations. Autrement dit, Verhoeven vous montre un film de propagande pour vous pousser à la réflexion sur le fait de le prendre, ou pas, pour argent comptant. Au delà de tous les indices qui sont jetés au visage du spectateur, plusieurs prises à partie directes via la caméra laissent peu de doute sur ce point : la séquence d'ouverture sous forme de reportage de guerre, un regard-caméra dubitatif du journaliste après le "kill'em all" de Johnny, et ce même Johnny lors de la destruction de Buenos-Aires demandant "Hey! What's goin' on?", question à prendre au premier degré puisque posée directement à la salle de cinéma. Mais loin de nous l'idée de déclarer que quiconque ne pleure pas devant Starship Troopers possède le gène du nazi. Il serait déplacé de plagier ainsi la fine fleur de notre cinéma national (5) Quoique :
C'est tout de même l'autre motif dominant du film: l'instrumentalisation du drame à des fins idéologiques passablement crapuleuses. Du point de vue de la dramaturgie, la séquence-clé du récit est bien évidemment celle de Buenos-Aires rasée par un météore arachnide, et qui fait directement référence à Pearl Harbor. A partir de cet acte de guerre, dont on crée ensuite commodément le caractère d'acte fondateur des hostilités en faisant fi des évènements précédents (l'expansionnisme panspatial de la Fédération, l'implantation des Mormons sur Klendathu), l'ensemble des personnages se jette à corps perdu, et sans se poser plus de questions, dans une guerre qui de toutes façons conditionne leur persona sociale. Le discours officiel qui suit prône directement la suprématie humaine et débouche sur une sorte de super-Baie des Cochons teintée de bourbier Vietnamien. Ne manque que la qualification de l'évènement en "jour marqué du sceau de l'infamie"... C'est aussi à partir de là que les spots propagandistes enclenchent la seconde et se font ouvertement belliqueux, avec notamment le spot du "visez directement les centres nerveux" et celui prônant le piétinement de cafards avec sa mère de famille hystérique, qui fait certes réponse à la séquence de dissection intervenant au début du métrage (niant d'emblée tout statut d'interlocuteur aux insectes géants, considérés comme des animaux stupides). Néanmoins, c'est à partir de cette attaque que la guerre totale est déclarée, mais aussi que Johnny s'engage à corps perdu dans l'idéologie fascisante de son armée, pour plus tard oublier son premier amour dans les bras de Dizzy, elle aussi complètement acquise à la cause (voir sa saillie sur l'engagement lors de la tentative d'abandon de Johnny au camp d'entraînement). Cet acte achève d'ailleurs de discréditer Carmen aux yeux du public, qui la voit alors définitivement comme une dilettante, son engagement (vis-à-vis de Johnny, mais aussi de la Fédération) n'étant pas assez affirmé ! Les cartons de projections-test sont éloquents à ce niveau, et montrent le piège rhétorique tendu par Neumeier et Verhoeven.
Ce piège consiste à prendre un certain nombre des représentations populaires et culturellement marquées de la culture populaire occidentale et plus précisément du cinéma mainstream hollywoodien, et à les observer en faisant un pas de côté, pour les mettre violemment en parallèle avec d'autres propagandes. Le discours résultant est bien sûr que tous les totalitarismes (politiques, culturels, sociaux, de droite, de gauche ou même religieux) fonctionnent sur les même mécanismes sociétaux, quelque soit la matière du gant qui entoure la main de fer : fonte émaillée de rouge et noir pour les utopies dures à la Orwell, ou velours pastel pour les utopies douces à la Huxley, l'effacement de l'intellect et du sens critique reste sensiblement le même : l'individu mis au service d'un système qui ne souffre aucune contestation de sa légitimité (6).
Cette rhétorique s'appuie sur deux modes opératoires, Le premier, le plus évident, est imputable plutôt à Verhoeven. Il consiste à reprendre des motifs ouvertement rattachés au nazisme, au fascisme ou aux heures les plus identifiables (et pas nécessairement les plus sombres) d'une certaine histoire occidentale et américaine. On trouvera donc les symboles de la gouvernance au sein de la fédération, à commencer par l'aigle frappant les drapeaux, symbole qui possède l'intérêt d'être commun aux pays de l'Axe lors de la seconde guerre mondiale, mais aussi aux Etats-Unis modernes ou à l'empire Romain. La référence plus ou moins évidente à des évènements qui font partie de l'inconscient historique américain complète le tableau: Pearl Harbor, Grenade, plus tard le, les bombardements sur Tango Uria qui évoquent le napalm et le siège final qui cite ouvertement Fort Alamo. La manière dont sont présentés les spots de propagande, titrés Why We Fight (citation des bandes de Capra lors de la seconde guerre mondiale) ou Countdown to Victory (référence ouverte à la couverture par CNN de la première guerre du Golfe, très orientée elle aussi) , convoque bien évidemment l'imaginaire des films éducatifs du milieu du siècle. D'autres symboles sont encore plus explicites, comme les coups de fouet disciplinaires (présents aussi dans le livre) ou l'iconographie nazie très présente, comme les uniformes ouvertement gestapistes du service stratégique. A propos de Gestapo, le casting du très aryen Casper Van Dien ne semble pas accidentel, dans la mesure ou le personnage de Carl (joué par Neil Patrick Harris, jusque là connu pour des rôles dans des séries télé... Tiens donc, comme Elizabeth Berkley dans Showgirls, plus connue alors pour ses prestations dans la série Saved by the Bell. Subversion, subversion...) évolue physiquement au fil de sa coulée dans le moule idéologique que représente son uniforme noir et cintré : de brun au début du film, il devient blond platine en dernière bobine ! Loin d'être le bouffon anodin de teen movie qu'il à l'air d'être au début, Carl semble jouer le rôle d'indicateur des réelles intentions des auteurs. Un bleu de méthylène thématique dont on se demande encore comment les détracteurs du film ont pu ne pas le voir.
En témoigne ce raccord abrupt au début du métrage, entre la séquence où est évoquée la télépathie et ses possibilités de contrôle des esprits (dernier plan sur Carl) et la séquence de Football (premier plan sur Carmen dans le public, qui répond au précédent comme un contrechamp). Ce bon vieil effet Koulechov finit d'unir les deux plans en un commentaire acerbe sur la gouvernance.
C'est le second mode opératoire, qui montre d'anodines pratiques culturelles qu'on a vu tellement souvent dans le cinéma américain qu'on ne les remet même plus en cause, tant on les a intégrées dans notre propre imaginaire (même lorsque lesdites pratiques sont strictement nord-américaines, comme le bal de prom night par exemple ou la notion même de cheerleader, que l'on gagne en même temps que le match). C'est Neumeier, américain de souche de ce projet bicéphale, qui joue avec ces codes. Ici, outre que ces occurences sont montées en parallèle avec les pires horreurs du régime - peine capitale multidiffusée, gosses de douze ans en uniforme ou à qui on distribue des fusils, charniers - elles sont trop ripolinées, trop clinquantes, et font avancer l'intrigue de manière trop mécanique pour être honnêtes. On citera le météore de Buenos-Aires qui croise dans un premier temps le vaisseau de Carmen et Zander au moment même où ceux-ci le pilotent. Ou encore la stratégie footballistique de Johnny qui lui permet dans un premier temps de gagner ses galons, puis à une autre occasion de sauver sa garnison en tuant tout seul un scarabée géant. Les dialogues sont à cet égard très amusants soit dans leur cucuterie excessive ("Chaque fois qu'on est tous les trois j'ai l'espoir qu'on peut sauver l'univers") soit dans le double sens malicieux que leur confère le contexte (le dialogue de la salle de classe). La seule autorité morale identifiable dans le film, le professeur Racsak est caractérisé à la même manière excessive-mais-pas-tant-que-ça-finalement : de théoricien de l'idéologie dominante, il devient acteur belliqueux du conflit, et récupère à l'occasion sa puissance et sa virilité, conférée par l'Etat en l'objet de sa main prosthétique. Pour preuve, il se permet même alors de prodiguer des conseils d'hygiène du couple. Le tout fait du film dans son entier un long pastiche de film propagandaire (les inserts du film dans son générique de début ne laissent aucun doute à ce sujet), contenant son propre commentaire implicite dans la fausseté apparente de son écriture.
Les deux démarches se rejoignent dans leur façon de reprendre la structure classique des films de guerre des années 50/60, ceux ou une jeune recrue idéaliste grandit au contact de la bataille et apprend patriotisme, valeurs républicaines et sens du devoir. Toutes les séquences-clé sont ainsi placées, et dans l'ordre, dans ce Starship Troopers: dernier baiser à la petite amie, classes avec un sergent-instructeur sévère mais juste, montée en grade, camaraderie, confrontations interpersonnelles suintant la testostérone, retrouvailles au front avec un ami du civil, personnage préférant baisser dans la hiérarchie pour vivre selon ses désirs, haut gradé désavoué, etc.. L'idée de la simulation de combat avec les lasers est par exemple une citation directe des 12 Salopards d'Aldricht, mais encore une assortie de l'ironie consistant à bien montrer une situation schématisée au travers les couleurs bien différenciées des rayons et des casques d'équipes. Verhoeven/Neumeier nous montrent d'ailleurs tout au long du métrage des situations plus complexes que les interprétations directes faites par le dialogue.
Le traitement des arachnides en est le meilleur exemple. Dans l'ensemble des cas, l'humain, persuadé d'être le sommet de l'évolution notamment par la grâce de la technologie, se voit mine de rien tenir une dragée sacrément haute par des insectes sociaux. Ces derniers se montrent en effet plus unis et moins dispersés que leurs ennemis : au moins 6 espèces différentes combattent et cohabitent dans un ensemble parfaitement complémentaire, là ou la Fédération multiplie les erreurs stratégiques, et où les militaires se méprisent entre corps d'armée voire se bagarrent entre eux. Le parallèle humains/arachnides est ainsi permanent, puisqu'ils sont montrés côte-à-côte dans les charniers, font l'objet de la même violence décomplexée (on est amené à prendre le même plaisir à voir les uns et les autres se faire démastiquer de manières multiples et amusantes) et de la même caractérisation basée uniquement sur la fonction au sein du groupe : le troufion sympa, le violoniste, l'ambitieux ou le suiviste un peu épais sont les pendants du soldat arachnide, du tanker ou du brainbug. Ils sont d'ailleurs l'objet la même optique désexualisée qui renvoie autant au politiquement correct étasunien des années 90 qu'au mouvement naturiste allemand de la fin du XIXeme siècle (7. La séquence de douche mixte, totalement dénuée de tension sexuelle ou érotique (et d'ailleurs la scène d'amour entre Johnny et Dizzy est elle-même strictement fonctionnelle), résonne étrangement avec la séquence de dissection où il n'est fait état d'aucun organe sexuel... On revient à l'individu réduit à néant, au service d'un système belliciste, enseigne des totalitarismes sous laquelle humains et non-humains sont logés de la même manière, ce qui constitue encore une fois le cœur même du discours défendu par le film.
Les arachnides sont tout de même le cœur du show, et l'autre élément qui fait de ce Starship Troopers un film marquant. Techniquement, le film constitue une date peut-être plus marquante que Jurassic Park. Petit historique : Phil Tippett, génie du stop motion, a conçu et animé le E-D 209 de Robocop (et le Caïn de Robocop 2) selon ce procédé, qui devait être celui des dinosaures du film de Spielberg. A la transition numérique des effets du film, il se forme sur le tas avec le résultat qu'on sait. Un cran de taille est passé avec Starship Troopers, qui présente non seulement enfin des créatures photo-réalistes (ce qui est exceptionnel en 1997), amis aussi en excellente symbiose avec les animatroniques. Le film est, enfin, un grand moment du compositing numérique, qui gagne là sa légitimité et trouve l'un de ses actes fondateurs (voir les plans de la bataille en orbite proche, contenant plus d'une centaine d'éléments superposés). Ils sont très rares, les effets spéciaux de l'ère numérique qui restent crédibles presque quinze ans après leur sortie. Pour Verhoeven qui voulait, de son propre aveu, signer un film à effets spéciaux fait sur le modèle de ceux de Ray Harrihausen, la victoire est grande, et renfloue par la même occasion son crédit bien entamé par Showgirls. Le film, qui a fait un four au box office américain, a depuis acquis un vrai statut de classique en lui permettant d'explorer jusqu'au bout sa tendance à pasticher les formes télévisuelles (8) (Starship Troopers est à bien des égards construit à la manière des publicités de Robocop et Total Recall).
Bien loin des considérations qu'on a pu lire çà et là voulant que Starship Troopers soit une sorte d'incident isolé dans la carrière de Verhoeven, c'est un métrage qui brasse l'ensemble des thèmes que chérit le cinéaste: personnage féminin faisant des erreurs, considérations sur l'identité par rapport au rôle présupposé, réflexion sur les faits de guerre et les errements de l'idéologie au sens large, violence outrancière, manipulation rhétorique du spectateur par l'agencement du récit et sa mise en scène dans le but de le pousser à la réflexion, ambiguïté des personnages. Au tournant des deux siècles, deux films semblent se répondre sur ces circonspections : Starship Troopers et Battle Royale. Les deux films, adaptés de romans très marqués politiquement, montrent des jeunes gens instrumentalisés par un pouvoir adulte fascisant, et poussés dans un monde de guerre qui cherche à les éliminer en tant que sujets, le tout en faisant ouvertement référence à un vingtième siècle plus chargé et pestilent que la langue d'un ivrogne frappé de tumeurs hépatiques. Le parallèle entre les deux films n'a rien d'arbitraire. Paul Verhoeven a grandi pendant l'occupation allemande de son pays, près des rampes de lancement des V2. Jeune homme, et à la même période, Kinji Fukasaku a dû nettoyer les rues de sa ville des cadavres qui la jonchaient après les bombardements. Tous deux exorcisent ces images dans leurs métrages respectifs. L'un démarre le climax de son film avec une flotte aérienne frappée par une DCA extraterrestre, et l'autre montre son antagoniste principal errant, rendu aveugle par le blast d'une explosion cataclysmique. Voilà assurément un double programme intéressant à se projeter, surtout à une époque ou la politique et l'idéologie font, de toutes parts, entendre des bruits de bottes de plus en plus nets. N'oublions tout de même pas l'incroyable maîtrise narrative et cinématographique de ces films, qui restent des films d'entertainment avant toute chose et ne sauraient être réduit à de simples Bucéphales pour les croisades de leurs auteurs.
F
(1) Nombre de projets rattachés au cinéaste lui ont ainsi échappé pour être reconvertis sous des formes lénifiées, le meilleur exemple étant Dinosaur, ultimement produit par Disney, à l'origine un projet totalement muet et bien plus graphique et jusqu'au-boutiste.
(2) Nom donné à la manière dont les Etas-Unis ont joué l'ingérence systématique et endossé le rôle de "police du monde" au sortir de la première victoire en Irak, en référence à la Pax Romana.
(3) Erreur qui revient à confondre purement et simplement "fasciste" et "fascisant". La collusion des termes, leur simplification et leur confusion, menant inévitablement à une novlangue, est d'ailleurs selon Orwell l'antichambre des totalitarismes : le langage étant suivant le terme célèbre de Lacan le vecteur de la pensée, simplifier et appauvrir le langage revient à simplifier et appauvrir la pensée, et de là l'individualité, le sens critique.
(4) L'un des tout premiers films frappés de classification X en France, en 1975. Juste pour situer.
(5) Voir à ce titre l'hilarante assertion de Rose Bosch dans Les Années Laser à propos de son film La Rafle, comparant quiconque aurait des réserves quant à son film à un militant hitlérien.
(6) Les scènes coupées, centrées sur Carmen, l'humanisent en la montrant comme une jeune femme qui évolue au fil de ses errements, la plaçant dans la tradition des héroïnes de Verhoeven.
(7) Ce mouvement a constitué l'un des lits idéologiques des théories pro-aryennes puis nazies.
(8) Au point qu'un des centres d'entrainement des recrues se nomme Fort Kronkite, du nom du présentateur vedette de CBS.
Scott Pilgrim VS the world
Première adaptation pour Wright, qui choisit pour ce faire la voie la moins facile : une bande dessinée dite d'auteur, entièrement basée sur la référence geek, et dans une mise en scène qui doit s'approprier les codes constitutifs mêmes du jeu vidéo plutôt que d'en simplement calquer la lettre. Paradoxalement, si l'incroyable maîtrise d'un Hot Fuzz ne se dilue pas dans ce gargantuesque gloubiboulga esthétique, et si le film se présente sous les atours d'un des meilleurs feel good movies de ces dernières années, l'arrière-goût qu'il laisse est en même temps assez amer.
"If your life had a face I would punch it."
Dans le monde de la BD "indépendante" (pour schématiser, ni comic book, ni manga, ni de l'école franco-belge qui chérit son humour datant des trente glorieuses, bref la BD n'entrant dans aucun autre marché de niche ayant une identité préexistante), le terme de phénomène est si galvaudé qu'il n'est même plus amusant : en gros, pour toute BD pour laquelle le destin de faire 54 tomes sur 20 ans chez Glénat ou Soleil n'est pas plié d'avance, l'industrie sera invariablement surprise si le tirage dépasse les 5000 exemplaires/monde. Et la presse spécialisée de s'esbaudir pour soutenir le mythe d'un huitième art préservé des crapuleries ordinaires du business culturel. Traité comme il se doit de phénomène dès sa sortie, Scott Pilgrim n'est bien entendu pas la panacée vendue à la va-vite par une sphère médiatique qui ne l'a la plupart du temps que rapidement feuilletée. Intéressant, attachant, l'ouvrage de O'Malley est surtout inégal. C'est à la fois inventif et (trop) familier, certaines planches ressemblent à du Valérie Damidot des mauvais jours alors que d'autres fonctionnent très bien, et le graphisme, pourtant plus travaillé qu'il n'y paraît, laisse néanmoins souvent une impression de gribouillage d'agenda d'étudiante qui aurait trop biberonné à Jamie Hewlett (pas mal des "nouveautés" visuelles de Scott Pilgrim ont déjà été vues dans les premiers Tank Girl). En termes de narration, c'est le même mélange qui gène par moment et plait à d'autres. Pas mal d'innovations et d'expérimentations de rythme et de ton font mouche (c'est souvent très bien dialogué), mais le tout reste une bande dessinée indé avec tout ce que ça peut impliquer de routinier et de pénible. Car si le pitch de base est excitant et le contexte maîtrisé, on se retrouve quand même avec une BD de dating d'adulescents dans une ville enneigée (ici Toronto, ça change de Seattle, Berlin Est ou Varsovie, villes très appréciées dans la BD artificiellement vintage), ponctuée de considérations sur le quotidien (plus souvent rideaux de douche et sachets de thé que cuvettes de toilettes et moteurs de tracteurs, étrangement) et l'étiquette des relations lycéennes amicales, le tout avec souvent une cucuterie embarrassante passé 19 ans (mes Dieux, cet horrible tome 4!). Bref, de la bande dessinée estampillée "jeunes adultes", cette veine occidentale de shojo manga rendue insipide par expurgation de toute vie graphique et thématique au profit d'un paravent (n)ostalgique aux contours peu définis, et qui plait tant aux hipsters urbains sillonnant le dernier étage de Boulinier entre deux achats de vinyles et de lomographie. Ce qui assurera au moins de bonnes ventes à la BO du film, très mode, qui leur caresse le poil dans le sens de l'époque (les morceaux du groupe Sex Bob Omb, composés par Beck, ressemblent à du White Stripes, et le seul qui soit intéressant à écouter a piqué son riff au Stigmata de Ministry...).
Wright signe une adaptation qui s'éloigne graduellement (et avec raison) du déroulé de l'original, mais surtout en clarifie les enjeux et en enrichit le visuel dans le processus, à sa propre sauce, comme ce fou furieux de Paul Robertson avec le jeu. Car si on lui enlevait la réalité augmentée d'innombrables éléments intriqués de culture pop n'geek qui le caractérise, le script n'aurait rien de bien différent de la veine la plus morne du film indépendant américain prenant place dans le New Jersey. C'est d'ailleurs dans les affranchissements à l'œuvre d'origine que Wright prend le pouvoir et remporte ses victoires esthétiques. Le cœur et principal intérêt du spectacle réside bien dans les fantastiques combats imagés ou Wright (aidé de son Bill Pope de chef op qui retrouve son énergie de Darkman) se permet absolument tout (bancs-titre grammaticalement corrects dans les raccords d'axes, intermèdes chantés dans la tradition de Bollywood, inflation de pixels, montage cut jamais illisible, plans fous en inserts), dans une virtuosité de propos et de mise en scène toute en emphase et fluidité qui remporte l'adhésion presque à tous coups et fait passer toutes les audaces comme si elles étaient naturelles, des changements de format image à ceux de tons. A ce titre l'élimination de Todd (evil ex#3) par la Vegan Police, après une ruse sortie du Village des Damnés, vaut à elle seule le prix de la place, et c'est le meilleur cameo qu'on ait vu depuis pas mal de temps.
Le pitch et la construction séquentielle restent globalement similaires à la BD : Scott (Michael Cera, qui fait du Michael Cera, faut aimer) traîne dans Toronto avec ses potes, son groupe et son geekisme patenté. Il vit chez un ami gay et dans le souvenir de son ex devenue rock star, au point qu'il dragouille une lycéenne de 17 ans, jusqu'à sa rencontre avec Ramona (Mary Elizabeth "soyez mienne" Winstead). Leur relation naissant, il se voit défié de vaincre en combats singuliers ses sept ex maléfiques comme autant de bosses de fins de niveaux, représentant des étapes dans ladite relation, mais surtout dans celle que Scott entretient avec lui-même, puisqu'il apprend au fur et à mesure à devenir un être humain acceptable. Les évènements diffèrent de l'original, notamment dans le traitement de Knives (la lycéenne) qui aura l'occasion de devenir, brièvement, une evil ex de Scott, mais aussi dans le placement plus opportun de l'extra life et du "let's both be girls", qui prennent plus de signification. Surtout, alors que O'Malley tourne autour du pot des potentialités de son histoire (le récit est-il ouvertement fantastique ou non?), Wright prend à bras-le-corps le parti de poser l'histoire comme étant contée exclusivement au sein de l'imaginaire de Scott, d'abord parce que l'intégralité de l'histoire passe par son point de vue, mais surtout via l'utilisation extensive des rêves, des passages dimensionnels ou même des visualisations littérales d'actions ou de jeux de mots (onomatopées à la Batman 60's, yéti sonique, écrans de versus, mots flottant d'une personne à l'autre...). A ce propos, c'est quasiment l'ensemble des tentatives de Wright qui s'avèrent concluantes, tant en termes de direction artistique que de post production et de découpage. Pas besoin donc de s'étonner, à l'intérieur de cet univers, que des gens explosent en laissant derrière eux des pièces, sortent des massues d'animés pour se mettre des avoines ou que des scores apparaissent à la fin de confrontations arrivant d'ailleurs aussi inopinément que le reste. Pas besoin non plus de se triturer l'entendement à chercher quid du réel ou du faux/du rêve/de la Matrice/etc. , puisqu'on n'en est plus là, si on l'a jamais été (1).
C'est là que le film développe, sciemment puis de manière autonome, un discours assez inhabituel et intéressant pour se démarquer du simple "manifeste geek" où l'on entend le cantonner ici ou là sur la seule base de son libellé, et qu'il est d'ailleurs nettement moins que pouvaient l'être les travaux précédents de son auteur. Partant du principe que l'on est dans l'imaginaire de Scott, le récit enjoint naturellement, de par sa nature même, à questionner cet imaginaire, à critiquer, même, ce dont il est fait. En effet, cet imaginaire est presque entièrement constitué de pièces rapportées, de références que Scott lui-même ne crée pas mais reprend en bloc à son compte, et même qu'il ne prend pas la peine de mettre en perspective ou de hiérarchiser. C'est la chronique non seulement d'un monde totalement déréalisé, mais surtout foncièrement nivelé du point de vue culturel : lors d'un concert, un groupe de rock indé se retrouvera ainsi à affronter un combo de dance music sans que ça gène personne, l'on se prendra dans le même temps pour un héros de RPG et pour le Kramer de la sitcom Seinfeld, demander à un membre de formation musicale de quoi il joue expose à la réponse "Zelda, Tetris", et Hemingway se retrouve mis de fait sur le même plan qu'un dance-dance-revolution quelconque (2).
Attention toutefois, dans un monde et pour un genre humain où la virtualité a autant sinon plus d'importance dans la constitution de la psyché que les expériences du "réel" (c'est une théorie que défend notamment Mamoru Oshii, dont l'Avalon fait ici l'objet d'un discret mais évident hommage à la fin du combat Katayanagi), il est évidemment ridicule de diviser les avatars de cette virtualité en bonnes et mauvaises occurrences. La hiérarchisation raisonnée de la culture n'a pas à être verticale, et certainement pas en fonction du médium, ce que bien des beaux esprits prennent pourtant encore pour argent comptant, du fond de leur inextinguible suffisance autophile. Wright, lui, comprend cet écueil et l'évite.
Ce qui est frappant, c'est bien l'indifférenciation elle-même des éléments de la vie culturelle de Scott, pas les éléments de cette indifférenciation. Et c'est cet aspect du récit qui laisse une impression étrange. Car Scott est ce qu'il faut bien appeler un connard, vivant totalement en vase clos dans sa tête, avec un système de valeur désespérément immature et l'égocentrisme d'un gosse de six ans. Commentaire sur le solipsisme d'une certaine catégorie de geeks/nerds bloqués dans une post-adolescence socialement et humainement peu concluante, le traitement de Scott est tout de même très à charge : il apparaît ainsi presque parfaitement asexué (ses non-aventures en terres d'intimité féminine font l'objet de commentaires constants, et le motif est opposé à la générosité avec laquelle son colocataire distribue ses turgescences - sans pour autant être moins fleur-bleue que lui), à peu près dénué de considération pour autrui (voir son histoire passée avec Kim, la manière dont il traite Knives, la crise d'ego qu'il sert à Ramona dans le club après l'élimination de Todd), s'apitoyant volontiers sur son sort en chérissant ses propres irrationalités (son incurie capillaire suite à sa rupture avec Envy, à qui il refuse plus tard toute forme de rédemption) d'un abord conversationnel relativement pauvre (la pitoyable anecdote sur PacMan qui lui sert manifestement de ciseau à badinage), globalement épouvanté par toute forme d'effort sur soi (il se plaint plusieurs fois de la difficulté de tel ou tel comportement adulte qu'on attend de lui, et n'a semble-t-il pris la peine d'apprendre que les accords de Ré sur sa basse), figé dans des représentations béotiennes ("He had a snotty nose? But, He's famous!") et incapable de sortir du casual ("Did you see a future with this girl? _You mean with jetpacks?").
Un élément musical permet de penser que ce commentaire n'est pas fortuit de la part de Wright. En effet, l'une des références vidéoludiques du film revient à plusieurs reprises, lors de moments où Scott s'isole pour se recentrer et/ou fuir une confrontation verbale (typiquement, aux toilettes) est une musique bien connue des joueurs de Zelda 3 sur Super Nes, celle des cavernes aux fées. Soit les endroits sans ennemis ou périls d'aucune sorte, remplis de bonus de vie, et où le joueur est pris en charge par une figure éthérée qui littéralement s'occupe de tout pour lui. La dernière preuve, si besoin en est, que l'entièreté du film se situe dans l'imaginaire de Scott et seulement là, est que cette musique sert à introduire la première séquence, dès le premier establishing shot. Elle colore également cet imaginaire comme étant celui d'un vieil enfant cherchant à se faire materner par ses relations amoureuses (c'est Knives, pourtant de six ans sa cadette, qui met des pièces dans les bornes d'arcade pour lui), ses amis (voir les conversations avec son groupe) et globalement par la vie elle-même (le montage elliptique dénote une capacité de concentration volontairement réduite, un besoin de stimulation constant, voir aussi à ce niveau la manière dont il expédie la lecture du mail de Matthew Patel, qu'il considère ennuyeux).
C'est bien entendu pour l'économie de l'histoire que Scott est ainsi dépeint, puisqu'il est censé y apprendre à murir. Cet apprentissage est toutefois cantonné à la toute dernière bobine, et pour se faire il devra perdre son hébergement, son groupe, se faire larguer deux fois, mourir, ressuciter, puis se vautrer publiquement dans une crapulerie passée pour s'en laver. Entre temps, la mise en scène l'aura montré quasiment dénué de tout tonus (l'hallucinante séquence où Ramona doit littéralement lui tenir les mains pour porter les coups à sa place!) et de tout charisme. La comparaison entre lui et les evil exes est à son désavantage complet : même lorsque tournés en ridicule et aisément défaits (certains combats sont expédiés), ils puent la classe à côté de lui, notamment par la grâce d'une direction artistique qui s'emploie à le faire ressembler à Snot, l'un des personnages secondaires d'American Dad, quand les ex affichent tous une prestance bigger than life. Cette opposition entre Scott et le reste du monde (comprendre : le monde concret et sexué), déjà évidente dans le choix du titre (qui n'est que le sous-titre de l'un des tomes de la BD), est encore appuyée par la mise en scène, qui place régulièrement des plans d'inserts de personnages plus terre-à-terre qui marquent leur opinion "seriously, WTF?" sur les évènements qui se déroulent devant eux (principalement sa sœur Stacey, la batteuse Kim, et Wallace dans une moindre mesure).
Et pourtant à aucun moment on n'en arrive à se dire « non mais franchement, comment ce type-là arrive-t-il à s'attraper une gisquette pareille? ». Ramona n'est pas non plus très sympathique à vrai dire. Distante, impossible à dérider, n'apportant à peu près rien sur la table à part le fait de tirer la tronche et de changer de couleur de cheveux (et être furieusement choucarde, oui), Ramona n'a pas grand chose pour elle, en tant que personne, à part son hyperséduction et une vie sentimentale résolument hype quant à ses objets d'affection. C'est une personne qui, au sens fort, se contente d'être, opposée de fait à Knives qui fait des pieds et des mains pour exister aux yeux de Scott, et que de fait on apprécie beaucoup plus.
C'est sans doute l'une des raisons d'un malaise a priori assumé par Wright, mais dont il n'aura peut-être pas anticipé les conséquences néfastes sur le destin de son film au box office US. Il est en effet impossible de s'identifier aux deux personnages principaux, pourtant vecteurs du spectateur, tant ils sont antipathiques. La promotion et même l'œuvre originale ne nous ayant en aucun cas prévenus, on se retrouve pendant presque une demi-heure de film à se demander pourquoi on n'entre pas dans le récit (l'adaptation du premier tome est strictement littérale, et lorsque le premier combat intervient, le mal est déjà fait) avant d'en identifier la cause. Bien des récits fédèrent sur le caractère antipathique de leur(s) protagoniste(s), mais en prenant soin de bien baliser cet état de fait afin que le rapport de distanciation/identification soit admis d'emblée. Or ici, comme dans certaines séries bien connues des années 90 et 2000 (au hasard, Malcolm in the Middle, Seinfeld, Weeds), les personnages secondaires sont plus sympathiques et plus intéressants que les personnages principaux. On se console ici devant les frasques de Wallace, les vannes de Kim, Stacey ou Julie Powers, et on se prend même à prendre plus de plaisir à suivre le boss final, Gideon, qu'à suivre Scott lui-même ! Bref, le film en tant qu'entité est plus sympathique que le personnage auquel on était censé s'attacher, et s'il apparaît dommage de prime abord de "perdre" deux ou trois bobines sur le métrage complet à suivre un type dont on n'a rien à faire, on peut voir Scott Pilgrim VS the World comme un indice de la maturité du cinéma geek.
Après avoir vu ses balbutiements (du postmoderne Rocky Horror Picture Show au succès inattendu d'Evil Dead), son avènement (Spielberg, Lucas), sa prise de pouvoir (Sam Raimi faisant Spider Man, la suprématie des barbus Jackson et Del Toro sur Hollywood) puis son assimilation (les moutonnières adaptations de comic books sabotées par Avi Arad, le cycle cinéma/memes Internets (3) qui s'internourrissent), le cinéma geek se permet ici de faire ce le jeu vidéo a fait au début des années 2000 : envoyer bouler son public-cible en lui tendant un miroir trop exact à son goût. En 2001, suite à une campagne de communication gigantesque, sort sous les vivats Metal Gear Solid 2. Le jeu, néanmoins, fait l'effet d'une douche froide pour le joueur, que Kojima envoie ostensiblement se faire voir ailleurs avec ses compliments. Lui refusant le contrôle du populaire Solid Snake dès la fin du premier tableau, le jeu force le joueur à incarner un jeune crétin falot, naïf et acharismatique au possible, qui s'avère totalement manipulé et dénué d'identité propre, puis le dénigre ouvertement via les dialogues (les PNJ (4) vous sortent sur l'intercom des bribes de phrases absurdes avant de vous sortir des injonctions comme «Eteins cette console, tu t'abimes les yeux et d'ailleurs tu joues trop mal» ou «Tu n'as pas mieux à faire que jouer à des jeux vidéo ?») avant d'annuler toute l'histoire en en révélant le statut de simulation implantée dans son esprit. Ce jeune crétin, c'est la représentation même du joueur, mordu par la pomme même dont il prétendait se goberger sans réfléchir. De même, Scott Pilgrim est la représentation du spectateur de Scott Pilgrim VS the World : apathique, infantile, se berçant de nostalgie et d'illusion qu'il ne s'est même pas créées (voir les ricanements entendus que génèrent tous les coups de coude référentiels au spectateur). On peut voir dans ce projet la marque d'un très grand cinéaste, qui se démarque décidément du tout-venant du cinéma référentiel par sa faculté à mettre en perspective sa culture populaire, plutôt que de s'en contenter. C'est le cas, et le geste, courageux, force à envisager avec une plus grande maturité une culture pop qu'on prenait trop souvent comme une évidence, et dont on niait la valeur même en la plaçant dans le tambour de machine à laver de l'absence d'esprit critique. Pour les geeks, le temps des simples "manifestes" contre d'hypothétiques ennemis passéistes est révolu. Il est temps d'entrer dans le monde des adultes avec tous ces beaux bagages en mains. C'est pas plus mal.
FL
1 Rappelons tout de même qu'il s'agit de films, de discours sous forme imagée, donc de virtualité de bout en bout où le réel n'est, au plus, qu'évoqué. Que la toupie tombe à la fin ou pas, Leonardo, le récit se clôt toujours par un générique. En ce sens, le cinéma (mais encore tous les modes de représentations humains, la peinture, la chanson de geste, la littérature ou les histoires de régiment de tonton Gilbert quand il est saoul à la fin d'un repas de noces) n'est que l'une des localités du possible, à ranger à côté du réel qui n'en est lui-même qu'une autre. Confondre discours et réel est une attitude d'ordre religieux au sens strict. Quant à confondre son propre discours et la vérité, c'est la marque d'une mégalomanie mal placée.
2 la réplique "A gig is a gig is a gig is a gig".
3 Le terme "meme" désigne l'ensemble des délires plus ou moins viraux qui se répandent quotidiennement sur Internet, dont beaucoup sortent de forums tels que 4Chan.
4 Personnages Non-Joueurs (NDA)
MONSTERS
Synopsis : Suite à une bourde de la NASA des germes de vie extraterrestre se sont développés dans la jungle mexicaine. Six ans plus tard, le Mexique et le Costa-Rica sont devenus des zones de guerre désertées par les populations locales, mises en quarantaine et peuplées de créatures monstrueuses. Un photographe est à son corps défendant chargé d’escorter une la fille de son patron vers les Etats Unis. Ne pouvant rentrer que par voie terrestre, ils traversent la zone de quarantaine.
Où les monstres ne sont pas tous ceux qu'on croit, ni même les seuls à regarder avec émerveillement.
Ayant bénéficié d’un buzz de taré autour de son budget anémique, il y a fort à parier que Monsters désarçonne son public justement à cause de celui-ci, et même pâtisse de cet état de fait. Tourné pour peau d’balle (les 15 000 dollars annoncés sont sans doute une fourchette basse, mais on est dans du pas bien lourd quand même) avec des résultats sans mesure avec l’investissement de base, Monsters fait jaser nombre de professionnels de la profession au son des deux mêmes mots : District et Nine. Certains citent même Cloverfield, c’est dire si Monsters doit s’extirper d’un malentendu pesant – généré en partie par sa propre promo.
Il faut d’entrée poser comme préalable que si l’on va voir Monsters avec ces deux précédents en tête, on sera sans doute déçu (pas d’un point de vue qualitatif mais de celui du « contrat narratif », pour causer avec prétention) car Monsters constitue l’antithèse des deux exemples suscités, quoique pas dans les mêmes domaines. Avec les deux films il entretient comme points communs le vérisme, l’intelligence des moyens, l’intégration « moléculaire » de l’élément fantastique à la trame narrative et plastique, ainsi qu’un filmage lorgnant vers l’esthétique documentaire (décadrages, caméra à l’épaule, jump cuts). Cependant l’humilité à tous les niveaux de Monsters le situe aux antipodes de la grosse machine à millions et à buzz qu’est Cloverfield, sa sincérité dans les sentiments des personnages aussi, tant l’amourette adolescente du film de J.J.Abrahams prête au mieux à sourire. C’est son humanité qui le place à cent lieues de District 9, exercice très brillant et bien fun, mais souffrant de la caractérisation hasardeuse de son foutriquet de perso principal et d’un militantisme trop peu dégrossi et subtil, bien que louable dans son objet naïf (« le racisme c’est pas bien », OK, tant qu’on veut, mazel fuckin’ tov mec).
Ce qui intrigue ainsi en premier dans Monsters, c’est la rareté des monstres dont il est question dans le titre, surtout en regard, par exemple, des chiées de fooking prrraunz qui courent partout dans le métrage de Blomkamp. Comme ce dernier, Gareth Edwards est habitué à tirer le maximum sur des projets audiovisuels faits avec de la salive et du scotch (il a surtout travaillé sur les parties de reconstitution qu’on voit parfois dans les docus historiques télé, de celles où deux pelés et trois tondus sapés avec des chutes de marché aux tissus tentent vaillamment de refaire la bataille de Samothrace dans un square du XIVème), au point de s’être fait un petit nom dans le milieu grâce à un savoir-faire qui rend nettement moins douloureux à voir les produits où il est passé. Il applique ici ses expertises d’infographie et d’intégration numérique pour donner dans autre chose que de la foule synthétique et faire plus difficile, dans la mesure où il est plus simple de faire illusion en termes de compositing avec 5000 petits éléments à l’écran qu’avec un ou deux gros (bien entendu, les foules numériques posent d’autres problèmes, mais fi). Le propos d’Edwards est volontairement anticlimatique, le spectaculaire passant après la construction d’un monde cohérent, et ça passe, dans le traitement même des gloumoutes, par un design simple et concret, exotique (des crabes-poulpes géants, c’est exotique, en tous cas on en voit peu Porte de Champerret) mais éthologiquement correct, c’est-à-dire que les monstres sont crédibles et que même si leur mode de vie ou leur fonctionnement biologique sont partiellement mystérieux (les pseudopodes luminescents), ils ne sont pas fantaisistes, et du coup leur assise dans l’univers dépeint est incontestable. En terme de traitement de la menace biologique sous un angle réaliste, on pense quelques fois aux dragons de Reign of Fire, qui avait d’ailleurs lui aussi, en son temps, déçu de prime abord quant à la rareté de ses clous du spectacle. Dans ce cas comme dans celui qui nous intéresse, le récit se fait à hauteur d’homme en termes de relations, d’action, mais surtout du point de vue métaphysique, dans la perception subjective d’une situation donnée : on passe beaucoup plus dans nos vies par un système de représentations, d’écrans et d’intermédiaires divers, que par la confrontation « réelle », concrète, avec l’évènement lui-même. Logique ainsi qu’on ne soit pas dans un nanar post-Starship Troopers où les deux mêmes persos, par la simple grâce du fait que la caméra est braquée sur eux, se retrouvent une heure et demi à patauger jusqu’aux genoux dans des floppées de streums à tous leurs stades de développement, pour se retrouver devant la reine pondeuse/le patient zéro/ le vaisseau-mère, à la fin, comme par magie. La menace – la menace biologique s’entend – de Monsters, le plus souvent cantonnée au hors champ, est également plus étalée, moins circonscrite, rendue omniprésente de fait (si on veut bien nous passer cette tautologie de première année d’analyse filmique) dans la mesure où tout par ailleurs la valide comme indiscutable (représentations naïves sur les murs, panneaux de mise en garde, reportages etc.).
De plus, le traitement de ce bétail lovecraftien tend très vite à le présenter pour ce qu’il est, à savoir des grosses bêtes certes dangereuses en soi mais de simples animaux sauvages néanmoins. Les tentatives des gouvernements en place, notamment celui des Etats Unis pour contenir et enrayer la menace, en revanche, font l’objet d’un constat plus critique. Précisément parce qu’il est présenté de la même manière, c’est-à-dire comme la mule de Gargantua (qui en cherchant à chasser les mouches avec sa queue rase une région entière de forêts, créant ainsi la Beauce telle qu’on la connaît, plane et glabre). Or ce qui est compréhensible venant d’animaux fussent-ils extraterrestres et en rut, revient à de la barbarie de la part d’êtres humains, qui plus est organisés en nation, qui plus est se considérant comme le phare de la civilisation occidentale… La pacification de la zone par la (bientôt plus) première puissance mondiale est il est vrai pas plus subtile dans cette situation que dans bien d’autres que l’on pourrait hélas recenser dans l’histoire politique récente : murailles de 50 mètres, tapis de bombes trois fois par par jours après les repas, reprendre la posologie si les symptômes persistent. Ou les civils après tout pour ce qu’on s’en cogne, eh, on est là pour casser de l’illegal alien - comme en atteste le prologue/épilogue. Malgré son cortège d’officiels corruptibles, le Mexique semble mieux loti humainement, avec des passeurs et hommes de terrain qui ont une meilleure compréhension du phénomène.
Mais ce phénomène n’est même pas le cœur du film, qui n’est qu’à la lettre un récit de SF. C’est avant tout un road movie, à travers un milieu inhospitalier (dans ce cas, la zone de quarantaine qui couvre le nord du Mexique et le sud des Etats Unis pour cause d’infestation par des bestiaux d’origine extraterrestre), ou deux personnages un peu forcés de se côtoyer voient naître un véritable lien. Ce que beaucoup de nos beaux critiques trouvent formidable lorsqu’on le leur sert dans un film dit généraliste ou réaliste (ou même, ah-ah, d’auteur tant qu’on en est aux termes improprement usités), avec contexte idéologique clé-en-main identifié dès l’affiche et marchant soigneusement dans les clous, ils l’ont trouvé caricatural et cul-cul dans un métrage dont ils n’attendaient à la base que du gunfight et du gore, avec à la rigueur une bonne histoire à écrire à base de chiffres et de budget. Parce que bon, le genre, ça ne se conçoit que si c’est con n’est-ce pas? Et pourtant.
Et pourtant, les personnages de Monsters sont parmi les plus joliment écris – et joués – de cette année. Bien entendu, ils partent d’archétypes dont ils ne s’affranchissent au mieux qu’à moitié. En somme, ce sont des persos de film, par essence archétypaux de toutes façons. Cependant, la subtilité de leur traitement en tant que personnages est ce qui fait tout le prix du film de Edwards. Andrew, le photographe, fait parfois des conneries mais n’est pas un connard. Samantha, fille bien née qui se la jouerait bien runaway bride, n’est ni velléitaire ni une Lady Di aux petits pieds qui se sentirait pousser une conscience sociale en voyant deux gamins de favelas avec des yeux émouvants. Le lien qui naît entre eux, par le truchement de leur promiscuité et de leur cheminement, géographique et intellectuel, se fait l’echo interne d’émotions externes successives, peur, soulagement, frustration, et l’émerveillement face au monde et au vivant (la forêt, les bêtes extraterrestres une fois envisagées comme animaux et non comme envahisseurs) qui chapeaute le tout et balaie toute tentation de cynisme, moral pour Andrew et socio-économique pour Samantha : la très belle séquence des oeufs luminescents, la muraille vue du sommet d’un temple, le tout culminant dans la station service ou à la peur d’un danger immédiat succède la fascination. De là, le cheminement est naturellement posé comme humain et spirituel, par la grâce d’un film produit avec l’intimité que réclamait le propos. Avec une équipe réduite à cinq personnes, une durée de tournage qui permettait de tourner en quasi continuité et d’improviser de manière extensive, les acteurs ont pu (ça se voit) avoir l’air nécessaire pour investir leurs rôles, les habiter et faire des émotions plus pures sans être pour autant brutes. La sincérité de l’ensemble est indéniable et est doublée d’une intelligence dans la facture qui rappelle que l’art consiste, par définition, à susciter de l’émotion, c’est-à-dire d’aller plus loin que le simple émoi.
Monsters est un film d’ambiances, extrêmement bien construit, qui réclame qu’on l’accueille et qu’on se laisse porter par lui pour apprécier son aspect contemplatif, ses envolées d’épouvante et sa grande mélancolie. C’est une vraie expérience émotionnelle, non pas malgré mais avec ses monstres proclamés, qui embrasse l’ensemble de ses aspects avec un naturel désarmant. Ce qui en fait la plus belle surprise de l’année, pas moins. Ou alors vous pouvez vous taper n’importe quelle autre sortie chaudement recommandée dans nos émissions culturelles ordinaires pour ses qualités de vrai cinéma de qualité, vous y serez à l’abri de tout effarement intempestif.
Buried
Dieux qu'il est difficile de causer d'un film quand c'est une pure tuerie qui se suffit à elle-même, surtout à notre époque internetienne où une logique locutive de commando/troll/j'te-mord-l'oeil constitue le réjouissant ordinaire. Problème du rhéteur perché sur ce petit bout de script php d'où il vous fait signe à l'instant même : Buried c'est bien mortel nom d'un chibre en tek.
Buried jouit d'un buzz énorme et une fois n'est pas coutume pleinement justifié. Buried retourne tous les festoches où il va et s'est taillé la part du lion à l'étrange festival (prix Nouveau Genre et contrat de dif' avec Canal Plus). Et paradoxalement il n'y a pas grand-chose à dire sur ce Buried, à part une poignée de généralités et des constats qui seront nécessairement un peu plats par rapport à un film étonnamment sensitif pour un truc filmé dans le noir et une boite d'un mètre cube .
En général, les films-concepts c'est très bien une demi-heure et après ça se délite et ça devient tout pourri. Pourquoi? Non pas parce que leur concept ne tient pas plus de quatre rounds, mais parce que le conteur (réa, scénariste, souvent les deux) jette l'éponge à quatre rounds. Lapalissade numéro 127 : une idée bien troussée ne suffit pas ; il faut surtout des responsables qui savent ce qu'ils font et dotés d'une bonne livre de gonades pour tenir leurs promesses jusqu'au carton de fin. Film-concept par excellence, et même presque jusqu'à la caricature (un type dans un cerceuil, avec la caméra, un téléphone, et presque rien d'autre), Buried est ni plus ni moins que miraculeux. Grâce à son script bien entendu, malin comme un corbeau de St Eustache, mais aussi par une mise en scène diablement virtuose, mais virtuose sans recours au moindre ralenti ou à des mouvements de caméra de ouf. La virtuosité de mise en scène qu'on connaissait par exemple chez le Carpenter de la grande époque (à tout péter, on citera en exemple The Thing et son découpage incroyablement classieux sans jamais être ostentatoire). Vraiment un raisonnement d'un autre temps tant des flopées de clippeurs font désormais des carrières sur trois effets d'appareils, quatre de lentilles, et douze jumpscares par bobine.
Le concept de Buried, ou plutôt sa réussite, ne tient pas tant dans son pitch übertendu que dans sa pleine acceptation des implications de son traitement, à savoir une inversion du dérisoire et de l'hyperbolique. Le moins que rien est gigantesque, le grandiose n'éxiste pour ainsi dire pas si l'on n'en sent pas les effets les plus locaux. Etant donné l'espace et le temps confinés dans lequel se situe le personnage principal, deux F14 balançant un tapis de bombes sur une ville irakienne (Michael Bay devient tout rouge, s'étrangle un peu et doit aller changer de pantalon) sont plus anodins que le fait de trouver la sélection des langues sur un téléphone pour pouvoir en comprendre les menus (votre petite soeur de treize ans hausse les épaules de dédain). Il faut dire que dans ce monde totalement confiné que constitue la boîte, le moindre geste (se retourner, attraper un objet, voir ce qu'on fait, respirer) devient un exploit, le moindre trou dans une paroi est une bouche biblique qui vomit des horreurs apocalyptiques, la moindre phrase entendue dans un téléphone à 20 dollars devient la plus importante que vous entendrez jamais. On oubliera d'ailleurs à cette occasion et avec joie les poignées de séquences émaillant le cinoche et la télé récents, qui capitalisaient sur l'inhumation de personnes vivantes, en particulier celle de Kill Bill - pillée de Frayeurs - qui annihilait toute tension dans un long flashback (difficile donc d'étouffer plus de 35 secondes d'affilée) et une résolution je-m'en-foutiste de sa situation initiale (bah tu vois tu pètes le bois tu vois, et après tu nages dans la terre et tu sors tu vois, c'est cool, c'est facile tu vois).
Rien de tout ça dans Buried. On nous montre un type qui lutte contre une mort certaine là, t'es pas dans ta banquette de MK2 avec ta réduc "cinéphile bon teint Libé a dit que c'était un bon film citoyen et y'avait plus de places pour le Maïwen" (oui bah ils en feront bien une un de ces quatre). On est dans le noir. On a peur. Un téléphone sonne et une voix agressive nous dit qu'on va crever si, avec le tout petit matos qu'on nous a laissé, on n'arrive pas à décider des gens à cracher des thunes.
Ce qui est très fort dans ce film, c'est d'abord la manière dont les péripéties successives subvertissent le simple suspense d'exploitation du postulat de base, pour en faire d'abord une expérience de transitivisme (j'ai l'impression d'être enfermé aussi, j'ai peur), ensuite un commentaire socioculturel (putain c'est trop abusé ce que le gars du consulat lui dit, j'ai peur), et enfin un drame universel (merde je vais mourir aussi un jour et ça a aussi des chances d'être dans la solitude et la misère, j'ai peur). Beaucoup de récits de tous métaux se contentent actuellement d'une de ces occurrences au choix, d'un seul niveau de lecture si on veut résumer. Certains auteurs se vexent d'ailleurs très fort quand on leur fait remarquer que c'est insuffisant : que le premier nazi qui n'a pas pleuré devant La Rafle nous jette la première pierre.
Le commentaire socioculturel de Buried est intéressant tout de même dans son ambition et son économie de moyens rhétoriques. Parce qu'il va plus loin que la simple saillie de chansonnier voulant que la guerre en Irak c'est pas bien et que tout ça c'est la faute à Enron, même si cet aspect est brièvement traité dans la raison même de la présence de Paul sur le territoire, et surtout via un bout de dialogue merveilleux de simplicité : Lors d'un des bouffages de nez entre Paul et son ravisseur, le premier répète au second ce qu'un col-blanc quelconque vient de lui dire, que "nous ne négocions pas avec des terroristes". Rire amusé du tortionnaire putatif, "alors puisque tu es terrorisé, je suis un terroriste?". Et c'est tout. Et ça suffit. Depuis une poignée d'années, bien d'autres films se sont déjà chargés de pointer un doigt accusateur vers qui de droit, en long, en large, plus ou moins bien selon les cas, et discourir sur le sujet n'est juste plus l'irrémissible priorité. Le contexte est là, mais peu malin celui qui croit que ce contexte est réductible à la seule politique étrangère américaine.
A ce titre le film de Rodrigo Cortès est construit plutôt comme une caricature microcosmique de la société dans laquelle nous vivons, et le conflit Irakien n'en est qu'un lointain élément constitutif ; le simple fait que la vie du protagoniste tienne à un téléphone portable en atteste assez. L'essentiel des rebondissements téléphoniques du film est ainsi d'ordre socio-économique, que ce soit dans l'absurdité ubuesque des politiques corporate (la surréalisante conversation avec le représentant de la CRT, complètement disproportionnée vis-à-vis de ses enjeux) ou l'horreur ordinaire des musiques d'attente et des téléopérateurs (qu'on connait tous, quoiqu'à un degré d'urgence moindre). Le point de bascule (théoriquement, il est atteint avant même le générique de début, mais bon) du récit, où l'on commence à prendre Paul au sérieux mais qui lui attire le plus d'ennuis au sein de son petit enfer personnalisé, est le moment où une vidéo prise par lui avec le téléphone se retrouve diffusée sur Youtube, ce qui amène directement à la notion d'image et au vérisme du propos conditionné exclusivement par ce qui en est visible. C'est l'image de soi (projetée, perçue) qui permet littéralement d'exister, bien plus que le discours lui-même : Toutes les preuves réclamées le sont via des images (l'exécution de Pamela à laquelle on croit d'emblée uniquement parce qu'elle est filmée, alors que rien ne permet d'infirmer qu'elle soit mise en scène - et encore la vidéo du doigt, ou celle du testament), alors qu'aucun salut ne vient de la discussion en temps réel. L'enregistrement comme unique espoir de subsister, fut-ce à l'état de mémoire externe: voir le licenciement enregistré en audio dans un soucis kafkaïen de couverture légale. Une séquence horrifiante, parce que crédible dans le contexte d'un occident où le procédurier joue le rôle de bouche-trou d'une crise profonde des représentations politiques et culturelles, faisant de la victime la figure tutélaire indiscutable du panthéon moderne. Le récit joue intelligemment de cet état de fait, puisque pour emporter l'adhésion du spectateur il présente Paul presque exclusivement comme une victime innocente, et pousse le même spectateur à relativiser les agissements de ses ravisseurs (tout de même des gens qui abattent de sang froid son amie sous ses yeux et l'ont enterré vivant dans un but crapuleux) en faisant se présenter le mystérieux interlocuteur téléphonique comme une victime économique de l'état de son pays... Ne reste plus pour étancher sa vindicte (on doit bien se trouver un antagoniste pour le confort de l'âme!) que le visage orwellien, protéiforme, d'une autorité domestique d'autant moins sympathique qu'elle est mal définie en termes d'identification. Pour preuve, Paul lui-mêmese voit obligé de prendre des notes pour s'y retrouver parmi ses divers interlocuteurs.
Néanmoins ce pitch alléchant avait besoin d'une mise en scène au cordeau, et ingénieuse encore, pour ne pas être un simple exercice d'écriture chiant à regarder, si brillant et bourré de coups de théâtre qu'il fût. Et comme on le disait plus haut avant de se perdre entre trois virgules sournoises, c'est là que Cortès sait exactement ce qu'il fait et comment l'obtenir. L'idée selon laquelle le manque de moyens rend créatif, seulement partiellement vraie (essayez de bosser avec des alternos tiens), se vérifie cependant dans le domaine des contraintes créatives, menant soit à une épure (Maléfique d'Eric Valette) soit obligeant à une invention constante. On peut dire qu'en termes de contraintes à contourner, le découpage de Buried se posait là. Sans jamais sortir de la boîte (en dépit d'une fausse alerte), avec des panneaux de bois aveugles comme seul horizon, Buried parvient à continûment innover dans ses angles de vue, se permettant même des travelings et autres "regards de dieu" tout en gardant le sentiment claustro de la situation, et le tout sans faux raccord. A cela est adjointe la seule entorse vraiment notable à la vraisemblance du récit, celle qui consiste à avoir laissé une assez large variété d'objets (flasque d'eau, couteau), et notamment des sources d'éclairage pléthoriques à Paul dans son cercueil : briquet, cyalume, lampe de poche dotée d'un filtre rouge amovible, et bien entendu le téléphone. La trouvaille, c'est de les utiliser pour rythmer le montage séquentiel, en créant des actes clairement définis par une teinte dominante, bleu, rouge, blanc, vert (et bien entendu noir) et en jouant sur les attentes immédiates (encore une fois) conditionnées par la seule colorimétrie...
Dernier point qui fait qu'on se fait trimballer comme des gosses de 4 ans devant un spectacle de Guignol, et franchement celui sur lequel on misait pas notre chemise (c'est le moins qu'on puisse dire), Ryan Reynolds, contre toute attente, joue la comédie. Souvenez-vous de Blade Trinity, de Wolverine (ces hommes méritent de brûler en place publique pour ce qu'ils ont fait à Deadpool), d'American Party ou de the Proposal (non mais non quoi)... Souvenez-vous maintenant de l'épilogue de Smokin' Aces, et vous approcherez un tout petit peu, mais alors un tout petit peu, de la performance que le type arrive à livrer tout seul dans Buried avec trois fois rien. Emouvant, juste, sympathique, on serait presque curieux de le voir dans Green Lantern. Bon presque; c'est quand même Green Lantern.
Bref. Buried c'est l'une des très grosses tueries de l'année, a voir impérativement en salle pour quiconque n'ayant de home cinema dans un caisson à oxygène à domicile, sous peine de perdre une part de ce qui fait de ce film une expérience physique quasi-complète. Putain ça fait du bien de se faire rappeler pourquoi on kiffe nos 24 images/seconde.
captifs -Y Gozlan
Trois humanitaires en fin de mission en ex-Yougoslavie prennent le mauvais tournant et tombent dans les griffes de trafiquants d'organes. Ces derniers les séquestrent et les nourrissent. Et à chaque fois qu'une commande tombe, un pensionnaire aussi.
Victime dans une certaine mesure de son système de prod, Captifs est un petit film sans prétention qui a la bonne idée de subvertir la mécanique trop bien huilée du torture porn. Pas super bien produit, franchement pas bien vendu, le moins qu'on puisse dire est qu'il n'est pas servi par certaines des options qui président à sa destinée. Cependant, et c'est suffisamment rare pour être signalé (surtout dans le cinoche de genre français), il a un scénario qui se tient et une réalisation cohérente, et le tout se permet même de donner un coup de collier au dernier acte. En termes de production, Sombrero nous y avait déjà habitués, la construction de Vertige étant relativement similaire.
Il faut néanmoins dépasser une vente du film qui laisse dubitatif, comme si la production n'y croyait pas plus que ça : peu d'affichage pour un nombre pourtant honorable de copies, quasiment pas de promo, des visuels et une bande annonce qui singent bêtement Ils (peut-être pour mieux vendre le film à l'étranger où Ils avait connu un joli succès d'estime, mais alors on vous met au défi de reconnaître Zoé Felix dessus)... A croire que le destin du film est déjà joué à l'avance. C'est dommage car pour une première réalisation, qui plus est sur un sujet relativement convenu, le film de Yann Gozlan ne manque pas de charmes... A commencer par une interprétation qui, mis à part un Arié Elmaleh bien transparent, fonctionne bien tout en n'en faisant pas trop. Les ravisseurs sont agréablement justes, loin de l'aspect "sourcils-moustache de méchant de film muet", et gagnent de fait une crédibilité de gars au turbin (si ignoble soit-il) que quelques touches de cruauté viennent rehausser sans la ruiner. Il faudra à l'avenir qu'on garde un œil sur Philippe Khrajac par exemple. Mais la grosse et bonne surprise vient de Eric Savin, trop cantonné aux rôles de troisième couteau d'habitude. Espérons qu'on continue à lui donner des rôles importants, le gars a les épaules pour les tenir.
Quant à Zoé Felix... Dans le monde de l'offre et de la demande en saltimbanques lochées et fionnées, Tartuffe et Procuste gambadent main dans la main plus qu'ailleurs, et ça fait quelques années que la Zoé en fait discrètement les frais. Jolie, charismatique, bonne actrice, on devrait la voir beaucoup, beaucoup plus (remarque, Mylène Jampanoï a le même problème de sous-représentation) dans le cinéma autochtone. Mais voilà les places sont chères et les meilleures sont déjà trustées par une chiée de filles-de pour la plupart tout sauf saillantes. Bref. Il est agréable de la voir de plus en plus en tête d'affiche, d'autant qu'ici elle donne de sa personne sans grande retenue (non, pas comme ça, bande de godelureaux, quoique son top moulant soit du plus bel effet pour tous les érotomanes déviants que nous sommes), les séquences du sang de sanglier et celle de l'écarteur à paupières étant par exemple bien croquignolettes. Les Dieux savent à ce titre comme certaines acrobaties auxquelles elle se plie ici sont assez casse-gueule en termes de crédibilité (va te bagarrer contre une rogomme qui fait deux fois ta taille tiens, pas facile de pas avoir l'air bête) et que courir et se faire taper dessus à longueur de métrage perd rapidement de sa fraîcheur. A ce propos, et pour un premier film, Gozlan fait preuve d'une retenue surprenante dans l'utilisation de son héroïne, laquelle ne se voyant par exemple pas obligée de passer par une scène de baiser lesbien ou de trifouillage de bouton magique (ça nous change). Qu'il en soit salué.
Un script pas si convenu que ça, qui va au bout de ses idées (on n'y va pas par quatre chemin quand un prisonnier tente une évasion, les mesures les plus drastiques sont après tout les plus efficaces, surtout quand on a des chalumeaux sous la main) mais sans bousculer sa propre logique (ni viols ni tortures, les captifs sont un business et pas un amusement pour leurs geôliers), une belle photographie et un découpage sec et savant complètent la liste des bonnes raisons d'aller en salle plutôt que sur Emule. En revanche, on ne sait toujours pas dialoguer un film de par chez nous, sans doute coincés que l'on est entre les deux traditions opposées et écrasantes du polar audiardien et de la diction ampoulée à la Bresson. Il y a bien entendu des exceptions, et Captifs n'en fait pas partie. Alors que les deux bons tiers du film fonctionnent très bien en étant quasi-muettes (des invectives incompréhensibles des kidnappeurs à la trouille réelle que colle la sonnerie du téléphone), on devra se taper des tunnels de dialogue sottement explicatifs et sonnant assez platement à une oreille qui aimerait qu'on lui foute la paix et qu'on arrête de lui réexpliquer ce que l'œil comprend très bien tout seul.
A propos d'être sottement explicatif, la caractérisation vaut son pesant de petits Larousse : outre le gars qui nous cause de ses gamins en se rendant compte que son engagement humanitaire relève d'un syndrome de Zorro plus égotiste que désintéressé (bravo mec, tu viens de trouver une belle lapalissade, on espère juste que t'étais pas dans la section psychologique de ton convoi MSF), et le collègue-qui-aimerait-bien-faire-le-cul-à-l'héroïne-mais-qu'est-en-fait-un-gentil-garçon, on doit se choper AUSSI la caractérisation de Carole faite à l'obus de 48. C'est bien sympathique de lui coller une phobie des chiens due au massacre de sa sœur quand elles étaient gosses, ça fait des intermèdes fort amusants (vraiment, du fun en barre une fois les chiens lâchés), mais à trop vouloir tout justifier avec zèle, Gozlan et Lemans alourdissent leur propos, allongent artificiellement leur récit, et aplatissent un peu trop véhémentement sur le bouton "pathos" de leur console d'effets. Pas besoin par exemple d'avoir une petite sœur décédée pour vouloir secourir sa voisine de cellule de huit ans vouée au désossage industriel. La phobie canine aurait pu être introduite par un évènement quelconque en début de seconde bobine, et sans tous ces flashbacks, on aurait gagné en célérité, et dix minutes de moins auraient donné un film plus équilibré, allant bille en tête vers son dernier acte revanchard (de très loin le plus convaincant du film, et une belle pièce de mise en scène). Parce qu'à part ça, c'est vachement bien, et y'avait vraiment pas besoin d'aller coller du psychologisme lourdaud. A force d'être taxés d'infantilisme depuis des décennies, les tenants du cinéma de genre français se sentent obligés de donner de ces signes d'intelligence, même quand le film qu'il font est objectivement solide et s'en sortirait mieux sans.
Ben voilà, un bien joli petit film, humble, bien torché et rarement en baisse de régime. On flippe gentiment mais sans voyeurisme, on n'a pas le sentiment d'être pris pour des imbéciles ou de voir un caprice de sale môme et tout ça fait du bien à voir. Un film solide et sympathique qui mérite qu'on y jette un œil, malgré une poignée de scories qui le préservent de l'excellence - mais qu'on lui passera grâce à sa bonne bouille. Et à celle de Zoé.
Natural Born Killers - Oliver Stone - 1994
Brulôt, film expérimental, démonstration didactique par l'excès (parfois à l'excès), propos jusqu'au-boutiste et forme inédite de dynamisme, Natural Born Killers constitue à plusieurs égards l'oeuvre charnière de la carrière d'Oliver Stone, comme si après tant de folie, l'homme n'avait plus qu'à s'assagir. Il faut dire que le film lui a valu bien des critiques et des ennuis, qu'il convient de dépasser pour considérer, comme cela doit se faire, le film lui-même.
"You've made my shitlist"
«Je suis un cinéaste, la manière dont des psychopathes peuvent prendre mon film ne me concerne pas.» Dans une courte interview accordée à Canal + en 1995 à l'occasion de la diffusion "exceptionnelle" de Tueurs Nés, Oliver Stone botte ainsi en touche avec un peu de facilité, face à la question de ce qu'il ressent face aux faits divers (abusivement) rattachés à son ouvrage. Le film a il est vrai été considéré comme facteur déclenchant de vocations criminelles, notamment en France où les affaires "de Gournay" ou Rey-Maupin(1) l'avaient monté en épingle, au point que son exploitation en vidéo fut interdite un temps. Stone a dû également essuyer une plainte pour "incitation à la violence". Globalement, c'est le terme qui revient le plus souvent dans l'ensemble des critiques, positives ou non, que suscite le film depuis 15 ans, ce qui constitue tout de même le premier degré de la description évidente. On retrouve souvent, à ce titre, l'ironique "ultra-violence", terme passé dans le langage médiatique courant et qui pourtant ne signifie, étymologiquement, rien: il était à la base une invention de Burgess dans son roman Clockwork Orange plus tard adapté à la manière qu'on connait, pour justement pasticher l'argot bâtard de la société en déliquescence qu'il y dépeignait, avec notamment des expressions sans aucun sens basées sur des analogies de sonorités, pointant là une perte de sens général. L'ironie, donc, réside dans le fait qu'on utilise désormais ce terme sans y réfléchir, donnant raison dans une certaine mesure à son militant conservateur d'auteur. La remarque n'est pas anodine, puisque Natural Born Killers est considéré comme le (ou l'un des) Clockwork Orange des années 90, ayant essuyé les mêmes critiques (frisant parfois l'hystérie) et ayant suscité les même types de débats que le film de 71, portant principalement sur l'aspect graphique des exactions portraiturées pour mieux éluder le discours social et politique desdits films. Et de fait les deux métrages partagent la même perplexité quant aux climats sous lesquels ils ont été produits, le même jusqu'auboutisme et la même innovation dans la mise en scène et la direction artistique, et la même manière ambigüe de traiter leurs personnages, sans les punir ni les juger, sans non plus les idéaliser, et en leur donnant le cadeau de l'apprentissage moral (voir plus bas). L'autre débat, aisément démontable tant il a été décongelé tous les cinq ans (pour Clockwork, Cannibal Hollocaust, NBK, et tant d'autres), est celui de la dénonciation de la violence en l'utilisant: dans tous les cas, et NBK ne fait pas exception, la violence dénoncée est plus large que celle qui est représentée: elle est sociale, économique, politique, et ici médiatique. Plus qu'une contradiction, il faut plutôt y voir une ironie, un commentaire par l'exemple.
"Frankenstein killed Dr Frankenstein, you know"
En effet, Stone est déjà coutumier du scandale autour de ses travaux, et le sera aussi par la suite (ses interviews de Castro, ses prises de positions vis-à-vis des FARC). Mais jamais au point d'ébullition que celui auquel sera porté NBK de toutes parts. Car les réactions sont à la semblance du choc. A commencer par Quentin Tarantino, auteur du script original, et tellement mécontent que le traitement de son premier jet ait trop évolué à son goût, qu'il s'en désolidarise purement et simplement et décourage même Michael Madsen d'y apparaître comme initialement prévu... D'une tarantinade à la True Romance (un peu de gore, de la pose, des références obscures à la culture pop, des dialogues astucieux), ce qu'il était à la base (voir à cet égard les scènes coupées des jumeaux Hun ou du tribunal), NBK devient non seulement un brûlot sur la sphère médiatique américaine mais surtout un voyage initiatique pour ses personnages principaux, qui s'arrachent de leur condition pour acquérir une plus grande sagesse. Ils le font d'abord dans l'extériorisation la plus radicale (le meurtre de masse) puis de manière intérieure (la rencontre du chamane, la prison) pour finalement s'arrêter de tuer, la métamorphose effectuée. Fait d'ailleurs intéressant, dans la mesure où tous les autres personnages, principaux ou non, sont punis par où ils ont péché faute d'avoir pu ou voulu évoluer : les parents de Mallory meurent respectivement tabassé et noyé pour le père, et ligotée et brûlée vive pour la mère, soit dans la violence et la décadence pour l'un et l'immobilité pour l'autre. De même, Scagnetti meurs de sa perversion et de son arrogance (égorgé par Mallory suite à un duel "à la dégonfle" où il aura été trop présomptueux), Wayne Gale est exécuté via la présence de sa caméra, Dwight McClusky est littéralement mis en pièces par ses propres détenus...
Que Stone n'offre ici l'opportunité d'évoluer qu'à ses électrons libres n'est pas fortuit, ce n'est pas non plus un caprice. En effet, d'abord envisagé comme un jeu autour du film d'exploitation, NBK se pose comme le film somme de la première moitié de la carrière de son auteur. Or l'un des motifs que l'on retrouve le plus souvent dans les films antérieurs à NBK est la mise en avant de l'outsider, de l'agent provocateur, du mutant. Comportement narratif que l'on voit retourné après 1995, période manifestement plus encline à suivre des personnages marchant dans le rang, certes souvent pour le pire ou au prix de sacrifices spirituels importants. Pompiers héroïques (World Trade Center), politiciens controversés (Nixon, Comandante, Alexander, W ...) et magnats du sport (Any Given Sunday) remplacent désormais speakers nihilistes (Talk Radio), activistes en tous genres (Born on the 4th of July, The Doors) et plus globalement agents s'éjectant du système par le scepticisme ou la délinquance (JFK, Wall Street)(2). On peut résumer la carrière du monsieur en comparant une première moitié dionysiaque, anarchiste, et une seconde moitié apollinienne, pour tout dire plus pantouflarde, NBK marquant (avec U-turn sur un mode nettement plus mineur) le point de friction et même de collision entre agents du Chaos et agents de l'Ordre (ou d'un certain Ordre), collision incarnée par la séquence de l'émeute carcérale qui voit Mickey/Mallory affrontant McClusky/Scagnetti, les médias (Wayne Gale) jouant le rôle d'arbitre et de catalyseur. Il est de fait intéressant que le couple de meurtriers sorte seul vainqueur de la joute, sort que n'avaient pas souvent de tels personnages auparavant chez Stone, mourant plus ou moins misérablement, ou finissant en prison... D'autant qu'une autre fin existe où Owen, ange gardien du film, abat les tourtereaux. Cette victoire totale résulte donc d'un choix. Que le choix soit rhétorique ou moral, ou qu’il constitue un dernier cadeau (sous forme de baroud d’honneur) à la faction que Stone est en train de quitter, la question se pose.
Oliver Stone se voit un peu comme un Zola cinématographique : son projet global, similaire à celui du romancier, est d'encapsuler la société qui l'entoure dans un grand-œuvre discursif qui tendrait à la montrer dans toute sa complexité. Que ce soit par l'analyse frontale (biopics, documentaires), par la métaphore (Alexander), ou par le pamphlet pur et simple (ce Natural Born Killers). Chaque film entreprend ainsi de démonter un aspect de la société américaine de la seconde moitié du vingtième siècle. Guerre du Vietnam, contestations, courants culturels, personnalités politiques, faits divers, explorations de milieux donnés… Natural Born Killers est particulier également vis-à-vis de cette démarche : en effet, si l’étude consiste en un démontage polémiste d’un certain système médiatique américain et de ses accointances avec des instances du(des) pouvoir(s) (la Fox anyone ?), il se place sur un point de vue extrêmement large, qu’il ne circonscrit pas à un contexte donné (par exemple, comme ailleurs, le monde de la bourse, celui du sport, les arcanes de la maison blanche, etc), et subvertit son propre sujet par un discours sur la liberté individuelle et la prise de conscience (au sens tant intellectuel que spirituel) qui prolonge certaines réflexions de The Doors, ainsi qu’une considération du terreau culturel et mythique de l’Amérique moderne, notamment dans son rapport ambigu à la violence. Le point nodal de l’histoire racontée, à savoir l’interview de Mickey, indique suffisamment comme matériau de référence la fameuse interview de Charles Manson par Geraldo Rivera, où curieusement le premier semble plus réfléchi et sensé que le second(3). Les références à Starkweather et à sa compagne (qui plus tard inspireront sur un ton plus léger les époux Bartlett du Frighteners de Peter Jackson), à Ted Bundy (autre tueur en série considéré comme « séduisant »), ou à Charles Whitman (la mère de Scagnetti compte parmi ses victimes !), mais aussi à Dillinger et Bonnie and Clyde, c’est-à-dire de grands hors-la-loi passés à une postérité culturelle via le cinéma, la littérature et la culture populaire, donne la mesure d’un sujet nébuleux, aux contours flous, sans cesse plus grand que lui-même tant ses ramifications sont protéiformes. Chapeautant tout cela, la charge contre les médias qui se nourrissent et produisent cette culture de la violence et de la célébrité induite par faits divers, cette charge n'est que plus féroce, que moins discutable, au point qu'aujourd'hui on a le sentiment d'enfoncer des portes ouvertes en en parlant. Stone lui-même a tendance à pontifier un brin dans cet aspect de son discours voulant que les médias sont un banc de requins lancés dans une frénésie de dévoration dès le premier sang, ou lorsqu'il se met en scène de manière à peine masquée à travers le personnage important du vieil indien qui fait "évoluer" Mickey et Mallory.
"How sexy am I now, hah ?"
Une telle note d’intention réclame un tonus et une certaine folie dans l’exécution, de peur de lénifier discours, sujet et effet. Impossible, avec NBK, de faire un simple shocker movie, un polar hard-boiled déjà routinier en ce milieu de 90's ou pire un film de prétoire. Une mise en scène linéaire (la narration l’est bien assez, elle se contente d’un long flashback dans le premier acte et d’une poignée d’ellipses) tuerait dans l’œuf le discours foisonnant qu’entend tenir Stone (et laisserait trop de coudées franches à la scolarisation systématique -et même pénible- de ce dernier, comme on le peut le voir dans ses films postérieurs). Au contraire d'un Michael Haneke, qui avec Benny's Video et plus encore Funny Games adopte un ton froid et clinique pour dénoncer la "glorification" de la violence au cinéma sans y toucher lui-même, Stone décide de s'y rouler, de mettre le nez du spectateur dans cette contradiction, de l'amener à s'interroger lui-même sur ses reflexes et attentes de spectateur en lui donnant ce qu'il est venu chercher, mais en trop grande quantité. Et puisque la toile de fond d'un tel récit est le postmodernisme forcené de son quand et de son ici, la forme appuiera le fond, le dépassera, risquant constamment de l'annuler dans son déluge de stimuli. Natural Born Killers se présente comme une vaste et pléthorique digression ; l'aborder revient à digresser soi-même pour rester en adéquation avec le contexte qui l'a enfanté. Le rhéteur devra alors boire la coupe jusqu'à la lie ou ne la pas boire du tout.
Selon la légende, à l'issue de la première projection en interne de Gremlins 2, Steven Spielberg aurait demandé à Joe Dante, sur un ton de supplique désespérée : «Mon Dieu, ce n'est pas à ça que vont ressembler les années 90 quand même ?» A bien des égards, les années 90 ont bel et bien ressemblé à la fameuse séquence où les gremlins prennent leur film en otage via un zapping d'autres images provenant d'un peu partout, et principalement d'autres films. On revient à Tarantino, symbole de cette omniprésence du postmodernisme dans la décennie, qui fait une carrière entière sur le principe que tout a déjà été fait, que rien n'est nouveau, mais sur le fait de nous le dire de manière cool, agréable, gouailleuse, whatever, man. Tout est, par extension, référence de référence. Dans le même sillage, on trouve des palanquées de Kevin Williamson et de Guy Richie, mais aussi des frères Wachovsky ou des Alex de la Iglesia, capables plus tard d'enfanter de nouvelles formes à partir des décombres de la prise de conscience réflexive. Car les 90's c'est aussi des séquelles qu'on commence à nommer "franchises", l'irruption du cinéma dans la télévision (X Files, Profit), de la télévision dans le cinéma (les premières adaptations à gros budgets de séries dont nous sommes si coutumiers maintenant), et le début d'une inflation de haut-parleurs et d'écrans nouveaux ou remis aux goûts des jours successifs. C'est enfin l'explosion durable du métatextuel, du récit qui s'observe en tant que tel, voire du pirandellien (le doute Dickien de Total Recall à Matrix, l'horreur métaphysique d'un In the Mouth of Madness, les réalités imbriquées de Last Action Hero). Tous ces épouvantails thématiques, artistiques, médiatiques, sont la forêt qui dissimule l'arbre d'un pourrissement global du mode de vie occidental tel qu'il a perduré pendant le demi-siècle qui a précédé, et que les mutations profondes que ce dernier subit feront peut-être évoluer dans la décennie qui suit. Autrement dit, dans les années 90 on est très occupés à regarder et analyser notre culture, démarche assez souvent stérile, mais nécessaire pour dépasser le nombrilisme/postmodernisme, et dans un troisième temps se remettre à créer du (un peu plus) neuf.
Tel un gigantesque tambour de machine à laver, NBK mixe tous ces éléments, en utilisant les mêmes forces centrifuge et centripète qui les animent à l'extérieur pour en décupler la vitesse. Après de très longs repérages effectués à travers tous les Etats Unis sous l'emprise sporadique d'hallucinogènes, Stone s'autorise absolument tout et signe un film qui, s'il tient sa narration de bout en bout en restant intelligible, le fait sous la forme du film expérimental le plus débridé: 3000 plans, dans 18 formats d'image différents de la beta au super 35 en passant par le 8mm, de la couleur, du noir et blanc, des prises live, de l'animation, des projections en fonds de décors ou dans les fenêtres, constituant des "paysages mentaux" et des états d'esprit, un montage vertical (entre niveaux de lectures et/ou de discours) autant qu'horizontal (entre évènements qui se succèdent ou axes de découpage dimensionnel), des superpositions lourdes de sens (la jeunesse de Mallory et les sévices subis par celle-ci présentés sous la forme d'une sitcom cradingue à la Mariés Deux Enfants, les inserts de publicités pour Coca Cola, les écrans vidéo refilmés en pellicule ou intégrés à des cadres plus larges), ainsi que quelques interpellations directes de la caméra par les personnages (deux fois par Mallory, une par McClusky), abolissant le quatrième mur, procédé repris plus tard dans des contextes voisins par Haneke, encore. Le tout dans un véritable maelström d'inserts en tous genres, chacun ouvrant sur un sens supplémentaire, une considération, un jeu sur le cliché ou simplement un commentaire, à la manière de renvois de bas de page ou de liens hypertexte. En termes de construction cinématographique, on peut considérer l'exercice comme une tentative de cubisme analytique dans l'intention de montrer simultanément les scènes sous tous les angles, physiques ou psychologiques.
Car aucun photogramme n'est fortuit, et si l'énergie nait du désordre elle ne nait pas de la confusion. Les symboles utilisés (crotales, tueries d'animaux, lumière verte, inserts de démons, archives diverses...) sont toujours cohérents avec l'ensemble et reviennent souvent dans les mêmes types de situations (les crotales pour l'apprentissage, les démons pour la caractérisation, le vert pour la maladie et le conflit...), ainsi d'ailleurs que les changements de standard image qui permettent de jeter une lumière particulière sur chaque aspect de la séquence. Le procédé peut paraître par trop didactique, il l'est par moments (c'est le refuge que prend le besoin qu'à Stone de jouer les doctes), mais l'ensemble est rendu si dynamique par le parti-pris que l'expérience en elle-même devient hallucinatoire, un viol par condensation si on peut oser la formule : une semaine de télévision normale, avec es tueries, ses faits divers, ses redifs constantes, ses talk-shows, ses débats, ses clips et ses publicités... Ramenée à deux heures, cette semaine concentrée y fait au final le même effet que trois ecstas arrosées d'Absinthe/Redbull aux stéroïdes, avec un zeste de citron cocaïné. Du sel pour les blessures.
La bande originale est à l'avenant, construite sous l'égide de Trent Reznor à l'époque où ses Nine Inch Nails signaient l'album Downward Spiral (album dont la tracklist reprend comme motif principal la tuerie menée par Manson et sa secte en 69, qui coûta entre autres la vie de Sharon Tate. On revient au gourou de "la Famille", vraie figure tutélaire du film, symbole de cette Société du Spectacle plus "sanguine" que celle de Debord). Outre le score original de Brent Lewis (déjà présent sur JFK, et assez anecdotique), et deux morceaux de Nustrat Fateh Ali Khan, la B.O. est une sorte de catalogue de culture musicale alternative: N.I.N., Jane's Addiction, Cohen, Dylan, Lard (groupe formé par Jello Biaffra après les Dead Kennedies), NWA, Dr Dre, L7, Patty Smith, mais aussi Rage Against the Machine, Cowboy Junkies et les Specials... Le projet y gagne une dimension supplémentaire, une assise également, qui tout en participant du montage vertical évoqué plus haut, joue le rôle de commentaire supplémentaire, de tremplin pour le discours global du film. Ce serait une erreur de voir la tracklist de NBK comme une simple illustration, un bête exhausteur de goût. Ici, l'influence de Tarantino se limite au premier jet du script, la musique est donc utilisée pour elle-même dans un ensemble plein, et un massacre sur une reprise pop de "Laisse tomber les filles" pour tout rendre cool et hip n'est donc pas le seul horizon créatif qu'on peut attendre du métrage... C'est même tout l'inverse.
"I've seen the future Brother, it is murder"
Il y aurait tant à dire de plus sur ce film, de son tournage à l'arrachée (deux mois, une vraie prison avec ses détenus condamnés à des doubles perpétuités comme figurants), sa postproduction gargantuesque (11 mois, 4000 points de montage sur le négatif), ses acteurs lancés dans des composition complètement folles, ses démêlées avec la censure... Contrairement à ce qu'en ont dit ses détracteurs à l'époque, NBK n'est pas un feu de paille, un simple "coup" de polémiste, pertinent uniquement dans une seule occurrence ou circonscrit dans son propre temps. Bizarrement, alors que Clockwork Orange avait eu peu de postérité immédiate dans le propos (au sens de films reprenant sa thématique et son discours), NBK semble tomber pile au moment où ce discours peut être perçu par l'ensemble de la société, le projet compris et suivi pour lui-même. L'idée directrice, l'utilisation du post-modernisme pour questionner le sens et la validité de celui-ci, et la forme de zapping telle qu'elle y est mise en place, se sont retrouvées depuis dans nombre de films importants de ces dernières années : Starship Troopers (il est vrai que le commentaire via un zapping ou le pastiche de formes télévisuelles est une habitude chez Verhoeven, voir par exemple Robocop), mais aussi une bonne partie de la carrière cinématographique de Rob Zombie (Evidemment House of 1000 Corpses, mais aussi l'injustement conspué Halloween 2), Perdita Durango, l'excellent 15 Minutes de John Herzfeld, le Slashers de Devereaux, pour ne citer que les plus évidents... Plus globalement, NBK semble avoir fait sauter la bonde de ce type de propos cinématographique où le dispositif fait partie intégrante de l'histoire et du sens généré. La vague de réflexions sur la subjectivité qu'on aura pu voir depuis vient, en partie, de ce film foutraque et mal reçu par la société qu'il dépeignait. Peinture bien entendu effectuée en vain d'un point de vue sociétal, en dépit d'une postérité indéniable dans son propre domaine culturel et le cinématographique. Quelques prix en festivals ne sont, avouons-le, qu'une maigre consolation face à la confirmation permanente que Wayne Gale reste maître et roi.
F. Legeron
1 Dans ces deux cas, l'argument a été infirmé et dénoncé pour ce qu'il était, c'est-à-dire un bon moyen de déplacer le débat sur la scène médiatique, et ainsi noyer le poisson et obtenir des circonstances atténuantes en attisant le sensationnalisme. Dans l'affaire Rey-Maupin, l'affiche du film "trouvée" dans la planque du couple avait été rajoutée après la première perquisition, et le meurtre d'Abdel par ses camarades Véronique et Sébastien n'avait strictement rien à voir, en termes de modus operandi et de motivations, avec ceux que l'on peut voir dans Tueurs Nés : Mickey et Mallory Knox ne préméditent pas leurs meurtres, ne torturent pas leurs victimes et ne cachent pas leurs corps. Ils tuent de manière instinctive, presque végétale, soit tout l'inverse de ce dernier fait divers crapoteux. La polémique est donc à considérer comme de l'opportunisme pur et simple. Tous ces "débats" ont aussi ceci d'ironique qu'ils utilisent toutes les ficelles démontées et dénoncées par le film même qui les suscite.
2 On pourrait aussi opposer les invocations de conflits armés perdus (la trilogie du Vietnam), à celles de conflits victorieux (les films sur Cuba, ou même W dans une certaine mesure).
piranha 3d - A Aja / F Levasseur
Assumant pleinement son statut de plaisir "coupable", voire de Gremlins pour adultes selon ses auteurs, ce nouveau Piranha (qui n'est ni un remake, ni à voir obligatoirement en relief) ne se prend jamais pour un chef-d'oeuvre et c'est précisément ce qui le rend aussi sympathique. Très gore, très cul et -faussement- très con: on aurait en effet tort de bouder son plaisir. Critique décontractée.
Un tremblement de terre subaquatique met au jour une faille d'où sortent des milliers de piranhas préhistoriques affamés. Heureusement pour eux, c'est le spring break et une foule de jeunes énergumènes font la fête à Lake Victoria. On va bien s'amuser, notamment une poignée d'océanographes géologues, la sheriff du cru, son fils engagé sur un porno semi-aquatique tendance "girls gone wild", ainsi que ses deux cadets et sa wannabe-girlfriend. Tout ce joli petit monde va donc devoir se sortir les tripes pour espérer ne pas se les voir bequeter, à l'instar des hordes de beefsteaks en slips de bain occupés à se trémousser tout alentour.
Piranha offre un bel arrière-goût de soleil ici, après un été "genre" qui était censé envoyer du fun par palettes de quinze et nous a laissés globalement un peu sur notre faim, avec notamment nombre d'essais sympathiques mais à moitié transformés (Predators, Inception, Repo Men, Djinns, Expendables), quelques perles (Splice!) et des arnaques pures et simples (on ne dira pas qui). Il est tout de même triste que pour sustenter ledit été au rayon imaginaire en salles, on doive attendre le 1er septembre... D'autant que (évacuons les problèmes d'emblée) la date de sortie semble encore un peu prématurée si l'on en juge une postproduction manifestement bouclée dans l'urgence : CGI aux textures parfois sommaires, un ou deux lags dans les séquences où beaucoup de poissons s'ébattent, quelques incrustations un peu grossières, etc.. Les piranhas eux-mêmes sont ainsi bizarrement assez moyens, alors, que l'ensemble des effets spéciaux en dur de KNB sont magnifiques. La conversion 3D se paie, même si étant donné le concept et le ton de ce Piranha, le procédé se justifie bien plus que dans pas mal des films qu'on a vus cette année (au hasard, un indice: "Good luck, Fisherrrman!").
Car Piranha est ludique, il ne prétend même (presque) qu'à ça. L'ambiance de parc d'attraction pour enfants de plus de 18 ans n'est jamais démentie, que ce soit dans le contexte (le spring break), le casting, la direction artistique ou les péripéties. Le programme des festivités? Des foules entières rongées jusqu'aux os! Ving Rhames armé d'un moteur de canot qui hache du poisson! De l'océanographe maniant jet-ski et fusil à pompe! Du full frontal en veux-tu en voilà! Eli Roth armé de pistolets à eau géants! Des chevelures prises dans des hélices! Des prothèses mammaires qui flottent! Des poissons qui traversent les gens par des issues que la morale réprouve! Un piranha qui rote un chibre!
Aja et Levasseur n'y vont certes pas avec le dos de la cuiller, comme on l'avait déjà remarqué dans Haute Tension et The Hills have Eyes. Ce qui est heureux dans la mesure où lorsqu'ils tentent de se calmer pour faire les yeux doux à l'industrie, le résultat déçoit un peu, et apparaît même en demi-teintes (2ème Sous-sol, Mirrors). Aja est beaucoup plus réalisateur que dramaturge (une part non négligeable de l'écriture est assumée en bout de circuit par le - bon - monteur Baxter), ce qui en soi n'est pas un défaut, mais s'accommode presque exclusivement de sujets archétypaux qui devront plus à la dynamique de la mise en scène qu'aux mécaniques scénaristiques complexes. En somme voilà un trium vira qui ne fonctionne pour le moment à plein qu'avec des récits simples et linéaires. On n'attendra logiquement pas de ce ride, porté sur un concept et un seul (20 000 crétins, 100 000 piranhas), qu'il redéfinisse nos horizons conceptuels ou nous ballade dans une mécanique bien huilée, subtile et puissante du point de vue de la poétique aristotélicienne... On n'est pas là pour ça. Alors bien entendu le déroulement des péripéties, pour rocambolesques qu'elles soient, est parfaitement balisé, et les personnages apparaissent comme leurs propres caricatures, ce qui nuit à l'éventuelle implication émotionnelle qu'on voudrait ressentir pour eux. Mais on est ici dans un projet de pure narration, où la manière de raconter prend dans une certaine mesure le pas sur ce qui est raconté, sur le mode de l'outrance la plus frontale induisant une certaine distanciation. Ce qui appelle les archétypes susdits. Cela se voit bien entendu d'abord dans le traitement des personnages et le jeu des acteurs, à commencer par Jerry O'Connell, qui vaut beaucoup mieux que ses prestations dans la série Sliders et retrouve dans Piranha sa tête d'abruti de Joe's Appartment, la méchanceté crasse et le teint buriné sur Venice Beach en plus. Et le fan service est encore assuré via Richard Dreyfuss qui reprend officieusement son rôle de Jaws, Eli Roth en pleine hystérie de jouissance forcée ou Christopher Lloyd en mode "Nom de Zeus!" permanent. Difficile pour les rôles principaux de ne pas être cantonnés à de jolis minois inoffensifs à côté de ces briscards qui cabotinent tant qu'ils peuvent. Pour être honnête, on se moque bien des persos et des enjeux humains du film (encore une fois, ce n'est pas le propos), et l'aspect complètement disproportionné de l'ensemble de l'entreprise y contribue, tout en assurant, paradoxalement, le spectacle qu'on en attend. Spectacle bien servi sur le mode du film d'exploitation pur et dur, et de fait un peu putassier quand même, car la grosse majorité du public ne viendra que pour le fat ass au mépris de toute idée discursive - courage donc dans les salles des multiplexes, même si c'est parce qu'il est con que Piranha est bon...
C'est finalement, d'ailleurs, ce manque de profondeur apparent qui confère son intérêt au film, qui dans son choix du contexte de spring break devient à la marge une sorte de démonstration ab absurdo. Aja/Levasseur ne s'en cachent pas, eux qui à longueur d'entrevues parlent de cette culture du spring break (et plus largement ce cocktail forcené boulot/consommation/jouissance de l'occident aisé) comme symptôme possible d'un stade terminal qu'aurait atteint la civilisation, une sorte d'apocalypse permanente à vivre dans la joie obligatoire, mais qu'on a tout de même un peu envie de rejoindre pour participer à la fête et ne pas être hors du coup. Un propos qui rejoint le discours de Neveldine et Taylor dans Tits against the Glass, le making of de Crank 2, lorsqu'ils évoquent carrément le contexte socioculturel actuel comme "les derniers jours de Rome"... Piranha, grand n'importe quoi jouissif mais toujours cohérent, qui met en évidence l'abêtissement général en semblant lui servir la soupe, fait ainsi partie de cette vague de ce cinéma intelligemment con qui fleurit depuis une petite décade. A ranger à côté des efforts de Trey Parker et Matt Stone, de ceux de Neveldine et Taylor donc (voir les indispensables séquences à la Second Life dans leur Gamer), mais aussi certains films du Frat Pack ou l'Idiocracy de Mike Judge. Ce qui n'est pas une tradition dont ils aient à rougir, tant le propos est bien servi par ce type de mise en scène excessive. Et la frénésie de l'exercice appuie au mieux ce propos qu'on a vu traiter de manières plus austères chez d'autres. C'est dire si on attend avec impatience leur Cobra, dont la mythologie entretient thématiquement pas mal de similitudes avec cette outrance aussi désabusée que joyeuse. Mais avec moins de poissons.
Chatroom – Hideo Nakata
Adapté d’une pièce de théâtre anglaise "pour les jeunes" (sic!), c’est-à-dire édifiante au sens le plus XIXème siècle du terme, "Chatroom" se veut une parabole tétanisante sur l’époque mais vole si bas dans son discours nauséabond et amalgamant que même le savoir-faire de Nakata ne parvient pas à le préserver au mieux du ridicule, au pire du révoltant. Internet, péril ou menace ?
CQFD : Le conteur peut raconter avec grand talent les pires infamies, mettre en scène très brillamment les discours les plus ineptes ou carrément débectants lorsque le climat culturel s’y prête. Certains en ont fait leur fond de commerce, d’autres s’y sont égarés, quelques uns s’y sont cautérisés les extrémités. Lovecraft, Heinlein, Céline, Bernanos, Riefenstahl, Burgess, Autant-Lara, Sartre ou Gide ont plus ou moins souvent pollué leurs proses d’idéologies douteuses, nombre d’artistes intéressants sont tombés dans de grands pataquès psycho-religieux, etc etc. L’autre mal qui guette, c’est celui du mercenariat poussant à appuyer n’importe quel appareil ou discours par des travaux de commande dont on feint de ne pas considérer la portée dans le monde "réel" (Riefenstahl encore, ou Eisenstein dans une certaine mesure). Et parfois, l’époque vous étouffe, vous assimile à la manière d’un Blob puissant et incolore, et vous bêlez bientôt avec le troupeau, tout content de traverser la vie dans les passages cloutés du courage autorisé de votre temps, les nombreux maquisards de septembre 45 en attestent, la tondeuse encore à la main, mais les avatars de ce panurgisme ne sont pas nécessairement aussi spectaculaires (au hasard, on citera les cucuteries citoyennement correctes de légions de Tardi ou de Bégaudeau à travers les âges médiatiques). Ils sont en revanche toujours relayés dans un art, disons officiel, ou reconnu comme valide par ses contemporains. Aussi l’analyse d’un film, qui plus est quand il est notoirement "à thèse" comme dans le cas présent, se doit de passer par l’analyse du discours servi par celui-ci, sous peine de passer à côté de la plaque.
Nakata fait pour la première fois de l’art officiel, et se met au service d’un discours simplificateur, démagogique, dont l’aspect répandu n’est pas le moindre de ses caractères révoltants. Notons que si l’homme n’a jamais été un ermite superbe, misanthrope et philosophe, jetant anathèmes et mépris sur le monde, ses films restituaient néanmoins, sous le manteau, une conscience un peu désabusée de l’état du monde, ou en tous cas n’éludaient pas les questions fâcheuses. On arrive de fait curieux à la séance de son nouveau film. Et la déception de vous attraper dès la première bobine pour ne plus vous lâcher. Car si Edna Walsh, instigatrice historique du projet, semble bien plus à blâmer que Nakata sur le fond du problème (on retrouve certaines thématiques chères au cinéaste telles que la desintégration des cellules familiales, et l’on comprend mieux sa motivation sur le projet), le fait est qu’il semble croire à ce qu’il nous répète, le bougre.
Une poignée d’archétypes, pardon de personnages jeunes et représentatifs de la cible : un dépressif asocial sous Rivotril, une fille à maman, une fashionista (la quasi-totalité des personnages féminins est à claquer à coups de pelle à neige) et un djeun’s ethnique amoureux platonique d’une môme de 11ans. Trop super cool jeunes et modernes, ils se retrouvent sur un chatroom ouvert par un ado charismatique, dont l’apparence de Tyler Durden aux petits pieds cache un horrible prédateur qui cherche à détruire leurs vies via les réseaux virtuels multimédia interactifs en Meuporgue 2.0. Parce que d’abord, il est malheureux, et qu’il ne désire que pousser les gens au suicide social ou physique, tout boursoufflé de frustrations qu’il est, y’a plus que ça qui l’excite. Ses parents ont bien essayé de lui confisquer son smartphone, mais malheur : Il en avait deux !
Comme dirait l’autre, c’est quand même du lourd. Même si une ou deux bonnes idées narratives émergent, comme le fait de faire de William (le méchant jeune donc) le fils d’une pseudo J. K. Rowlands : ça c’est très bien vu, mais pas comme l’imaginait l’auteure Edna Walsh, qui cherchait par là à montrer une cellule familiale enviable et équilibrée détruite par un agent extérieur – ici le «virtuel», avec son couteau entre les dents – pour faire trembler dans les maisons mitoyennes. Ou encore la jolie évocation par Jim de l’abandon de son père. Autre point à mettre au crédit du film, une tentative concluante de montrer l’espace virtuel avec des moyens cinématographiques satisfaisants, ce qui à notre époque n’est toujours pas gagné – voir à ce titre le récent L’autre Monde de Gilles Marchand. Ici, même si l’opposition des colorimétries entre net et « monde réel » (qui apparaît comme le plus faux des deux) est un peu trop appuyée pour être bien sérieuse, l’idée de faire des espaces virtuels des salons reliés entre eux par des couloirs à l’infini, façon Playstation Live dans un souterrain, n’est pas nécessairement idiote. Elle permet au moins de transposer les horribles habitudes visuelles des homepages et blogs d’ados, avec leurs cortèges de gif-animés/effets-glitter/lensflares-photoshoppés/tout-ce-pique-les-yeux-lol, dans un langage pictural identifiable immédiatement, puisque utilisant des objets réalistes, souvent volontairement assez laids ou jurant entre eux, quand ce n’est pas une jeune fille qui tapisse les murs (i.e. sa page en ligne) de photos d’elle-même.
Tous ces avatars plus ou moins bien observés empaquètent cependant un discours qui n’appelle que récusations de la part de quiconque ayant un horizon culturel allant plus loin que les humoristes survivants des époques pompidoliennes et les journaux de treize heures régionalistes. Quiconque, donc, ayant un usage d’Internet ne se limitant pas à l’échange de chaines d’e-mails bourrées de Powerpoint humoristiques dans la boîte à courriels de l’entreprise, et une vision dudit bornée aux reportages de société alarmistes à destination de la mère de famille qui y croit. Bref, à part pour l’oncle Gilbert ou madame Michu, voilà un film qui ne rencontrera que levés de sourcils circonspects dans un premier temps, avant de s’attirer quolibets et jets d’articles maraîchers pas frais dans un second.
Dans Chatroom, on ne peut rien trouver de bon dans quelque monde virtuel existant, et ça fait peur; à la rigueur (à la marge même), l’on s’en servira pour organiser des rencontres IRL vouées à lutter contre les dangers de ce monde décidément trop neuf et intangible pour être honnête (c’est l’objet du dernier acte). C’est bien connu, Internet c’est rempli de hackerz de cartes bancaires nazis pédophiles d’Al Qaeda en mp3. On retrouve, de fait, l’ensemble des fantasmes et amalgames pour le moins excessifs des dix dernières années dans les pays occidentaux, dans ce film pourtant conçu par un japonais (certes reprenant à son compte une théorie d’origine strictement anglo-saxonne). Au point qu’on se retrouve, bientôt, devant une sorte de version longue de la publicité gouvernementale sur les dangers du web, qui avait fait couler un peu d’encre l’année dernière, où les simples adeptes de jeux vidéos étaient placés au même niveau, et mis au même ban, que le porno hardcore, les molesteurs d’enfants et les skinheads. La photo désaturée très "mode" de la moitié du film reprend d’ailleurs à la teinte Pantone près celle dudit spot…
www.dailymotion.com/video/xbg16q_dangers-potentiels-d-internet-pub_news
Par moments dans le métrage, comme avec l’épisode du pédophile, c’est carrément la grammaire entière de tels spots de pub qui est reprise telle quelle, du découpage à la direction artistique. Et pour appuyer la thèse imbécile qu’on entend nous implanter à coups de bèche, on ne reculera devant aucun sacrifice, aucune dépense, aucune invraisemblance. Comme ce sous-pitch ridicule de bout en bout où une ravissante goth décide comme ça, d’un coup, que ce jeune garçon renfermé qui rentre les épaules devant son PC portable est incroyablement séduisant, et va ni une ni deux lui faire du plat (raclements de gorge polis). Lui, plutôt que de sauter sur l’aubaine (il a 17 ans, ils sont à Londres, elle est jolie et s’intéresse manifestement à lui de manière romantique : dans n’importe quel monde que vous arpenterez ces dix prochaines années, il ne se passerait pas une demi-heure avant qu’il ne la gave de GHB à l’aide d’un entonnoir.), préfère fuir ventre à terre pour rejoindre ses faux amis virtuels, qui vont d’ailleurs bientôt le pousser au suicide. Tout ceci est pire qu’incrédible, c’est insultant. Passons sur la jeune dinde (jouée par une protagoniste de la série Skins, tiens donc, si c’est pas l’un des sujets brûlant de l’année médiatique au rayon "Internet change notre jeunesse en Sodome et Gomorrhe") que deux actes de vandalisme véniel rapprochent de sa famille, ou sur la jeune mannequin tête-à-claques qui prend de grands airs de manipulatrice à gros QI sans voir venir à trois kilomètres le piège qu’on lui tend pourtant avec de gros sabots.
Le summum du jusqu’au-boutisme dans l’imbécillité intervient quant à lui lors d’un épisode dans le virtuel où un salon est entièrement consacré au cyber-bullying (une bande de forumeurs s’acharne plusieurs jours d’affilée sur un gosse de dix ans et se balancent des high-five de joie lorsque ce dernier prend des cachets pour mourir plutôt que de simplement se déconnecter... Véridique. Heureusement la cyber-police intervient bientôt, nous voilà rassurés), et un autre où l’on se rend volontairement pour se faire farcir les méninges de propagande pro-suicide assénée par une veuve noire qui elle non plus ne semble jamais se déconnecter. Sans doute une évocation masquée des sites pro-ana, ou des skyblogs arborant une poignée de photos d’albums d’Evanescence. Vivement la prochaine pièce de théâtre à l’usage des 9-15 ans où ces sujets ne manqueront pas d’être abordés. De fait, Chatroom est intéressant en tant qu’objet d’étude, symptomatique de l’époque d’où il est issu et dont il ne s’affranchit jamais.
Il paraît intéressant de remettre les choses en perspective tant on ronge son frein lors de la projection : à la vision de Chatroom, on se demande à nouveau (alors qu’on pensait avoir soldé ce vieux débat) combien de temps il faudra pour qu’une certaine catégorie de la population (typiquement, la génération de nos pères) comprenne qu’un média (en comptant à rebours : Internet, les jeux vidéo, la télévision, le rock n’ roll, le cinéma, jusqu’à un Nietzsche qui blâmait les jeunes admirateurs de Wagner) n’est jamais la cause des maux sociaux qu’il met en évidence, qu’il ne fait au mieux que les relayer. Les drames de la bêtise, de la méchanceté ou du désœuvrement sur Internet ne sont que des drames de la bêtise, de la méchanceté ou du désœuvrement. Lorsqu’un un crétin se fait reprocher par son patron une photo de lui, saoul, sur une plateforme sociale où tout est public, prise le jour où il s’était déclaré en maladie, c’est uniquement son propre crétinisme qui est en cause. Après tout, personne n’abat les tigres d’un zoo quand un abruti se jette dans leur enclos et s’y fait boulotter. Croire à la fable (mais Nakata y croit-il vraiment ?) selon laquelle tuer un bouc émissaire éloignera la malédiction est non seulement naïf, c’est virtuellement criminel dans la mesure où l’on n’agit jamais sur le mal. C’est aussi vivre dans un monde totalement déréalisé, se goinfrer de rêves médiatiques (informations officielles, commerce, téléréalité, pièces de théâtre "pour les jeunes") tout en méprisant et craignant les mangeurs de lotus d’un quelconque World of Warcraft, sans se rendre jamais compte que ces deux sphères d’expérience sont faites de la même pâte irréaliste. Comportement qui englobe d’ailleurs terreurs irrationnelles et désirs irraisonnés : Madame Michu, toujours elle, croit autant le journal qui lui dit que Facebook va transformer sa chaste pré-ado en prostituée adepte d’apéros géants, que la publicité qui lui affirme que le docteur Kawashima la sauvera à coup sûr d’Alzheimer ! Ce qui nous donne régulièrement des occasions de trembler ou de se gausser, mais cette fois pour de vrai, avec des gens reprenant la même réthorique, mais en y croyant eux dur comme fer :
www.dailymotion.com/video/xe3ey7_jessi-slaughter-after-b-cyberpolice_webcam
C’est précisément le cas dans Chatroom, qui ne raconte finalement qu’un conte pour endormir les parents inquiets face à cet écran qui ne les intéresse pas : William, le méchant jeune manipulateur, se châtiera bien entendu lui-même dans le final pour que tout le monde puisse rentrer chez soi, tous ses problèmes magiquement réglés, à temps pour le dîner et sans toucher à MSN. Ce qui ouvrira sur la seule idée réellement troublante du métrage, passée en contrebande avant le générique : celle du même jeune homme, seul dans l’espace virtuel après son décès – y persistant d’une certaine manière – nous ramenant à ce malaise qu’on a lorsque l’on retombe sur le profil en ligne, encore en service, d’une personne qu’on a connue et qui est décédée. Seulement, Masamune Shirow et Mamoru Oshii en avaient déjà parlé dans Ghost in the Shell, sans tirer aucune salve contre une imaginaire faction inhumaine, sans flatter dans le sens du poil une poignée de cauteleux chérissant leurs œillères. C’est d’ailleurs pour cela, en premier lieu, que Ghost in the Shell est un film, un ouvrage de cinéma appréciable avant tout pour lui-même, et que ce Chatroom n’est que l’émanation de son temps et de la sphère médiatique qui lui est afférente.
Ah, et c’était il y a quinze ans.
FL
Predators
Cherchant à faire retrouver son lustre à une franchise attachante mais malmenée, ce reboot se veut un retour aux sources et aux fondamentaux de la mythologie "Predator". Du progrès, oui, il y'en a, mais on est encore loin du compte, la faute à un traitement timoré et brouillon.
Quand on est sniper, commando, mercenaire, yakuza ou maniaque homicide et qu'on se réveille en pleine chute libre, largué avec armes et bagages dans une jungle inconnue avec d'autres types au moins aussi dangereux que vous, nul doute que la journée s'annonce chargée. S'il s'avère en plus que tous ces affreux sont votre seul rempart contre les comtes Zaroff extraterrestres qui vous ont amené là dans l'optique de vous chasser et prendre votre crâne pour trophée, et que la jungle qui leur sert de réserve est située sur une planète inconnue et hostile, on devine que ce sera carrément la tasse.
D’emblée, le projet Predators (dont le premier jet écrit par Rodriguez au début des 90’s devait suivre rapidement Predator 2) se frotte à pas mal de problèmes. La mythologie, mise en place presque parfaitement dès le premier film de la série, s’accommode mal des ajouts trop divergents, les ratages Alien versus Predator sont là pour le prouver : le concept de base des deux films (et dans une certaine mesure des jeux qui avaient précédé) était d’emblée en contradiction avec l’original, où les prédateurs chassent la proie de choix qu’est l’être humain. Dans AVP, l’homme est au mieux un larbin, au pire un emballage pour une autre race de gibier d’élevage. Adieu le « pour lui, vous êtes le lion » de Predator 2… La preuve que procéder à des ajouts aptes à relancer l’intérêt sans dénaturer la pureté de B movie de la mythologie Predator est un exercice de funambule. En termes de mise en scène ensuite, il est extrêmement ingrat de passer après McTiernan. Sa réalisation virtuose, constamment en rapport avec la conscience qu’ont les personnages de leur environnement, personnifiant cet environnement sans jamais paraphraser l’action, fait encore école aujourd’hui (le découpage de l’attaque du camp !). Predator 2 était à ce titre un vrai petit miracle, qui tirait l'ensemble vers le comic book hardcore décomplexé (le gang des jamaïcains), intention relayée par une mise en scène qui iconisait à fond les personnages et une direction artistique maline mêlant univers futuriste déglingué et imagerie discrètement 50's, le tout en approfondissant les pistes du premier film (sur la civilisation des extraterrestres chasseurs surtout).
Etrangement, mais logiquement, c'est dans ses tentatives de se refaire une virginité que Predators (aussi dénommé « Predator 3 » pour définitivement évacuer les AVP) perd des points. Ainsi la structure narrative marque trop l'original à la culotte, reprenant parfois à l'identique le montage séquentiel (déboisement à la Gatling, plongeon dans la rivière, combat final bestial – la preuve, il est torse nu –, camouflage thermique à base d'argile humide), quand la caractérisation ne donne pas dans le badass excessif et un peu brouillon. La plupart du temps, les personnages sont résumés par une ou deux répliques, pas plus, constituant l'alpha et l'omega de leur personnalité, ce qui les ravale souvent au simple rang de cast de trognes (Danny Trejo ou Oleg Taktarov sont ainsi assez inutiles, ce qui est bien dommage car cela fait toujours plaisir de les voir). Mauvais calcul puisqu'espérer égaler ou dépasser le capital sympathie/attitude des hommes de Dutch relevait de toute façon de la vue de l'esprit (par exemple, Sonny Landham, interprète de Billy dans l'original, était tenu par contrat d'avoir un garde du corps sur le plateau – pour protéger les autres !). Ce traitement n'est profitable qu'au tueur à gage yakuza, qui garde son mystère jusqu'à sa mise en relation avec les codes des predateurs lors d'un très beau combat à l'arme blanche, qui remet la notion d'honneur chère aux aliens à dreadlocks au centre des préoccupations. Et ce n'est pas le personnage de Topher « mon twist est éventé depuis que j'ai sorti mon scalpel » Grace qui à ce niveau va tirer les marrons du feu, même si paradoxalement sa proximité philosophique avec les bourreaux ne manque pas de sel. Quant aux autres, et bien justement, c'est « les autres » et on s'en moque comme d'une guigne.
Sans grande surprise, seul le duo Isabelle/Royce se sort de ce marigot, ce qui avouons-le est gênant pour un film de groupe. A ce propos d'ailleurs, Brody est à l'avenant du reste des éléments du films : crédible dans son rôle de dur précisément quand on n'essaie pas de le rendre crédible dans son rôle de dur, à grands coups d'abdos taillés en salle de sport et de mixage vocal qui pousse les basses avec enthousiasme (par moments on croirait une imitation de Christian Bale en Batman). Bref, à la caractérisation concise et étanche de l'original (voir la séquence de l'hélico), ce Predators substitue une mise en place des personnages à la serpette, bourrée de trous béants assez embarrassants (i.e. une petite sniper du MOSSAD qui connait l'histoire de 1987 alors que le super-barbouze ex-CIA, par ailleurs tellement au courant de tout que ça confine à la télépathie, n'en savait lui que dalle...) et d'évolutions mécaniques, pas toujours logiques et souvent lourdaudes. Si le survivant Noland (Larry Fishburne qui continue d'enfler) est assez réjouissant dans son pêtage de câble permanent, ses répliques du 1 sorties telles quelles sans justification réelle, et surtout les trois mesures fredonnées de la Chevauchée des Walkyries empêchent quand même de prendre tout ça avec autant au sérieux qu'on le voudrait au départ...
Tout ceci est d'autant plus dommage que Antal sait emballer une série B avec classe et efficacité, Motel l'avait prouvé. Si leurs rapports sont par ailleurs confus, les deux ethnies de predators ont pour le moins de la gueule et ne sont pas là pour faire dans le social, comme une bonne partie de ce qui concerne la planète et ses prisonniers. Mais voilà, certains éléments, comme les nouvelles armes des predators ou l'autre race d'extraterrestres-proies, ou encore les stratégies de traque (qui démarquent des stratégies guerrières éprouvées), sont tout simplement effleurés en laissant le désagréable sentiment que la production se garde quelques cartouches sous le coude pour d'éventuelles suites, selon ce principe pénible du film envisagé comme pilote de série, qu'on retrouve trop souvent depuis quelques années (poser l'univers, un ou deux protagonistes, trois-quatre éléments intrigants, finir sur un cliffhanger, passer à la caisse). Lorsque la production laisse à ces idées neuves un peu de place pour s'ébattre à leur aise, le tout se suit en revanche avec un vrai plaisir : le début en chute libre, les chiens, toutes les apparitions des predators...
Les options sur lesquelles la communication s'est le plus répandue sont respectées avec bonheur, de l'utilisation extensive de décors en dur et d'effets physiques à la classification R pleinement assumée, et le moins qu'on puisse dire est qu'il est agréable de retrouver de vrais prédateurs plutôt que l'espèce de Lassie chien fidèle d'AVP (on parle tout de même de bestiaux de deux mètres vingt qui étripent des gens pour leur arracher la colonne vertébrale). La demi-mesure est en tous cas oubliée ici et c'est heureux. Les personnages s'expriment certes par one-liners, mais le spectacle est dynamique et présente un rythme sans grands ralentissements, avec une belle photo et une direction artistique excessive et cohérente. On regrettera bien entendu le script trop je-m'en-foutiste pour être bien honnête, mais l'ensemble reste très amusant et chasse un peu du sale goût laissé par les précédents films. La déception que l'on ressent toutefois est à la mesure de l'attente et des espoirs placés dans ce reboot, à la faveur d'une promo qui voulait nous faire croire que « mieux que les derniers » pouvait s'entendre « aussi bien que les premiers »... Une idée toute bête, comme ça : pourquoi ne pas approcher à nouveau McTiernan pour le suivant, en ayant un script qui dépasse le second jet ? Mmmmh ?
Splice , ou Vincenzo Natali vu sous l'angle du pamphlet
"Issu de toi, issu de moi, on s’est hissés sur un piédestal ; et du haut de nous deux, on a vu."
A. Bashung
Note : il est préférable d’avoir vu le film avant de lire cet article.
Nombre de papiers critiques sont dithyrambiques à l’égard de Splice, et ce à juste titre en regard de la qualité indéniable de cette démarcation très shelleysienne des aventures de Dolly au pays des dérives bioéthiques. Cependant, les arguments et considérations que l’on y trouve le plus souvent sont assez similaires (pour tout dire relativement convenus) dans leur manière d’en rester à la surface des choses. Il ne s’agit pas ici de fustiger une prétendue (quoique probable, certaines publications se contentant de copier-coller le dossier de presse) paresse éditoriale qui consisterait à traiter les films avec une grille préconçue de type « décris tout ce que tu vois dans le dessin », et à y appliquer une réflexion formatée dont l’un des symptômes serait la subordination aux tics de la langue journalistique (celle-là même qui fait par exemple accoler systématiquement le terme
"bagatelle" à toute mention d’une importante somme d’argent).
Il apparait pourtant surprenant que sous prétexte que Splice est un film de SF, on ne le traite que par le petit bout de la lorgnette de la Hard Science, tant le discours sociétal pur et dur (et d’un pessimisme patent) s’y étale en indices trop multiples pour être fortuits. Bien entendu, la prospective scientifique de l’objet est solide et soulève ses propres questionnements, notamment en ce qui concerne la bioéthique, la marchandisation du vivant (aujourd’hui même l’on brevette des êtres vivants en tant que technologies, au nom de grandes sociétés cotées en bourse), la virtualisation des rapports humains, le contrôle de la recherche et plus largement la notion de progrès technique et les questions qui en découlent. Mais débarrassé de ses atours les plus évidement science-fictionnels, que raconte au final Splice ? Deux jeunes gens, membres productifs de la société mais aussi foncièrement immatures, font un enfant par la grâce de la procréation
médicalement assistée. Objet de tous les caprices (après tout il en est un lui-même), l’enfant sert de réceptacle à tous les désirs plus ou moins refoulés de chacun de ses géniteurs, qui le traitent tantôt en enfant-roi, tantôt en animal de compagnie. Enfants eux-mêmes, leur relation avec un être qu’ils ont conçu pour eux et non pour lui-même est pour le moins ambiguë, laissant la porte ouverte à l’inceste et aux pires maltraitances et castrations, symboliques ou non. Dans un tel environnement pathogène, l’enfant d’abord innocent devient littéralement un monstre oedipien aux passages à l’acte violents, uniquement préoccupé de toute-puissance et de domination, seule issue d’une cellule basée sur la collusion d’égocentrismes puérils eux-mêmes prostrés dans un sentiment de toute-puissance informulé mais jamais dépassé. Expliquons-nous :
Bien plus que tout autre genre de récit narratif, la science fiction se caractérise non par son folklore (sciences dures, prospective technique) mais en ceci que ce folklore sert de tremplin à des considérations universelles : humanité/non humanité, politique, religion, rapport à la technologie, au temps, à l’espace, au réel, etc.. Herbert, Ballard, K. Dick, Asimov, Huxley ou Verne développent ainsi, plus ou moins en filigrane, des réflexions théoriques complexes sur leurs terreaux mythologiques et techniques, au point de rencontre de la distance que leurs univers entretiennent avec le nôtre, et du vérisme de leur démarche d’écriture. Ce faisant, ils prennent la philosophie, engluée plus ou moins dans le quotidien et les sciences humaines depuis le situationnisme, pour mener des questionnements qu’on ne trouve plus que dans ce domaine fictionnel "fantaisiste", ou dans les publications scientifiques les plus pointues d’astrophysique ou de neurobiologie.
Au fil de sa filmographie, Natali s’approche par la métaphore de considérations sociologiques que l’on retrouve par exemple dans le cycle Dune de Herbert (tomes 4 à 7 principalement), concernant les multiples modes de coercition sociale et technologique, la pulsion messianique et la notion même d’individu au sein de structures données. Elevated et plus encore Cube montrent des sociétés (schématisées à l’échelle de petits groupes humains archétypaux) s’écrouler sous la pression de la lutte pour la survie, démontrant que le plus court chemin d’une barbarie à l’autre semble bien être la civilisation. Le constat est pessimiste, et l’ouverture proposée par la "victoire" du simple
d’esprit ne fait qu’en entériner l’amertume : plus il est "malin", performant en société, spécialisé dans ses compétences, plus l’être humain se ravale rapidement au rang de la bête féroce, le calcul froid en plus. Sous ses dehors de fable dickienne, Cypher fait fort lui aussi : dans un monde corporate, mais par extension dans tout groupe humain (voir les séquences domestiques), l’individu est une quantité négligeable et même un mythe mis en place pour la régulation (comment ne pas penser à ce titre aux notions modernes de marketing de niches ?), sauf dans le cas des électrons libres et agents provocateurs que le corps social cherche à éliminer à la manière de virus informatiques. Révolutionnaire, libertaire, la morale de ces récits? Le méconnu Nothing montre bien que le pessimisme de Natali envers l’humanité n’est pas soluble dans la liberté d’action de l’individu, ou en tous cas dans cette vision tronquée qu’a notre temps de la liberté individuelle, dominée par un égocentrisme d’enfants en bas âge : devenus virtuellement omnipotents par soustraction des éléments du monde qui les dérangent, les deux personnages ne sortent pour autant jamais de leurs carcasses, ni de l’immaturité qui les pousse à ne chercher que des solutions simples (i.e. l’amputation du réel plutôt qu’une appréhension plus poussée de celuici). Lorsqu’arrive l’inévitable point de rupture, il ne reste plus qu’à s’entretuer.
Splice apparaît comme une synthèse de ces jugements sans appel. Y sont dénoncés l’immaturité individuelle, son encouragement à l’échelle de sociétés entière par les agents décideurs du monde économique (il est à l’heure actuelle plus facile de vendre des Iphone que des livres de poche), ses effets délétères sur la (les) génération(s) suivante(s), jusqu’à des cataclysmes (sociaux, guerriers, écologiques) dont il est difficile, voire impossible, de prévoir les futurs et successifs raffinements d’abjection.
A vrai dire, devant Splice on pense beaucoup à Philippe Muray, grand - et salubre - sceptique devant la joyeuse parade pimpante de l’époque, joyeuse et pimpante elle aussi (et disponible en plusieurs parfums pour masquer l’arrière-goût des charniers qui la contituent). Un article en particulier publié à l’époque dans le regretté mensuel L’Imbécile, où celui-ci s’étonnait du culte de l’Enfant-Dieu devenu omniprésent dans les pays occidentaux, dénommé par lui infanthéisme et qu’il qualifiait de "maladie infantile de l’humanité contemporaine sénile" avec la verve qui le caractérisait. Ainsi « l’infanthéisme fait rage quand justement il n’y a plus d’enfants ni d’enfance. Plus d’adultes non plus par la même occasion. La frontière entre les deux stades s’efface au profit du premier dont l’adulte infanthéiste épouse à toute allure les goûts, la façon de parler, de jouer, de croire ou de ne pas croire, de s’émouvoir, de réclamer des friandises et des divertissements mais aussi des lois qui le protègent des dangers du monde extérieur », et « l’infanthéisme (…) est d’abord une auto-croyance, un auto-culte, le culte de soi-même idéalisé, de soi en tant que néo-enfant tout-puissant ». Guillermo del Toro tenait des propos similaires en promotion de l’Espinazo del Diablo , en réponse aux étonnements d’interviewers devant son absence de scrupules à tuer ou blesser des enfants dans ses films. Il remarquait ainsi qu’à Hollywood et plus généralement en termes de climat culturel, l’enfant est devenu une figure fantastique au même titre que le vampire ou le loup-garou : parfait, immortel, invincible, ayant toujours le bénéfice de l’innocence mais toujours aussi une réplique sarcastique concernant la vie sexuelle ou sentimentale des adultes… Del Toro a depuis sauvé Splice du development hell en le coproduisant, et c’est peut-être autant par proximité philosophique que par goût du film de monstre. Film de monstre qu’est tout de même principalement Splice, son concept démarquant bien entendu Frankenstein, mais en en biaisant d’emblée le concept de base - le Nietzsche de la mort de Dieu étant passé par là depuis l’écriture du roman. Ici, les scientifiques ne jouent pas à Dieu, ils jouent, tout simplement, incapables de voir plus loin qu’eux-mêmes et oublieux des éventuelles conséquences de leurs actes. Jusqu’à Elsa, qui reproduisant les maltraitances qu’elle a elle-même subies, ne se rebelle pas par ses actes contre une figure tutélaire mais en réplique le modèle, sans filtre ni réelle réflexion préalable. D’autant que le fait qu’elle ait intégré son propre ADN dans Dren, à l’insu de son conjoint, indique déjà à quel point l’enfant obtenu est instrumentalisé d’emblée (la raison d’être de leurs travaux est de produire une hormone - voir les créatures Ginger et Fred - mais la conception de Dren sert aussi à combler un désir de maternité que par ailleurs elle nie).
Car les indices de sa prise de position, Natali les dissémine partout dans son film. Dans sa structure narrative elle-même, nous l’avons vu, mais aussi et surtout dans les éléments de son imagerie et la caractérisation de ses personnages : ne supportant pas de travailler si l’environnement n’est pas personnalisé sous la forme du loisir (fonds musicaux, gadgets), ils s’habillent et vivent comme des adolescents (la déco de l’appartement, remplie entre autres d’artoys, d’objets de design à la mode et de posters à la manière d’une chambre d’étudiant), ont du mal à investir leur relation hors du stade du "chuis-beau-t’es-belle-on-baise", et conçoivent Dren en catimini, par défi envers une autorité qui leur a refusé d’avancer bille-en-tête, comme on fait le mur pour aller taguer les murs du lycée en buvant de la vodka bon marché. Une fois celle-ci née, ils la vêtent de petites robes, la nourissent de bonbons et alternent ébaubissements quant à ses mille merveilles et crises d’autorité aussi ponctuelles qu’incongrues. Ne reste plus qu’à mettre
l’infortunée sous cloche (dans le labo, le sous-sol, la caisse de transport puis la grange), tant physiquement qu’intellectuellement. La conséquence directe de tels comportements est l’explosion, à l’adolescence de Dren, de toutes les pulsions contradictoires qui déferlent sans frein.
Le parallèle est évident avec les enfants et adolescents tueurs, adeptes de pornos hardcore, d’alcoolisations massives, de tortures de SDF, etc. etc., et qui font les choux gras de la presse à faits divers depuis une trentaine d’année. Successivement, les medias et/ou personnalités politiques jamais bégueules dans l’anxiogène, auront accusé pour expliquer le phénomène les video nasties, les jeux de rôle, la télévision (ah, l’adoption de la V-chip au début des années 90 !), les jeux vidéos, Internet, le black metal… Une cause plus diffuse, mais nettement plus convaincante, pourrait justement être la déréalisation générale d’un certain occident, cet imaginaire entièrement rose et bleu pastel dans lequel on cherche à confiner l’enfance, tant dans sa vie physique que psychique, en le protégeant virtuellement de toute expérience traumatisante ou simplement désagréable. N’ayant pu construire, enfants, leur imaginaire sur des limites telles que peur, douleur, pathos ou frustration, il apparaît logique, du moins explicable, qu’arrivés dans le maelström émotionnel, hormonal et conflictuel de la puberté, ils recherchent ces limites, cette réalité, avec une force d’impact décuplée par l’élan pris sur plusieurs années d’enfance sans histoires.
C’est ainsi que Dren évolue, et commence à manipuler son entourage et en particulier Clive, son"père" putatif qui aurait plutôt un rôle extérieur, repoussé hors de la relation entre elle et sa mêre. Lui-même a un comportement tranché envers Dren, il essaie à plusieurs reprises de la tuer dans un reflexe quasiment prophylactique, bientôt teinté par le dépit narcissique : la scène de la noyade intervient après qu’Elsa ait refusé de faire un enfant avec lui, alors qu’elle s’investit bien au-delà de l’éthique avec son sujet d’étude. Le fait de simplement vouloir annuler l’expérience clandestine (par élimination de Dren donc) avant de se faire prendre, ne fait pourtant pas de Clive un agent de la modération ou de la maturité ; elle serait plutôt à voir comme une expression Peter Pannesque de vouloir absolument rester (ou retourner) dans un statu quo sécurisé "d’avant tout ça", comme l’on souhaiterait à l’issue d’une rupture douloureuse n’avoir jamais rencontré l’objet de son tourment, ou comme on forcerait sa petite amie à avorter…
Seul référent masculin de Dren (manifestement hétérosexuelle), mais suffisamment extériorisé pour être un objet de convoitise "légitime", il sera rapidement séduit par la créature lorsque sa rivalité avec sa mère est, elle aussi, sortie de gestation. Le spectre de l’inceste plane, mais ne se posera réellement qu’à l’occasion du climax qui voit une Dren totalement pervertie par une éducation calamiteuse, et qui transgresse volontairement ledit tabou.
Car Dren est tout d’abord innocente, la répétition d’une séquence de tuerie animalière suffit à le souligner : lors de sa première sortie, elle tue et dévore un lapin, mais il s’agit d’un geste animal, instinctif, en somme ingénu, qui n’est pas sans rappeler la Jennifer de Dario Argento dans le segment éponyme des Masters of Horror. Lorsqu’elle se bat contre Elsa dans le but de se débarasser d’une rivale et de s’affranchir de mauvais traitements absurdes, elle pique le chat dont elle s’était entichée à l’aide de son aiguillon dans une démonstration perverse de pouvoir. Une fois qu’elle a repris le dessus, Elsa ne s’y trompe pas et entreprend d’emblée de castrer Dren de son appendice caudal. Qu’à cette occasion, Clive passe d’objet de référence et de désir à simple sujet de pulsions et de rétorsions, est évident et logique. Vers un dénouement qui ouvre le sujet du point de vue scientifique, mais laisse le protagoniste restant dans le même état de grand poupon capricieux, boudant devant le gâchis par lui-même engendré.
Dernier point : ces lectures scientifique et sociétale ne sont pas opposées, elle sont bel et bien complémentaires. La science, comme toute activité humaine, s’inscrit dans son époque et les climats sous lesquels elle est pratiquée. Que Natali émette des réserves quant à la société qui produit Clive, Elsa et finalement Dren, n’implique pas qu’il n’a pas d’empathie pour ses personnages. Justement, il les accompagne presque sans les juger, leur donne des occasions de mûrir, de s’amender, de tout simplement ne pas trop mal faire. Ce faisant il constate avec eux les conséquences logiques de leurs errements, et par la même occasion, le spectateur le peut lui aussi, en étant aussi fasciné et attiré par la créature que le sont les protagonistes. A ce titre, le parallèle fait à l’envi dans la presse avec le Cronenberg de la première époque (surtout The Brood) est intéressant au même titre : Si un regard superficiel ne permet de voir que de la prospective scientifique, le tout est sous-tendu par un contexte sociétal très fort : pour la petite histoire, The Brood était la réaction explicite de Cronenberg à Kramer contre Kramer, qui l’avait horrifié alors qu’il traversait des épisodes similaires. Décidément, les territoires de la SF et plus généralement de l’imaginaire, c’est-à-dire d’une pensée qui dépasse le quotidien de l’individu, de l’ici et du maintenant, peuvent constituer des instruments de métaphore précieux pour appréhender cet ici ce maintenant. Mais c’est aussi bien plus que ça : en dépassant l’immédiateté de l’appréhension facile d’un réel tronqué par le rationalisme bon teint, ces domaines forcent à une vision plus mature des choses. Pas mal pour des genres considérés le plus souvent comme infantiles.
F Legeron
Last Exorcism - Daniel Stamm
Ç'aurait pu mais non
Synopsis : Cotton Marcus, pasteur évangéliste roublard, perpètre pour la dernière fois un de ces faux exorcismes qui ont fait son beurre, chez de pauvres gens qui y croient et pour une équipe de reportage, afin de "faire publiquement la lumière sur cette arnaque". Mais à mesure du travail sur la jeune Nell, ainée d'une famille recluse au père très pieux, la situation se complique, s'intensifie, jusqu'à bouleverser les convictions des visiteurs quant à la nature réellement démoniaque du problème...
Attention : ce papier contient quelques spoilers. Mais vu la manière dont le suspense du film est mené, c’est pas bien grave.
Sur le site officiel du film, à la section cast and crew, l’équipe technique compte 5 courtes lignes, dont trois tenues par des postes de producteurs, ce qui donne un bon aperçu des intentions de l’entreprise, à savoir fabriquer du buzz, n’importe comment, autour de n’importe quoi, pourvu que ça fasse des entrées. De fait, tout y passe: affiche blanche de type séquelle de Saw, faux site de l’exorciste malheureux, rigolo mais totalement hors de propos (étant donné la fin du film, pourquoi la nier en montrant le début du climax, sachant que le concept de found footage invalide complètement cette fictionnelle insertion : les agresseurs de l’équipe sont donc en possession des codes d’accès du site de Mr Marcus?), marketing viral sur Chatroulette (non mais sans déconner, et pourquoi pas un Twitter du faux cadreur du film? « On est poursuivis dans les bois, lol »), citations de critiques superposables à la virgule près avec ce qu’on pouvait lire sur les affiches d’un Paranormal Activity… Qu’en est-il du film ainsi servi ? Et ben ça se confirme les amis.
Ça démarre pourtant avec quelques atouts, c’est même parfois intriguant. La direction artistique se tient pas mal dans sa peinture des états ruraux et pauvres du sud des Etats Unis, avec une ambiance redneck/white trash plausible voire par moments authentiquement oppressante. On pense même parfois à un Jeepers Creepers pluvieux. Le cast est aussi intégralement bon et crédible (personne n’est réellement connu, ce qui n’est pas pour nuire au vérisme des situations), c’est d’ailleurs manifestement la partie de l’équipe qui croit le plus à ce qui se passe sur cette prod. Les trois membres de la famille Sweetzer jouent avec justesse (mention spéciale au petit frère) et la jeune possédée fout les jetons à une ou deux reprises… Une poignée d’idées pas mauvaises ressort également (l’évocation de la possibilité d’un inceste, l’annonce d’évènements futurs par les dessins de Nell, l’alcoolisme et le fanatisme du père), mais tout cela est noyé dans un gloubi-boulga de scénario et surtout de réalisation qui passent rapidement de l’imbitable à l’imbuvable.
Ce qui agace vraiment avec Last Exorcism, c’est qu’il pue le projet de gros malin à 500 lieues à la ronde, et s’aliène la sympathie qu’on voudrait mettre dans l’histoire sur la base de ses quelques éléments bien foutus. S’il parvient à retrouver l’ambiance des séquences réussies de Blair Witch (celles du début et de la fin, c’est-à-dire celles qui étaient effectivement écrites), Stamm cherche tellement à lui en remontrer qu’il en méprise complètement la grammaire. Il n’abusera donc que les plus crédules et les morts de faims qui en on marre d’essayer d’avoir peur devant les infâmes remakes de Freddy qu’on nous sert depuis deux-trois ans. D’abord, le trip de nous balancer douze fausses pistes pour faire un twist qu’on voit venir depuis la fin du premier acte, option « Ah! J’vous l’avais bien dit ! » et qui nie en partie les péripéties qui péripétiaient joyeusement quelques minutes auparavant (cf la blessure du frangin). Climax non seulement enfoncé à la va comme je te pousse au mépris de la structure de l’histoire racontée, mais manquant aussi singulièrement de générosité : si vous vous voulez voir un démon, rematez-vous l’Exorciste en image par image.
D’autre part, et là c’est quand même franchement impardonnable, il y a ce fait de vouloir le beurre et l’argent du beurre, avec la vanité de vouloir s’arroger l’aspect cinéma-vérité (oh le vilain mot) en jouant le sous-genre du found footage (après tout y’aura bien quelques préados adeptes de spiritisme qui seront foutus de croire que c’est pour de vrai. C’est du bon buzz, ça, coco.), tout en se faisant passer pour un grand architecte du cinématographe qui peut tout se permettre grâce à son génie de la mise en scène. Rappelons tout de même que le genre susdit est comme un chiot de race, il réclame qu’on s’occupe de lui, qu’on le bichonne, qu’on lui donne uniquement la bonne nourriture et le bon environnement ; sinon, il attrape des vers et il tombe malade, et après on peut plus frimer avec. Bref, le film en cam subjective (pour faire intelligent on dira « en occularisation directe » ça fait plus joli dans un mémoire) ne s’accommode pas de tout un pan de l’arsenal cinématographique tel que champs/contrechamps, musique et autres sons en off, monologues intérieurs, flashes-back, ou intervention de tout élément dont on ne peut pas justifier la présence effective dans l’ici et maintenant de l’univers dépeint. Toutes ces règles, Stamm se mouche avec. On aura donc de la musique, des sons derrière des portes que les micros ne pourraient pas choper (ou alors je veux les mêmes), de la « vidéo numérique » qui ressemble furieusement à du 35mm (elles font bip les Arriflex?), et du découpage merveilleux d’invraisemblance. Ainsi, le deuxième exorcisme de l’histoire, « véritable » celui-là, et qui a lieu dans la grange, se verra servi par un fond musical et des raccords internes à la continuité venant de huit angles différents… Voilà bien une manifestation surnaturelle : le cadreur se change en calmar géant doté de huit caméras ! A trop faire son gros malin, Stamm nous éjecte irrémédiablement de son histoire et ne parvient qu’à énerver. C’aurait été trop demander de réduire le budget pub de moitié et de consacrer la thune ainsi économisée à une correction de script, et peut-être un assistant réa pour dire au grand chef quand il merdait ?
Propulsé par une ou deux bonnes intuitions, mais mal conduit par l’orgueil de son réalisateur et jamais remis sur ses rails par une boîte de prod trop occupée à jouer les web guru, Last exorcism est un ratage, parfois amusant, que ses rares qualités rendent d’autant plus énervant au sortir de la salle. Même s’il ne mérite pas non plus un autodafé de ses négatifs, il n’est vraiment, mais alors vraiment pas indispensable. Juste à considérer comme un exercice de style d’autant plus vain qu’il est pris par-dessus la jambe.
Enter the Void – G. Noe
Gros buzz depuis - au moins - le dernier Cannes, attendu avec fébrilité par les uns, envie d’en découdre pour les autres, mais toujours avec grande curiosité, le dernier film de Gaspar Noé sort donc sa frimousse idiosyncratique ces jours-ci. Si la comparaison rebattue avec 2001 est très abusive, ça ne ressemble en effet à rien d’autre en tant qu’objet. Mais à trop serrer son film contre lui, Noé lui refuse au final son envolée, qu’on espère en vain tout au long de la projection.
Un peu dealer, un peu junkie, Oscar vivote à Tokyo avec sa soeur Linda. Après quelques considérations avec un ami artiste sur la vie, la mort, la philosophie tibétaine et les hallucinogènes, ses magouilles et coucheries le rattrapent bientôt et il ramasse un pruneau dans le crasse chiotte d’un club quelconque. De là, on suivra les pérégrinations de son esprit autour de la soeur sur qui il a juré de veiller, via divers flashes-back et élévations successives de conscience vers une ataraxie, disons, relative.
Le but revendiqué de Noé était de faire un film authentiquement psychédélique, de l’ordre donc du totalement immersif et de l’inédit sensoriel (pour la grosse majorité de la population en tous cas, qui n’a pas forcément connu les bons plans peutri des glorieuses nineties. Ah, le peyotl de nos jeunesses!). Le pari est gagné haut la main à ce niveau : la construction en plan-séquence subjectif systématique s’admet sans effort avec un code fluide entre dispositif du flash-back (où le personnage se tient derrière sa propre tête) et dispositif de l’errance de l’âme (en occularisation directe). En termes de travail de conteur, c’est magistral, et la beauté plastique de pas mal de séquences est incroyable (Benoît Debie est en grâce, même si on peut trouver quelques options discutables, nous y reviendrons). Loin d’être un simple gimmick, la vue subjective est pleinement légitimée, sans qu’on ait besoin de lui trouver une justification, et en parfaite adéquation avec le sujet là où, parfois, les contorsions d’Irreversible pouvaient paraître brouillonnes. A ce propos, Enter the Void et ses prises de vue en caméra libre constituent une belle réponse au train de Tartuffes qui se paumoient depuis quelques mois sur la "révolution" de la 3D, qui avouons-le n’apporte rien de fondamental au trio image-découpage-son du medium. Il y a plus de vertige dans deux minutes d’Enter the Void que dans une heure du Choc des Titans. Ou du dernier Burton. On louera aussi Noé de s’essayer enfin à un certain optimisme, relatif certes mais indéniable.
Dommage alors, et Ô combien, que le script ne suive pas. La simplicité du pitch de base n’est pas en cause, elle est même plutôt bien vue étant donné la masse d’informations visuelles et sonores que doit par ailleurs admettre le spectateur. Après tout, à notre époque, ne pas céder à la tendance du script à tiroirs à tous propos est une qualité. Le souci vient plutôt de protagonistes mal dégrossis, d’une insuffisance de relectures du scénario, et d’un certain ethnocentrisme fortuit.
Qu’on s’entende bien : les films de Noé se ressemblent beaucoup d’un point de vue structurel et partagent qualités et défauts. On sera donc ici en terrain connu. Ce seront, pêle-mêle, la grande élégance visuelle, le montage séquentiel indiscutable, l’abus d’un grand tube de musique symphonique, toujours un seul par film (ici l’Aria de Bach), le goût d’une subversion souvent déplacée et finalement bien peu choquante (ici l’on trouvera matière à des débats creux sur l’inceste suggéré ou le fait de se taper des MILF, bigre, j’en suis tout retourné), et un recours au sur-signifiant qui commence à devenir agaçant. A certaines voix-off "Captain Obvious to the rescue !" de Seul Contre Tous, ou au carton « Le temps détruit tout » (Non, sans blague ?) d’Irreversible, se substitue ici une surdose de répétitions inutiles des séquences les moins intéressantes du métrage. Si montrer à plusieurs reprises l’accident de voiture se justifie (Selon le livre tibétain des morts, l’esprit doit en premier lieu se débarrasser de ses peurs les plus profondes), quid de celle du parc, à laquelle on a droit trois ou quatre fois, où les personnages se répètent ce qu’ils savent pertinemment pour l’information du spectateur ?
En schématisant un peu, on pourrait dégager un embryon de théorie en extrapolant sur les qualités argentines (disons sud-américaines) et les défauts français (disons européens) de l’auteur. D’un côté un esprit désinvolte, emprunt de poésie et de vie (à la manière d’un Jodorowski, ou même d’un Jose Mojica Marins par exemple), sanguin et impétueux. De l’autre un intellectualisme de posture (la face godardienne), qui cherche à tout de même donner des signes lisibles d’intelligence ou en tous cas de réflexion, parce qu’il faut quand même pas pousser Mémère dans les arbres chuis un garçon qu’a d’l’instruction moi. En résultent les objets uniques mais hybrides que l’on connaît, qui rembrunissent autant qu’ils enthousiasment.
Ici Noé commet trois de ces fautes de goût : le manque de confiance au spectateur qui rend pas mal de moments très lourds (avait-on besoin de revoir TOUT le cast dans le love hotel ?) et ruine toute surprise (en gros, le film se présente comme un mémoire de maîtrise, avec présentation du plan en avant-propos). A trop vouloir enfoncer le clou de son propos ("la vie la mort et le cycle des réincarnations, oh là là ce n‘est qu’une seule et même roue ma bonne dame"), Noé flanque là des séquences totalement inutiles comme celle de l’avortement, doublée d’un plan assez scandaleux de foetus parfaitement formé digne d’un tract pro-life (disons que si la dame dépote ce type de gluon après 5 à 6 semaines d’aménorrhée, c’est carrément un remake de Hidden). Deuxièmement, le propos est affreusement hermétique par moments et ça se regarde un peu filmer en oubliant qu’il y a des gens qui vont venir, un jour, voir le film. Ainsi, un bon quart du métrage est carrément flou…
Enfin, et c’est ce qui pose le plus problème, le propos est très fermé sur lui-même notamment en termes ethniques. On a le sentiment de voir le fantasme de jeune cinéaste de bonne famille (ou de bonne école, c’est selon la foi qu’on a dans le système français) : Voyager parce qu’on peut se le permettre, mais sans jamais sortir de sa tête, de son identité et de ses fréquentations. On n’en ramènera que des photos-souvenir et la bonne prononciation de "kawaï". Encore pire dans l’ethnocentrisme qu’un Lost in Translation, Enter the Void ne nous montre que des caucasiens qui traînent avec des caucasiens à part un coloc qui fait de la figuration, une ou deux accortes donzelles peu avares de leurs nichons d’extrême orient (quel exotisme !), et le mec de Linda, nommé Mario (il aurait eu un frangin, il se serait appelé Luigi ?) ! L’honneur est sauf puisqu’elle choisira, enfin, un blanc il est vrai présenté comme plus sympathique. Le reste est à l’avenant : ainsi aucune réplique en japonais n’est sous-titrée, ce qui sous-entend que les personnages principaux vivent à Tokyo mais n’ont appris aucune formule de conversation, par mépris ou par paresse peut-être. Joli. Il aurait été plus pertinent de sous-titrer partiellement ces répliques, à la manière de la compréhension d’une langue dont le protagoniste n’aurait que des notions ; mais ce n’est qu’une proposition.
Tout ceci, bien entendu, est fortuit (l’idée d’un Gaspar Noé raciste ou xénophobe est en soi ridicule). C’est le sous-produit collatéral d’un oeil situé trop près du lorgnon, et qui par là même ne voit pas l’ensemble de ce qu’il prétend raconter. Et c’est bien la virtuosité de l’objet qui rend, par contraste, ses scories d’autant plus grotesques et gênantes. Il faut dire que le film est très long en regard de ce qu’il raconte, et que 40 bonnes minutes de moins ne seraient pas du luxe. Sans compter que comme on l’a remarqué plus haut, cela permettrait de sabrer dans les répétitions de flashes-back et les sous-pitches inutiles… Maintenant dans le cinéma dit d’auteur de notre pays, Noé est l’un des très rares à être, effectivement, un auteur, c’est-à-dire à avoir un point de vue. Et ça donne toujours quelque chose d’intéressant à voir.
FL
Moon – Duncan Jones
Sam Bell est l’unique employé sur site de la compagnie minière Lunar Industries, consortium qui extrait l’hélium 3, source vitale d’énergie, sur la maison des sélénites. Son contrat de trois ans prend fin d’ici peu et il a hâte de retrouver son épouse et sa fille, d’autant que son seul interlocuteur sur la base est Gerty l’ordinateur de bord et que sa santé se dégrade. Après un accrochage bénin dans l’une des moissonneuses, il se réveille à l’infirmerie sans réel souvenir, et part inspecter le véhicule accidenté…Pour y découvrir un autre Sam Bell, commotionné, qui s’avère être son clone.
Alors ils l’ont tous fait, le jeu de mots moisi autour du Major Tom, on le fera pas ici. Oui, Duncan Jones est le marmot de David Bowie, ça c’est pour la partie people.
Voilà, ça, c’est fait, maintenant on peut s’en foutre, c’est pas la rédac de Elle ici.
Parce que Jones, il en a dans la caboche et dans le CV, il en avait déjà avant ce premier long qui montre aussi qu’il en a dans le fute. Faire un film de SF dans le circuit indépendant, austère, avec des maquettes et un ton résolument 70’s, un pitch qui ne multiplie pas les sous-intrigues et ne joue pas la carte du twist pour avoir l’air astucieux (on découvre le pot aux roses dès la fin du premier acte), y’a pas, c’est couillu. Tenir l’exploit sur tout son récit, c’est carrément de la grâce. Bien entendu, le terrain est assez balisé, que ce soit esthétiquement ou sur le plan philosophique : les citations abondent parmi les plus évidentes et la réflexion ne vous retournera pas les sangs, c’est le moins qu’on puisse dire. Sans forcer, on trouvera de la solitude à la Silent Running, du dialogue avec ordinateur et des sorties spatiales à la 2001, du travail à la Outland, des visions qui lorgnent vers Solaris, des couloirs à la Alien (en même temps, c’est intégralement tourné aux Shepperton Studios), des réflexions génétique/humanité/finitude tirées de Blade Runner, de l’héroïsme qui rappelle Sunshine, un final à la Gattaca… Et pourtant le film surprend à sa manière douce et poétique, porté en cela par la très belle musique de Clint Mansell et une photographie qui n’en fait pas trop (c’étaient les délires de lentilles qui plombaient le final de Sunshine justement). Partant de concepts durs (l’instrumentalisation du vivant, la déshumanisation face à l’économie, la vanité des démarches d’amélioration de soi), Jones tire son film sinon vers un optimisme, en tous cas vers un ton plus solaire qu’on aurait pu l’envisager, et évite le cynisme facile qu’on aurait pu trouver dans un tel exercice. Et la caractérisation de(s) Sam échappe - un peu - à la routine des représentations de "gars tout seul" de la SF moderne : même si le premier Sam taille du bois pour en faire une maquette, parle à ses plantes et fait de la gym, il ne passe au moins pas de longs moments à regarder par la fenêtre ou à jouer aux échecs contre Deep Blue. La manière de poser le personnage s’affine et s’affirme lorsqu’il est confronté à son clone, autre lui-même plus jeune de trois ans de solitude, qui constitue une sorte de version plus immature de lui, plus impulsive, mais aussi plus volontaire.
Mis à part en ce qui concerne la compagnie (qui a de sévères relents de Weyland Yutani), donc, pas de manichéisme excessif, l’opposition de caractères n’étant jamais tranchée en bon/mauvais entre les Sams. Surtout, et c’est le point qui paradoxalement touche le plus au niveau émotionnel, Gerty n’oppose pas une logique froide aux considérations des Sam (l’imagerie Maria/HAL/Mother qu’on applique sans trop réfléchir d’ordinaire), bien qu’il soit à la base programmé comme agent de la compagnie, et il se pose en figure la plus humaniste ici. Si c’est lui qui active, successivement, chaque nouveau clone lorsque le précédent est arrivé en fin de vie, sa programmation asimovienne le pousse à considérer chaque nouveau Sam comme LE Sam, et donc à l’aider, coûte que coûte. Au final, le taylorisme ultime appliqué aux clones (durée de vie limitée, systèmes de coercition induits, tâches simplistes) les rend potentiellement moins humains que peut l’être un simple ordinateur (1)… Jusqu’à ce que deux de ces clones en viennent à se rencontrer et à créer de nouvelles interactions. En résulte une réactivation de ce qui fait leur essence, voire leur humanité, qui se traduit par une propension retrouvée à la rébellion et un désir de plus d’interactions (i.e. un retour sur Terre). Dans son film sur la solitude, Jones ne dis rien d’autre que ça : l’homme est un être social dont le supplément d’âme tient dans le flux des interactions. On pense bien entendu à Dennett et ses théories neurobiologiques, puisqu’on est dans une pensée de la cybernétique où la liberté s’acquiert via les moyens de communication (la destruction des tours de brouillage, le fait de rendre publiques les pratiques de la Lunar).
Pour porter ce message humaniste, Jones a choisi Sam Rockwell (en fait il revendique avoir carrément écrit le film pour Rockwell) qui y va lui aussi mollo sur les effets dont il est coutumier et du coup, joue tout simplement bien, sans doute plus occupé à être synchro dans les prises où il discute avec lui-même qu’à faire son numéro. L’empathie fonctionne à fond et même si on ne mise pas beaucoup de kopeks sur le métrage de prime abord (de la curiosité, oui, mais il est facile d’être d’abord rebuté par le rythme très lancinant), on se fait au final cueillir comme une midinette face à des exploits dérisoires, loin de l’héroïsme clinquant revenu à la mode. Comme la technique suit impeccablement de bout en bout (putain, ces scènes d’extérieurs !) on sort assez chamboulé de l’expérience avec le thème du score dans la tête pour au moins trois jours. On regrettera bien entendu que l’histoire n’aille pas un poil plus loin (en confrontant par exemple les Sam à leur original revenu depuis belle lurette sur Terre) mais en louant tout de même la limpidité du récit. C’est sans doute le prix de l’entreprise de Jones que de faire adhérer sans réticence ses interlocuteurs (ça c’est nous) à son histoire, finalement toute simple.
Tout simple, bien entendu, c’est ce qu’est le DVD français délesté de quasiment tous ses compléments visibles sur les galettes d’outre-Manche-et-Atlantique, ce qui est franchement pénible. Propre, rien qui dépasse, particulièrement dans un making off strictement promo (un quart d’heure, un trailer, et puis s’en va), et après un supo et au lit demain y’a école. Bah, c’est un DVD France Télévision, on a l’habitude. Remember les coffrets de Doctor Who sans VO ni épisodes spéciaux ? Eh les mecs, ça vous écorcherait la gueule de nous mettre aussi les trucs intéressants dans vos disques (même pas de les fabriquer, juste de les remettre à leur place) ? Vous voulez vraiment qu’on n’aille plus se fournir que sur les sites en .co.uk ?
Pas révolutionnaire, pas prétentieux, le film de Duncan Jones. Si on vient pour se prendre la tête à deux mains mon cousin, on pourra être déçu, mais ce serait oublier que la sincérité de l’entreprise et de l’histoire sont la raison d’être de ce projet qui est tout simplement, au final, émouvant dans sa facture. Ce que d’aucuns qualifieront de naïf, mais est en vérité la marque de la maturité de son auteur, qui ne se laisse pas submerger par l’aspect hard science de son univers, ni par les implications discursives des évènements qu’il relate, et garantit constamment la fluidité de son métrage. Allez, on fait pas sa mauvaise tête et on oublie le cynisme, les enfants. Regardez, c’est vraiment un joli film.
Lovely Bones - Peter Jackson
Susie Salmon est violée et tuée à 14 ans par un voisin car elle ne s'est pas assez méfiée de sa pédo-moustache pourtant proéminente. Du haut de l’entre-deux mondes fantasmatique de son après-vie, elle observe sa famille, ses amis, et son meurtrier, dans les mois de deuils qui suivent sa disparition.
Et pis, c'est tout. Oui, c'est maigre. Adapté d'un best seller tendance Ripolin-Marc Levy, Lovely Bones est le premier film vraiment fastidieux de Jackson. Fastidieux et même carrément rebutant d'affectation et de cucuterie. Le texte du quatrième de couv’ est intégralement un copier-coller de Marie-Claire, ce qui donne une idée du public-cible et de la teneur du propos qu’on entend nous asséner.
Retour proclamé au film sensible et "intimiste" (de l'intimiste avec un casting ostentatoire et une chiée de production value en veux-tu-en-voilà tout de même), Lovely Bones ressemble surtout à ce qu'il est dans une certaine mesure : un objet transitoire destiné à se refaire une virginité et faire oublier les soucis rencontrés sur Halo et la préproduction chaotique de Bilbo. Seulement voilà, une reconstitution d'époque, avec adolescence féminine, monde imaginaire et nature humaine sombre cachée sous le vernis de Suburbia, bah il l'avait déjà faite, le Peter, ça s'appelait Heavenly Creatures et c'était très bien. Que dire de cet auto-plagiat à part qu'il ne retrouve qu'à de trop rares occasions la grâce de ce premier effort? La réponse est dans la question. Car Walsh et Jackson nourrissaient une vraie passion pour leurs égéries meurtrières de l'époque et avaient porté leur projet à bouts de bras : la poésie du résultat n'était, elle, pas feinte et c'est pour ça que ça marchait.
Ici on a tout le contraire. En gros ça ressemble à un gros téléfilm Hallmark ponctué de vérités premières et touchy-feely à la "l'esprit de Noël c'est donner et aimer", tout en démarquant American Beauty (l'épilogue donne envie de filer des coups de latte à un chien) et Virgin Suicides, avec de grosses louches de la calamiteuse adaptation de Matheson de 1998, What dreams may come, pour un au-delà d'une ringardise presque jamais démentie. C'est d'ailleurs ce qui énerve au plus haut point à la vision du film : l'outrance de la caricature pour un objet qui se proclame aérien et subtil, c'est-à-dire du fantastique à usage de celles qui n'aiment pas le fantastique. Entendons-nous, Jackson à toujours manié l'archétype et la caricature dans ses films, notamment dans la caractérisation de ses personnages, mais il l'avait fait, jusqu'à présent, avec la subtilité qui lui fait aujourd'hui défaut (voir Braindead). Alors qu'est-ce que ce sera ? Et bien, pêle-mêle, une reconstitution des seventies trop pimpante pour être totalement honnête, les deux tiers du cast au charisme sabré par la D.A. (on a rarement vu Rachel Weisz dégager aussi peu de présence, même dans Return of the mummy), des séquences tellement tayloristes du point de vue thématique qu’elles en deviennent individuellement putassières (la partie musicale autour de Susan Sarandon en mamie rigolote, abattez-moi, de grâce), le tout saupoudré d’une caractérisation à la Kolossale finesse.
Oh, une jeune medium un peu lunaire. Faisons-la brune avec une tête à s’être cogné un orteil dans un meuble. Un prétendant ? Un peu typé latin, mais pas trop, histoire que ce soit pas menaçant, et déclamant de la poésie passque c’est joli, ça va nous en lubrifier des boîtes à ouvrages dans les travées du cinoche. Et hop, une maman très digne avec des yeux tristes et un papa un peu juvénile mais à la virilité rassurante. Et bien entendu : comment reconnaître le méchant ? Les lunettes carrées, la station-wagon et la pédo-stache bien entendu ! En plus il fabrique des maisons de poupées l’enflure, c’est sûr qu’il est pas net. A ce train là, Fritzle aurait été arrêté 25 ans plus tôt les amis, hein.
Ce qui est bien pénible étant donné qu’il reste quand même un peu à bouffer, niveau mise en scène surtout (une ou deux options de montage sequentiel, bien qu’elles éludent le coeur du récit, c’est-à-dire le meurtre), et que les acteurs y croient visiblement à mort. En gros, ils jouent très bien des grosses quiches taillées à la serpette. La mention va bien entendu aux deux principaux protagonistes, Susie et son bourreau, qui lui se taille la part du lion des scènes où on rouvre un œil pour sortir de sa torpeur de haricot tiède. Dans la plupart des séquences qui le touchent (hu hu), on retrouve un Peter Jackson à la mise en scène plus outrée, plus "interne" et plus incarnée de ses débuts, à grand renforts de paluche sur des détails et de courtes focales lourdes de sens sur des objets a priori anodins ou le regard inquiétant de Stan Tucci. Dommage alors d'écrire aussi mal autour de lui ! D'un dernier acte qui tire à la ligne comme c'est plus permis (6 bonnes minutes de coffre qui roule) à une punition ultime à la fois très Deus ex Machina et peu satisfaisante (encore une fois, on sent bien que pour ne pas froisser la spectatrice de base il faut bien punir le méchant, même si c'est pas logique et que ça prend le film comme une envie de pisser), le syndrome "il en reste 4 tonnes, j'vous les mets quand même de LOTR frappe à nouveau. Dommage aussi que l'écrasante majorité du temps, la réa se résume un peu à appuyer du plat de la main sur le bouton Weta Digital pour faire de la fantasmagorie parfois bien vue (les victimes précédentes, le phare), souvent piquante pour les yeux. Techniquement c'est irréprochable, mais ça ressemble au mieux à une longue pub pour écran plat, avec grosses CGI en mode HDR forcé et petit kiosque "lothlorien quality". Et de finir sur un looooooong ralenti qui tire trop véhémentement sur la corde lacrymale avec la superbe Song to the Siren (This Mortal Coil), fourrée ici à grands coups de boutoir, et qui aurait dû rester chez David Lynch et dans nos souvenirs émus (la scène d'amour dans le désert de Lost Highway, nda).
Bref, de l'image d'Epinal qui marche bien dans les passages cloutés de notre belle époque casual. Idéologiquement, on voit bien la manière dont tout ceci sert la soupe à la gonzesse de pays occidental aisé, en lui assurant sur un ton égal de berceuse qu'elle a bien raison de mener son existence déréalisée, dans le même imaginaire rose bonbon que ses coreligionnaires du grand rien qui fait de mal à personne. Pour faire bon poids, on aura soin d'agiter un croque-mitaine tellement caricatural qu'on se croirait revenu dans la Belgique post-Dutroux, celle des marches blanches et de la communion simplificatrice de sens : attention au vilain monsieur bizarre, brûlons-le d'emblée fut-ce en effigie pour nous rassurer à peu de frais, soyons totalement tournées vers la surprotection tous azimuts de nos gosses et dédouanons-nous des effets délétères de telles pratiques éducatives. Ne me sortez pas de mon néant confortable, je préfère vivre dans la terreur exagérée de me faire NatashaKampuscher par un inconnu, ça m'évite de regarder en face l'abjection inhérente à tout être humain. Ce filigrane vient certes surtout du bouquin de base, mais c'est rageant de voir le gars qui a fait King Kong s'abaisser à montrer une femme de tête, qui naguère lisait Camus, se ravaler joyeusement au rang de stricte pondeuse dès qu'elle a des mômes (un plan ou livres de cuisine et méthodes d'élevage de marmaille ont remplacé les auteurs à gros neurones).
Dernière chose, qui achève de rembrunir : dans cette optique d'être gentiment bercé par les bras oublieux de la société du lustprinzip, on accepte toutes sortes de pratiques de gredins, notamment, ici, commerciales. Ainsi, si le bluray est gargantuesque au niveau éditorial (avec des modules parfois carrément hypertrophiés en regard de leur objet), pour le DVD, nada, zobi, pas la queue d'un bonus. Z'avez qu'à être des bons citoyens et acheter des équipements HD. Sinon on envoie des pédophiles dans votre quartier. Bouh !
On passera miséricordieusement sur ce film très anodin, transitoire et prônant le renoncement mou. Une maigre poignée de bonnes idées et d'images sympathiques ne vaut pas la peine de risquer d'en vouloir à un cinéaste dont c'est le premier faux pas. Heavenly Creatures se trouve un peu partout à grave pas cher, je dis ça, je dis rien.
FL
Shutter Island – M. Scorsese
Adaptation d’un bouquin dont vous entendîtes sûrement parler via le Tintin hardcore du Journal de la Santé, et plus intéressant pour la période où il se déroule (qui suit l’apparition du largactil en traitement antipsychotique) que pour son déroulement finalement convenu. C’est néanmoins le film de fiction de Scorsese le plus recommandable depuis Gangs of New York, pas moins : le script extrêmement galvaudé laisse froid lorsqu’on n’a pas vécu dans une grotte pendant 15 ans ou qu’on a un minimum de culture psychiatrique, mais ses manquements servent de marchepied à un réalisateur qui en profite pour redevenir inventif en termes de mise en scène. Joie !
Nous sommes donc en 1954 et l’US marshal Daniels vient avec un nouvel équipier enquêter sur la disparition présumée d’une patiente de l’hôpital psychiatrique de Shutter Island, réservé aux patients difficiles, hôpital dont les pratiques thérapeutiques sont pour le moins mystérieuses : psychothérapie, camisole chimique, lobotomies ? De cachotteries plus ou moins flagrantes des soignants en messages plus ou moins codés des patients, il devra avant tout gérer ses propres traumatismes issus d’un passé personnel douloureux et de souvenirs de la libération de Dachau à laquelle il a participé. Lorsqu’une tempête les bloque sur l’île, c’est peut-être la vie de l’inspecteur qui est en jeu, ainsi que sa santé mentale.
Attention, spoilers.
Bon, le script en lui-même n’est saillant que par ses éléments d’imagerie, ses exhausteurs de goût : l’île gothique à souhait (son quartier d’isolement, les rats de sa falaise, son cimetière), les souvenirs de Daniels, l’univers de la psychiatrie alors en mutation. Parce que pour une histoire originale dans son strict déroulement, on repassera. Une fois éventé le fait qu’on n’est pas dans un whodunit qui pourtant empruntait des pistes thématiques passionnantes (McCarthisme, expérimentations sur les malades mentaux, traumatismes des soldats de la seconde), on se retrouve dans un récit finalement balisé de twist schizophrénique et de conflits d’intérêts entre réalité et illusion (« Qui est qui ? Ce qu’on me raconte sur Unetelle, est-en fait sur quelqu’un d’autre ? Qui suis-je, ou vais-je, suis-je dans la Matrice ? Viens manger à la maison, c’est Maman qui va être contente, signé Norman Bates »), et dont on peut tous citer quarante références plus définitives que ce que ce scénario propose. Pêle-mêle Identity, Jacob’s Ladder, Fight Club, Avalon, l’excellent Chasing Sleep dont le personnage joué par Jeff Daniels entretient plus que des points communs avec celui joué ici par Di Caprio, etc, etc, ad nauseam.
A ce titre le final sonne carrément comme un renoncement, un dernier « bah, après tout qu’est-ce qu’on y peut », avec ce dernier retournement d’épilogue qui cherche à boucler le scénario sur lui-même (fléau de l’artisanat scénaristique de ces 15 dernières années : le script qui à force de trop vouloir faire du bien écrit et du bien structuré, ne parvient qu’à devenir inutilement autarcique, trop récursif, bref hermétique et artificiel), assorti d’une invraisemblance qui cherche à réunir le pitch psy et le pitch thriller mais ne parvient qu’à éjecter définitivement le spectateur hors du récit : traverser tout un parc, la côte, et quelques dizaines de mètres de couloirs crasseux, avec à la main un instrument chirurgical qu’on s’apprête à utiliser ? Pourquoi une perle aussi grossière alors que le dernier plan sur le phare aurait suffi à suggérer le traitement qui attend le personnage ? A trop vouloir faire montre de virtuosité, l’histoire ne parvient qu’à être certes plaisante mais somme toute assez plate et fouillie. C’est dans l’appropriation de cette histoire par Scorsese, ou plutôt dans ses choix esthétiques et narratologiques, qu’on va trouver de quoi se sustenter.
D’abord le cast, intégralement composé d’acteurs solides qui font bien mieux que se dépatouiller des situations, et les transcendent le plus souvent par la seule conviction qu’ils mettent dans leurs rôles. Qu’ils soient archétypaux (Kingsley, Ruffalo, Von Sydow), duplices (Michelle Williams sur qui on n’aurait pas misé grand-chose) ou carrément excessifs et à seule valeur fétichiste (les caméos d’Elias Koteas et Haley qui suffisent à ne pas regretter ses 9 euros, quant à Patricia Clark, une seule scène lui suffit pour être à la fois glaçante et empathique), tous les acteurs sont impeccables, ou peu s’en faut concernant Di Caprio (qui a de plus eu la bonne idée de désenfler depuis ses derniers rôles) qui doit jouer constamment tout et son contraire et se démène comme il peut d’un rôle pas toujours cohérent.
Ensuite, que le pitch soit par certains aspects convenu n’empêche pas son réalisateur de développer des trésors de subtilités de mise en scène. La direction artistique pour commencer, qui suit avec bonheur le chemin extrêmement étroit entre réalisme et outrance gothique. Le passage dans n’importe quel hôpital psychiatrique occidental ayant un peu d’histoire pose de manière indélébile le caractère paradoxalement bigger than life qu’ont ces lieux confinés, à la fois englués dans le quotidien le plus prosaïque, voire le plus misérable, et pris constamment dans la fantasmagorie et, presque, le surnaturel, entre fanges et rigueurs cliniques. Cette ambiance est merveilleusement rendue ici, ce qui n’est pas un exploit à la portée de beaucoup de tâcherons qui posent leurs caméras dans un asile. Il suffit de voir la longue séquence du quartier d’isolement pour retrouver ce quotidien sordide magnifié par une ambiance d’épouvante toute victorienne. Ce n’est pourtant pas tant du côté d’un gothique hammerien que Scorsese semble puiser ses références picturales, que de celui du gothique italien des années soixante. En attestent les éclairages qui évoquent par moments le Bava du Masque du Démon et de Opération Peur.
Autre analogie avec l’Italie, le traitement étrange apporté au découpage des séquences elles-mêmes : à première vue, le film est truffé de faux raccords temporels et surtout spatiaux. Attention, il ne s’agit pas ici de traiter Marty d’illettré cinématographique, bien au contraire : c’est l’érudition et l’expérience du bonhomme qui le poussent à utiliser ces entorses à la grammaire filmique élémentaire afin de donner tous les indices nécessaires au spectateur quant à la teneur réelle de ce qu’il regarde, sans appuyer frénétiquement du plat de la main sur le bouton "explique moi-ça". Or si le faux raccord temporel ou le défaut de continuité mineur sont des armes bien connues pour instaurer le doute, ou instiller l’angoisse et l’étrangeté (ici on retrouve le procédé dans les séquences ouvertement oniriques), il est nettement plus rare de retrouver des faux raccords dans le découpage lui-même pour installer le spectateur dans l’idée ténue mais prégnante que ce qu’il voit est une construction bancale qu’il convient de questionner. Ces faux raccords volontaires se font jour dès le quatrième plan sur le bateau, et reviendront de façon apparemment fortuitement dans tout le métrage, à l’exception notable des séquences de prise de conscience (dont on ne dira rien dans ces lignes). Le procédé lorgne-t-il vers le Dario Argento de Suspiria, qui y met en place une topographie complètement incompréhensible pour accentuer la suggestion et l’onirisme ? De la part d’un connaisseur tel que Scorsese, c’est plus que plausible.
Il est au final un peu rageant de voir un tel morceau de mise en scène (c’est peu dire qu’elle est virtuose) mis au service d’une narration pas franchement plus intéressante que le tout-venant du thriller. Il faut se pencher sur le métrage au niveau organique pour en voir l’intérêt, disons, tératologique. En poussant un peu, on pourrait dire que Shutter Island est décadent, au sens civilisationnel du mot : un extrême raffinement des moyens y sert la grossièreté des effets. N’oublions pas néanmoins que les objets les plus malades, donc les plus intéressants, sortent de la décadence et des "fins de siècles".
FL
Vynian – F. du Welz
Quatre ans après le surprenant "Calvaire", Fabrice du Welz et son équipe nous proposent un nouveau film atypique, radical dans ses partis pris aventureux, qui constitue une expérience fascinante. Mais, sans doute victime de son statut à part, il n’échappe pas à des affèteries assez énervantes qui l’éloignent un peu trop d’une excellence pourtant à sa portée.
Thaïlande, 2005. A la vue d’une vidéo tournée en Birmanie, Jeanne Bellmer (Emmanuelle Béart, en roue libre) se persuade que son jeune fils, disparu dans le Tsunami de 2004, est à l’image, de dos, vivant. Son mari Paul (Rufus Sewell, à la fois juste et réactif), sceptique, ne peut cependant que suivre sa femme dans des recherches désespérées sur les traces d’un éventuel rapt. Complètement baladés par les autochtones, puis par le puissant et ambivalent Thaksin Gao (l’étrangement charismatique Petch Osathagrunah), ils s’enfoncent dans la jungle, où les morts et les rêves sont très tangibles… Et en veulent aux vivants.
Du Welz, et c’est ce qui le rend passionnant, est un cinéaste assez paradoxal. N’éludant pas les occurrences les plus déviantes ou excessives de ses thématiques, il fait en même temps preuve d’une grande pudeur (voir la manière dont le fameux "top shot" de Calvaire avait déçu les fans de splater movie et ceux qui voulaient se vautrer dans le Mondo). Intellectualisant énormément son propos, il lui donne cependant toujours une forme très charnelle, que les lumières naturalistes de Benoît Debie appuient de tout le grain explosé que peut donner une pellicule très sollicitée. Enfin, une véritable humilité vis-à-vis de ses récits côtoie une certaine propension à ne pas se prendre pour n’importe qui.
D’emblée ce paradoxe s’impose à la vision de Vinyan : le film se donne comme très envoûtant et fait montre de qualités (trop) rares dans un cinéma dit de genre, produit ou coproduit en France ; cohérence formelle et thématique, imagerie subtile et néanmoins forte, exotisme non feint (à l’instar d’un Kounen parti corps et âme en Amazonie, l’équipe - très réduite - est partie dans un vrai tournage-guerilla dans la jungle thaïe), enjeux humains extrêmement justes (on salue le traitement des personnages de Sonchaï et M. Gao, qui se montrent plus épais que les seconds rôles où on les avait abusivement cantonnés au début du récit, en l’espace d’une séquence où l’on apprend qu’eux aussi ont beaucoup perdu dans le Tsunami). Et pourtant le film agace souvent. Caméra qui tremble et longs plans flous pour montrer qu’on n’est pas n’importe qui, qu’on maîtrise son scope jusqu’aux limites du lisible, montage qui cherche tant les cassures de rythme qu’il plante parfois des plans trop brefs ou trop longs, et toujours selon le schéma "ça tremble dans tous les sens avec de la montée de cacophonie en crissements et infrabasses, et hop un plan fixe sur du silence". On y ajoutera une Emmanuelle Béart presque constamment en mode "Isabelle Adjani dans un Zulawski", criant très fort et roulant de grands yeux égarés, ainsi qu’un ENORME Fabrice du Welz’s en carton de début avant le titre, et on conviendra que se rembrunir est tentant.
Ces affèteries (car ces défauts découlent de l’affectation, c’est pas spontané pour deux sous) font souvent partie du lot des seconds films de cinéastes, dont le particularisme leur a fait accoucher d’un premier film météore. Ici, l’ambition côtoie certaines facilités : chacun semble se passer un ou deux caprices et se laisser aller au pilote automatique. Outre Béart qui applique tout son bréviaire de la prestation d’actrice habitée, du Welz recycle ainsi telles quelles des séquences entières de Calvaire : on aura donc droit à une scène où le héros regarde par un trou dans un mur les pratiques sexuelles particulières des indigènes, à une balade de nuit dans la forêt avec lampe de poche unique et rencontre d’enfants, ainsi que les quelques plans "Bettelheim approved" tels que gros oeil qui roule, traversée de pont, etc, dont il est famillier. Benoît Debie est certes l’un des chefs op’ les plus talentueux de la planète, mais il s’accorde lui aussi deux séquences toutes en rouge comme d’habitude, l’une justifiée (une scène de rêve), l’autre moins (une citation d’Irréversible avec boite de nuit glauque et travesti)… Ce qui est d’autant plus dommage que l’évocation du Tsunami se fait, elle, avec une retenue bienvenue dans le générique de début, imposant d’emblée un malaise et une ambiance à la fois aqueuse et aérienne, à la fois pudique et horrifiante.
Et pourtant la sauce prend, et de quelle manière. On se retrouve complètement ballotté, tantôt émerveillé, tantôt inquiété, soufflé par une traduction très réussie de l’humidité et de la chaleur de la jungle (bien que pas si révolutionnaire qu’on a voulu le dire, puisqu’on pense souvent au troisième acte d’Apocalypse now, mais la nouveauté n’est pas un critère absolu de valeur artistique), et pour peu qu’on soit sensible au sens du grotesque de Du Welz, les diverses incursions dans la fantasmagorie imprimeront des images indélébiles dans l’imaginaire.
Fantasmagorie, et non fantastique au sens strict. En effet, le traitement est d’une grande intelligence dans son refus de baliser le terrain entre surnaturel et naturel, dans sa manière de flouter les limites entre réalité, fantasmes de Jeanne, et vraies incursions fantastiques. Là où Calvaire développait une dialectique de passage du miroir (le pare-brise, les inserts, le plan des nains, les chimères empaillées dans le rade), Vinyan impose une progression plus ouatée dans un monde où les esprits ne sont pas séparés des vivants, comme en témoignent deux séquences capitales, celle des offrandes à l’arbre et surtout celle de la cérémonie des lumières, tradition indonésienne très poétique (la séquence est d’ailleurs très belle), où chacun allume une torche volante pour guider les âmes des morts vers l’au-delà. Un personnage vivant recommande à un autre d’en allumer une… pour lui. Plus tard, les enfants (morts ? Vivants ? Entre deux ?) persécutent des vieillards moins que vivants dans la jungle, et le final (un plan qui va faire couler pas mal d’encre pour cause de téton célèbre, mais qu’on ne divulguera pas ici afin de ne point épuiser le fumet du troisième acte entier), sera au choix la plus vivante des scènes du film, ou l’entrée dans le monde des morts sans espoir de retour. Ou les deux. Ainsi, chaque séquence peut être vue sous l’angle du prosaïque pur ou de l’onirisme, dans une dialectique de cauchemar (parfois trop ostentatoire dans son libellé), sans réel repère temporel ou topographique, où les transitions sont plus symboliques que logiques (le vieux temple du final, qui débouche lui-même sur une caverne presque verticale vers la jungle, la lumière du soleil, et la mort), tendant vers un paroxysme forcément cataclysmique pour le couple de héros.
Et c’est la principale qualité du film qui se fait jour à l’aune de cette rhétorique : ce n’est finalement pas un, mais trois récits superposés, qui nous sont offerts ici. Le premier est une bande fantastique qui séduit par son rythme onirique et sa vision charnelle d’une menace qui ne fait pas irruption dans le monde réel (dialectique occidentale moderniste que l’on retrouve aussi dans le fantastique japonais récent), mais où l’on est obligé de s’enfoncer soi-même. Cet aspect orphique rappelle, dans un autre registre, la veine mythologique empruntée par Stallone dans son récent John Rambo qui partage d’ailleurs certaines péripéties avec Vinyan. Le second film, c’est celui qu’on "pouvait attendre" de Du Welz, où il creuse ses thèmes sur un autre mode que dans Calvaire, mais pas avec moins de force : c’est encore l'histoire du manque effrayant causé par un deuil, d’aveuglement affectif, d’amour inassouvi qui mène, peut-être, à une folie incarnant une damnation ou une rédemption, au danger ainsi qu'à une forme de transcendance perverse. Le troisième récit, c’est celui qui horrifie, qui fascine, et qui remporte, au final, l’adhésion. C’est un film d’horreur pur et simple. Il montre un homme qui se voit forcé de suivre la femme qu’il aime dans son irrationalité grandissante, qui doit pénétrer dans sa folie et s’annihiler dans ses reproches, s’arroger la haine qu’elle nourrit en son sein à côté d’un amour stérile. C’est l’histoire d’une autodestruction par capillarité, où une faute illusoire devra être expiée de la pire des manières, dans la douleur et la trahison. Sewell excelle dans l’exercice (on se rappelle cette dimension christique dévoyée qu’il assumait déjà dans le Dark City d’Alex Proyas, mais dans une optique alors bien plus optimiste), et c’est lui, bien plus que la figure de la mère ici terrible, qui est le vecteur du spectateur dans ce voyage certes imparfait (ses prétentions se voient un peu occultées par celles de son auteur, dont on ne doute pas qu’il redescendra sur terre dans ses prochains exercices), mais assurément envoûtant, beau, empathique et au sens fort, unique.
Il s'agit en tout cas de l’une des propositions cinématographiques les plus passionnantes de cet automne. Mais aussi du point de vue tératologique.
FL
Midnight Meat Train – Ryuhei Kitamura
On l’aura attendu, celui-là. Terminé début 2008, faisant sensation dans tous les festoches depuis, repoussé maintes et maintes fois (on se demande bien pourquoi, peut-être pour pouvoir soutenir HADOPI en se plaignant des téléchargements ?), le film de Ryuhei Kitamura (ouais !) produit par Clive Barker (ouais !) à partir de sa propre nouvelle (ouais, ouais!) arrive enfin en France, juste à point pour égayer un été singulièrement morne au niveau des sorties ciné. L’expectative se voit récompensée puisque l’adaptation trahit suffisamment son matériau de base pour l’améliorer drastiquement en termes de narration et d’imagerie.
Leon Kauffman photographie la ville de nuit, à la recherche de clichés "forts" que sa Brooke Shields de galeriste lui réclame. Il est végétarien, a une petite amie serveuse dans un diner assorti d’un patron/cuistot pittoresque, un ami avec qui il boit du vin et un simili-Leica M. Bref, c’est un citadin d’apparence upper middle class bien tendance et bien gentil qui s’encanaille à peu de frais dans le but de "percer". Un soir, il croise la route de Mahogany, boucher taciturne à la mise impeccable, qui ,accessoirement, massacre les derniers usagers vespéraux du métro avant de les dépecer avec méthode dans un but mystérieux. Leon est bientôt obsédé par l’homme au point d’enquêter sur ses exactions et de devenir lui-même un homme de plus en plus rugueux. Il va jusqu’à le suivre jusque dans le métro où il réalisera que l’histoire de Mahogany est moins locale qu’à première vue…
Bon, on a tous découvert Hellraiser et les Livres de Sang dans notre adolescence, et l’on colore toujours un peu de nostalgie les expériences de cette époque-là. Dans le cas de Barker, cette peinture flatteuse prend la forme d’une subordination du style (souvent gênant par un excessif didactisme, voire un certain maniérisme) à la mythologie effective (foisonnante, novatrice, dérangeante, adulte et intelligente), celui-ci profitant de celle-là. De fait, relire la nouvelle originale, Le train de l’abattoir (merci messieurs d’avoir gardé le titre anglais au fait), après avoir vu le film, montre les bénéfices d’une adaptation assez audacieuse pour ne pas hésiter à reconfigurer les éléments d’une histoire assez ténue et lui faire cracher tout son potentiel.
On pouvait en effet craindre que la collusion de Barker et de Kitamura ne donnât un machin mou couvert d’incongrues boursouflures : le premier, en tous cas celui des débuts, se perdant parfois dans les méandres de son propre ouvrage au point de nous en éjecter (en produisant ce que John D. McDonald nommait des perles, par exemple le monologue intérieur de Mahogany dans la nouvelle, qui ruine toute iconisation). Le second, alternant souvent sa belle virtuosité ostentatoire et des tunnels de dialogue plus pénibles qu’une réunion de syndic d’immeuble (Versus, Azumi ou Gojira Final Wars font souvent montre d’une belle énergie, mais dureraient une bonne demi-heure de moins qu’on ne s’en plaindrait pas). Miracle à l’époque du torture porn triomphant (le film s’est fait en 2007), MMT mise bien plus sur son script que sur le splatter pur et simple. Avant d’être le film de son réalisateur ou de son producteur, c’est avant tout celui de son scénariste, Jeff Buhler. La voix du conteur se met ici au service d’une mythologie pour la déployer au maximum. Là où on n’avait qu’une grosse péripétie voyant l’affrontement de deux personnages principaux aux contours peu définis (ce qui est l’apanage d’une nouvelle "de jeune homme"- il s’agit d’une des premières histoires de Barker), un récit en crescendo, très articulé, se développe désormais. C’est Mahogany qui en est le principal bénéficiaire : complètement mutique, affublé d’étranges lésions cutanées dont on aura l’intelligence de ne rien nous dire, des attributs de sa fonction (énorme attendrisseur à viande chromé et autres outils joviaux, tablier, sacoche de médecin et horaires des trains, et bien entendu sa bague aux armes d’une secte étrange) et d’une posture monolithique en diable (Vinnie Jones décroche un demi-sourire durant tout le film), il acquiert un aura de boogeyman qui irradie bien au-delà des séquences de chasse. Le voir à son travail, dans les rues ou chez lui fait autant froid dans le dos que le guetter dans le métro. Néanmoins, une vraie vie a été insufflée au personnage et on s’y attarde via la description de ses routines ou de faiblesses sporadiques venant peut-être d’une maladie chronique. L’élément fantastique n’a quant à lui pas besoin de s’étendre en interminables money shots pour exister : moins de cinq plans, ainsi qu’une courte explication, suffisent tant l’univers se tient et mène vers la révélation.
Et c’est cette existence en dehors du cadre du film, accordée aux personnages comme aux situations (le métro et sa ligne "spéciale" en tête) qui nous offre un point d’entrée, d’identification, et nous permet de ne pas nous foutre de ce qui se passe pour les uns et pour les autres. Leon est certes falot, mais c’est en tant que personne et non comme entité strictement fonctionnelle (et, bien sûr, pour servir son évolution morale au fil du récit – le dernier plan du film est une tuerie). Même un perso, aussi peu représenté que la galeriste, possède cet aspect vivant, servi juste par deux répliques bien choisies. Le bémol à cela se nomme Maya, la petite amie, qui pour le coup échappe trop peu au mécanicisme, fait gênant, encore accentué par la séquence de type "jeu en point n’ click" où elle visite la suite de Mahogany. Et par le manque de présence assez impressionnant de Leslie Bibb, jolie mais transparente au possible. Un gant de toilette serait plus fascinant que Leslie Bibb ; Emmanuel Mouret serait plus fascinant que Leslie Bibb. Cette faute de goût mise à part, on saura se réjouir de voir une relation de couple un peu réaliste : l’inévitable scène de turgescence en binôme ne ressemble pour une fois pas à un rêve humide de Lorie et insuffle un peu de brutalité dans l’exercice (enfin, rien que du très classique, ce n'est pas non plus un gonzo, et du cul un peu violent, dans une adaptation de Barker, avouez que ça manquerait un peu).
Quelles que soient les qualités et défauts d’un script (on déplorera des ellipses parfois un peu abruptes, notamment concernant la relation Leon/Maya), un film ne peut pas s’y résumer. Surprise ! Kitamura devient sobre ! Laissant de côté beaucoup d’afféteries envahissantes, bien qu’elles ne nuisissent jamais à la lisibilité de ses films (travail amorcé depuis Gojira Final Wars), il développe ici une mise en scène ample et travaille à fond le motif de la réflexion et du miroir d’une manière qui rappelle Spielberg. Tout y passe, miroirs donc, surfaces brillantes, vitres, outils et lames, et même flaque de son propre sang où une victime se verra brièvement. Ce qui pourrait paraître gratuit sert, bien entendu, par la forme, le propos narratif et sémantique, à savoir la relation opposition/analogie entre Leon et Mahogany. S’il est encore à la mode en critique ciné de parler de twist à tort et à travers, le retournement de situation de MMT n’en est pas un, c’est le point de sortie naturel d’un récit qui ne s’achemine que vers lui. Il est ainsi logique que cette conclusion soit "éventée" dès la fin du premier acte. En filigrane, c’est la subjectivité dans le récit de terreur qui est affirmée et prônée par un tel dispositif de mise en scène, comme antidote immersif à la fausse astuce du penchant voyeuriste et de sa pseudo-interpellation du spectateur (dans le torture porn encore, mais aussi dans la palanquée de survivals qu’on se tape depuis cinq ans). Regards caméra, vues subjectives et manipulations de la profondeur de champ sont ainsi légion. Ajoutons à cela un rythme et un découpage qui jouent au chat et à la souris avec la perception du personnage/spectateur de manière totalement opératique (la partie de cache-cache dans les carcasses, l’appartement) pour bien enfoncer le clou d’un réalisateur tout entier voué à son récit.
Kitamura n’oublie tout de même pas ce qui fait le sel de sa mise en scène et se paie des effets de formaliste, dont certains vraiment bluffants qui apportent leur pierre à l’imagerie Barkerienne: un affrontement dans une rame de métro en marche, où est pendue par les pieds une vingtaine de corps, dans les mains de pas mal de monde, ça donne un champ – contrechamp dans un couloir. Kitamura, lui, traverse les parois dans des travellings circulaires qu’il faut voir pour les croire (pleure, Michael Bay, pleure !) ou se permet des plans de coupe très brutaux qui utilisent tous les axes, y compris dans des mouvements verticaux, par exemple, le tout magnifié, par la photo incroyable de Jonathan Sela.
Si tout ça ne convainc pas (en ce cas, grand pardon de la part du rhéteur trop médiocre), il reste un morceau de bravoure qui justifie à lui seul le déplacement, en la personne de Vinnie Jones, qui campe un incroyable Mahogany et porte une bonne partie du métrage sur ses épaules de footballeur. Un boogeyman nouveau est né, en tous cas : si Mahogany est aussi glaçant, c’est surtout grâce à Jones qui ne cède jamais au tongue n cheek et souffle un froid aussi irréfutable que, disons, un coup d’attendrisseur à viande à l’arrière du crâne. Et un bon coup de froid, ça ne se refuse pas en pleine canicule.
Le vilain – Albert Dupontel
Pour sa quatrième réalisation, Albert Dupontel reste dans la veine d’Enfermés Dehors, celle de la comédie cartoonesque/humaniste. Alors bien entendu le film met KO un régiment de petits Nicolas avec une main dans le dos (on n’en doutait pas en même temps), mais on sera en droit de préférer les efforts précédents de Dupontel, qui faisaient moins de concessions à la bienséance.
Le bon Dieu a frappé Maniette d’invincibilité. C’est la faute de son fils, bien plus méchant qu’elle le croit : il est en cavale depuis une vingtaine d’années, ce qui constitue la suite logique d’une carrière dans la délinquance et la vilénie lancée dès son âge tendre. Il se réfugie justement chez elle, traqué par des complices. C’est là qu’elle découvre le pot aux roses et se lance dans une lutte homérique avec son rejeton pour le racheter de ses fautes vis-à-vis des gens du quartier dont il a jadis détruit les vies. Le vilain survivra-t-il à la police, à son médecin, au promoteur véreux qui veut raser le quartier et à la terrible rancune de Pénélope, sa vieille tortue suppliciée ?
Pour ce qui est de ses participations aux films des autres, Dupontel fait penser à Busta Rhymes dans le hip hop : un type avec un talent monstrueux, qui connaît son travail sur le bout des doigts, mais qui fait des featurings avec un peu n’importe qui. En revanche, sur ses projets personnels il a une constance qui fait peu de cas des effets de mode. Quoi qu’il arrive, même en passant le cap du « j’ai quarante berges, j’aimerais faire des films que mes mômes puissent regarder » (ce qui rendait parfois Enfermés Dehors frustrant), l’homme se fend toujours de références à un certain esprit trash des années 80, avec l’aspect "fuck it all" de l’époque où il sortait de la misère en faisant les Sales Histoires avec Vuillermoz. Les meilleurs moments et idées du Vilain sont dans cette veine : antique trafic de neo-codion, arnaque au fauteuil roulant (là c’est carrément toute une sale histoire qui se retrouve dans la séquence), pièges à la Tex Avery, tags gravés sur la tortue et courses-poursuites à la mise en scène joliment dynamique.
Le - petit - bémol, c’est que parmi ces séquences réjouissantes comme une annonce de prison ferme pour Pasqua (les 80’s, le trash, tout ça), on jurerait qu’une partie du métrage a été emballée par une seconde équipe, et que cette seconde équipe officiait avant ça sur des courts-métrages de fin de cursus FEMIS. Il faut quand même faire un petit effort, lors de l’ouverture du film, pour ne pas trop se rembrunir, et attendre l’arrivée de Dupontel à l’écran et à la réa… Tout y est : générique de photos kitsch sur lit de papier peint trop décalé de mémé, lumière qui embaume le studio à vingt lieues à la ronde, plans extérieurs de mouvements d’appareils à la fois ostentatoires et cadrés un peu platement, jusqu’à une voix off assez envahissante qu’on entend heureusement assez peu par la suite (mais qui reste redondante). Entre ça et l’aspect gentillet de certains dialogues ou situations, on se prend de loin en loin à regretter le chat Momo et les « kenavo les bouseux » de jadis.
Attention, cet aspect "sucrerie grolandaise" est nettement moins omniprésent que dans Enfermés Dehors où le discours social, au demeurant de très bon aloi, devenait irritant à force d’être asséné. De plus, l’humanisme affiché du Dupontel cinéaste est sincère et raisonné, là où souvent ce n’est qu’une pose assez snob (le premier qui cite trois chantres du théâtre bien mis ayant fait un peu de beurre sur Canal +, j’y offre un bretzel). Enfin, une comédie française qui n’est ni sinistre, ni lénifiante, ni stupide, c’est un tour de force. Car le film est drôle, très même. Bien écrit (les péripéties sont plus imbriquées et moins gratuites qu’on pourrait le penser à première vue), bien joué (ça fait plaisir de voir Catherine Frot dans un rôle un peu inhabituel, ça change de l’impression de pilotage automatique qu’il lui est déjà arrivé de donner) et peu manichéen (bon, y a quand même du méchant promoteur irrémissible), Le Vilain est absolument réjouissant les quatre cinquièmes du temps, peuplé de conneries magnifiques qu’on se raconte comme des crétins en sortant de la salle (vous allez adorer le médecin et la poubelle à chats) et de personnages que leur auteur aime vraiment. La gentillesse d’unetelle n’est pas con-con, la méchanceté de tel autre n’est pas systématique, et le traitement des uns et des autres échappe à un moralisme de bazar pour faire évoluer l’histoire dans la direction qu’elle réclame, et avec une vraie ambition visuelle la plupart du temps : quand on mentionne Tex Avery, c’est tout à fait justifié, et la direction artistique est d’une rare finesse. Au final, la seule véritable déception vient d’une retenue encore trop manifeste dans la férocité, même si de ce point de vue il y a eu de gros progrès depuis le dernier. Au prochain film, il l’aura trouvé le dosage entre ses élans Amélie-Poulinesques et sa veine "historique" de décapitateur d’oiseaux hirsute. Vivement. Ah, et Bignolas est un con. Envoies-y pas dire, Albert !*
*Voir à ce titre le "clash" lors d’une interview où le passe-plats déclarait fièrement n’avoir pas vu le film dont il était censé parler.
FL
Le locataire – R. Polanski – 1976
Adapté de Topor. C’est-à-dire méfiant envers le genre humain dans son ensemble, et maniant l’absurde, le grotesque et la cruauté ; le Locataire est de très loin le film le plus effrayant de Polanski à ce jour. A revoir pour se souvenir qu’il n’y a pas que les exils suisses et les adaptations de Dickens dans la carrière du monsieur, et qu’un cœur nettement plus noir se cache dans sa filmographie.
Virtuosité et psyché troublée, c’est à la scène comme à la ville ce qui caractérise la vie de Polanski grosso modo jusqu’au milieu des années 80, après que les déboires qui l’ont chassé des Etats-Unis (et referont régulièrement les gorges chaudes de nos organes de presse) l’eurent poussé dans une respectabilité bon teint en Europe. Là, ses statuts combinés de cinéaste "installé" et de paria pour affaire de mœurs lui confèrent un certain confort social et médiatique qui se ressent bientôt sur son cinéma. Les fragrances qui s’élèvent de ses efforts des années 60 et 70 sont autrement plus musquées que celles, au hasard, d’un Lunes de Fiel. C’est au sein de cette période que prend place une trilogie officieuse, aux attaches assez lâches, où le lieu de vie(s) d’un personnage catalyse la folie qui le guette ou l’a déjà conquis. Ce sont dans l’ordre chronologique Répulsion, Rosemary’s Baby et ce Locataire des plus inquiétants. S’il s’agit à chaque fois d’adaptations, force est de constater la constance des obsessions qui en transpirent : environnement oppressant, délire de persécution, montée d’une personnalité seconde (en terme de tradition psychiatrique, on pense beaucoup au Clérambaud de la poussée automatique et du facteur S), étrangeté de plus en plus envahissante et destructrice, vers une désintégration complète, psychique et/ou physique.
Il serait improductif de dresser un portrait du Locataire sans spoiler l’intrigue, car la narration, très explosée, se base sur la répétiotion d'un évènement au début et à la fin du récit. Petit employé effacé, Trelkovski (Polanski lui-même) obtient un minuscule appartement après le suicide de sa locataire précédente, une certaine Simone Choule, employée au Louvre qui a joyeusement traversé la verrière en contrebas de sa croisée. Lorsqu’il visite la moribonde à l’hôpital, celle-ci ne lui lance qu’un long hurlement de terreur. De là, sa vie s’organise dans le microcosme de la résidence, où les mesquineries absurdes succèdent aux absurdités mesquines : pétitions pour l’expulsion d’une voisine, concierge inquisitrice, propriétaire très à cheval sur une moralité pourtant fluctuante, voisins à l’oreille aussi perçante que leur intransigeance est grande… Peu à peu, l’étrangeté le submerge et il assume de plus en plus l’identité de Choule, via la découverte d’effets personnels, de courrier, d’un admirateur secret qu’il devra consoler lui-même, et bientôt d’une dent enchâssée dans un mur. Sa relation naissante avec Stella (dont on se doute qu’elle a pu être amante occasionnelle de Simone) n’arrange rien à un sentiment de persécution de plus en plus prégnant encore accentué par les habitudes bizarres de la maisonnée. Il finit par se travestir pour suivre le même chemin que celle qui l’a précédé : la verrière, puis le lit d’hôpital où il hurlera longuement devant Stella, venue lui rendre visite accompagnée d’un autre lui-même. Générique.
Que Polanski se réserve le rôle de Trelkovski en dit déjà pas mal sur sa démarche : après son début de vie mouvementé, puis un succès qu’il a payé extrêmement cher (le meurtre de son épouse, considéré comme plus ou moins consécutif à Rosemary’s Baby lors d’un cirque médiatique d’une violence assez incroyable), le voilà amené à mettre tous ses outils de subjectivité à l’épreuve, ceux-là mêmes fourbis sur ses deux précédents huis clos psychopathologiques. Autrement dit, que Polanski s’identifie directement à une figure pathétique tirée de Kafka sans même le filtre d’un interprète entre lui et le personnage, rend assez évidente la part cathartique de son implication dans le projet. Néanmoins on arrêtera ici la psychologie de bazar souvent affectionnée dans l’exercice tant le cinéaste donne constamment les preuves d’une maîtrise que ne parasite pas le nombrilisme de l'exercice d'autoanalyse . Pour appuyer cette analyse, on se penchera sur l’usage fait de la caméra, d’abord très factuelle et extérieure puis de plus en plus lyrique pour accompagner le délire du protagoniste : recours à des focales courtes, des plongées/contre-plongées et à des perspectives forcées voire à des trompe-l’oeil, là où auparavant on a beaucoup de plans moyens volontairement anti-iconiques.
Exception essentielle, le plan d’ouverture (qui contient aussi le générique), premier de l’histoire du long métrage français tourné à l’aide d’une louma, et qui glisse sur les façades et fenêtres de la cour intérieure pour mieux présenter cette dernière comme le théâtre du drame. Un autre plan à la louma, renvoyant directement à celui-ci, nous montre l’ensemble des habitants regroupés à même les niveaux et toits de cette même cour transformée en salle de théâtre applaudissant le clou du spectacle constitué par la défenestration de Choule-Trelkovski. Le premier de ces deux plans jumeaux contient déjà la clé du délire de Trelkovski, puisque qu’avant même son arrivée sur les lieux c’est sous ses traits qu’on voit une évocation de Choule à sa fenêtre ; la caméra panote vers la verrière, revient à la vitre et nous voyons désormais Choule à la même place. Apparemment sans coupe (il y a en fait deux ou trois raccord presque invisibles dans la séquence), le pont de vue balaie enfin les parois et fenêtres, et l’on verra encore Trelkovski à cette occasion. L’action démarre réellement à la fin du même plan avec l’arrivée effective de Trelkovski. Qui donc avons-nous vu à la fenêtre ? Assurément pas lui, ni même Simone Choule qui s’est de fait déjà jeté dans le vide au moins plusieurs jours auparavant. La thématique du doppelganger, qui servira pourtant de fil rouge au film, est d’emblée infirmée comme faisant partie de la folie d’un personnage pour lequel la mise en scène n’aura que peu de complaisance. Ainsi si le monde extérieur semble brimer le protagoniste, on nous montrera à plusieurs reprises, à l’aide de simples plans d’insert, que Trelkovski est victime d’hallucinations pures et simples en accolant sa vision d’une situation à celle du point de vue omniscient, lui interdisant de fait le statut de vecteur du spectateur, donc de sujet de l’histoire pour n’en faire qu’un objet du récit. Bref, le jouet de forces qu’il croit externes (la persécution, voire des instances occultes), et sont, en fait, directement issues de lui-même. Par exemple les voisins, qui passent sous les yeux de Trelkovski des heures immobiles dans les toilettes de pallier, semblent en stase à ces occasions, attendant explicitement (du point de vue du metteur en scène) à être investis d’une fonction dans sa construction délirante : il ne les voit à ce titre dans les toilettes qu’après les avoir rencontrés dans des circonstances plus quotidiennes, et fabrique ainsi son drame au fur et à mesure, tricotant sans patron préalable.
C’est pourquoi il convient mieux de parler de délire de persécution que de paranoïa, le délire de type paranoïde se caractérisant par une organisation logique qui fait défaut à Trelkovski et aux évènements tels qu’ils nous sont présentés, avec des prises d‘air que le script offre à une possible vision fantastique du récit . Si ledit récit démarque très nettement Kafka, c’est pour mieux en explorer les ramifications mentales et les lancer, littéralement, à la face du spectateur apparemment en vrac, ou du moins en bloc. Ainsi la mise en scène paraît faussement feutrée, mais s’avère en fait extrêmement agressive envers son héros et le spectateur d’un point de vue sensoriel : contrastes forts de luminosité entre les premiers et seconds plans, péripéties ramenant au corps avec absurdité (la dent dans le mur, le maquillage, la séance de pelotage devant un écran de cinéma qui nous montre Bruce Lee démastiquant plusieurs adversaires), emphase des dialogues (ceux de Bernard Fresson ou Romain Bouteille).
Il faut cependant rendre à César ce que Brutus met, certes avec brio, en valeur avec sa maestria propre. Le film en l’état est très marqué par Polanski et ses préoccupations, en effet, mais son cœur réel, son centre de gravité, et son aspect très français, c’est de la personnalité de son auteur "originel" qu’il vient, Roland Topor. Attention, pas le Topor blanchi, revu et lénifié post-mortem par son très influent ancien ami capable de sommets de subversions tels que Musée Haut Musée Bas. Non, le Topor horrible et méchant des années 60 et 70 où point déjà l’auteur complètement autre de Marquis (H. Xonneux, 1989) ou d’un Dom Juan dont le rôle-titre est hermaphrodite. LE Topor de publications comme la Vérité sur Max Lampin, horrible fascicule qui culbute la bienséance avec des olisbos surdimensionnés (et de préférence cloutés). Bref, tout sauf Palace.
L’influence du malhomme se retrouve à l’évidence dans la direction artistique (une poignée d’affiches à la fois amusantes et vaguement inquiétantes, comme ces publicités pour la peinture Lure, le décor final, l’agencement de l’appartement, les petites ailes faustienne d'un pardessus...) et certaines options de casting, avec des Rufus, des Claude Pieplu, ou encore un Romain Bouteille qui amène dans ses bagages ses protégés du Splendid de l’époque (qui bouffent encore de la vache enragée, puisque pas encore auréolés du succès de leur Bronzés… Trois ans plus tard, les mêmes n'auraient peut-être pas joué dans un aussi petit projet. Ils ont d'ailleurs laissé tombé Romain Bouteille, qui leur met ici le pied à l'étrier, dès leurs premiers gros succès publics, comme l'avait fait Coluche quelques années avant eux. Bouteille ne s'en est jamais vraiment relevé. On voit bien ce que ça dit du passage des années 70 aux années 80 : l'utilisation cynique des moyens et idéaux communautaires d’une décennie pour acceder à l'ego-trip et à l'accaparement qui caractérise la seconde. Ou quand la réalité confirme la misanthropie de la fiction.) pour jouer une belle galerie de lie de l’humanité (la lie de l'humanité, ici, c'est la quasi-totalité de l'humanité). La cruauté du final porte aussi la marque de son auteur, quand Trelkovski se jette à travers la verrière et rampe jusqu’à son appartement pour se défenestrer à nouveau. Tout le motif de la momie également, et l’analogie avec Choule couverte de bandages. Et plus généralement cet iconoclasme où se mélangent mépris des atavismes et de la maréchaussée, goût pour la scatologie et le scabreux, méchanceté gratuite (la tournée générale « sauf pour ce gars-là ») et ambiguïté sexuelle maladive. C’est ce qui fait, aussi, une bonne part du prix de ce film, à la fois horreur viscérale de l’esprit d’un cinéaste encore capable d’inouï, et faisant partie de la parenthèse enchantée d’une certaine culture française des années 70, celle des Yanne, Boisset, Jessua, et parmi eux Topor, dont on n’a pas revu la liberté depuis trop d’années d’endogamie forcenée, tant au niveau des têtes que des formes.
1- Trelkovski a été renversé par la voiture d’un couple. En pleine crise d’hystérie, il croit y voir son propriétaire tentant de le tuer, et doit être sédaté. Le couple le ramène chez lui, inconscient, en voiture. Cependant il a été préalablement établi (lors d’une séquence absurde au commissariat) que sa nouvelle adresse ne figure pas sur ses papiers. Comment alors ces parfaits inconnus savent-ils où le déposer ?
FL
Heathers – M. Lehmann - 1989
Indispensable à la culture générale. Méconnu de par chez nous, Heathers est un film plus important qu’il n’y paraît en termes de postérité. A la fois misanthrope et humaniste, féroce et intelligent, c’est le film qui créé le genre du teen movie tel qu’on le connaît tout en le rendant obsolète.
Au sens où on l’entend dans ce beau royaume de l’ici et maintenant dont on tente de nous faire croire qu’il est notre monde, la "Jeunesse" est une création de l’occident victorieux de l’après-seconde guerre mondiale. Finissons d’enfoncer cette porte ouverte : de même que le concept récent "d’Enfance" est né d’une chute relative de la mortalité infantile après l’ère napoléonienne, ainsi que de grands bourgeois et "enfants du siècle" portés sur l’innocence rousseauiste, la jeunesse est entre autres née de l’euphorie économique et nataliste du XXème siècle. Toute cette nouvelle population, qu’aucune vidange belligérante de grande envergure n’est venue réguler, s’est bientôt mise à constituer un gigantesque marché dont il convenait de flatter les successifs penchants moutonniers (conduire pour aller en surboum, lever le poing contre Papa, copuler apparemment sans contrainte - extérieure ou explicite en tous cas, s’enthousiasmer pour tous les avatars de la société des loisirs à l’aune unique de leur nouveauté proclamée…).
Bref. Avec le teen est apparu le teen movie, qui a pris diverses formes au fil des ans et des modes, du film de biker à la bluette disco, du slasher eighties à la grosse comédie de spring break, la tendance semblant être désormais dominée par une composante de comédie. Si le motif des jeunes gens fut bien entendu utilisé auparavant (vous avez vu Horse Feathers ?), ce n’est pour ainsi dire qu’en tant qu’imagerie ou toile de fond. La chronique adolescente au sens propre s’intéresse à la jeunesse non comme motif mais comme moteur thématique. Il est donc logique que celle-ci prenne des formes diverses, par exemple dans l’entertainment américain où l’on trouvera autant de la grosse machinerie que du ressortissant de Sundance(1).
Nous allons nous intéresser ici à un titre qui signe une certaine maturité à cette chronique de la jeunesse et dont on pourrait voir un prolongement lointain dans la série animée Daria. Heathers (Fatal Games en français, sur un anémique DVD zone 2 à repousser dédaigneusement du pied au profit de l’import) traite pour la première fois frontalement des années lycée en tant que pire période de la vie d’un être humain. Déjà enkystée dans sa sociabilité à la surcodification décadente, basée sur les critères socio-économiques des adultes, mais encore engluée dans une barbarie compétitive de cour de récré basée sur la loi du plus fort (ou du plus beau, du plus sportif, du plus actif sexuellement, etc.), la high school américaine est un microcosme de la société qui la contient. C’est d’ailleurs ce que déclare J.D. lors d’un climax qui préfigure (avec le roman Rage de Stephen King sous le pseudo de Bachmann) le défilé de massacres scolaires qui allait égayer les campus d’Amérique et d’Europe dès les années 90 (et assurer des seconds souffles à certaines carrières d’opportunistes médiatiques, n’est-ce pas Gus ?).
La trame est étonnamment complexe en regard de son argument de base : Veronica, malgré son intelligence et donc sa répulsion, s’acoquine avec les trois Heather, filles les plus populaires du lycée qui règnent du haut de leur proto-sororité. Cette suprématie se perpétue par l’écrasement décomplexé des petits, des laids et des non-sportifs, et au bénéfice des plus écrasants frat-boys (footballeurs amateurs de brimades, étudiants-phallus sur pattes). Elle tombe bientôt amoureuse du nouvel arrivant, J.D., agent provocateur fils de démolisseur et porté sur une ironie poussée jusqu’à l’anarchie. Ensemble, ils tuent "accidentellement" la plus puissante des Heather et maquillent l’évènement en suicide. C’est ainsi qu’un grand mouvement populaire autour du suicide, avec morceau de musique MTV et grands élans d’hystérie collective comme en fabriquaient si bien les années 80 (Que celui qui n’a pas un vieux badge « Touche pas à mon pote » dans un tiroir jette la première pierre au rhéteur !). Pendant ce temps, leurs exactions continuent jusqu’à ce que prise de remords, Veronica se retourne contre J.D. qui veut, de son côté, pousser le phénomène jusqu’à l’éradication du lycée entier lors d’un rassemblement anti-suicide.
Thématiquement, Heathers est d’une profondeur et d’une richesse surprenantes, mais aussi d’une agressivité jamais démentie et assez revigorante. La faute à Daniel Waters, peu prolixe mais intéressant à cette période (à son actif, les iconoclastes Ford Fairlane et Batman Returns, et les injustement méprisés Hudson Hawk et Demolition Man), qui plaisante en avouant qu’il destinait son script à Kubrick lui-même pour en faire le "teen movie ultime". Finalement tempéré par le très gentil Lehmann, le film est moins nihiliste et véhément qu’il aurait pu l’être sans cette tempérance, et l’on sent bien l’opposition des personalité qui a présidé à la genèse du film dans la caractérisation et les prises de positions de Veronica (Wynona Ryder à l’époque abonnée à ce type de rôle) et J.D. (Christian Slater, pas encore abîmé). Lehmann, par ailleurs très lénifiant, humanise ici régulièrement un récit dont la satire aurait pu verser dans la noirceur. Cette férocité se retrouve intacte à des moments ponctuels du récit : dans un mouvement de mortification, Veronica se brûle la main à l’aide d’un allume-cigare de voiture. Le premier réflexe de son amant est d’allumer sa cigarette sur la plaie encore fumante (cette saillie se retrouve dans le final à une puissance démultipliée). Ce dernier fait une entrée très remarquée dans le lycée, avec des balles à blanc certes, mais mises dans une vraie arme à feu.
Les quelques meurtres, toujours contextualisés culturellement (la bouteille d’eau minérale révélatrice d’homosexualité pour son détenteur !), participent du même mouvement, tandis que les dialogues sont bien souvent des bijoux de verve ironique. Maniant savamment la caricature (les dialogues répétitifs avec les parents, au découpage identique), constamment à la lisière de l’outrance (les oraisons funèbres, le père de J.D., les conseils de professeurs, les séquences oniriques), le film de Lehmann n’hésite pas à verser ouvertement dans le décalage et ne prétend jamais au vérisme. Bien entendu, c’est en maniant la fable que le récit est le plus juste et épingle les plus belles vérités. Ainsi, l’inversion des rôles entre J.D. et son père (ils s’appellent respectivement Papa et Fiston) intervient 15 ans avant les palanquées ce "reportages de société" sur les dérives d’une culture de parents-copains qui s’évertuent à ne pas comprendre Dolto. De même, l’imaginaire amoureux strictement oro-génital de la jeunesse américaine est dépeint sans grande complaisance mais sans éluder la question. En règle générale, l’apathie, en tant que vertu cardinale de cet univers, est placée en exergue des actions de nos héros, notamment lors d’un réveil de la mère de Veronica qui sort le couplet, au demeurant pas idiot, sur le fait que lorsqu’un ado demande à être traité "comme un être humain", c’est généralement qu’il l’est déjà, c’est-à-dire mal. La direction artistique relaie constamment cette caractérisation de l’univers dépeint, tant dans les détails du décor (un billet d’un dollar au centre d’un cœur dans le casier d’Heather) que les vêtures (Le nœud rouge du pouvoir chez les populaires, l’obèse Martha qui tente de se suicider dans un t-shirt à l’effigie du groupe Big Fun…) ou certaines situations qui constituent des microcosmes dans le microcosme, comme le jeu de croquet ou les discussions avec les adultes.
A la misanthropie stricte, Heathers préfère cependant la proposition d’alternatives. Ainsi, les personnages et situations, archétypaux, n’en sont pas autant des caricatures et ne manient pas le cliché comme figure tutélaire ou unique. Ce qu’on peut voir précisément comme un humanisme, opposé au taylorisme thématique qui sera bien vite l’apanage du teen movie routinier (un personnage loser, un drôle, un crasseux, une jeune fille pure, une déluré en fait malheureuse, un vieux coincé, etc, ad nauseam). Si l’on rit lors d’un enterrement, un plan sur une gamine éplorée ramène brutalement à la dimension humaine de l’évènement. Contre un J.D. insensible ? Pas réellement, puisque ses actions sont conditionnées par un trauma particulier qui entre directement en résonance avec ses exactions (c’est d’ailleurs la partie la plus faible du film). L’effet pervers même des suicides maquillés, à savoir qu’ils confèrent artificiellement de la personnalité à des infâmes qui n’en avaient pas, est une marque d’espoir ; d’espoir sombre vu par le prisme de l’humour noir. Quant au triumvirat de Heathers elles-mêmes, elles ne se ressemblent pas : si la première, seule à être physiquement châtiée, est réellement une petite pustule bien née, arriviste et dominante, bien parée pour une vie corporate ou devenir une desperate housewife, la seconde est finalement une pauvre fille, suiviste mais pas méchante, et la dernière s’avère pire que la défunte lorsqu’elle goûte au pouvoir. Potentiellement plus dangereuse aussi, même si la prise de pouvoir finale de Veronica permet de rééquilibrer un peu les forces et de finir sur une note d’humanité en offrant enfin une réplique à la paria Martha.
On peut néanmoins voir dans ces vœux pieux le plus gros pied-de-nez de Waters, tant le modèle dominant reste, au final, obligatoire (Heathers est une fable, pas une affabulation), et la rébellion au mieux présentée comme vaine, et au pire, délétère. En ce sens, ce film tend à créer et enterrer le genre du teen movie moderne dans le même mouvement, puisqu’il met en lumière la vanité des images d’Epinal bientôt véhiculées par les interchangeables American Pie du box office, avec passages à l’âge adulte et prise de confiance en veux-tu en voilà (vous y croyez vraiment, vous, au gentil binoclard qui perd ses lunettes et gagne une paire de cojones par la même occasion, qu’il va s’empresser d’aller tester sur la super bonnasse devenue soudain consentante ?). L’espoir d’un changement ? Un rêve de midinette. Tout au plus, un acte héroïque passera inaperçu (Veronica sauve l’école entière) et l’on ne pourra changer les choses qu’à la marge. Le final passe ainsi pour une assimilation quasi physique de J.D. par Veronica après une castration symbolique (le majeur tendu de J.D. dans un geste de défi, est soufflé par une balle. Rappelons que les deux antagonistes sont présentés comme seuls personnages adultes et agissants du récit par le prisme de leur sexualité - ils sont les seuls à pleinement consommer une union charnelle). Ayant neutralisé puis assimilé les caractères les plus affirmés de son ancien amant (un peu à la manière d’un vaccin), elle peut les utiliser non pas pour se faire bien voir du pouvoir en place comme elle le faisait auparavant, mais pour devenir ce pouvoir et en user. La phrase de Jello Biaffra, "Don’t hate the media, become the media", l’une des antiennes les plus importantes de la décennie, vient bien entendu à l’esprit. On lui préfèrera, à la rigueur, la sentence de la poétesse May Sarton : "One must think like a hero to behave like a merely decent human being"(2). Tout dépend du choix de point de vue qu’on envisage : Lehmann ou Waters. Gentillet ou énervé.
FL
(2)Littéralement « Ne détestez pas le media, devenez le media. » et « Il faut penser en héros pour pouvoir se comporter comme un être humain à peu près acceptable »
LA HORDE – Y. Dahan / B. Rocher
Dernier arrivé en date dans le genre français et le film de zombies, c’est-à-dire un domaine pas assez peuplé et un dont on a fait une indigestion, un film qu’on attendait avec pas mal de curiosité suit cette trajectoire duelle et cause autant d’irritation que de plaisir immédiat, ou inversement.
Une bande de policiers part de sa propre initiative en expédition punitive/opération de sauvetage d’indic dans le fief de criminels endurcis, à savoir une tour presque vide dans une crasse banlieue lépreuse. Le carnage qui suit laisse la poignée de survivants des deux camps face à plus grand péril : les morts se réveillent justement dans tous le pays et ont manifestement faim. Il va falloir s’entraider pour fuir de la tour afin de rallier un hypothétique refuge de l’armée.
Voilà un pitch qui semblerait né des amours de Requiem et Nid de Guêpes, le tout avec la structure de From Dusk till Dawn : un film de commando en lieu clos doublé d’une tarantinade de bon aloi qui adjoint au polar hardcore un fantastique décomplexé. Une chose est sure, cet aspect ne se dément pas à la vision du film, tant dans ses qualités que dans ses défauts d’ailleurs. Généreux en action et en effets, gouailleur et visant avant tout l’iconisation de ses situations et personnages (Aurélien Recoing et Eriq Ebouaney sont à ce titre impressionnants – pour une fois c’est pas Jo Prestia le type qui fait le plus peur dans le cast !), La Horde paie malheureusement ce dynamisme par une caractérisation à la serpe, des dialogues à la fois trop écrits pour être vraiment efficaces et pas assez fouillés pour dépasser le statut de one-liners, ainsi qu’un découpage qui s’emmêle un peu les pinceaux par moments (un combat au couteau assez illisible par exemple, ou un montage parallèle généralisé peu utile surtout dans le dernier acte). On passera un contexte socio-politique à peine effleuré (hélas, car on sent que les loustics pouvaient faire preuve d’un peu plus de finesse d’analyse que leurs prédécesseurs – Frontières et A l’Intérieur surtout – via l’habitante déjà zombifiée alors qu’elle est encore vivante par exemple) et des évènements parfois absurdes (pourquoi ce sacrifice final n’ayant d’autre utilité que de donner un joli massacre à la machette ? Pourquoi les zombies envahissent puis vident les lieux alternativement sans aucune logique ?) pour jouir pleinement d’un cast solide, mis à part deux persos masculin un peu falots en regard de l’intensité de jeu, parfois désordonnée il est vrai, d’une Claude Perron joliment aride et d’un Eriq Ebouaney étonnamment énervé ("Je suis un nigérien, moi ! Un putain de nigérien !").
Le gros soucis vient finalement de références foisonnantes mais pas toutes digérées, notamment dans le domaine du jeu vidéo : pour un très beau fight entre Perron et une zomblarde qui prend la forme d’un combo de God of War (avec ralentit au coup de grâce !), ou l’arrivée très Resident Evil 4 de René (Yves Pignot, hilarant jusqu’à un point de rupture où son personnage finit par devenir pénible), il va falloir se fader une progression scénaristique qui reprend malgré elle le principe de checkpoint dans les jeux sur consoles : une fois un objet trouvé ou un endroit précis traversé, une cutscene fait avancer le scénario de manière utilitaire et artificielle. Ce sera ici une explosion, un mort revenant à la vie pile au moment où on abat un personnage principal, la télévision qui décide de fonctionner enfin au moment le plus opportun pour faire avancer le schmilblick, ou encore la façade vitrée qui résiste vaillamment au flot de morts-vivants jusqu’au passage par l’armurerie pour céder d’un coup au retour de ladite… Dommage, surtout quand de telles références sont traitées chez d’autres avec une maestria incontestable, ce qui prouve que c’est possible (les films de Neveldine et Taylor, l’incroyable Crank 2 en tête). On déplorera enfin quelques promesses non tenues (pourquoi pas plus de Recoing ?) et un feeling général de récit à la fois trop et pas assez écrit.
Attention cependant : il sera pardonné beaucoup (enfin, selon l’humeur du moment ou le degré d’ouverture d’esprit du spectateur) à Dahan et Rocher qui ne pèchent que par excès de générosité. C’est parce que le film avance bille en tête qu’il se prend régulièrement les pieds dans le tapis. Ses défauts sont même dans une certaine mesure ce qui le rend attachant, d’autant que c’est quasiment le premier film de genre français depuis Baby Blood à ne pas jouer la carte du sérieux à tout crin et à miser sur l’aspect film du samedi soir (on passera sur Sheitan qui semblait n’être qu’à l’usage des potes des réals). Sur ce point, la promesse tend à être tenue, certes à la manière d’un type qui vous fait des cookies et réussit à mettre le feu à la cuisine et à se couper un bras dans le processus, et même si trop de badass tue parfois le badass. Foutraque, brouillon, mais Ô combien plaisant. Allez, on attend les prochaines aventures de nos duettistes en espérant que plus de subtilité y servira un propos qui reste humble et sympathique. Vous avez quand même réussit là où pas mal de vos camarades se sont cassé les dents, les mecs.
FL
Freddy les griffes de la nuit – Samuel Bayer
La mode des remakes a encore frappé. Hosana in excelsis Deo. Calibré pour les incultes, les moins de 15 ans ou de 85 de Q.I. et les fans de revival 80’s abâtardi type Lady Gaga, c’est au tour du grand brûlé de Wes Craven de devenir la dernière victime des injections de flotte en intramusculaire. On en regretterait presque le Bal de l’Horreur tiens.
Spoiler : la faconde de ce papier sera à la hauteur de la purge de l’année que représente ce film, dont la facture est d’un cynisme à faire froid dans le dos. Autrement dit, l’on y sera aussi énervé qu’à la sortie de projo. Mille excuses.
Une poignée de jeunes têtes à claques s’empêchent de dormir car dans leurs rêves un méchant monsieur tout moche avec des lames aux doigts s’amuse à les y tuer, ce qui n’est pas très pratique pour vivre de petites détresses existentielles vibrantes d’indigence dans le monde de l’éveil (de "Avec Maman on s’est disputé" à "Avec mon ex on s’est disputé" en passant par "Avec le psy de l’école on s’est disputé"). Bigre ! Voilà-t-il pas que le méchant monsieur vengeur était un pédophile qui les avait tous tripotés dans leur enfance (depuis opportunément refoulée) avant de subir l’ire meurtrière des parents bien mis et notables (dont Clancy Brown qu’on voit à peine) qui l’ont incinéré sans anesthésie préalable ni formule de politesse. Nancy survivra-t-elle ? Pourquoi son petit ami est-il si prodigieusement laid ? Le châtiment de Freddy Krueger sera-t-il complet ? Utilisera-t-il un antirouille ininflammable pour ses griffes ?
« Non mais sans déconner » est la phrase qui vient le plus souvent à l’esprit à la vision du métrage. Absolument tout le catalogue des fautes de goût et foulages au pied est balancé en vrac sur une mythologie qui méritait bien mieux, te le cumshot d’un gonzo rital degueulasse. Même si le contenu du seau promet d’être pour le moins indigeste, trayons cet animal étique voulez-vous ?
Il y a deux bonnes idées dans le film. C’est peu. L’une est anecdotique et l’autre thématique, mais toutes deux sont inexploitées. C’est décidément peu. Dans l’anecdotique, on saluera cette notion de Freddy qui, au cœur de sa dimension parallèle, se sert du fait que le cerveau humain reste en activité sept minutes après la mort clinique pour torturer encore un peu l’une de ses victimes. On aurait ainsi pu ouvrir sur l’idée d’un purgatoire cauchemardesque où le croque-mitaines aurait régné, dans une optique proche des cénobites de Barker. Las ! Ce sera juste une réplique parmi les semi-vannes dispensables du personnage.
La seconde bonne idée, celle de faire de Krueger un véritable pédophile, aurait pu faire mouche (rappelons que c’était déjà l’intention de Craven à l’époque de l’original et que la New Line avait alors freiné des quatre fers). Freddy pouvait y acquérir un vrai statut de loup de conte de fées, et surtout, les ex-enfants n’étaient plus un simple moyen de rétorsion dans sa vengeance, mais les acteurs du drame puisque leurs témoignages avaient mené le jardinier à sa perte. De plus, on se trouvait dans un schéma de vengeance contre vengeance, et le rôle des parents devenait plus ambigu, notamment dans leur entreprise de refoulement des souvenirs de petite enfance chez leurs gamins, aboutissant sur une broderie autour du thème du viol (physique, psychique, spirituel voire historique ou sociétal). Bien entendu, rien de tout cela ne sera même esquissé, et le spectateur désoeuvré n’aura que ses propres conjectures pour tromper l’ennui de la séance. On se saura d’ailleurs jamais par quels moyens les parents ont occulté les souvenirs de leur progéniture, ni la manière dont le jardin d’enfants a fermé, et encore moins comment tout ce petit monde a pu reprendre ses activités normales après les faits… A part ça, rien que de très balisé sur les conséquence de la déprivation de sommeil, avec des infos déjà données dans l'original. R.A.S.
Placés devant l’opportunité de touiller la pâte mythique qui fait de Freddy Krueger une figure multidimensionnelle et même fascinante, pour en tirer des pépites thématiques intéressantes, les margoulins aux commandes ont préféré faire une heure et demie de remplissage ronge-tête et confier le tout à un clippeur yes-man pour tenter de brouiller les pistes sous trois effets de lentille. Les péripéties se superposent sans suite réelle au sein d’un script dont personne, de toutes façons, n’a envie de boucher les voies d’eau (au hasard, pourquoi en premier lieu les parents amenaient leurs mômes dans un jardin d’enfant distant d’une bonne trentaine de kilomètres ? En quinze ans, pas un SDF n’est venu s’installer dans les locaux désaffectés ? Par quelle magie Freddy se paie-t-il un mirror-scare à la fin? Ça manquait ?). On a donc une bande de jeunes horripilants des beaux quartiers, les sourcils en accents circonflexes et arborant des fringues de créateurs dignes des pires boîtes de nuit des Champs (l’une des protagonistes porte des Ugg jusque dans ses propres rêves !) qui surfent sur Internet, refont Beverly Hills 90210 entre deux prises de caféine et montent dans la voiture de Papa quand Papa le demande. Bien sages, bien lisses et bien plats. Comme disait Otto, mauvaise viande. Au milieu de ça, on a Haley qui cherche à camper un personnage quand on le laisse faire, c’est-à-dire dans les deux flashes-back qui le montrent avant sa canonisation artisanale (un comble). En tant que Freddy, il place une idée de caractérisation (un tic avec ses griffes) mais ne peut rien contre un découpage qui l’émascule systématiquement et une direction d’acteurs qui lui réclame une voix rauque "comme quand tu faisais Rorschach, là, tu sais".
Le métrage, dans son aspect horrifique, se résume en fait à un festival de jump-scares où toute évocation (et par là toute menace tant soit peu palpable) est annihilée au profit du sursaut immédiat. Lesdits surgissements intempestifs sont d’ailleurs tous prévisibles une bonne minute avant leur survenue et sont, de fait, nuls et non avenus. Lorsque ce sont des exactions de l’original qui sont reprises, c’est sans aucun souffle et dans un découpage qui les minimise, quand il ne les nie pas carrément. Exemple : le meurtre d’un personnage, traîné au plafond en se vidant de son sang. Dans le film de Craven, l’effet de pièce rotative était discret et efficace, le supplice prégnant. Ici, c’est carrément l’occasion de balancer la pauvre fille tête la première dans les murs et le plafond ! On se croirait dans un film des Z-A-Z ou des frères Wayans. La mythologie du griffu est d’ailleurs méprisée dès l’ouverture, quand le premier insomniaque se tranche lui-même la gorge au terme de sa lutte avec notre Fredo. De là à traiter le rôle-titre d’hallucination, il n’y a qu’un pas qu’il serait déjà malaisé de rebrousser avec de la bonne volonté, alors là, vous imaginez. Non, ne nous y risquons pas et démarquons des motifs des succès des 15 dernières années comme le premier Kevin Wiliamson venu (un protégé de Craven d’ailleurs) : le maquillage de Freddy, par ailleurs réussi, évoque furieusement le Mason Verger de Hannibal, la lame d’un massicot sert d’arme comme dans The Faculty, un blogueur se fracasse sur sa webcam comme dans les spots télé de Paranormal Activity, quand la direction artistique ne démarque pas carrément les derniers remakes en date (dont Fog !) ou les clips de Marylin Manson, Garbage ou Cranberries, « ça tombe bien, on a le réa de tous ces clips sous la main dis donc ! » Il est d’ailleurs presque amusant de voir l’imagerie onirique de l’original reprise telle quelle (trente ans après, l’étrangeté s’est éventée bien entendu, puisqu’on nous l’a déjà servie au moment où elle était fraîche), chance que n’aura pas le thème musical qui reste lettre morte. Au final ce remake totalement je-m’en-foutiste rappelle, à plusieurs reprise, Cut, un calamiteux semi-slasher australien de la vague post-Scream, dont le tueur fantôme mourrait lui-aussi dans l’incendie de ses effets personnels. Et Freddy là-dedans ? Il a déjà de la chance d’être à l’affiche. Une bien belle production Platinum Dunes, en somme.
N’y allez pas. Sauf pour en faire un screener. Non mais.
FL
Getting Any ? Beat Takeshi
Alors bon, on ne va pas essayer de vous faire croire que Getting any ? est le chef-d’œuvre méconnu du japonais taciturne, à ranger d’emblée entre Hana-bi et Sonatine. Non, c’est un film de tâcheron qui ne cherche pas à contribuer à un quelconque grand-oeuvre, une grosse pochade seulement symptomatique de son époque, et qui permet de remettre un peu en perspective, par le petit bout de la lorgnette, certaines obsessions esthétiques que l’on retrouve dans ses autres films. C’est moche, c’est bête, c’est pas respectable pour deux sous, et c’est ça qu’est bien.
Asao veut baiser. Problème : Asao n’est pas très séduisant et surtout, Asao est un crétin. Pour arriver à ses fins, il imagine donc des stratagèmes : avoir une voiture, avoir de l’argent, être acteur, voyager en avion pour se taper une hôtesse, être un acteur riche dans un avion pour se taper une hôtesse, etc. Mais comme c’est un crétin, il va s’en prendre plein la poire et jouer de malchance sur le mode de la catastrophe exponentielle. Quel enchaînement d’événements le mènera donc à se faire écraser par une tapette géante sur un énorme tas de merde ? Suspense !
Il est amusant de jeter un œil aux résumés de Getting any ? qu’on trouve en France. Petite citation du quatrième de couverture du DVD, reproduit sur un site marchand : « Un jeune homme naïf et influençable, attirant les catastrophes, est prêt à tout pour arriver à ses fins : s'envoyer en l'air. Tout à tour loser, acteur, yakusa, il finit par être le sujet d'une expérience scientifique improbable (devenir invisible) mais se retrouvera transformé en homme-mouche... » Mes Dieux, que tout ceci est policé ! Sur des sites anglo-saxons, on trouve carrément des descriptions de la satire sociétale tétanisante que représenterait le film… Le statut d’auteur (mettez autant de majuscules que vous voudrez à auteur) de Kitano dans les pays occidentaux nous pousse trop souvent à oublier qu’avant les personnages dépressifs, l’accident de moto et les marionnettes automnales, Kitano était surtout Beat Takeshi, amuseur public télévisuel équivalant aux plus crétinoïdes de nos Lagaf’(1). Ce film violemment con émane, on l’aura compris, de la face Beat Takeshi du personnage.
Et ce n’est clairement pas du côté des têtes de pont de la Nouvelle Vague qu’il faudra aller lorgner pour trouver des références érudites et des figures tutélaires dont se réclamera, plus tard, le cinéaste. Le film le plus proche de celui de Kitano, en fait, semble être La cité de la peur de nos Nuls nationaux sorti peu ou prou à la même période. Ici, le comique est basé sur l’instant gag, le scatologique, le slapstick, la mise en œuvre de références de la culture pop, les situations improbables et la dégradation de personnages savamment caricaturaux. La structure en sketches successifs fait penser au Kentucky Fried movie de John Landis et des Z-A-Z (autre référence profonde de Chabat et Farrugia à l’époque), et certains gags sont même interchangeables chez Kitano et les Nuls : à ce titre, le premier gag de Getting any ? (un type se trompe de banc-titre et se fait engueuler hors-champ) fait directement écho à la scène « bruitée à la bouche » de La cité de la peur, tandis que le final à base de Kaiju rappelle étrangement une fausse bande-annonce de l’époque Canal + à la gloire de T-Rexona !
Venu beaucoup plus de la télé que du cinéma, Getting any ? défie, dans une certaine mesure, l’analyse filmique. C’est une suite de saynètes parodiques, brocardant pour certaines les codes de genres ou sous-genres donnés, voire carrément de figures populaires : Asao réussit à devenir acteur et à jouer Zatoïchi, le Masseur Aveugle mythique du chambara qu’incarnera quelques années plus tard (et avec quelques accents comiques) le même Kitano. D’emblée, l’ensemble des gags tournera autour de la cécité, le sommet étant atteint avec le combat à coups de louche à purin qu’Asao aura méprise pour sa canne-katana. Plus tard, c’est encore le caca qui sauve le Japon dans un décalque de Rodan, et l’Asao-mouche expirera en lâchant, majestueux, le cri ancestral du crétin qu’il est : « Car sex ! ». Mais que les hagiographes conventionnels se rassurent, la majeure partie des élans parodiques tient sur les films de yakuzas et l’on sera en terrain connu pour causer Kitano dans les cocktails : ainsi sont brocardés les poses interminables, codes d’honneur abscons, performances virtuoses des tueurs à gages (un simili-ronin capable de trancher un atome en deux !) et gerbes de sang subséquentes, ainsi que la déférence au chef, ici performer travesti à ses moments perdus. L’aspect furieux, méchant et ouvertement misanthrope (le héros vend sont grand-père en kit pour s’acheter un pussy-wagon quand même, chez un concessionnaire qui passe son temps à flanquer des tartes aux gamins), est cependant moins à mettre au compte d’un quelconque hommage à Tex Avery qu’à celui du désenchantement précoce de son auteur. Ici on se paie la tête des enfants, des otakus, des vieux, des travestis, des handicapés, des chefs d’entreprises en faillite (le show du pilote de Cessna, mambo, qui fait quand même très très mal à voir, mambo – vous comprendrez en le voyant. Mambo.), du porno, des femmes bien entendu, des scientifiques (la coiffure de Kitano dans le rôle, enfin quoi), de la culture en général et du cinéma en particulier, de la police, des maffieux, du salary-man de base et des animaux. Ajoutons à cela un récit qui fait fi de toute vraisemblance (les personnages meurent plusieurs fois, y compris Asao) et un goût du lourd que ne dément jamais la moindre pointe de finesse, que ce soit dans un jeu outré ou des situations énormes, avec un sens de l’emphase tout japonais.
Dis comme ça, ça devrait être très drôle, on devrait risquer la rupture d’anévrisme à force de fous-rires. Mais voilà, le film est franchement sous-rythmé, ce qui constitue un handicap de taille, en particulier pour une comédie. On se laisse porter sans vrai déplaisir de séquence en séquence, riant franchement par moment, mais le plus souvent on s’ennuie un peu, car si certains gags fonctionnent sur la durée (mambo !), on passe souvent par des tunnels où il ne se passe strictement rien. De plus, pas mal de gags sont absolument éculés et du niveau de nos plus horribles gaudrioles Max Pecassiennes (toutes les péripéties automobiles par exemple). C’est un film plus que mineur, une curiosité dans la filmo de Kitano, peuplé de moments totalement extérieurs (MAMBO !) barbotant trop mollement dans une graisse qui fige doucement.
Cependant !
Le vrai plaisir que l’esthète y trouvera est plus périphérique, mais Ô combien jouissif : voir une figure telle que Takeshi Kitano, réduite un peu vite au seul statut d’Auteur Sacré du Cinématographe Intelligent, se rouler dans la fange avec jubilation, faire des gags que les Charlots auraient repoussé du pied avec mépris, ne rien respecter et se foutre de tout, surtout de la bienséance. Imaginez seulement un critique de (insérez ici le journal cryptique de votre choix), lors de sa première vision, tentant de se gratter la tête, le sourcil haussé, devant le spectacle de danseuses mi-nues attirant une mouche géante sur un tas de fumier dans un stade, le tournage d’un porno inter-espèces avec des bestiaux empaillés, ou une anesthésie au bouquin ennuyeux. Ça, ça fait plaisir. Vive la cinématographie pas propre. Mambo.
Watchmen – Zack Snyder
Entre ceux qui vont s’étonner de la profondeur du propos d’un comic book qu’ils n’ont pas lu (« je savais pas que la BD ça pouvait faire ça dis-donc ! »), ceux qui rejettent déjà le film en bloc parce que Snyder n’est pas politiquement correct (il est à la NRA, comme John Millius, ce qui ne peut pas leur chaloir des masses, mais aussi comme Michael Moore, hein, juste pour situer), et les geeks du net qui pourrissent déjà le projet depuis un an parce que telle image ou telle réplique ne s’y trouve pas, il convient de calmer le jeu et de parler de la seule chose qui compte, à savoir le film, excellent en soi et tout à fait bon en tant qu’adaptation. Ne serait-ce que pour Rorschach, on n’a pas attendu pour rien.
N’en déplaise à certains, Snyder n’est pas à ranger sur la même étagère que Uwe Boll, et si sa principale qualité est d’oser les partis-pris les plus casse-gueule (par exemple, remaker un Romero quand celui-ci ne se roule pas encore dans les pages de Bourdieu tel le goret dans sa propre fange, ou encore faire un péplum extrêmement esthétisé en vidéo dans un seul studio, tout en traitant frontalement l’idéologie spartiate), il sait s’entourer des bons talents pour ce faire, et ne confond pas respect et déférence dans le traitement du matériau de base (pour le moment, le bougre ne signe que des adaptations). Alors il sera erroné, pour le moins, de se lamenter çà et là que Paul Greengrass, Daren Aronofsky ou même (on en rit encore) Terry "je fais n’importe quoi par caprice depuis dix ans et ça passe pour du génie" Gilliam n’aient pas survécu à un development hell démentiel qui a duré 20 ans. Et pourquoi pas Brett Ratner pour faire un X Men tant qu’on y est ? Parmi les réas en activité, Snyder était sans doute l’un des plus qualifiés pour mener un projet à bien des égards fou. On y opposerait a priori Christopher Nolan, dont la gestion un peu flottante des trop nombreuses storylines de The Dark Knight laisse planer le doute sur la narration qu’aurait donné son Watchmen, récit remarquablement foisonnant dont les éléments thématiques se chevauchent sur une structure en fascicules et annexes variées.
Quoi qu’il en soit, on pouvait craindre, à la vue de ses précédents efforts, que l’aspect foncièrement désabusé et crépusculaire du graphic novel de Moore et Gibbons soit le premier à passer à l’as : en 1985, dans un monde uchronique où les États-unis ont gagné la guerre du Vietnam grâce à un übermench du nom de Dr Manhattan et né d’un accident scientifique, les héros masqués ont été prohibés et mis à la retraite par le Keene act. Le meurtre d’une sorte de super barbouze nommée le Comédien force les Watchmen, confrérie de justiciers dont les destins ont divergé, à se retrouver pour interroger leur passé héroïque, politique et même affectif face à la menace immédiate d’un tueur de héros. C’est dans ce contexte qu’un vigilante psychotique, Rorschach, mène l’enquête, alors que la quatrième administration Nixon fait face au réchauffement de la guerre froide et que l’apocalypse nucléaire frappe à la porte.
Or, l’apocalypse, Snyder l’avait déjà traitée avec son Army of the Dead, et l’avait fait sur un ton plutôt léger, presque badin mise à part la séquence du bébé. L’issue fatale, il la rendait exaltante et même amusante pour les spartiates de 300. Du film très fun, un cinoche pop corn de très brillante facture et, n’en déplaise, intelligent, mais par trop positif si l’on songe à l’ambiance de film noir dramatique, volontairement anti-climatique, qui baigne Watchmen – le novel et pouvait être à craindre pour Watchmen – le film. Bien entendu, d’autres réserves étaient nées sur la toile et dans la presse, notamment l’interrogation quant au style de mise en scène, né de 300, voulant que la stylisation puisse prendre le pas sur le fond. On aura vu fleurir un débat assez absurde sur le nombre de ralentis qu’on verrait dans le film. Outre que le ralenti s’avère, dans une certaine mesure, un moyen efficace de retranscrire au cinéma le découpage iconique d’un comic book (le Sin City de Rodriguez montre à quel point une stricte transcription en plans à vitesse de continuité peut ruiner la plus dynamique des splash pages), Snyder prouve que son goût pour le ralenti (il y en a pas mal dans Watchmen, pas toujours absolument nécessaires, et dont l’appréciation sera laissée aux inclinations de chacun) n’est pas un cache-misère pour une réalisation qui serait par ailleurs branlante : la bagarre dans la ruelle mettant en scène le Hibou et le Spectre se fait entièrement à vitesse normale, et fait montre d’une clarté et d’un dynamisme tout à fait impressionnants dans le découpage. Snyder sait s’adapter à son sujet (à observer la différence entre ses trois longs métrages, c’est d’ailleurs évident) et le fait magistralement ici.
Le film présente une profondeur esthétique incroyable, et la direction artistique est littéralement à tomber de richesse et de texture. Gibbons est sur la direction artistique et ça se ressent dans chaque aspect, des teintes à base de couleurs secondaires aux décors et costumes extrêmement cohérents avec le projet : ainsi l’aspect des Watchmen costumés se veut une analyse tacite des courants esthétiques du comic book moderne (ainsi que de ses retranscriptions cinématographiques) là où le Watchmen papier reprenait les codes du comic book des années 30 à 60. D’ailleurs, les costumes tendance "fetish/transcription littérale de concept/grand n’importe quoi" des divers flashes-back au temps des Minutemen (ah, le proto-smiley sur la ceinture du Comédien !) participe de cette démonstration. Les deux personnages ouvertement hors de cette temporalité, Manhattan parce qu’il est un surhomme et Rorschach parce qu’il est bloqué dans les fifties d’Eisenhower et Truman, sont des décalques parfaits des dessins originaux, des plus petites taches sur le pardessus à la plus bleue des verges flacides. Certes, Ozymandias a carrément l’air d’un premier de la classe dans ses divers costumes (encore que dans le climax en Antarctique il s’avère tout à fait crédible en super-héros). Mais qu’on revoie la version papier : Ozymandias est de toutes façons un type imbu de lui-même avec un costume de héros proprement ridicule, et c’est volontaire. La beauté plastique de Watchmen est imparable, et la critiquer revient à pinailler sur des broutilles : le maquillage du vieux Comédien est moyen, le fard autour des yeux de Manhattan un peu évident, et pour un Henry Kissinger magnifique on a droit à un Nixon par trop caoutchouteux… Bon, ajoutons une Bubastis assez factice, et… C’est à peu près tout, le reste est magnifique, point. La cinégénie du matériau de base est le plus souvent magnifiée par la foi incroyable qu’a manifestement Snyder dans le medium cinéma et dans ce que d’aucuns désignent par l’épithète hautain de « monoforme hollywoodienne » : les scènes d’action sont franchement brutales, les scènes d’amour franchement érotiques, les plans larges franchement ambitieux et les séquences dramatiques tirent sur les cordes émotionnelles. Si le sous texte est distancié, l’empathie avec les personnages sur le plan humain n’est pas entamée. On appelle ça du cinéma. Mais oui.
Le miracle du film de Snyder, c’est que cette profondeur esthétique (à ce niveau de détail dans tous les recoins de chaque image, c’est même du layering fractal) n’est que la face émergée de la profondeur thématique, restituée intacte du comic book, et même enrichie dans le processus d’adaptation. On est d’emblée saisi par le générique de début qui donne le ton réflexif, mélancolique et acerbe de l’ensemble du métrage, avec l’intervention du premier Spectre sur le B 52 d’Hiroshima ou l’infirmation de la théorie du tireur isolé à Dallas en 1963. Des errements idéologiques, culturels et politiques de son univers et de ses personnages, Snyder, à l’instar de Allan Moore, n’éludera rien. Rorschach est vraiment malsain, Osterman/Manhattan est véritablement flou et naïf dans ses accointances plus ou moins coupables, le Comédien est une vraie ordure, le Hibou est un loser jusqu’à ses nuits avec Laurie qui échappe, elle, à la « malédiction de la gonzesse de film de super-héros », puisqu’elle possède de vraies motivations et une vraie personnalité. En termes narratifs, Watchmen est vigoureusement fidèle à son modèle, et la plus grande incartade prise par le scénario, concernant la nature même du plan ultime du tueur de masques, permet de rendre plus cohérentes certaines implications du récit (les dernières actions de Manhattan lors de l’épilogue, l’implication du Comédien, les recherches scientifiques d’Ozymandias et surtout la manière dont ledit plan fait évoluer le conflit mondial imminent). Le texte politique n’est en aucun cas escamoté, que ce soit au Vietnam ou lors des répressions de manifestations. Snyder y intègre, de son côté, une assez subtile rhétorique autour du 9/11, ne manquant pas de montrer les tours du World Trade Center (une grande partie de l’intrigue prend place à New York, et nous sommes en 85) à chaque moment clé de l’intrigue, et se permettant même de montrer plein cadre un Ground Zero à l’emplacement de Times Square sans plomber le récit avec un discours trop appuyé sur l’interventionnisme de son pays (bien que le « United States do not start wars » de Nixon soit savoureux).
Cette énorme fidélité montre cependant des limites dans la reprise à l’identique du découpage séquentiel en 12 chapitres. En effet, le rythme global du film s’en retrouve lissé, loin d’un rythme en creux et apogées allant vers un pinacle de l’action, et qui eut galvanisé l’aspect épique du récit. Ici l’accent est mis sur la réflexivité des actions, des contextes et des personnages, dans la même optique anti-climatique qui présidait à l’histoire originale de Moore et Gibbons, qui ne cherchaient certes pas à exalter. En dépit de certaines séquences d’action allongées et d’autres scènes rendues étrangement elliptiques, le rythme global du film est ainsi bizarrement égal, là ou dans la structure même des séquences les rebondissements abondent. Reste alors à voler d’idée saillante en image picturale forte, ce dont le film ne manque heureusement pas. Watchmen, ainsi, fait l’effet d’une très longue exposition, la faute à une enquête laissée un peu en retrait dans la seconde moitié.
Mais quelle exposition. C’est à elle qu’on doit LE morceau de bravoure du film, le point ou il fait mieux que on modèle, Jack Earle Haley en Rorschach. N’ayons pas peur des mots, il égale la performance de Heath Ledger en Joker haut la main, en ajoutant en plus une empathie pour son personnage pourtant effrayant dans son jusqu’au-boutisme. Le film est bien entendu à voir impérativement en VO pour le timbre de voix du justicier psychotique, et se permet l’exploit de surpasser le Rorschach du comic book. En effet – et on n’aurait pas cru ça possible, surtout quand on est fan de Rorscach – là où le Walter Kovacs de papier est une version anodine et diminuée de l’incroyable charisme du vigilante, on se prend à espérer que celui de celluloïd ne remette pas son second visage ! Et pourtant, le masque ondoyant du vengeur est magnifique et fascinant, changeant sans cesse de dessin selon l’émotion de Kovacs et (trouvaille cinématographique) lors des impacts de coups. Cependant, oui, un long métrage centré uniquement sur Kovacs en prison parviendrait à tenir debout tout seul, entièrement sur Haley. Parmi les ellipses un peu dures à avaler (mais encore, là, on pinaille), il y a d’ailleurs la création du masque et une grosse partie des entretiens avec le psychiatre de la prison. On attend bien entendu le director’s cut à paraître pour voir ça, ainsi que toute la sous intrigue du kiosquier et de la BD the Black Freighter (qui fait l’objet d’un métrage d’animation) et, peut-être, la mort du premier Hibou dont on n’entend pas parler ici. Ce cut, cependant, ne corrigera pas deux ou trois séquences un peu trop informatives (heureusement rares), où les personnages se répètent ce qu’ils savent pertinemment pour la gouverne du spectateur. Les scories de ce montage salles se ressentent encore dans l’introspection de Manhattan sur Mars, certains épisodes de son aventure se trouvant hors champ avec le Pruit Igoe de Philip Glass tronqué, ce qui laisse présager un traitement plus complet de ces quelques lacunes. Bref, on attend, en espérant aussi qu’Ozymandias sera un peu moins immolé au dieu Suspense en termes de temps de présence à l’écran… A trop vouloir ne pas asséner le discours et la symbolique pour ne pas alourdir le film aux yeux des profanes, on risque de s’aliéner un peu les fans.
Seul point ou la dialectique semble un peu trop appuyée, l’utilisation de la musique illustrative (des morceaux représentatifs de leurs époques, ou signifiants en soi) qui éclipse le score original (qui, en salle, ne semble pas être à se damner non plus – c’est un score, quoi), et passe du tétanisant (The times they are-a-changing de Dylan sur le générique de début) au sursignifiant envahissant (99 luftballons, ou encore la Chevauchée des Walkyries sur la séquence de Vietnam). On a toutefois fait pire comme faute de goût rédhibitoire.
Sortie effective de la chrysalide pour le film de super-héros (Dark Knight avait fini de défricher le terrain du comic book movie strictement adulte), Watchmen est bel et bien le plus grand film de super héros à l’heure actuelle, sa dimension réflexive achevant de démontrer que les 7 ou 8 dernières années, et plus encore 2008, ont marqué la fin esthétique effective du vingtième siècle : Election d’Obama (fin de l’arc politique et idéologique entamé avec Rosa Parks), morts de Betty Page (qui résumait à elle seule le passage du burlesque à l’érotisme moderne), Cornell Capa, Bing Crosby (toute une imagerie américaine) ou même Horst Tappert (dernier avatar du krimi allemand), Michael Chrichton et Samuel Huntington, mais aussi du dernier poilu de Verdun ou de Markus Wolf (célèbre espion russe), mise en vente des effets personnels de Gandhi, ou encore la fin de cette vague idée de New York comme capitale officieuse, esthétiquement parlant, des Etats-Unis (le dernier avatar de cette bizarrerie culturelle étant bien entendu le destin du World Trade Center), et qui trouve d'ailleurs écho dans le final de Watchmen. Cette idée diffuse ayant été véhiculée en partie dans les comic books (du Metropolis de Superman au New York de Spiderman), ce n‘est que justice.
Profond, graphiquement très beau, foisonnant, intelligent, fidèle à l’original, magnifiquement interprété, ce film est même capable de réconcilier les plus rétifs avec le concept même de blockbuster malgré trois/quatre détails qui risquent fort de se voir corrigés dans une version étendue. Jetez-vous dessus.
Chemical wedding – Le diable dans le sang (titre français) Julian Doyle
Bruce Dickinson mêle sorcellerie et hard science autour de l’occultiste Aleister Crowley, et se lance dans un récit manifestement trop gros pour lui. Emballé avec trop peu de rigueur et de dinguerie par Julian Doyle, et malgré quelques bonnes idées, le résultat est ringard comme du Iron Maiden… Et rigolo comme ses pochettes de disques.
On a envie d’aimer son film, à Bruce. On entame en tous cas le visionnage avec un a priori positif, tant le musicien, mais aussi son Julian Doyle de réalisateur (monteur de Brazil tout de même) attirent la sympathie du fait de leurs statuts respectifs. Aleister Crowley, occultiste du vingtième siècle qui avait déchaîné les passions en son temps ("the wickedest man in Britain"), est une figure intrigante, suffisamment peu traitée par le passé (au cinéma en tous cas) pour provoquer au moins un levé de sourcil curieux et motiver toutes les extravagances narratives.
Mais voilà, l’extravagance, c’est précisément ce qui fait défaut à un film qui s’en réclame à corps et (surtout) à cris. Le script, confus sans être vraiment complexe, nous montre Crowley mourant dans les années 40 en maudissant deux étudiants qui se trouvaient là. De nos jours, à l’université de Cambridge, plusieurs notables adeptes de l’occultisme (dont nos étudiants depuis montés en graine) parviennent à ressusciter le sulfureux personnage par l’entremise d’une combinaison de réalité virtuelle qu’est venu tester son inventeur, le chercheur américain Mathers. Haddo, professeur timide et bègue, est après son passage dans la combinaison habité par l’esprit de Crowley, qui va chercher à compléter sa résurrection par un rite puissant, le mariage chimique : pour ce faire, il compte utiliser Lia, très jolie étudiante rousse, celle-là même que Mathers s’apprête à tutoyer pendant deux bons tiers du film. Ce faisant bien entendu, cadavres et attentats aux bonnes mœurs s’empilent, physique quantique et alchimie se rencontrent, les considérations scientifiques pleuvent, les chassés-croisés se multiplient, chacun poursuivant tous les autres. Y arrivera-t-il, y arrivera-t-il pas, sommes-nous dans un monde parallèle, la science et la magie sont-elles les deux faces de la même médaille, pourquoi Haddo s’est-il rasé la tête, et avait-il vraiment besoin de faire pipi sur ses étudiants (spoiler !) ?
On le voit, la trame en elle-même est ultra linéaire, ce qui ne l’empêche pas de se perdre dans les méandres de multiples péripéties au mieux esquissées (les mondes parallèles, l’agence d’escort girls, la relation entre celui qui sait et son camarade en fauteuil roulant), au pire inutiles (le sabbat en milieu de métrage) ou carrément grotesques (l’affrontement final du plus haut ridicule en CGI criantes d’amateurisme), mais des péripéties presque toujours inutiles au déroulement global de l’intrigue. On les jurerait d’ailleurs disséminées au hasard dans le déroulement du film, ce qui s’avère carrément contre-productif dans un récit qui entend développer un sens de l’urgence (le tout se déroule sur 4 jours) et du suspense (y arrivera-t-il, y arrivera-t-il pas, tout ça), et surtout qui touche à des concepts qui réclament une rigueur accrue dans le traitement, à savoir le paradoxe spatio-temporel. Aux deux tiers du film, on se contrefout déjà du sort de tous ces personnages : le main plot est en pilote automatique (bien entendu tout rentre dans l’ordre mais l’épilogue se remet in fine en question avec l’énigme qui fait peeeuuuur, bref tout ceci est routinier) ; restent des gesticulations multiples qui s’avèrent fatigantes dans leur démonstrativité.
Car l’autre problème, le principal peut-être, est bien cette démonstrativité qui se verrait bien en subversion, mais n’atteint guère que la bouffonnerie, au sens médiéval du terme : les coups d’éclat transgressifs de Haddo/Crowley, loin de susciter phobos et eleos, provoquent le plus souvent un amusement réel, mais somme toute plutôt bon enfant : Du cul frileux, des gros mots, un peu de méchanceté gratuite, des saillies scatologiques et une violence le plus souvent hors-champ. Doyle et Dickinson, eux, sont persuadés de bousculer des tabous et d’horrifier le chaland à la manière d’un Sade, d’un Rochester ou même pourquoi pas d’un Manson. Seulement, à part quelques plans de full frontal nudity, un chat crucifié dans un coin de cadre, de l’ordure assez anecdotique (une scène de rasage se démarque pourtant dans le subversif, on n’en dira pas plus) et beaucoup de morgue dans l’attitude de Simon Callow (qui s’amuse comme un petit fou en Crowley et est de loin le meilleur acteur du cast), tout ceci est plutôt touchant de candeur de la part des auteurs. Ce qui apparaît au final, ce sont de ces affectations de turpitudes mises en scène par des adolescents qui y croient à mort, de celles qui fleurissent à longueur de skyblogs de gothiques en carton. Ainsi les turpitudes de Crowley se manifestent le plus souvent au-dessous de la ceinture ou dans une coprolalie ampoulée, qui mettrait même en valeur ce qu’on avait pu voir dans le domaine chez Brian Yuzna (dans Society certes, mais aussi dans Faust, ce qui est franchement plus grave !)… On évoquera ici ce qu’en dit Pierre Jourde dans l’avant-propos de son indispensable Littérature sans estomac : « Certains auteurs prétendus « sulfureux » (…) ont l’air de vivre il y a cinquante ans, ils se gargarisent d’audaces cacochymes, s’étonnent du courage qui consiste à briser des interdits pulvérisés depuis des lustres. » Ici c’est la même chose, on aurait même l’impression de se faire arnaquer en termes de déviance filmée si la pompe dont les auteurs font preuve ne montrait pas, encore une fois, leur candeur vis-à-vis de leur projet.
La preuve de cette candeur, c’est assurément le didactisme excessif dont fait preuve le dialogue dès qu’il s’agit des références scientifiques et relatives à l’informatique. Trop pointues, trop pléthoriques, et surtout mal fondues dans le script, elles ne font que parasiter la célérité du récit et en éjecter le spectateur qui avait déjà du mal à se sentir concerné (le prix de la réplique incongrue va sans doute, dans le domaine, à un « I feel like Schrödinger’s cat ! » juste avant le climax ; difficile de faire plus lourd dans le sibyllin !). C’est un peu comme ces mauvais récits de SF où les personnages se croient obligés de nommer chaque gadget d’un nom à rallonge qui en dévoile le fonctionnement : vous dites souvent que vous prenez votre véhicule roulant à énergie fossile, ou que vous vous brossez les dents à l’aide de votre dispositif à pression hydraulique ? Non ? Alors les gens du futur ne prendront sans doute pas de douches à radiation ionique inversée, mais simplement des douches, quelque exotique qu’en soit le principe moteur… C’est tout à fait pareil ici, où les personnages confondent jargon et vulgarisation au cas où une équipe de Discovery Channel passait par là quand on cause boulot.
Quant au charabia magique de Crowley, il est à l’avenant (c’est après tout aussi un jargon), et partant il ne fait quasiment jamais mouche et passe toujours pour un cheveux dans la soupe, un discours pompeux apposé à la va-comme-je-te-pousse sur des séquences qui n’en demandaient pas tant. Ce n’est certes pas la subtilité qui étouffe la caractérisation : Haddo est timide et inoffensif, il est donc bègue et arbore des boucles blondes, caractéristiques qui s’inversent à l’arrivée de Crowley (boule à zéro, diction emphatique, costume violet vif !). Et les personnages de s’étonner – sans blague.
Ajoutons à cela une production carrément en dessous de son sujet (la HD, pas assez bien éclairée, ne fait jamais illusion, et dès qu’on a des matte paintings ou des intégrations, ça devient vraiment criant), les trois quarts du cast jouant comme des briques (mention spéciale à Karl "une seule expression faciale" Weber dans le rôle du gentil héros), ET du Dickinson flanqué aux moments les plus inappropriés du métrage, et on ne pourra pas dire que Chemical wedding est un bon film. Même pour de la production télé, c’est en dessous des standards actuels de ce qui se fait au Royaume Uni. Mais il serait injuste de le qualifier de mauvais film, comme ça, de manière unilatérale. Ce n’est même pas un navet : c’est un vrai petit plaisir coupable, du genre qu’on se tape un samedi, avec des potes, de la pizza et de la bière ; on sait que c’est mauvais, mais ça peut tout de même faire plaisir… A condition de ne pas être tout seul (sino on s’ennuie et on s’énerve) et de savoir avant le visionnage à quoi s’en tenir. Plus maîtrisé, cela aurait donné une recommandable petite série B sans prétention comme avait pu l’être un Razor blade smile. Plus fou, moins retenu, dans d’autres mains peut-être, ç’aurait pu être une vraie bande psychotronique comme on en voit rarement.
Dommage.
L’Autre – Bernard/Trividic - 2009
Voilà donc un film que d’aucuns voudront vous forcer à aller voir pour cause de prix d’interprétation à Venise, comme cela se fait dans les milieux culturels de chez nous. Aller voir L’Autre sur ces seules prémisses serait l’erreur à ne pas commettre, en ce sens que le dernier Bernard/Trividic est un métrage paradoxal, qui confirme les qualités de formalistes et de créateurs d’ambiances des deux cinéastes, mais conforte aussi les postures un rien artificielles qu’ils croient devoir entretenir comme certaines coquettes leur accent. Dont la direction d’acteurs justement.
Guettez bien les divers papiers que vous trouverez sur L’Autre – il y a fort à parier qu’on n’y trouvera peu ou prou que des dithyrambes sur le rôle de Dominique Blanc (pourquoi pas, y’a eu un prix pour en attester, on risque rien à s’ébaubir avec ostentation, pis sur un quart de colonne y’aurait pas la place de faire une analyse filmique de toutes façons), des considérations sur le mode de vie autofictionnel des cinéastes (carrément hors sujet, mais bon, ça permet toujours de causer de cul – le court ceci est une pipe, déjà vieux – et de s’arroger un certificat d’humanisme à peu de frais – "ouais, moi j’suis trop à l’aise avec l’homosexualité, comment j’suis trop courageux"), sans compter les considérations auteuristes d’usage (avec mots tarte à la crème tels que : interstices, filigrane, portrait en creux, etc.. Le premier qui en trouve quatre autres gagne un pin’s parlant Télérama). De telles saillies sont bien entendu assez stériles, et il convient de se pencher sur le film en lui-même, bien plus riche en enseignements qu’il n’y parait.
Anne-Marie a couvert son miroir de papier journal et se regarde dans une petite ouverture qu’elle y a pratiquée. Elle insulte son reflet, puis utilise un marteau sur ledit avant de le retourner contre elle. À l’hôpital elle se remémore sa rupture - facile - d’avec un beau jeune homme qui s’est vite trouvé une nouvelle amie, et son obsession à propos de cette "autre" qui l’a remplacée. Lors de pérégrinations diverses (affectives, théoriques, sexuelles) dans la grande banlieue et dans sa propre psyché, elle s’est trouvée en proie à une paranoïa grandissante, confinant bientôt au trouble schizophrénique, se trouvant même confrontée à l’image de son double, pour se trouver dans un climat constant d’inquiétante étrangeté. Et puis plus rien : elle guérit des excroissances les plus violentes de son trouble, reprend sa vie, nous cause un peu en off, et générique.
On voit bien ici que Bernard et Trividic creusent leur sillon thématique et travaillent les mêmes matières que précédemment : doppelganger, trouble psychotique, isolement, fantastique en demi-teintes, obsession plus ou moins malsaine, sentiment amoureux, Peter Bonke en trickster. Premier paradoxe du film : s’il se déroule dans un cadre plus ouvert que Dancing (ici la banlieue des centres commerciaux anonymes, des espaces urbains interstitiels et des transports en commun, là où le film précédent prenait place dans un décor quasi-unique malgré quelques excursions), L’Autre est bien plus localiste, centré sur le particulier, en un mot il possède moins d’ampleur narrative et thématique. Exemple : les premiers plans de Dancing nous montrent la côte Atlantique, tendue vers des horizons extrêmement larges. L’Autre s’ouvre sur des plans (très beaux d’ailleurs) d’autoroutes dans un mouvement de convergence (vers des péages, puis Paris et sa région). De même, le lieu qui s’ouvre sur la tentation fantastique est ouvert dans le premier en termes diététiques (le sous-sol, la multiplication finale du galeriste), et fermé dans le cas présent (puisque évoqué en flash-back, et localisé explicitement dans la tête de la protagoniste via l’intervention du marteau), à l’exception notable DU plan le plus troublant du film, celui du recouvrement du miroir vu de l’intérieur de celui-ci, et qui ramène (volontairement, sans doute) au Prince of Darkness de John Carpenter. Resserrement narratif ou appauvrissement thématique, le débat est ouvert.
Second paradoxe, l’approche de la sexualité au sens large : bien qu’abordée avec une plus grande pudeur graphique que précédemment (en même temps, difficile de faire plus graphique que les empoignades érectiles un peu vaines de leurs précédents efforts), la sexualité est très "cinéma français" dans son traitement, c’est-à-dire qu’on y met beaucoup d’emphase tout en la traitant avec un manque de ludisme confondant. Dieu que ces gens sont peu primesautiers ! Qu’il vous soit dit, cinéastes français cherchant à choquer le bourgeois d’une main en lui flattant le poireau de l’autre, il ne suffit pas de dire "queue" à voix haute pour en provoquer les tressaillements… Ici l’on baise comme dans un film d’auteur : avant on a peur, pendant on s’emmerde un peu, et après on regrette. Par exemple, le rapprochement physique avec Lars apparaît comme anecdotique, anachronique dans leur relation, à vrai dire pas la partie la plus intéressante de leur amitié pour les deux personnages. Mais encore une fois, occasionnellement, les cinéastes surprennent agréablement par une retenue bienvenue : on se doute bien qu’il arrive quelque chose de physique entre l’héroïne et sa collègue venue passer la soirée, mais aucun plan revendicatif et incongru ne vient étayer cela, et c’est tout à fait bienvenu, car sitôt qu’elles se fussent embrassé devant la caméra, le trouble eut disparu, on eut été en terrain connu.
C’est ce qui agace un peu à la vision du métrage. On sent que s’ils s’écoutaient vraiment, Bernard et Trividic feraient leur film comme ils l’entendent et sans se soucier du qu’en dira t’on des voisins, du microcosme cultureux ou des communautés diverses. Mais non, il faut sacrifier à toutes sortes de conventions, parce que c’est comme ça qu’il faut faire, point trait, au CNC c’est ce qu’on m’a dit et ils s’y connaissent en cinéma. L’exemple le plus représentatif, et accessoirement le truc pénible à subir pendant la projection, c’est l’incroyable préciosité de la diction réclamée à Dominique Blanc sur la quasi-totalité du métrage (bon, et le fait de la teindre en blonde aussi, mais on donne plus facilement les prix d’interprétation féminine aux actrices grimées d’une manière ou d’une autre pour un rôle, de Cotillard à Theron en passant par Kidman…). Pas tout à fait théâtrale, certainement pas naturelle, cette diction ampoulée dénote le plus souvent une affectation bressonnienne, et sonne, le plus souvent, comme du Rohmer, c'est-à-dire mal. Bref c’est joué comme un texte lu sur prompteur. Or, Blanc sait jouer avec naturel et la quasi-intégralité du cast autour d’elle joue tout à fait juste également. Et même quand il y a un peu de théâtralité, elle passe très bien (Peter Bonke justement). Pourquoi diable alors, le perso principal doit-il causer comme une voix off d’Agnès Varda ? Mystère ! Un mystère aisément démontable cependant s’il l’on veut bien se souvenir du jeu fort similaire de Trividic dans Dancing, et dans une moindre mesure des voix off du docu Le cas Lovecraft. Tentative de distanciation brechtienne ? Citation de Bresson ? On a tout de même du mal à croire que c’est réellement par goût qu’un cinéaste va saboter une partie de sa dramaturgie en faisant déclamer aussi grossièrement ses dialogues ! C’est plus vraisemblablement une affectation de cinématographe A.O.C. Qualité Exception Culturelle, estampillé je fais comme ça parce que c’est la valeur prescrite dans mon cercle (les évènements vénitiens semblent d’ailleurs leur donner raison sur ce point). Le spectateur qui se fout un peu de ce genre de considérations, qui n’a pas envie de faire le pion de collège et de distribuer des points de bonne conduite, lui, s’embête un peu devant tant de pose.
Pose dont ILS N’ONT PAS BESOIN, répétons-le. Ici même, ils font preuve de grandes qualités formelles, composent des tableaux vraiment très beaux : toutes les plages atonales en train et dans les rues, certaines rêveries autour de la nouvelle amante/arlésienne, et surtout les séquences de nuit en lumières artificielles (les toits de Rosny 2, les parkings de Val d’Europe). Ce sont pour le moment quasiment les seuls à savoir se dépatouiller de la vidéo pour faire de vraies belles images avec. Créateurs d’ambiances troubles, ambiguës et à la lisière entre étrange et fantastique, Bernard et Trividic font merveille dès qu’on se laisse porter dans une narration qui procède plutôt par analogies de formes que par rigueur scénaristique. Le film reste à voir, assurément. Moins à écouter, pour ne pas se gâter le plaisir, mais à part les échanges avec Lars, les dialogues ne sont pas absolument nécessaires au voyage. Toutefois, à ne pas échanger trop promptement contre son baril de Dancing, plus digeste, plus étrange, et plus équilibré car il n’a pas, lui, autant le cul entre deux chaises, à faire du fantastique honteusement, en le niant constamment dans un traitement voué en partie à flatter les plus frileuses commissions de notre beau pays.
Il est certes difficile de faire un film avec du fond quand on adapte du Ernaux. Autofiction et imaginaire ne font pas bon ménage. Allez-y pour les cinéastes et ce qu’ils savent faire, pas pour les multiples "bonnes raisons" compatibles avec la charte du bon spectateur intelligent. Car un vrai film se cache derrière.
[REC] de Jaume Balaguero et Paco Plaza
Voilà un film qui remet l’auteur de La Secte sans nom sur les rails du pitch tendu, et donne enfin ses lettres de noblesse au sous-genre "casse-gueule" du film en vue subjective. Y’a bon .
Dire qu’on attendait avec circonspection le prochain essai de Balaguero tient de la litote.
Après le monument de glauque dépressif La Secte sans nom et le très classique mais joliment flippant Darkness (la balançoire !), le gars avait déçu avec un Fragile logiquement sorti en DTV. Parsemé de jolies idées mais plombé par une poésie de midinettes (Callista Flokhart en héroïne. Besoin d’en dire plus ?), une épure qui nelaissait au final plus grand-chose à bouffer et une narration leeeeeeente, le film peinait à laisser un souvenir en relief. Quant à Plaza , on attendait encore qu’il nous captive vraiment (Les enfants d’Abraham, ou le concept rebattu au service du genou mou). Mais on sentait bien qu’un cinéaste se cachait quelque part par là. Nous suivons un reportage orienté divertissement, où une assez sympathique équipe de JRI nous fait vivre une nuit chez les pompiers de Madrid : Angéla pétule tant qu’elle peut devant la caméra de son coéquipier. Pendant un quart d’heure de ce qui apparaît comme les rushes d’un sujet de télé-réalité, il ne se passe rien et on s’attache doucement, mine de rien, à ces personnages en quête de biscuit. Une unité que suivent nos reporters intervient dans un immeuble où des hurlements se font entendre, pour trouver dans l’un des appartements une vieille femme ensanglantée. Celle-ci mord à la gorge un des policiers, avant d’être abattue. L’immeuble est bientôt placé en quarantaine. L’équipe de tournage est désormais coincée avec les habitants et les secours devenus impuissants, alors qu’une rage infectieuse se répand parmi eux…
Le premier semestre 2008 étoffe un sous-genre dont le dénominateur commun est le traitement particulier de sa narration : l’histoire est vécue intégralement par le point de vue subjectif d’une caméra intra-diégétique. En gros, on pensera, dans cette typologie, au Blair witch project (1999), au récent Cloverfield et au prochain Diary of the dead de Romero. Problème : ces films tombent tous dans le piège de leur concept à un moment ou un autre. Il ne se passe strictement rien dans Blair Witch, qui n’est intéressant que dans les moments scriptés (c’est-à-dire hors du gimmick de faire du faux cinéma-vérité); Cloverfield s’appuie à 100% sur un concept malin, tellement qu’il en oublie d’avoir un scénar (J.J. Abrahams les mecs !), et Diary se tape des séquences de fuite à la steadycam dans des décors tous dotés d’éclairages de studio (c’est pratique à filmer, l’apocalypse dans la région de Pittsburgh).
Reste [REC] qui, lui, va mettre tout le monde d’accord. D’abord parce que le film est pensé en termes d’immersion totale et de rythme séquentiel, pour devenir rapidement un ride doté de moments de flippe comme on n’en avait connu que dans le premier Silent Hill (le jeu où on est dans le noir hein, pas le film où on voit jusque dans les bords du cadre et les confins de l’horizon), et un peu dans Darkness aussi, justement. Balaguero et Plaza veulent vous faire peur, pas montrer qu’ils sont malins ou faire un cours de mise en scène. Tout est, de fait, orienté vers l’efficacité du récit. Ainsi tout se déroule dans une ambiance quotidienne et malsaine de copropriété, où survient une horreur fulgurante et brutale, et l’on y suit des personnages tour à tour pittoresques ou attachants présentés dans des séquences de pause. Angéla est à ce titre fort bien campée en jeune journaliste à l’idéalisme impulsif, juvénile, prompte à s’indigner contre l’autorité. On prend également beaucoup de plaisir à voir Carlos Lasarte dans un rôle très amusant de voisin, à contre-courant du Santini de La Secte sans nom.
Ces séquences, apparemment lénifiantes en soi (beaucoup sont des interviews des habitants de l’immeuble, qui relatent les faits qu’on vient de voir se dérouler), mettent en exergue les séquences horrifiques qu’elles flanquent. Bref un rythme en dents de scie qui, parce qu’il est pensé dans ce but, donne au film le pouvoir de ne jamais lâcher son spectateur, ballotté par les évènements et ne sachant jamais ce qui va(littéralement) lui tomber dessus ou lui sauter au visage.
Cependant, ce ne serait pas suffisant si le script n’était pas au cordeau, et la mise en scène constamment lisible. Car la difficulté de ce type de récit est qu’on ne peut pas utiliser la majeure partie de l’arsenal du découpage et de la narration classiques: adieu plans de coupe, montage parallèle, explications venant de l’extérieur, l’histoire finale comportera des trous plus ou moins béants. Les personnages principaux conditionnant non seulement l’histoire mais surtout la manière dont elle est racontée, on voit bien qu’il est crucial de bien les choisir. Ici, point de crétins parkinsoniens incapables de pointer la caméra dans une direction (bonjour
Cloverfield !), pas plus que de docu « sur le vif » avec caméra vidéo qui shoote en 35mm(le Romero donc). En prenant comme personnage vecteur un reporter d’image, c’est-à-dire un type qui sait cadrer rapidement une action qui se déroule devant lui ET courir pour sa vie quand ça pète, le tandem Balaguero/Plaza tape dans le mille. Et décuple le sentiment d’immersion dans une histoire par ailleurs assez classique à laquelle le point de vue appliqué redonne toute sa saveur. Car l’action, aux rebondissements jamais téléphonés (il est impossible de prévoir certaines péripéties, et le teaser tourné dans la salle au festival de Sitgès montre vraiment ce qui vous attend), utilise avec beaucoup d’intelligence les moyens qu’offre le dispositif : une petite fille qui joue avec la caméra nous permet d’entendre une conversation secrète entre la journaliste et le cadreur, caméra elle-même utilisée à bouts de bras pour éclairer une trappe, espionner l’infirmerie improvisée ou voir dans l’obscurité totale via le mode infrarouge… Cependant, conscients que ce dernier procédé à déjà été utilisé, et bien (
The Descent ), les réalisateurs ont le bon goût de ne s’en pas servir pour nous dévoiler une créature quelconque qui se tient derrière un personnage. Le principe est détourné pour nous ramener à une scène de cache-cache claustro héritée de la fin du Silence des agneaux, qui intervient non pas comme un effet de surgissement (« Bouh, fais-moi peur ») mais bien comme séquence d’angoisse réelle.
L’histoire, pour n’être pas furieusement originale (c’est le moins qu’on puisse dire), se permet des crochets bienvenus du côté de la mythologie des deux premiers longs de Balaguero (le magnétophone notamment distille des informations qui ont un goût de Secte sans nom ) et, mine de rien, retourne son pitch mainte fois entendu de film de siège (ici l’on n’essaie pas d’empêcher un mal d’entrer, on tente de s’échapper d’une zone en quarantaine où le mal s’épanouit) en le nourrissant d’influences extrêmement pertinentes et bien digérées (tout un épisode autour de la recherche de clés pour un éventuel passage vers les égouts sent très fort le premier Resident Evil de la Playstation 1), puisqu’on sent toujours qu’elles ont, aussi, été considérées cliniquement en termes de vraisemblance. Ainsi, si le récit lorgne vers la télé-réalité (une influence revendiquée), le docu-drama et le reportage de divertissement, la réflexion n’est jamais assénée à coups de boutoir, et toujours sous-jacente. Tout simplement parce quand on est pris dans le feu d’une action où tout ce qui bouge veut vous tuer, on ne se prend pas la tête à deux mains mon cousin sur les implications sociétales de Big Brother comme un élève de Sorbonne 3, on court.
Seule vraie faute de goût, qui sent un peu trop le pamphlet au détriment de la ligne dramatique : une séquence rembobinée « à vue » à la Funny Games, s’avère ici pataude et plante un peu le suspense et le rythme, heureusement suffisamment tôt dans le métrage pour lui permettre de reprendre de l’inertie par la suite. Donc voilà. Un ou deux détails empêchent le film d’être parfait, et il ne constitue pas le monument de terreur viscérale qui vous hantera pendant des mois. Toutefois, le ride se savoure comme un magnifique train fantôme pour adultes (le film fourrage du côté du dérangeant, mention spéciale à un très beau final s’arrêtant exactement ou il faut) et confirme que le cinoche de genre hispanique, devenu très propret ces deux dernières années (le dernier Del Toro, version ratée de l’Echine du Diable, ou encore l’arnaque L’orphelinat, qui impressionne les gens n’ayant pas vu de film de maison hantée depuis la Maison du Diable), est encore méchant et a encore envie de mordre. En tant que film tendu, efficace, qui remplit son contrat (« Tu entres dans la salle à 20h00, et à 21h40 je te repose au sol ») et ne prend le spectateur ni pour un crétin ni pour un thésard, [REC] fait violemment plaisir. Parce que c’est rare ces temps-ci.
A HISTORY OF VIOLENCE
Il y a deux faces à la carrière de David Cronenberg.
La première, la plus précieuse, est celle qui imposa le cinéaste : un cinéma viscéral et transgressif, qui, en sus de l’astuce de ses thèmes et de l’intelligence de son propos, n’oubliait pas de livrer de vrais films, des morceaux de péloche opératiques aux narrations solides et aux effets cathartiques. C’est le Cronenberg de la grande époque, celui qui 20 ans avant Matrix se permettait une scène de hacking informatique par télépathie au téléphone (le gigantesque Scanners) ou de réalité virtuelle (Videodrome, définitif). Celui qui ne s’embarrassait pas d’épilogue lénifiant à la fin de The fly. Celui qui osait la frénésie vénérienne (Shivers et Rage) cinq ans avant le sida et l’agression explicite d’enfants (The brood) pour peu que ça serve son cinéma. Ces premiers films sont trop souvent considérés par certains comme embarrassants et pas propres : Ils constituent pourtant des pierres angulaires du cinéma des années 70 et 80.
Hélas ! Il y a aussi l’autre David, le Cronenberg respectable qui apparaît avec Faux Semblants. Celui-là délaisse Sitgès et Avoriaz pour ne plus fréquenter que Venise, Berlin ou Cannes. Il a des amis bon teint qui ont lu tout Freud et possèdent au moins une édition de Sexus. Il est traversé de fulgurances de son ancienne vie (l’excellent Naked lunch), mais passe globalement à côté de ses sujets, plus occupé à donner à voir qu’il réfléchit qu’à questionner réellement son cinéma. Voir pour s’en convaincre Existenz , plantade condescendante et pataude sur le jeu vidéo, là où Videodrome avait tout compris de son sujet qu’il prenait à bras-le-corps. On le vit aussi dans cette volonté de faire du film intellectuel avec poil au cul (le consternant Crash). En voyant un personnage lancer du sperme à la caméra après une masturbation, dans Spider, on se remémorait l’un des aphorismes d’Almanach Vermot de Lacan, "tout symbole est à interpréter littéralement".
Et l’homme de goût se désolait sur la dépouille du réalisateur de Scanners en apprenant qu’il envisageait un documentaire sur Orlan, égérie jusqu’au-boutiste de l’enculage de mouches mondain… Douloureux de la part de l’homme qui jadis trépanait Michael Ironside !
Aussi la surprise est d’autant plus réjouissante à la vue de A history of violence, western déguisé (car récit archétypal de lonesome cow-boy rangé qui reprend les flingues pour défendre les folks du coin) qui n’oublie jamais son spectateur en route et va de son point A à son point B de manière frontale et dévastatrice. Loin des maniérismes alambiqués de ses derniers films (plages colorées à la Bava, mouvements de caméra peu utiles, jeu d’acteurs parfois à la limite du Rohmer), Cronenberg y renoue avec sa mise en scène sobre, ample et opératique, celle qui fait passer les plus grandes audaces comme des évidences. On jurerait certains plans arrachés de The Brood. Le film, magistral, trimballe son spectateur de bout en bout avec une histoire simple contée solidement, où l’analyse des caractères se fait au service de l’émotion plutôt qu’à celui de l’intellect. Les acteurs (mention toute particulière à Maria Bello et Viggo Mortensen) exsudent littéralement l’humanité de leurs personnages, rendant tout à fait crédible et palpable l’existence de ces derniers en dehors des bords du cadre. C’est un monde tout à fait quotidien et identifiable qui s’étale devant nous, où la violence est réellement douloureuse lorsqu’elle explose. Quelles qu’en soient les motivations, gratuité, défense ou affirmation, la violence est ici, au coin de la rue, dans les interstices de la journée mais surtout logée au coeur de l’humain, qui doit l’affronter pour se retrouver, au final, moins frais mais plus complet qu’avant. Quitte à affronter Ed Harris. Le film est réjouissant pour l’amateur de bons films, car maîtrisé, immersif et surtout émouvant. Le
cinéaste est, enfin, impliqué dans son histoire, ce qui faisait défaut à ses derniers films. Le résultat est une péloche sincère, ce qui est une qualité trop rare par les temps qui courent…
Il est d’ailleurs touchant de voir à quel point Cronenberg semble s’approprier l’histoire de "Tom Stall" pour nous parler de lui.
Tom Stall est attaqué par des délinquants homicides dans son coffee shop. Il se défend avec un brio meurtrier et assez suspect. Evènement qui va obliger le personnage à se confronter au chien fou qu’il fut autrefois pour "se ré-assimiler" (comportement que reconnaîtrait le James Woods de Videodrome !) et finalement être un homme plus complet, plus moral que le good guy utilitaire qu’il s’était forcé à devenir en procédant par soustraction. Confrontation violente à un monde violent (et plus vaste, Mortensen ne sortant des murs de sa bourgade à la Norman Rockwell que pour affronter son frère et son ancienne vie), qui va changer des personnages fonctionnels (le bon père de famille, le fils un peu lunaire en butte à l’animosité des mômes populaires, l’épouse/femme active qui porte la culotte et distribue les faveurs sexuelles comme des bons points…) en véritables personnes, complexes et bourrés de recoins. Le fils s’affirme en homme, le good guy assume ses zones d’ombres et la maman accepte la putain en elle et ses désirs d’animalité (le rapport sexuel dans l’escalier qui traite de cette dualité autrement plus subtilement que tout Spider). Le "mal" (au sens de sauvagerie), s’il est - momentanément - pourfendu, est surtout pleinement accepté et intégré. A l’attaque du restaurant correspondrait alors la découverte du comic book original.
Il semble en effet qu’en adaptant l’ouvrage de John Wagner et Vince Locke, Cronenberg laisse de côté sa respectabilité de poseur de festivals. Il accepte enfin (on devrait dire : à nouveau) ses "antécédents de violence" pour se tourner vers sa jeunesse de trublion : photo naturaliste peu saturée, découpage efficace, factuel et solide (la séquence d’ouverture !), jusqu’à la partition d’Howard Shore qui revient à une épure et un lyrisme proches du score de Scanners. Il revient à un cinéma extrêmement charnel (les coups portent douloureusement par le biais de cuts frontaux très agressifs, on sent toujours le physique des personnages par les pieds nus, les blessures, les bleus, la sueur toujours rappelés dans l’action), un cinéma où le concept n’est jamais prééminent à l’action. La preuve ? Cronenberg a ôté de son montage final une scène onirique, auto-citation propre à faire jaser les cinéphiles lacaniens, et où il se laissait aller à "faire du Cronenberg" sursignifiant et peu utile. Ce faisant, il choisit explicitement de servir l’économie de l’histoire qu’il raconte, plutôt que de se faire mousser à peu de frais en se montrant malin.
C’est aussi pour ça que l’on écrase sa petite larme à la fin du récit. A l’instar de son personnage, David revient nous voir, enfin débarrassé de ses oripeaux de nouveau philosophe, ayant accepté cette autre partie de lui qui est moins plaisante pour les gens de bon goût, les gens civilisés. Il sait, et nous le dit, qu’à trop chercher à complaire à une idée proprette d’un monde jalonné de certitudes rassurantes, il participait au mensonge de la respectabilité. Qu’il s’amputait de ce qui faisait son identité et sa valeur, et qu’il est désormais plus fort avec que sans. On est ému, parce qu’on est trop heureux de lui avoir gardé son assiette.
Sabir cyber
Cet article se veut une exploration subjective de diverses pensées et divers avatars culturels autour de la cybernétique. Dans cet opuscule, on ne traite donc pas de la cybernétique en tant que mouvement(s), mais en tant que notion.
A l’heure où le jeu vidéo, après avoir atteint une certaine maturité en tant que medium narratif fils du cinéma et de la télévision (on songe bien entendu aux expérimentations d’Hideo Kojima sur les Metal gear, à Shinji Mikami et ses jeux "B movie" Biohazard et Devil may cry, à l’univers de Legacy of Kain ou à la mise en scène toute en emphase de God of War, mais qu’il soit permis de rappeler les constantes avancées depuis 20 ans dues à Shigeru Miyamoto, père de Mario, Metroid et Zelda), à l’heure, dis-je, où à la faveur de la clientèle des light gamers, toute une frange du marché vidéoludique se recentre sur des party games dont l’intérêt se borne à la pure manipulation de mini-jeux dénués de contenu, on peut s’interroger sur ce qui constitue, en termes de propos mais aussi d’indicateur culturel, une régression au stade de Pong et de Galaga(1).
Il semble en effet qu’à la faveur des dernières avancées techniques dans le domaine du grand public, du next gen à la portabilité, on ait ravivé un imaginaire technologique comparable à celui des Etats-Unis de l’après-seconde guerre mondiale, c'est-à-dire ceux du début de l’ère atomique : une vie toute faite de plaisirs cybernétiques plus ou moins sophistiqués, où chaque aspect de la vie serait virtuellement comblé par un avatar de la vie moderne. On peut ainsi voir un parallèle entre l’Ipod et la radio à transistor, entre la gym cérébrale du docteur Kawashima et les fantasmes d’éducation par la télévision, ou entre Aibo et les flamands roses en plastique ! Car d’ici à là, de l’avènement de la consommation de masse à la sursegmentation des marchés qui a pour effet un conformisme généralisé (le fait, par exemple, que tout le monde ait un téléphone portable adapté à soi, sa niche ou sa "tribu", ne doit pas nous cacher que le fait le plus significatif est celui-ci : TOUT LE MONDE a un téléphone portable, besoin créé presque ex nihilo au milieu des années 90), la pratique de la cybernétique est éminemment sociale, structurante d’un point de vue identitaire, ce qui constitue une relative nouveauté à mettre au compte du vingtième siècle.
Cette cybernétique, ses implications tant sociales que métaphysiques, des hommes se penchent dessus, anticipant par l’art ou la théorie les problèmes qu’elle pourra poser au hasard des technologies ou des cultures. De Platon à Anton Dennett, en passant par William Gibson, Aldous Huxley, Shinya Tsukamoto ou David Cronenberg, ils définissent, prophétisent ou alertent. On peut, certes audacieusement, tracer un axe idéologique, le diamètre d’une roue dont le moyeu serait le cyberpunk créé en 1984 avec Neuromancer. La question cybernétique sert de relais à la métaphysique en lui offrant un ancrage fort, et l’on part d’une simple théorie du contrôle pour arriver à rien moins que l’interrogation sur le réel même.
Le terme même de cybernétique semble bien anodin dans son acception de base énoncée par Platon, à propos de la navigation maritime : il désigne simplement l’action sur le gouvernail des trirèmes. On retrouve alors une définition du terme tout à fait sibylline mais riche de ramifications : la science constituée par l'ensemble des théories sur les processus de commande et de communication et leur régulation chez l'être vivant, dans les machines et dans les systèmes sociologiques et économiques. Le mot lui-même sert de base à tous les concepts de gouvernance, cruciaux dans toute société moderne, et d’autant plus, peut-être, dans un pays et à une époque où un syndrome de Napoléon sur pattes se revendique chantre d’une nouvelle civilisation(2), tandis qu’on
s’affronte à grands renforts émotionnels outre-Atlantique pour diriger la première puissance mondiale(3). On connaît la tentation, forte, d’énoncer que les principes et notions sont affranchis de la circonstance, qu’ils existent par leur propre grâce indépendamment, par exemple, des avancées technologiques. Or la cybernétique ainsi définie est clairement subordonnée, en tant que théorie, au contexte tant social que technique. Le contrôle, c’est pour une grande part l’ensemble des moyens de contrôle, Gutenberg et MacLuhan peuvent en témoigner..
Les medias technologiques, industriels, que sont la photographie et ses dérivés (cinéma, jeu vidéo), ainsi que la radio et son protéiforme rejeton, la télévision, ont d’abord pour effet de massifier le contrôle en permettant de toucher des quantités d’individus phénoménales : on peut désormais envoyer un message à la planète entière. Dans cette acception, ceux qu’on appela les Mass Media sont assez comparables à l’automobile et à l’arme à feu, en ce sens que ce sont des procédés qui libèrent une énergie sans commune mesure avec celle qui sert à les actionner. Mamoru Oshii sait s’en souvenir lors d’un plan séminal de son Ghost in the shell(4), qui montre Motoko démantibuler un tank à mains nues, détruisant par la même occasion ses bras, dans une négation du corps jusqu’au boutiste. Dans son excellente critique de Innocence(5) (la "suite" de GITS) dans Mad Movies n°169, Bertrand Rougier résume : « Oshii affirme (..) qu’à force de se regarder dans des miroirs de plus en plus parfaits, l’homme leur confère plus de réalité, plus de vigueur, plus d’intérêt, qu’à sa propre existence. » Ce qui s’applique au cinéma tel que le définit le trop rare Jean-Pierre Dionnet(6) : un art de fantômes pour des fantômes où l’on ne peut virtuellement plus faire la différence entre morts et vivants. Les Media de l’image tels qu’on les connaît posent clairement, de par leur nature, la question de la déréalisation à l’échelle d’une société dont ils peuvent être l’instrument. A ce stade, l’émotion, l’idée ou la frustration, peuvent s’incarner dans le monde réel : c’est le propos des premiers films de Shinya Tsukamoto, les deux Tetsuo en tête : ces films, via un folklore de fusion entre la chair et le métal, montrent un salary-man dont la haine explose de manière littérale, lui conférant pouvoir, virilité et contrôle. C’est une idée qui culmine de manière magistrale dans cette séquence de Tetsuo 2 - Body Hammer (1992) , ou l’homme-metal, machine de guerre consciente et enragée, relié par le front à la secte de culturistes, hurle. Tous le membres se mettent à hurler de concert, leurs esprits subordonnés au sien par autant de câbles. Une image radicale du contrôle médiatique et politique !
L’idée n’est bien entendu pas de fustiger à peu de frais la virtualité ou les "nouvelles technologies", ce qui serait ridicule. Il convient toutefois de s’interroger sur les implications des pouvoirs colossaux que nous donne la technique actuelle, peut-être aussi importantes que celles de l’atome en leur temps. Oshii termine d’ailleurs ses réflexions(7) en se disant moins concerné par l’idée d’anéantissement de l’humanité que par sa perte de sens.
La cybernétique telle qu’on l’envisage dans la science fiction, par exemple, nous renvoie
directement au mécanicisme, à L’homme machine de Julien Offray de la Mettrie8, mais interroge aussi explicitement sur la notion du sensible, du sens, et de la praxis qui en découle. Ainsi, Gibson, lorsqu’il pose la somme qu’est Neuromancer (notamment l’idée d’un univers virtuel parallèle au monde physique, où l’on projette sa conscience par s’adonner à toutes sortes d’activités, s’y répercutant peu ou prou(9) et plus tard les Wachowsky qui recyclent beaucoup de ses trouvailles dans le premier Matrix, font passer dans le langage courant l’idée que la surface de contact de l’être humain avec le monde - et par extension toute cybernétique pratiquée par l’humain – n’a que peu a voir avec les
organes sensoriel et/ou cinétiques pour peu qu’on puisse relié directement les fonctions cérébrales à une interface donnée. Mais rappelons que deux ans avant Neuromancer, point de départ théorique du cyberpunk(10), David Cronenberg livrait, avec Scanners, une réflexion similaire et diablement prophétique : en 1982, soit plus de 15 ans avant Matrix, le bonhomme se permet une scène de hacking d’ordinateur par télépathie, via les lignes du téléphone ! Un an après, c’est le chef-d’oeuvre du genre (avant même qu’il ne soit officiellement créé) que Cronenberg livre avec Videodrome, qui approfondit encore la réflexion : on y verra tout de même la première représentation convaincante d’un appareillage de réalité virtuelle informatique au cinéma (en un champ/contrechamp montrant James Woods portant un casque, puis la pièce où il se trouve, pixellisée, avant de le retrouver, dans l’univers ainsi posé, sans casque), un professeur Oblivion affirmant sans emphase que bientôt « tout le monde aura un nom de télévision » (à l’heure des pseudos sur MSN, on ne peut plus affirmer le contraire), mais surtout un homme que l’on programme littéralement en lui enfournant des cassettes VHS dans le bide ! (A ce titre on passera sur le pataud Existenz, qui échoue dans sa démonstration là où Videodrome réussissait la sienne : quand le second est le film sur l’image d’un cinéaste impliqué par son travail, le premier est un film sur les jeux vidéos mené manifestement par un homme qui n’y joue pas. Il en résulte une certaine condescendance à l’égard d’un medium alors en pleine prise de maturité(11)
La question du danger potentiel représenté par un instrument sophistiqué au point de développer une conscience, et virtuellement de demander à être du bon côté de la télécommande, cette question est posée dès le mythe du Golem, et au cinéma de manière quasi-définitive dans le Metroplolis de Fritz Lang, en 1927 (récit de cybernétique à - au moins - deux niveaux, puisqu’en plus du robot Maria qui devient néfaste, il traite aussi de l’effondrement d’un système social dont le contrôle est strictement vertical), et n’attend ni le terrible Skynet de Terminator(12), ni les Répliquants de Blade Runner(13), pour être abordée. La création comme altérité potentielle est d’ailleurs une thématique très Shelleysienne. L’avatar le plus intéressant de ce questionnement est peut-être le Brave New World d’Aldous Huxley, qui date tout de même de 1931 : Le sixième siècle de Notre Ford montre un monde où la cybernétique constitue sa propre fin en soi, et où même les chefs sont des instruments mais les instruments d’aucun agent. Chacun chérit une servitude au plus grand nombre, puisqu’elle a été justifiée par lavage de cerveau, induite par la génétique, avec en contrepartie la mort de la conscience de soi, et même de la conscience tout court, dans des plaisirs immédiats et futiles.
Ce qui nous amène à l’idée même du Moi et de l’Humain : l’être le plus conscient est-il seulement celui qui exerce le plus grand contrôle ? L’humanité se définit-elle à cette aune ? C’est l’une des questions que pose, en convoquant le darwinisme, Daniel Dennett, philosophe et directeur du Center for Cognitive Studies à l'Université Tufts. Dans un article récent, il prouve que rien, en théorie, ne s’oppose à la conception d’un robot conscient. Ce faisant, il appuie la nature strictement réductible au physique de l’être humain. Selon lui, le Moi est une fiction : il conviendrait mieux de le qualifier de centre de gravité narratif, la personnalité étant à considérer comme une manière d’organiser les datas. Une vision qui nous ramène encore au mécanicisme, et à au moins le mérite d’interpeller quant à la quintessence que nous pensons incarner : selon Denett, nous sommes des entités fictionnelles, produites par un corps qui est une machine sophistiquée programmée pour développer une lutte darwinienne des pensées. Ainsi, nous "sommes" car nous pensons, certes, mais notre pensée n’a rien de divin. Autrement dit, nous secrèterions le langage (qui nous constitue), d’une manière aussi stupide et atavique qu’un escargot qui secrète sa coquille. Des escargots high tech(14).
A partir de là, on peut s’interroger sur le réel lui-même : si celui-ci n’est que la conscience qu’on en a et l’action qu’on y imprime, étant nous-même une conscience d’ordre fictionnel, qu’est ce qui peut bien rendre le monde "réel" ? Ce questionnement du réel n’est lui-même pas nouveau, on peut en situer le début effectif dans la pièce La vie est un songe de Calderon de la Barca (1635), où le personnage principal, abusé par un simulacre, c’est-à-dire une expérience fallacieuse et induite, se demande si l’ensemble de ses expériences ne peut pas être, lui aussi faux. Plus tard, ce questionnement se voit prolongé par la paranoïa Dickienne (on sait que Phillip K. Dick considérait le monde de son quotidien avec méfiance). Mais encore une fois, on peut se demander : Et alors ? Pourquoi l’expérience virtuelle serait-elle moins valide que celle du réel ? L’idée directrice, en termes qualitatifs, ne pourrait-elle pas être l’intérêt, en tant que propos, des interactions dans un contexte donné ? C’est finalement ce qui fait tout le prix, par exemple, des questions soulevées par les derniers volets de la trilogie Matrix : à l’instar d’Avalon(15), qui nous montre une joueuse du virtuel qui cherche à progresser dans le jeu, opposé à un monde-contenant froid et terne, rien ne nous prouve qu’à aucun moment on n’a vu le "monde réel" dans l’action, et bien que l’enjeu univers physique/univers virtuel soit crucial pour les personnages(16), tout porte à croire que la virtualité est générale : Néo, dans le monde réel, détruit par télékinésie des robots volants alors que de tels exploits ne sont théoriquement possible que dans la Matrice. De même, Ash, l’héroïne d’Avalon, voit son chien disparaître de manière inexplicable alors qu’elle lui prépare à manger… Plus tard c’est l’image du chien qui la guide dans le niveau supérieur du jeu. Et que dire d’un Agent Smith qui passe sans problème de la Matrice au monde "physique" ? Les humains de Matrix ne sont-ils que des programmes persuadé d’être humains, car générés pour être anthropomorphes(17) ? Si tel est le cas (tout porte à le croire), les parti-pris est pour le moins fort : Comme le souligne David Doukhan dans Mad Movies n°165, « tous les évènements qui ont lieu dans Matrix sont donc les manifestations d’une déesse artificielle qui a fait en sorte de sauver ses croyants en créant un messie virtuel. (…) En générant un univers monde où les dieux sont des machines, le Wachowsky subvertissent l’oeuvre de Campbell (…) en livrant le premier film cyberpunk mythologique. Les I.A. rêvent-elles de messies électriques ? ».
La question « qui contrôle ? » revient nécessairement à se poser celle-ci : « quelle est sa nature ? » et de là, c’est le monde même qui vacille sur ses bases théoriques. Et tout ça à partir d’un jeu de tennis sur un oscilloscope, bidouillé par un informaticien en 1958.
Fabien Legeron, master 2, article
1 Il est communément admis que l’apport du Japon dans le jeu vidéo est en premier lieu culturel au milieu des années 80 : là ou le jeu à l’américaine (Pong, Pac Man) ne propose comme accomplissement qu’un high score, l’approche d’un Super Mario, par exemple, est de développer une progression au sein d’un univers diversifié, dont l’exploration même est la récompense du joueur.
2 L’hilarante conférence de presse présidentielle de ce début d’année ne laisse pas de choquer, ou d’amuser (selon les espoirs qu’on place dans l’Homme), par sa répétition presque incantatoire de ce mot désormais galvaudé de "civilisation".
3 "La politique est l'ensemble des procédés par lesquels des hommes sans prévoyance mènent des hommes sans mémoire." Jean Mistler
4 1995, Oshii, Mamoru
5 2004, Oshii, Mamoru
6 Dans une présentation des Autres de Alejandro Amenabar, lors de sa diffusion sur Canal + en 2002.
7 In Mad Movies 169
8 1748, Julien Onffray de la Mettrie
9 L’idée n’est toutefois, et pour le moins, pas neuve : qu’on songe simplement à l’assez innocent Tron, de Steven Lisberger, en 1982…
10 Mouvement esthétique mêlant hard science, considérations cybernétiques, informatique, et culture populaire : « Le courant Cyberpunk provient d'un univers où le dingue d'informatique et le rocker se rejoignent, d'un bouillon de culture où les tortillements des chaînes génétiques s'imbriquent. » Bruce Sterling
11Pour illustrer cette assertion, on mettra en parallèle les actions scriptées jusqu’à l’absurde (un vendeur se met en boucle, un terroriste répète la même phrase) des personnages du jeu Transcendenz au sein du film de Cronenberg, avec l’interpellation constante du joueur en tant que tel, mis face à ses propres actions au sein du jeu, dans Metal Gear solid de Kojima, ou même simplement dans la scène de procès du jeu Chrono Trigger, qui jugeait en milieu de partie le joueur sur des actions commises au début du jeu.
12 1984, Cameron, James
13 1982, Scott, Ridley
14 Voir à ce titre l’interview donnée dans L’Imbécile n°9
15 2001, Oshii, Mamoru
16 Nous ne nous situons d’ailleurs QUE dans le virtuel dans ces cas de figure. Il s’agit après tout de films.
17 La discussion avec le père de Sati, programme qui parle d’amour, au début de Matrix Revolutions, vient à ce titre en droite ligne des reflexions de Dennett.

Comme son nom l'indique, ce mémoire de master, écrit sous la direction de Sylvie Thouard et Martin Laliberté en 2007, n'évoque même pas de la façon la plus marginale la cuisson idéale des souflés au fromage.
Alors bon, ça fait 100 pages. Il est donc nettement plus confortable d'aller lire tout ça sur SCRIBD :
Ce papier date de 2007, il est donc à moitié obsolete dans la mesure ou ça a bougé un un peu sur le sujet. Il y a aussi un gros oubli sur Levistrauss, des concessions à la bienséance universitaire pas très agréables à lire, et toutes sortes de scories qu'on aura soin d'imputer à la jeunesse du plumitif et au fait que suite à diverses circonstances cocasses, le machin a été confectionné en trois semaines.
Merci bien, Nodens vous bénisse.
_As we beg and steal and borrow, life is hit and missed, and this, I hope, I think, I know_.
Zabriskie Point
Making of et captations: enjeux d’une écriture documentaire sur le vif.
La notion de discours est au coeur de toute oeuvre audiovisuelle, qu’elle soit de fiction ou documentaire. Cette notion implique un corollaire évident : celui de l’écriture filmique, de la mise en scène. On voit ce que cette idée peut avoir d’apparemment paradoxal dans le cas du documentaire, qui se veut une captation du réel, une traduction pour être plus précis.
Certes ce paradoxe est d’une pertinence assez relative au regard du statut d’oeuvre de l’esprit que le documentaire a autant que tout autre ouvrage audiovisuel ; et pour paraphraser Truffaut les seules caméras objectives sont les caméras de surveillance (encore que : quelqu'un les a, également, placé en des endroits choisis). La question d’écriture et de mise en scène documentaire ne s’en pose pas moins dans la spécificité de son objet : le réel, l’évènement existant. Quelle écriture dans ce cas ? Car pour être différencié du reportage, le documentaire est envisagé comme film "à thèse" dans sa défense d’un point de vue, si anodin soit-il. Le regard d’un auteur s’y fait jour, même s’il ne consiste qu’à se dresser sur un surplomb pour balayer la scène du crime et dire : "C’est ainsi que tout s’est passé". C’est le problème que posent les making of et captations : ces exercices poussent dans ses derniers retranchements l’écriture documentaire telle que nous l’envisageons ici.
Entendons-nous sur les termes : par captation, nous désignons la démarche de suivre le déroulement d’un évènement culturel donné, concert, spectacle, etc.. Le making of est une captation "étendue", qui se propose de dépeindre la production d’un film ou d’un spectacle. Cette définition exclut de fait les documentaires rétrospectifs convoquant les différentes parties d’une production pour décrire a posteriori cette production.
L’étymologie même du terme de Making of, l’emploi d’un participe présent au sein d’un vocable transitif, dénote la notion de témoignage sur le moment, et de témoin sur place.
La spécificité de l’exercice apparaît alors comme la suivante : comme nous l’allons voir dans cet opuscule, l’écriture et la mise en scène ne peuvent être faites en amont de la prise d‘images que de manière vague et prospective, et se font pour l’essentiel a partir des images tournées.
En effet les éléments disponibles avant l’évènement seront peu ou prou, pour un film, le plan de travail, le script et la bible de production. Sur un spectacle, on ne pourra se fier à guère plus que le texte, le livret, la setlist, éventuellement la connaissance de la mise en scène au regard d’observations antérieures, en répétitions par exemple. De ces éléments découlent de grands axes de mise en scène impliquant des possibilités de découpage ultérieur. C’est alors bien au montage que se fait le réel travail de préhension du réel capté, moment où la pâte ductile glanée sur le terrain sera modelée pour donner une sculpture-reflet du discours de son auteur. Cette écriture n’est pas moins prégnante en regard des conditions particulières de sa réalisation, et le discours n’est pas moins marqué ou plus objectif que sur tout autre exercice documentaire : penchons-nous sur Making the Shining de Vivian Kubrick, fille de Stanley dont elle signe ici le making of du Shining en 1980.
Dans l’acception que nous admettons ici, le film est "hybride", avec des saynètes de la vie du plateau prises sur le vif, et des interviews posées dont rien ne prouve ou n’infirme qu’elles furent réalisées sur le plateau (au vu des costumes portés par Danny Lloyd ou Scatman Crothers sur ces images, on imagine qu’ils sont entendus sur le plateau lors de pauses, alors que celle de Shelley Duvall est faite semble-t-il a posteriori étant donné le contraste entre sa sérénité et son attitude sur le plateau).
Les parties de making of pur et dur contiennent ce qui fait les meilleurs documents de tournage : la connivence de l’ensemble de l’équipe donnant du "biscuit" à ne plus savoir qu’en faire (les prises de bec aujourd’hui célèbres entre Kubrick et son actrice, Nicholson donnant des trucs de travail, la visite de la mère du réalisateur -et donc aïeule de la réalisatrice du making of -, le coaching du petit Danny par le fils à l’écran de Barry Lindon ), et des détails d’imagerie très heureux (Nicholson se retire aux toilettes de manière théâtrale pour nous laisser voir sur la porte un magnifique calendrier de Page 3-girls du Sun !). Les entrevues sont de facture tout à fait classique : questions hors-champ, camera posée, longue focale mettant en valeur le regard du sujet, ce qui permet de voir tout à son aise l’intelligence aiguë du regard de Danny Lloyd ou les émouvantes larmes de Scatman Crothers.
L’alternance terrain/entrevues est un traitement qui tend à se standardiser sur les making of et featurettes, et qui permet d’avoir le beurre et l’argent du beurre en proposant à la fois l’aspect attrayant de la simulation de présence (le spectateur évolue sur le tournage via la vue "subjective" qui lui est offerte) et une somme d’informations données de manière plus simple et efficace. Les interview permettent aussi, incidemment, d’asséner un discours promotionnel lénifiant qui fait plaisir aux ayants-droits…
Mais c’est justement l’accolement violent des interventions policées de Shelley Duvall avec ses crises de larmes un brin capricieuses sur le plateau (où l’on voit aussi l’ostracisme qui en résulte) qui permet de faire exploser le cadre plan-plan du film-promo, et de montrer du doigt le premier moyen d’écriture dans le making of : le choix du dispositif. On a déjà évoqué la caméra semi-subjective, de mise dans l’exercice, mais pas ce qu’elle implique. Le dispositif en place sert à la condensation du temps de l’action montrée : on rend aux yeux du spectateur le plateau aussi attrayant que le film fini, dont on peut considérer alors qu’il n’est que l’un des points de vue sur le tournage, n’est-ce le fait qu’il est la raison d’être même dudit tournage (on aura suffisamment fantasmé un éventuel making of de Mister Stitch, film assez médiocre au tournage marqué par les pètages de plombs de son Roger Avary de réalisateur, ou glosé sur l’amusant Full Tilt Boogie qui suit les historiettes du tournage du From Dusk Till Dawn de Robert Rodriguez). Là où, dans un temps similaire, le dispositif des interviews sous-entend une objectivation du propos par sa forme plus austère et extérieure au temps diégétique du making of.
Là où le propos se fait réellement jour, c’est dans le dispositif final de mise en scène du film : le découpage, qui organise les morphèmes glanés en discours articulé : le sentiment qui sort de Making the Shining est celui d’une tendresse pour ce monde du simulacre signifiant et ceux qui donnent de leur personne pour le faire vivre, sentiment logiquement assorti d’une hostilité larvée pour les divas (réelles ou présumées, là n’est pas vraiment la question) et partiellement explicable par les liens du sang qui unissent la réalisatrice du making of au réalisateur du film. Ce discours passe par des moyens somme toute assez simples : Afin de faire partager l’émerveillement face à la logistique du film, on monte par exemple les images du film de fiction avec le son d’ambiance pris sur le plateau au moment du filmage du plan pour mettre en évidence la qualité technique du produit fini et les efforts consentis pour obtenir de tels résultats. On sent bien ce que ce parti-pris a de construit en soi, d’artificiel, bref de discursif, puisqu’on entend un son continu pris par la Bolex de Vivian sur les images montées de la scène dirigée par Stanley.
Pour gagner en clarté, penchons-nous maintenant sur un autre film à la lisière du documentaire et de la captation, à savoir celui tiré de l’édition 1970 du festival de l’île de Wight, réalisé par Murray Lerner. Le dispositif montré est encore plus simple que précédemment : on n’y trouve pour ainsi dire que du making of, en ce sens qu’on y voit des scènes de la vie du festival (tentatives de l’organisation pour empêcher l’entrée en masse des resquilleurs, problèmes avec les toilettes de chantier postées à disposition du public…) encadrant des images des divers concerts de l’événement. Le tout synthétisé, à l’instar des captations de Woodstock un an plus tôt, en une poignée d’heures (plus ou moins selon les différents montages et éditions) résumant les temps forts. Il en ressort l’illusion d’un survol de l’événement dans son ensemble par la condensation du temps réel en temps cinématographique soumis à la célérité du découpage discursif ultérieur.
Dans cette optique, on devine deux démarches distinctes : Lors des inserts "vie quotidienne", l’optique sur le tournage est à l’évidence de prendre tout ce qu’on peut en caméra subjective, dans une perspective temporelle et géographique linéaire qu’on se propose de réorganiser en un tout cohérent et dirigé au montage.
La profusion des panoramiques prospectifs et de travellings avant en est symptomatique et il est amusant de s’interroger sur la dimension presque mystique qu’acquiert, au cinéma, cette course au temps dirigé et structuré (l’idée d’un temps vectorisé, narratif, intelligent, est profondément religieuse, elle est d‘ailleurs à la base de la plupart des casuistiques, notamment judéo-chrétienne, gréco-romaine, scandinave, par opposition aux théories dimensionnelles modernes considérant le temps comme un espace supplémentaire vu imparfaitement)…
L’autre démarche, celle de captation en multi-caméras des spectacles musicaux du festival, prend le contre- pied de la première, puisqu’elle simule l’ubiquité du spectateur dans un intervalle de temps rigide. Encore une fois il s’agit d’exprimer un point de vue par le montage puisqu’il découle du choix du réalisateur/monteur et non de la libre déambulation du spectateur dans l’image : "Concentrons-nous maintenant sur tel point de l’action" induit "Le choix de ce point est justifié par son intérêt par rapport aux autres à tel instant". Et à nouveau, le plaisir de reconnaissance du dispositif montré est au centre de l’entreprise : de la même manière que je vois Shining avec le son du plateau, appréciant ainsi les moyens mis en oeuvre, je suis ici invité à me concentrer visuellement sur l’art de chaque musicien des Doors tandis que j’entend le morceau entier, résultat des efforts simultanés de tous ses membres. Le plaisir d’apprentissage est dans les deux cas prégnant et voulu, ou en tous cas assumé. A l’instar d’un forain du dix-neuvième siècle, le réalisateur vous invite à enrichir votre expérience du monde, ou du moins du pan de monde qu’il vous prétend montrer.
Les deux démarches sont complémentaires bien entendu, et ont un effet bien connu des monteurs : celui du montage parallèle. Le principe en est, pour schématiser, qu’on accélère par deux la vitesse d’un récit en éclatant ce dernier géographiquement puis en passant d’une sous-action à l’autre de manière alternative. Même si ici, techniquement, il s’agit de montage séquentiel classique, l’effet d’accélération de l’action est ici prégnant et relance constamment l’intérêt du spectateur, stimulé par les points de montage et les passages d’un dispositif à l’autre. Stimulé par l’aspect attrayant d’une constante nouveauté (au niveau neurologique et
sensoriel s’entend), il est plus réceptif au discours du film dépeint plus haut.
Nous avons vu ici le cas le plus répandu pour des raisons tant pratiques qu’économiques, celui du mélange entre les dispositifs de captation et de documentaire sur le vif. Acheminons-nous à présent vers les deux extrêmes, respectivement la captation de spectacle et le video log.
En exergue du DVD tiré de J’veux être grand et beau, spectacle de Tristan-Edern Vaquette, on trouve l’assez juste phrase de Jacques Livchine : "Le théâtre, c’est précisément ce qui ne passe pas en vidéo". On pourra être légitimement amusé ou atterré par cette manie très française d’asséner avec théâtralité de grandes notions péremptoires sur l’art avec un grand A. Cependant, si l’on ne s’en tient dans l’analyse qu’aux aspects techniques de la sentence, on constate vite qu’une captation de spectacle ne laisse que fort peu de place aux prétentions d’auteur d’un film de fiction ou même d’un documentaire. En effet, une captation de est un travail de commande, dont le but n’est pas discursif mais illustratif : Le spectacle est déjà, en soi, discursif, et la greffe trop véhémente d’un point de vue de réalisateur par-dessus celui-ci résulte le plus souvent à un parasitisme mutuel des deux propos et une annulation de ceux-ci. Bref, une telle démarche ne met pas en valeur le sujet et livre en outre un piètre objet filmique.
Car la raison d’être d’une captation est tout de même, à la base, de retranscrire un événement par définition flottant en lui prêtant une trace tangible et durable, et de préférence d’être flatteuse envers ledit spectacle, qu’elle se met en demeure de montrer. Si le découpage, nécessaire, va être en soi discursif pour les raisons expliquées plus haut, son objet sera plutôt, alors, de diriger et fluidifier la monstration du sujet, et de compenser l’unicité du point de vue en "couvrant le terrain" de la manière la plus totalisante possible. De là, on retombe également sur les mêmes enjeux d’écriture en amont, avec la nécessité de penser le dispositif en regard du but sus-cité. A ce titre la captation de la première du Côté bleu du Ciel d’Estelle Faye et la compagnie Neuvième Cercle, ci-jointe, s’est faite sur ces prémisses et selon un système éprouvé : considérant que la scène constitue un quart de sphère, le placement des trois caméras à disposition s’est fait selon un axe partant du centre du plateau vers le fond de la salle. Afin de ne pas couper cet axe des 180° ni en vertical ni sur la médiane horizontale, le plan d’ensemble en courte focale est placé en plongée sur l’axe et les deux plans d’action en longue focale sont de part et d’autre de la scène sont en contre-plongée. L’avantage en est double : La contre-plongée est plus flatteuse pour les acteurs et les costumes, et tout est raccordable "proprement" à quelque instant où l’on voudra introduire une coupe au montage. Les raccords sont alors naturels et ne sortent pas le spectateur de la narration de la pièce. Il est, de plus, possible pour les deux opérateurs du bas de composer des images dynamiques ou esthétisées, sachant que la géographie pourra, à tout moment jugé nécessaire à la clarté du récit, être rappelée par le plan d’ensemble neutre. Dernier avantage de ce dispositif prévoyant : en cas de problème technique sur une source (ce qui n’a pas manqué d’advenir, au changement de bandes de l’entracte), les deux autres peuvent suffire à la lisibilité de l’action et à l’appréciation du spectacle.
C’est le problème qu’à d’ailleurs rencontré Vaquette sur sa captation : comme on peut aisément le voir à la facture de l’objet (disparité des standards image, cadrages parfois très flottants, découpage manquant par moments de clarté), et comme il s’en explique lui-même lorsqu’ interrogé à ce sujet, la captation n’a pour ainsi dire presque pas été préparée en amont, notamment en regard du montage ultérieur. En outre, l’exiguïté et la topographie retorse de la salle (La Miroiterie, squat punk de l’est parisien, ne possède ce soir-là qu’une travée latérale, les sièges étant collés au mur de gauche) n’aident vraiment pas à développer une réalisation tridimensionnelle "étanche". On peut alors d’autant plus saluer la prouesse de montage pour fluidifier ce tout hétéroclite, que l’on déplore qu’un spectacle aussi graphique (trichromie blanc/noir/rouge, paravent, cartons explicatifs, intermèdes drolatiques) n’ait pas pu recevoir un plus beau traitement. Une conséquence de ce que l’artiste qualifie lui-même des grandeurs et servitudes de l’underground…
On le voit, le problème ici est moins de faire valoir un point de vue "original" que de traduire un événement donné : l’optique est bien documentaire au premier degré, et le fait que l’exercice de style nécessite une certaine rigidité, du moins d’un point de vue logistique, n’enlève rien à cet état de fait. D’aucuns diraient qu’on se situe plus dans une dialectique de reportage, cependant l’on vient de voir que le régime de visibilité cher à Gérard Leblanc est tout à fait pensé d’un point de vue documentaire et non simplement réactif à un fait donné. Nous sommes bien ici dans une préhension du sujet. Le but est néanmoins de rendre cette préhension aussi discrète et subtile que possible, car ici on ne parle pas du sujet, on lui prête voix, ce qui est un exercice sensiblement différent.
De l’autre côté du spectre, et dans une postérité sans doute un peu plus anecdotique puisque relégué au format court de featurette et toujours en complément des "vrais" making of décrits plus haut, on trouve le format documentaire subjectif par excellence : le video log.
Penchons-mous sur l’un des nombreux suppléments bon enfant du premier film en tant que réalisateur du scénariste James Gunn, Slither. Ce supplément nous montre Lloyd Kauffman, patron de la boite de production culto-trasho-désargentée de séries Z, Troma films. Kauffamn est entre autres le réalisateur des fleurons de la firme, la série des Toxic Avenger et surtout Tromeo and Juliett, scénarisé à l’époque par son protégé, James Gunn justement. Il est donc invité sur Slither pour un cameo, un tout petit rôle d’ivrogne. Kauffman se filme tout au long de sa journée sur le tournage, et ne manque pas une occasion d’opposer un regard mi-étonné, mi-critique à propos de la démesure budgétaire qu’entraine le moindre élément d’une production de studio. On voit d’abord Kauffman nous confier qu’il est tout naturel qu’un scénariste ayant fait ses armes sur un film de promotion de l’inceste (Tromeo donc) soit passé par la case "film pour la famille" avant de se voir réaliser ce sympathique film d’horreur potache.
Le reste est à l’avenant de la part du chantre du film fait pour trois fois rien. On le verra pèle-mèle s’ébaubir sur le luxe de sa caravane privative, s’étonner de se voir attribuer une telle caravane pour un rôle d’une réplique, ainsi que du nombre de véhicules disponibles et de la profusion pléthorique de l’équipe. Autrement dit on voit deux visions du cinéma s’opposer, l’une proprement inflationniste (Slither est presque une micro-production dans son contexte de production de studio, mais ses 15 000 000 de dollars en font un budget collossal en regard de l’intégralité des films Troma) et l’autre ouvertement Z (Lloyd Kauffman ne se montre pas extrêmement soigneux de son costume ou de son maquillage, visiblement peu au fait des exigences visuelles des tournages en super 35 mm).
Le video log est limité, on le voit, précisément par sa dimension strictement subjective ; celle -là même qui en fait le charme et le prix. Il est très plaisant de vivre la journée d’un figurant zombie comme on peut le faire dans l’un des suppléments de Shaun of the Dead , de Simon Pegg et Edgar Wright, grâce au journal vidéo de deux figurants. D’un point de vue didactique, en revanche, la pitance est maigre, si ce n’est dans l’imagerie : Peu d’informations sont généralement distillées dans ce genre d’exercice, et l’aspect strictement illustratif de l’entreprise laisse peu de place à d’éventuelles velléités de propos. C’est pourquoi on ne peut réellement considérer ces objets comme des documentaires, mais plutôt comme des documents, morceaux de matière première qu’un orfèvre filmique pourrait enchâsser dans un artefact plus large.
Trop souvent, le making of et la captation sont considérés comme des documentaires au rabais, des films où le discours de leurs auteurs est dilué dans des impératifs économiques (il s’agit toujours de films de commande, ou au plus de compléments d’autres produits culturels qui constituent leur raison d’être) et techniques (on a vu ici les spécificités d’écriture filmique tout à fait particulières de ces différents types filmiques), et où, de fait, ce discours perd en force ou en présence. Il n’en est rien, étant donné qu’une mise en scène, fut-elle appliquée au "réel", ou au discours de quelqu’un d’autre, est nécessairement affaire de point de vue, de propos, bref de volonté, celle d’un auteur. Au même titre que d’autres exercices documentaires ou, d’ailleurs, fictionnels. Indépendamment de son sujet, le documentaire ne constitue-t-il pas une fictionnalisation du réel, consistant à le plier à une narration orientée ?